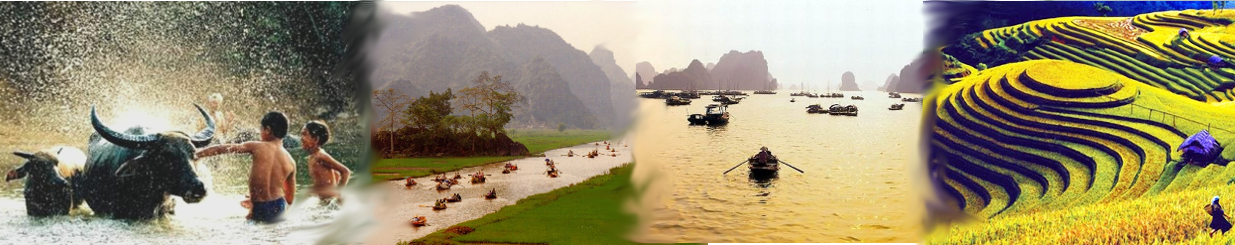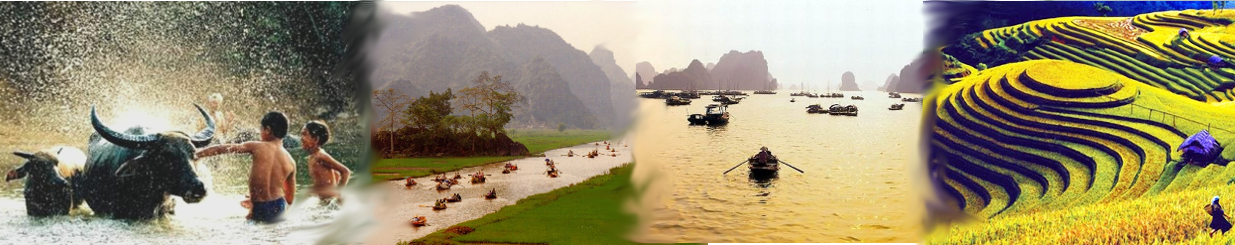Communications aux colloques
Communications aux colloques
À la recherche d'un habitat écologique pour un environnement
écologique :
héritage & modernisation de Phú Yên.
À la recherche d'un habitat écologique pour un environnement
écologique :
héritage & modernisation de Phú Yên.
Communication faite au symposium international lors de la célébration du 400e anniversaire de la
fondation de la province de Phú Yên, Tuy Hoà, 2 avril 2011.
Bản tiếng việt
Le Vietnam est un pays pauvre selon les critères internationaux, on disait "
en voie de développement"
dans les années 1970. Ses infrastructures ne sont pas comparables à celles des pays dits développés,
il accumule des handicaps liés à son histoire récente (colonisation, guerres). Le problème a déjà été
posé dans les années 1990 quand le Vietnam a dû affronter une nouvelle conjoncture suite au
changement de cap en matière d'économie : quel modèle de développement suivre ? Les responsables
politiques n'ont pas longtemps réfléchi avant d'adopter le modèle dominant, la voie toute tracée par
l'Occident triomphant portée par le néolibéralisme. L'objet de notre réflexion ne se situe pas à ce niveau
mais à une échelle plus modeste, celle d'une province littorale centrale dite pauvre (absence d'usines,
d'autoroutes, de supermarchés, bref de lieux de production et de consommation de masse selon les
critères des sociétés occidentales devenus la norme pour toute la planète). Comment faire disparaître
cette "pauvreté" ou mieux, la valoriser ? Comment renverser la situation qui nous relègue en queue de
peloton ? En temps de guerre, le Vietnam a su s'en sortir face à un ennemi beaucoup plus puissant en
intégrant l'environnement, l'existant dans sa stratégie pour en faire un allié. Grâce à la prise en compte
de l'environnement le Vietnam a pu retourner la situation pour évacuer les difficultés et obstacles vers
l'ennemi. C'est donc cet état d'esprit, cette démarche originale qu'il faut réactiver en période de paix.
Mais cette pauvreté n'est que relative si on intègre d'autres paramètres à caractère environnemental et
qualité de vie. Quand on regarde la densité démographique de la province, on se trouve dans la
fourchette tout à fait acceptable qui n'est ni surpeuplement comme le cas des provinces du delta du
Fleuve rouge, ni désert comme les hautes régions montagneuses, puisqu'elle est de 170 hab au km².
Comme il n'existe pas de gros centres urbains, la majorité de la population (80%) habite la campagne.
Un paysan riziculteur qui dispose d'une habitation agrémentée d'un lopin de terre suffisamment
conséquent pour faire pousser des cultures vivrières, pour élever quelques volailles ou cochons, une
mare pour élever des poissons et faire pousser des plantes aquatiques est considéré comme pauvre
car ses sources de revenus sont faibles
[6]. D'un autre côté, ce paysan qui se nourrit de produits issus
de son labeur, lesquels produits sont sans doute plus sains que ceux qu'on trouve dans les
supermarchés en Occident, est à l'abri des risque de contamination par les produits issus de l'agriculture
intensive productiviste. Son mode de vie en milieu rural qui nécessite des déplacements, des travaux
manuels en plein air (jardinage, travaux des champs...) lui assure un équilibre pour la santé physique, -
on ne voit pas encore un paysan vietnamien obèse, alors qu'il y a beaucoup de gens en Occident dont le
poids devient un véritable problème même à la campagne, en France ou aux États-Unis, par exemple.
Les trois éléments essentiels de la vie paysanne vietnamienne, potager, mare et abris pour les bêtes,
constituent ce que les agronomes appellent le système V.A.C
[7], un cadre naturel et vital pour les
paysans pour ne pas dire un véritable écosystème tout à fait ingénieux pour leur survie. Rappelons à
cet égard que la fonction de la mare est multiple. À part celles déjà citées précédemment, cette petite
étendue d'eau chère aux paysans vietnamiens, joue encore le rôle de climatiseur en été : la chaleur fait
évaporer l'eau qui se transforme en micro-gouttelettes qui viennent rafraîchir naturellement l'atmosphère.
Nous avons évoqué l'habitat traditionnel de la région chez les minorités ethniques comme chez les
Vietnamiens. Si ces constructions s'intègrent bien dans le paysage et présentent bien des avantages,
elles souffrent tout de même de certaines incommodités eu égard à la vie moderne : chez les
Vietnamiens la maison est souvent trop basse, dépourvue de plafond et elle n'a pas assez de fenêtres,
ce qui entraine des conséquences sur la qualité du confort : manque de lumière surtout en saison des
pluies, et comme la toiture n'est pas isolée sur le plan thermique, en été (ou saison sèche) la chaleur
devient étouffante même à l'intérieur. Si les murs sont en torchis ils ne sont pas assez épais pour jouer
pleinement leur fonction d'isolant. Comme on vit les portes ouvertes, la chaleur entre dans la maison, et
si on ferme les portes l'intérieur n'est pas assez éclairé. Chez les minorités, si les maisons sont
construites sur pilotis et pourvues de plus d'ouvertures, on a sensiblement les mêmes inconvénients.
Malgré le fait que les paysans vietnamiens ont toujours récupéré les déchets humains pour en faire
des engrais, certes naturels, ce mode de recyclage présente tout de même des inconvénients sur un
plan d'hygiène et de commodité. Chaque famille disposait d'une fosse septique en général pas loin des
bêtes, où l'on faisait ses besoins. Les odeurs qui s'en dégageaient devinrent une source de nuisance
désagréable, mais les habitants habitués à ce mode de vie s'en accommodaient sans trop se poser de
question. Puisqu'il n'y a pas eu de réflexion globale sur la question, l'alternative à ce mode de vie est à
l'heure actuelle l'adoption systématique de modèles d'habitations urbaines parce que celles-ci offrent des
conforts modernes : toilettes à chasse, les murs en béton armé ou du moins en brique assurent une
meilleure solidité aux yeux des paysans. Bref, c'est la campagne qui suit la ville sans trop se poser de
questions. En général les paysans sont fiers d'avoir une nouvelle habitation en dur comme celle des
urbains contre laquelle la vieille bâtisse est bonne à être bradée ou à démolir. Le boum immobilier qui fait
suite à la nouvelle orientation économique décidée par le Parti en 1986, fait apparaître dans le paysage
urbain et à un moindre degré celui de la campagne, une nouvelle génération d'habitations en dur qui
n'est ni occidentale ni orientale et encore moins vietnamienne : les Vietnamiens diront à leur façon
"
lấy đầu cá vá đầu tôm" (prendre la tête de poisson pour racommoder la tête de crevette). Ces styles
de maison d'inspiration sans doute disneylandienne qui poussaient comme des champignons en ordre
dispersé, pour ne pas dire anarchique, font désormais partie du décor urbain du Vietnam, et les
provinces n'ont pas été épargnées, car ici comme ailleurs, ce qui se fait à la capitale est imité par la
province. Au point de vue esthétique, ces villas ou maisons individuelles, aussi spacieuses soient-elles,
ne brillent pas par leur originalité. En général les murs sont aveugles car la proximité aidant, ces maisons
sont dépourvues d'ouvertures. Sur le plan confort, il faut un équipement supplémentaire en air
conditionné pour qu'elles soient supportables en été, car le gros inconvénient de ces constructions
est l'absence totale d'isolation (des murs et du toit), sans l'air conditionné, on y est mal : chaud en été
et froid en hiver, alors que le but devrait être le contraire : l'intérieur d'une maison doit être frais en été
et bon en hiver. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'équiper de système d'air conditionné doivent se
contenter de ventilateurs en été, qui font du bruit et qui chauffent, en fin de compte on ne sait pas si on
gagne en fraîcheur.
L'utilisation des W-C à chasse représente aux yeux de tout le monde un signe du niveau de vie supérieur,
un confort moderne alors qu'en Occident ce mode d'évacuation de déchets humains est fortement remis
en cause par les amateurs de maisons écologiques et des écologistes : c'est une aberration totale
d'utiliser l'eau potable venant des usines de traitement, par un système de conduites et de plomberie,
pour évacuer les déchets humains qui se retrouvent en fin de parcours dans les égouts, avec les autres
eaux usées des ménages (lessive, bains, cuisine...). Chaque jour, chaque foyer utilise des centaines
de litres d'eau pour les W-C qui représentent 25 à 30% de la consommation totale d'un ménage.
L'eau usée revient à l'usine de traitement qui rejette des matières indésirables, en neutralise d'autres,
la rend potable par des opérations compliquées en utilisant de produits chimiques comme le chlore
pour la désinfecter. L'ensemble de ces opérations a un coût lourd pour la communauté, pour chacun
des habitants, consommateurs d'eau, et lourd pour l'environnement. En Occident, pour une large part,
la pollution des rivières est d'origine domestique : la matière organique provenant des déchets
ménagers est transformée par des stations d'épuration en nitrates et en phosphates, ces deux
substances rejetées dans la nature viennent polluer les rivières. 97% de l'azote et 50 à 80% du
phosphore contenus dans les eaux usées urbaines viennent des W-C. D'après une étude récente,
faite à l'Université Catholique de Louvain (Belgique) en 2000, le contenu azoté des déjections
humaines représente 40% de l'azote utilisé dans l'agriculture mondiale
[8]. Les toilettes à chasse ne présentent pas ainsi un progrès par rapport aux fosses sceptiques traditionnelles. Si on gagne d'un côté un peu de confort, de l'autre, on devient dépendant d'un système, d'un réseau (distribution d'eau, plomberie), et de surcroît cela a un prix d'abord financier puis en termes de pollution de l'environnement. Gagne-t-on vraiment à l'échanger les fosses septiques contre les W-C à chasse? Par conséquent les nouvelles habitations construites à la va-vite avec des matériaux non uniformes tels que les briques mal dimensionnées, équipées de W-C à chasse, ne sont certes pas des exemples à suivre si on cherche à innover ou trouver une solution originale et fonctionnelle.
Située sous les tropiques, le climat de Phú Yên est simple : les pluies arrivent dès septembre et se
terminent en décembre, la saison sèche s'étale sur le restant de l'année. À côtés des rivières, petits
cours d'eau et étangs, les pluies constituent une source abondante d'eau. Les paysans vietnamiens
récupéraient traditionnellement l'eau de pluie pour leurs usages quotidiens (consommation, bains,
cuisine, lessive, etc.), pour compléter ce qui provient des puits individuels ou collectifs, voire suppléer
à ceux-ci. Ces pratiques ne demandent pas d'investissements lourds ni de gestion particulière car il n'y
a pas de centralisation comme dans le cas d'un réseau de distribution d'eau en milieu urbain. L'eau
est l'affaire de chaque foyer. Mais on pourrait améliorer cette pratique pour assurer les habitants d'une
consommation régulière sans risque de rupture en cas de sécheresse. Dans cette région, les cours
d'eau ont leurs sources sur le territoire du Vietnam même, si ce n'est pas sur celui de la province.
C'est un atout majeur dans un contexte où la recherche et la maîtrise d'eau deviennent un enjeu
stratégique planétaire. Si le charbon domine le XIXe siècle, le pétrole le XXe siècle, l'eau est déjà
une ressource naturelle convoitée à l'aube du XXIe siècle, la bataille sera dure, et il n'y en aura pas
pour tout le monde. À l'heure actuelle, un milliard d'êtres humains n'ont pas d'accès à l'eau potable,
tandis que l'agriculture productiviste consomme 80% des ressources mondiales de ce bien commun
naturel, contre 12 % pour l'industrie, et 8 % pour la consommation publique
[9]1. À titre d'exemple, pour
produire 1 kg de blé il faut 1.500 litres d'eau, et 1 kg de viande industrielle 10.000 litres d'eau. Le Nord
et le tiers Sud de l'Inde sont classés comme zones de forts stress hydrauliques et pourtant l'Inde subit
de fortes pressions de la part des institutions mondiales qui la poussent à la privatisation des services
dont la distribution d'eau. La Banque mondiale y a financé la construction d'un barrage au détriment des
peuples vivant dans les environs ; un des chefs de tribu s'est retrouvé assassiné et Vivendi ramasse la
mise
[10]. À cet égard que peuvent faire le Vietnam, le Laos, la Thaïlande ou le Cambodge face à leurs
voisins chinois en amont qui détournent l'eau du Mékong pour leurs usages, certes légitimes par ailleurs ?
L'entretien des sources et tout le long des cours d'eau devient une tâche impérative pour empêcher
les rivières d'être polluées, pour sauvegarder un environnement accueillant et agréable pour tout le
monde. Personne ne viendrait contempler un coucher du soleil au bord d'une rivière polluée ou couverte
de détritus.
Sur le plan énergies, la ville comme la campagne sont équipées grâce au réseau central de l'État qui se
déploie sur l'ensemble du territoire. Les sources d'énergie électrique sont d'origine hydraulique ou
thermique alors que le pays a des potentiels énormes en énergies renouvelables telles que le solaire,
le vent ou les marées éventuellement. C'est un choix politique et de société car un réseau décentralisé
présente bien des avantages par rapport à un réseau centralisé : en temps de guerre, d'instabilité, ou
de troubles, un réseau centralisé est la cible facile pour l'ennemi, car il suffit de paralyser le cœur du
réseau pour que l'ensemble soit mis hors service, à l'inverse un réseau décentralisé ne peut pas être
détruit aussi facilement, on peut en détruire un maillon mais le reste demeure fonctionnel, pour paralyser
l'ensemble du réseau il faudrait s'attaquer à tous les maillons, ce qui demanderait plus de temps, plus de moyens.
Nous venons d'évoquer quelques aspects du mode de vie de l'Occident qui est en pleine crise. Il n'est
pas inutile, nous semble-t-il, d'aborder ici des facettes de cette crise. Crise d'abord du monde agricole.
L'agriculture intensive et productiviste mise en place aux États-Unis, puis généralisée dans le reste de
l'Europe, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale a fini par achever la désertification de la
campagne, en Grande Bretagne la campagne a disparu puisqu'il n'y a plus de paysans, la France est
en bonne voie sur cette planche glissante
[11]. Plus de paysans signifie aussi plus de vie paysanne,
plus de connaissances traditionnelles, plus de passé paysan. Les paysans d'anciens Pays de l'Est qui
viennent de rejoindre l'Union Européenne sont en train de déguster les fruits amers de la modernisation
agricole. La devise est produire plus (au moindre coût) pour vendre plus (au meilleur prix), mais les
grandes centrales d'achat et de distribution s'interposent entre producteurs qui doivent leur vendre aux
meilleurs prix et consommateurs qui doivent leur acheter aux prix fixés par elles. Ces centrales font la
pluie et le beau temps dans le commerce transnational et national grâce à la liberté du commerce qui
permet aux grands d'éliminer les petits à coups de réglementation et d'une politique de prix
concurrentielle impossible à suivre pour les petits producteurs. Il va de soi que dans ce contexte, la
quantité prime sur la qualité : par exemple, les pommes et les tomates trouvées sur les étals des
supermarchés sont jolies et tentantes, mais elles n'ont aucun goût car elles n'ont plus que l'aspect
sans parler des pesticides qui s'y retrouvent
[12] ; les parfums des fleurs ont disparu mais les fleurs de
toutes les couleurs sont de plus en plus abondantes sur le marché. L'agriculture moderne a sacrifié
l'essentiel pour le superficiel. On produit des poulets dans des exploitations industrielles au plus vite,
dans un espace clos, exigu, à la lumière artificielle, et avec une alimentation industrielle, elle aussi.
Résultat, on obtient des poulets visuellement normaux sous emballage, mais dont les os ne sont plus
que du cartilage, et qui n'ont plus la consistance d'un poulet élevé en plein air, lui n'a pas à marcher sur
les autres pour essayer de trouver une place dans des poulaillers concentrationnaires. En somme, on
produit des bêtes malades, sans goût, sans saveur pour la consommation irréfléchie. Si cet élevage
subsiste encore c'est parce qu'en fin de chaîne, les consommateurs continuent à acheter ces produits
pour satisfaire leurs besoins conditionnés, manger de la viande deux fois par jour, sans parler d'autres
produits carnés annexes comme les saucissons, le jambon, etc. En Europe on n'en est pas encore à
manger des biftecks de 500 g comme aux États-Unis mais la surconsommation de viande a des
conséquences néfastes sur les autres domaines : santé, transport, qualité de vie, sol, etc. Plus de la
moitié de la surface cultivable dans le monde est dégradée d'une manière ou d'une autre (dégradation
physique, érosion hydraulique, érosion éolienne, altération de la composition chimique du sol), soit près
de 2 milliards d'hectares
[13]. Si la couverture forestière des pays industrialisés comme la France, la
Suisse, l'Espagne, les Pays scandinaves, les États-Unis, la Chine est en légère augmentation, celle
d'autres pays dont ceux du Sud tels que le Brésil, l'Afrique équatoriale, l'Asie du sud-est, et la Russie
continue à diminuer d'année en année
[14]. Le consommateur ne connaît pas toujours l'origine du produit
en vente, les conditions de production, le stockage, le transport, etc. Le problème de l'information est
crucial dans le secteur primaire comme dans d'autres domaines. Le consommateur doit dénicher lui
même les informations concernant les produits qu'il achète car les producteurs se contentent de faire
de la communication, autrement dit de la publicité. À charge donc du consommateur de prouver si la
publicité est conforme au produit ou mensongère. Alors que dans un monde sain, s'il n'a rien à cacher,
le producteur a l'obligation de fournir toutes les informations nécessaires au consommateur.
Dans le secteur secondaire, on n'est guère mieux loti. Si la cadence de fabrication est, selon les
industriels, optimale et le produit final bénéficie de la dernière technologie, ce produit n'est pas pensé
et fabriqué pour durer. Sa durée de vie est fixée à l'avance : celle d'une machine à laver, d'un poste de
télévision, d'un robot ménager, d'une imprimante, d'un aspirateur, etc. ne dépasse pas un certain
nombre d'années même si la partie centrale, le moteur d'un robot ménager par exemple, est en bon état,
car il suffit qu'une pièce mineure soit cassée pour que l'appareil devienne inutilisable. Pour changer
cette pièce il faut se lever de bonne heure si on a de la chance. Le cas des aspirateurs est révélateur :
au bout d'un certain temps d'utilisation, on ne trouve plus de sacs qui vont avec le modèle acheté. Que
faire ? L'appareil est, lui, encore en bon état mais le modèle devient "obsolète". Par lassitude, on finit en
général par le jeter. Le but des fabricants comme celui des producteurs agricoles est le même : pousser
à la consommation et peu importe le prix à payer pour la communauté, le prix à payer en termes de
pollution. Sauve qui peut, après moi le déluge. Aucune responsabilité ne leur est demandée. On ne
répare plus une montre, un poste de télévision, on les jette. Dans une économie néolibérale, le critère
financier l'emporte sur toute autre considération. Pour un fabricant de jus de fruit, il lui revient moins cher
d'utiliser à chaque fois de nouvelles bouteilles que de récupérer les bouteilles vides mais tout à fait en
état de resservir pour les recycler, c'est cela qui compte et c'est ce qui se passe : une fois qu'on a vidé
une bouteille, celle-ci se retrouve dans le meilleur des cas, dans des containers avant d'être acheminée
vers des centres de traitement où se font les tris, puis vers des usines de recyclages, à la charge des
communes, de la collectivité. Le fabricant, lui, s'en lave les mains. Les autorités politiques sont
impuissantes devant les industriels si elles ne sont pas leurs complices. Ainsi les carcasses d'ordinateurs
se retrouvent au Ghana, considéré comme décharge pour les industries d'Occident. De même, 50 à
80 % des déchets électroniques des États-Unis collectés en vue de leur recyclage aboutissent en Asie
(Chine, Inde, Pakistan) où l'opération coûte dix fois moins cher qu'aux États-Unis, malgré l'interdiction
formelle par la Chine d'importer de vieux ordinateurs et des déchets électroniques
[15]. Des produits
chimiques comme des métaux qui composaient les objets de la vie quotidienne se retrouvent dans la
nature. Les deux géants industriels -États-Unis et la Russie – autrement dit les plus grands pollueurs
du monde n'ont signé aucune des quatre conventions internationales en matière de production et de
commercialisation de déchets dangereux
[16].
La société industrielle est une société à déchets, c'est une de ses caractéristiques restée dans l'ombre
avant que les déchets finissent par trop envahir la vie quotidienne pour qu'on les ignore. Chaque jour la
société moderne produit des millions de tonnes de déchets ménagers et industriels. Dans un petit pays
comme la Tunisie, dont le président a dû partir récemment sous la pression de la population qui
réclamait plus de dignité, chaque année, l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) collecte
près de 15 mille tonnes de déchets plastiques, son ministre de l’Environnement et du développement
durable a fait remarquer que deux millions de tonnes de déchets ménagers et plus de 200 mille tonnes
de déchets industriels sont produites
[17]. En France, selon l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME), 849 millions de tonnes de déchets, toutes catégories confondues, sont produites
chaque année, et 75 départements ne sont plus en mesure de traiter leurs propres déchets d'après le
Commissariat général au Plan. La pollution dans les pays industrialisés est tenue pour responsable d'un
taux de mortalité alarmant : 6000 à 9000 morts par an en France par exemple. L'asthme touche un enfant
sur dix, les cancers et les maladies cardio-vasculaires constituent 60 % des causes de décès dont
l'origine est la pollution de l'air, de l'eau, de la chaîne alimentaire allant jusqu'au lait maternel.
L'augmentation des maladies auto-immunes, de l'obésité, des difficultés à procréer s'explique par un
désordre hormonal causé par des produits "perturbateurs endocriniens" qui ne sont autre chose que
des composantes dans la fabrication de détergents, de plastifiants, de solvants ou de pesticides
[18].
On comprendra aisément pourquoi toutes ces maladies de l'ère moderne quand on aura appris que
47 % des fruits et légumes seraient contaminés dans l'Union européenne, et ce pourcentage est en
hausse constante par rapport aux données recueillies de 2003, que les labos ont retrouvé au total 197
pesticides différents dans les 60.000 échantillons analysés, pire, que 400 polluants, hydrocarbures,
dioxine, pesticides, résidus de plastique, de colle, d'encres d'imprimantes, se retrouvent dans le fœtus
humain
[19].
Si l'image de l'Occident est souvent montrée sur les écrans à travers des voitures de sport, ou de luxe,
effleurées du bout des doigts par une jeune femme aguichante qui fait saliver les mordus de la
consommation irréfléchie, la production d'automobiles et son utilisation ont aussi un prix en termes de
dégradation environnemental. La pollution liée à la consommation d'hydrocarbures d'origine fossile
comme le pétrole vient alourdir la facture collective. Le choix du tout-voiture décidé en haut lieu a été fait
au détriment des solutions plus responsables en matière de lutte contre le gaspillage et la pollution.
D'autres solutions alternatives au pétrole existent mais rendues impossibles à la réalisation par le lobby
du pétrole
[20]. Le démantèlement du réseau ferroviaire
[21]. qualifié de "peu ou pas rentable" finit par élever
la "bagnole" au statut d'objet sacré : en milieu rural, sans voiture on est marginalisé, la vie devient
impossible. Les marchandises arrivent par camions dont le tonnage augmente d'année en année, du
coup le transport explose et asphyxie le réseau routier sans parler du risques d'accidents inhérents à la
circulation. À titre d'exemple, la croissance mondiale des transports de marchandises durant ces deux
dernières années est de 170%
[22].
La science et les technologies n'y peuvent rien car elles ne sont jusqu'à présent que des outils au service
d'une politique et d'une stratégie de conquête de marchés, de domination économique sans passer
forcément par une conquête territoriale. L'humanité n'a jamais autant produit de denrées alimentaires,
de biens de consommation, et dans le même temps une bonne partie de cette humanité meurt de faim
tous les jours à cause de la richesse accumulée par ailleurs : selon le CCFD (Le Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement) chaque jour, 10.000 enfants meurent de malnutrition. En 2008,
durant le premier trimestre, des émeutes de la faim ont éclaté dans 37 pays du Sud dont l'Égypte, les
Philippines, le Bangladesh, Haïti, etc. Plus de deux milliards d'êtres humains des pays du Sud vivent
dans la « pauvreté absolue » selon les termes mêmes de la Banque mondiale peu suspecte de
sympathie avec les causes humanitaires
[23]. La spécialisation du monde en termes de production relègue
les pays pauvres en position de faiblesse qui doivent se contenter de sous-traitance ou de produire
pour les entreprises transnationales qui dominent le marché. Les bourses des grandes capitales
occidentales qui fixent tant le prix des matières premières que celui des produits agricoles contribuent
à déposséder les producteurs des pays du Sud. En Occident même, des voix s'élèvent pour contester le
modèle énergivore et producteur d'inégalités sociales, et de misère. Des groupes de réflexion prônent
une sortie du développement vers une autre voie : la décroissance, la sortie du tout nucléaire, du tout
automobile, par exemple. Cela fait débat mais le modèle occidental a montré ses limites en termes
de progrès social et de bien-être. Une frange de la population qui est à la recherche d'un autre mode
de vie, se retourne vers la nature, en consommant des produits locaux et en construisant des maisons
écologiques pour ne plus être dépendants du système dominant et pour montrer qu'un autre modèle,
qu'un autre monde est possible.
Puisqu'il s'agit aussi du tourisme comme voie d'ouverture vers l'extérieur pour faire évoluer la province
de Phú Yên. Des questions essentielles méritent d'être posées, des constats constatés avant d'aller
plus loin. Ceux qui sont passés par l'Asie du sud-est font beaucoup d'éloges de la ville de Luang-Prabang,
classée par l'Unesco comme patrimoine culturel de l'humanité. Ce n'est pas simplement la ville en tant
que monument historique mais la vie qui s'y déroule, la façon de vivre de ses habitants, tout un ensemble
culturel qui fait la différence avec d'autres lieux. Mais ces dernières années, la pression immobilière finit
par décider bien des habitants à quitter la ville pour aller habiter dans les environs en laissant le terrain
libre aux promoteurs le soin d'édifier de nouveaux hôtels à touristes. Si le mouvement continue la ville
sera vidée de ses habitants pour devenir une attraction touristique pour ne pas dire une ville sans âme
qui est menacée de perdre aussi son statut de patrimoine culturel de l'humanité reconnu par l'UNESCO
en 1995. Ce serait la rançon de la réussite si rien ne se fait pour stopper la tendance. Saint-Tropez, un
petit port de mer, une petite commune du Midi de la France a connu la même évolution dans les années
1950-1960 : attirant des artistes et vedettes de cinéma elle s'est développée, puis la pression immobilière
a chassé ses habitants pour la transformer en un bourg mort la moitié de l'année et l'autre moitié pris
d'assaut par les touristes. Quant au Vietnam, si Hôi An est appréciée, elle risque de perdre son âme et
son statut de patrimoine culturel de l'humanité, à force d'être réduite à une simple attraction touristique
qui détruit le pittoresque, le savoir vivre au profit des objectifs à court terme. La station de Sapa reste
un lieu incontournable pour beaucoup de touristes venant de l'Occident : il n'y a pas que les minorités
ethniques en tant que telles qui comptent - car, dans ce cas, Phú Yên pourrait aligner plus de peuples
différents sur son territoire -, mais un ensemble fait de contacts, d'échanges, d'exotisme qui fascine les
visiteurs. D'ores et déjà on peut se poser une première série de questions qui pourraient aider à définir
les objectifs :
- Est-ce qu'on souhaite s'adresser aux touristes ou aux voyageurs, deux catégories tout à fait différentes ?
Souhaite-t-on voir venir des touristes de luxe qui réclament des terrains de golf et des hôtels à cinq
étoiles ?
- Quel type de touristes souhaite-t-on recevoir car il y a de tout chez les touristes, les respectueux, les
moi-d'abord, les profiteurs de la vie, les gens à la recherche d'un lieu exotique, les consommateurs du
sexe, les becs fins ? Etc.
- Est-ce qu'on souhaite recevoir des touristes venant des pays voisins ou ceux d'Amérique, d'Europe,
d'Afrique ?
- Que préfère le touriste qui débarque au Vietnam : se fondre dans la marée humaine des capitales
comme Hà Nội et Sài Gòn ou se détendre dans un endroit calme et reposant, et découvrir un autre
environnement, un autre mode de vie ? Est-ce qu'il souhaite revoir le même environnement que
celui de son lieu de résidence (embouteillages, grands immeubles, hypermarchés, etc.) ou trouver
autre chose qui n'existe pas chez lui en matière d'art, de culture, de mode de vie, etc ?
Chaque réponse à ces questions comporte des conséquences en matière de politique d'accueil,
d'infrastructure, d'investissement, d'image qu'on souhaite faire connaître à l'extérieur comme à l'intérieur
du pays.
Notes :
[6]. Nous partageons au sujet des paysans vietnamiens,
l'avis de l'agronome, ancien directeur de l'Institut d'Agriculture de Hà Nội, Đào Thế Tuấn qui vient
de nous quitter, exprimé dans un entretien recueilli par le journal
Nông thôn ngày nay du 12 mars 2009.
En substance, les paysans sont exploités dans les échanges avec des sociétés de commerce du riz
qui en fixent le prix. Ils ne bénéficient d'aucune des retombées de la croissance économique du
pays, la terre agricole est sous-estimée dans ses valeurs, le cadre de vie rural est pollué par des
activités tels que l'élevage, l'artisanat et les industries qui y déversent leurs eaux usées. Etc., etc.
[7]. V pour vườn (jardin, potager, verger) ; A pour ao (mare) et C
pour chuồng (abri de bêtes : poulailler, porcherie, étable, etc.)
[8]. Bertaglia Marco, in Séminaire en pollution de l'environnement, Université Catholique de Louvain (Belgique), Unité de génie biologique, 1998-99,
cité d'après l'article de Joseph Országh paru sur les sites web suivants :
http://www.ec-eau-logis.info/articles.php?lng=fr&pg=415#sdfootnote1anc
http://www.eautarcie.org/05f.html#dixhuit
[9]. "L'Atlas environnement. Analyses et solutions", n°
Hors série du
Monde diplomatique, p. 52.
[10]. Petrelle Ricardo (sous la dir.),
L'eau. Res publica ou
marchandise ?, La Dispute, Paris, 2003, p.107-108.
[11]. Ces dernières années plusieurs dizaines de milliers de
petits exploitants agricoles disparaissent chaque année car ils ne peuvent plus suivre l'évolution imposée
par la bureaucratie européenne qui exige de satisfaire les normes mises en place pour pouvoir continuer.
[12]. La France est le premier utilisateur de pesticides en
Union européenne : 80.000 tonnes sont déversées annuellement sue les champs de culture, soit 3 kg
de matière active par hectare.
Sources : http://www.agirpourlenvironnement.org/campagnes/c271.htm
[13]. "L'Atlas environnement.",
op. cit. p. 16.
[14]. op. cit.
[15]. La consommation assassine. Comment le mode de vie
des uns ruine celui des autres, pistes pour une consommation responsable,
Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2005, p.66-67.
[16]. Ibid. p. 82.
[17]. http://www.tunisia-today.com/archives/38968.
[18]. "L'Atlas environnement",
op. cit., p. 60-61.
[19]. Nicolino Fabrice & Veillerette François,
Pesticides.
Révélations sur un scandale français, Fayard, Paris, 2007, pp. 43, 51
[20]. Comme alternatives, il existe le moteur à eau ou plus
précisément à hydrogène, le moteur Pantone, le moteur de Yasunori Takahashi, le moteurs magnétiques
de Kohei Minato entre autres.
[21]. En moyenne 600 km de voies ferrées sont démantelées
chaque année en Europe.
Sources : "transporter autrement les marchandises", in Atlas environnement, op. cit.
[22].Ibid.
[23]. Ziegler Jean,
La haine de l'Occident, Albin Michel, Paris, 2008, p. 285.
|
Sommaire de la rubrique
|
Haut de page
|
Suite
|