T h è s e
T h è s e
Le Bắc Bộ de la fin du XIXe siècle à la seconde guerre mondiale
Le Bắc Bộ de la fin du XIXe siècle à la seconde guerre mondiale
Thèse de doctorat d'histoire
Spécialité: connaissance des Tiers mondes
Soutenue le 13 octobre 1992
par Nguyễn Văn Ký
devant un jury composé de :
Mme CHEMILLIER-GENDREAU Monique, Professeur, Université Paris 7, Présidente ;
M. HEMERY Daniel, Maître de conférences, Université Paris 7 ;
M. TRINH Van Thao, Professeur, Universsité d'Aix
M. BROCHEUX Pierre, Maître de conférences, Université Paris 7 ;
M. COULAND Jacques, Maître de conférences, Université Paris 8.
Sujet : La société vietnamienne face à la modernité.
Le Tonkin de la fin du XIXe siècle
à la seconde guerre mondiale
Mention: Très honorable
R E M E R C I E M E N T S
Mes profonds sentiments de gratitude vont tout d'abord à Daniel Hémery qui a bien voulu accepter de me diriger durant toutes ces années de galère. Ce travail n'aurait pas abouti sans sa patience et sa générosité, ses conseils et ses encouragements sous une forme ou sous une autre. A cet égard, Pierre Brocheux et Georges Boudarel en ont fait autant avec leurs conseils précieux et inestimables. Je ne pourrais passer non plus sous silence l'octroi d'une allocation de jeune chercheur par le Labo Tiers-Mondes qui m'a permis de faire un voyage d'étude de trois mois au Vietnam pendant l'été 1990.
Mes remerciements vont également aux chercheurs et spécialistes vietnamiens au Vietnam qui m'ont facilité la tâche. Je pense particulièrement à l'historien Phan Huy Lê, directeur du Centre de coopération sur les études vietnamiennes, et à ses collaborateurs; aux ethnologues Diêp Dinh Hoa et Nguyên Tu Chi, aux historiens Dinh Xuân Lâm et Dào Hùng, aux professeurs de littérature Trân Dinh Huou et Truong Chinh, au littérateur de culture populaire Lê Trung Vu, au spécialiste des arts populaires Nguyên Du Chi, aux écrivains Tô hoài et Bui Hiên, au musicien Nguyên Xuân Khoat et à la chanteuse Kim Dung, etc, etc. La liste serait trop longue à énumérer.
Je tiens aussi à remercier Monsieur Hoàng Xuân Han pour sa gentillesse, et les conseils qu'il m'a donnés au cours des deux entretiens que j'ai eus avec lui.
Enfin, que mes proches trouvent ici l'expression de mes pensées les plus amicales; et particulièrement Anne Bagot qui m'a soutenu ces dernières années par sa patience et sa compréhension. D'ailleurs la relecture qu'elle a faite aurait été difficilement remplaçable .
ABREVIATIONS & SIGLES
AN : Archives antionales du dépôt de Hà nôi.
ASI : Annuaire statistique de l'Indochine.
BAVH : Bulletin des amis du vieux Huê.
BGIP : Bulletin général de l'instruction publique.
BSEI : Bulletin de la société des études indochinoises
CEDAOM : Centre des Archives d'Outre-Mer.
Coll : Collection.
Ed : Edition.
EFEO : Ecole française d'Extrême-Orient.
ESSH : Editions des Sciences sociales de Hà nôi.
IDEO : Imprimerie d'Extrême-Orient.
Imp. : Imprimerie.
IN : Imprimerie nationale.
Pub : Publication.
Vol.: Volume.
AVANT-PROPOS
Si la modernité est devenue un thème à la mode en France dans les années 1980, que représentait-elle pour le Vietnam de l'époque coloniale ? La séduisante civilisation occidentale à travers l'entreprise colonisatrice a-t-elle rallié les classes dirigeantes vietnamiennes fortement opposées dans le passé à toute innovation ? La rencontre de deux cultures, l'une matérielle, axée sur le savoir scientifique, et l'autre morale, basée sur les connaissances littéraires, ne constituait-elle pas déjà en soi un mélange explosif ? Il reste cependant à définir les conditions de cette rencontre, de même à comprendre les processus qui l'ont conduite vers telle ou telle finalité.
L'histoire sociale et culturelle du Vietnam pendant les quatre premières décennies du siècle est riche de renseignements et d'événements reflétant, si l'on peut dire, l'image d'un vaste laboratoire de transformations qui brassent à la fois les idées, les pratiques sociales et les hommes. La colonisation comme facteur et promoteur de modernité a réussi à minimiser, ne serait-ce que pour un temps, la question nationale. Ce déplacement du centre de gravité a eu pour conséquence la montée de la question culturelle comme préalable à tout changement en profondeur, du moins pour certains Vietnamiens. Ce qui s'est produit à cette époque n'avait sans doute pas son équivalent dans le passé. On assiste à la fois à des innovations et à des remises en cause profonde des valeurs traditionnelles, surtout celles léguées par le confucianisme d'Etat. La plupart des lettrés de l'ancienne école se résignent à regarder disparaître leur point d'appui, tandis que certains d'entre eux se décident à rattraper le train de la modernité, du moins sur le plan culturel. Plus radicale que ces derniers, la jeune génération formée aux idées modernes de l'Occident tourne définitivement le dos au passé en créant de nouveaux modes d'expression. A cet égard, la poésie et la littérature modernes constituent les deux principaux pôles d'attraction, par lesquels les jeunes intellectuels esquissent une nouvelle société. La presse florissante des années 1930 devient leur moyen favori pour affirmer les idées modernes et pour s'affirmer comme partie prenante de ces transformations en cours. Leurs sensibilités et leurs approches différentes les conduisent à une sorte de répartition des tâches dans une même entreprise. Les poètes s'aventurent dans les profondeurs de l'âme tandis que les écrivains s'efforcent de démonter les mécanismes sociaux qui entravent la bonne marche du progrès. Dans ce vaste chantier, les femmes contribuent à redéfinir leur rôle vis-à-vis de la famille et de la société. Par ailleurs, ces transformations font apparaître un déphasage entre la ville peuplée d'éléments modernes et la campagne, vivier du peuple vietnamien, qui continue à observer les pratiques et les coutumes ancestrales. Au fur et à mesure que la modernité avance cette dichotomie qui sépare les deux mondes apparaît de plus en plus nette. La fin des années 1930 apporte sur ce point une illustration formelle et exemplaire.
Loin d'épuiser toutes les questions soulevées, les analyses avancées dans ce travail n'ont qu'une valeur indicative et provisoire, car bien des zones d'ombre restent à être éclaircies. Par ailleurs, non seulement l'étendue du sujet rend difficile l'approfondissement de tous les aspects traités, mais elle interdit encore la prise en compte de tous les facteurs susceptibles d'influer sur le cours des événements. A cela s'ajoutent les sources incomplètes ou partiellement rassemblées qui viennent limiter les investigations. Ainsi la colonisation comme "agent de modernisation" ne sera traitée que d'une manière partielle à travers uniquement l'enseignement, les sciences et les techniques, et la santé. Il en sera de même avec "les milieux porteurs de modernité", la Cour et le contingent de tirailleurs, d'ouvriers non spécialisés (ONS) auraient pu faire partie de cette enquête. Dans le domaine culturel, nous regrettons de n'avoir pu faire une rétrospective sur la peinture et sur la chanson modernes, nées l'une dans les années 1930 et l'autre dans les années 1940. Si la vie matérielle est abordée à travers "les identités corporelles", tout ce qui relève de la consommation et de l'utilisation des moyens de communications comme le train, le vélo, le pousse-pousse, etc., ne figure pas malheureusement dans ce travail. Enfin, les traditions populaires et régionales d'ailleurs fort riches et fort vivaces encore pendant la colonisation ne seront traitées qu'à travers le quan ho.
C'est la raison pour laquelle, des renvois fréquents tout au long de ce travail vers d'autres auteurs ou d'autres ouvrages plus spécialisés visent à compléter les choses dites. Peut-être tous ceux qui s'intéressent à cette période de l'histoire sociale du Vietnam trouveront-ils l'esquisse d'une société à l'épreuve des temps modernes, avec ses acquis et ses contradictions. Si le passé permet d'appréhender le présent, le présent peut aussi expliquer le passé.
I N T R O D U C T I O N
QU'EST-CE QUE LA MODERNITÉ ?
La réplique d'un jeune Beur: "Touche pas à mon pote", adressée à un agent de la RATP (Régie autonome des transports parisiens), pour défendre son copain menacé, est apparue comme symbole d'un mouvement de jeunes des années 1980 en France. Ainsi, le recours au contexte économico-politique et à l'environnement socio-culturel qui ont donné naissance à une expression, complétant la recherche de l'origine étymologique, constitue souvent une étape vers la compréhension des idées exprimées à travers des vocables. Bref, l'histoire des mots a en outre l'avantage de nous amener au coeur du débat, à l'essentiel qui, parfois, pourrait être camouflé, maquillé pour perdurer.
Il est ainsi utile de localiser dans l'espace et dans le temps le terme "modernité". Ce mot vient du bas latin modernus qui, dérivé lui-même de modo ("récemment"), est attesté pour la première fois dans la dernière décennie du Ve siècle, au temps où se faisait le passage de l'Antiquité romaine au monde nouveau de la Chrétienté 1. Déjà, à cette époque, modernus ne signifiait pas simplement "nouveau" mais "actuel". S'il a fallu attendre jusqu'en 1849 pour que le substantif "modernité" fût reconnu, l'adjectif "moderne", quant à lui, avait vu le jour bien avant, en 1361, c'est-à-dire un siècle avant la chute de Constantinople, point de départ de l'Histoire moderne de l'Europe et de ses espaces d'influence. Ce qui nous conduit par la même occasion à admettre provisoirement que l'idée du moderne, faute d'une historiographie complète sur les autres régions du monde (Amérique précolombienne, Afrique, Asie) puisait ses racines dans la pensée de l'Occident.
Mais une idée, comme un individu, doit s'affirmer face à son adversaire, voire le renverser avant d'être reconnue, surtout quand celui-ci est en position dominante. A l'apogée du Classicisme français, Charles Perrault contestait le 27 janvier 1687, devant l'Académie française, le règne sans partage de cet idéal humaniste et universaliste de perfection, marquant ainsi le début d'une querelle, celle des Anciens et des Modernes. Armé des progrès scientifiques et techniques développés depuis Copernic et Descartes, et de la philosophie des temps nouveaux, cet académicien s'est insurgé contre les Anciens pour affirmer que dans les rapports des temps modernes à l'Antiquité, les Modernes étaient bien le "maître" et non "l'élève" 1.
Ainsi le rapport de forces a été inversé. La Querelle est devenue dans l'histoire de la pensée occidentale l'aube d'une nouvelle époque: le Siècle des Lumières.
Dès sa naissance, la modernité a été érigée en mot d'ordre d'une nouvelle esthétique par Baudelaire. Pour "ce théoricien du Beau", La modernité c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable 2. Cette modernité se voulait l'empreinte d'une nouvelle ère dans l'histoire, baptisée "Romantisme". Mais déjà à cette date, la modernité apparut non comme une philosophie, une réalité temporelle, mais bien comme un mouvement perpétuel qui allait rallier le temps, gagner l'espace, pénétrer la vie avant de se transformer en conscience; laquelle viendrait à son tour se détacher de la conscience romantique qualifiée de "figure de classicisme" à l'épreuve du temps 1.
Plus d'un siècle après, cette distinction reste maintenue malgré la substitution du modernisme au romantisme. En effet, la notion de modernisme est bien postérieure à celle de modernité puisqu'elle n'apparut que vers la fin du XIXe siècle. Ce "culte du nouveau pour le nouveau", pour reprendre les termes de Henri Lefebvre dans son Introduction à la modernité, apparaît plutôt comme un spectacle triomphaliste que comme l'aboutissement d'un travail critique, car il impose ses vues à tous ceux qui discutent ou refusent, sous la menace d'être rejetés dans le démodé 2. Dans un ouvrage consacré à cette question, Georges Balandier écarte toute confusion :
Le modernisme s'en distingue (du romantisme) en tant que mode, concession à ce qu'une époque porte en surface sans inscription dans la durée, illusion produite par l'intégration hâtive à l'oeuvre d'aspects contemporains, par l'incorporation de courants culturels pour un temps dominants, par le recours aux mots et signes qui provoquent l'attention et le succès précaire. Au contraire, la modernité de la création requiert de fuir ces commodités; elle exige une constante remise en question; elle est recherche, expérience, aventure qui la fait difficilement situable ou détériorisée. Elle impose l'exploration de nouveaux possibles. Ce que Roland Barthes formulait autrement : "Etre moderne c'est savoir ce qui n'est plus possible" 1.
Dans ce XIXe siècle riche de bouleversements et de rebondissements, le contour de la modernité se précise avec deux analyses. Si Baudelaire, "poète maudit, marqué par la Révolution et son échec", était le penseur de la modernité sur le plan esthétique, Henri Lefebvre a montré que Marx cherchait, à la même époque, à donner un contenu à la modernité politique 2. D'après Marx, "l'abstraction de l'Etat comme tel n'appartient qu'aux temps modernes, parce que l'abstraction de la vie privée n'appartient qu'aux temps modernes. L'abstraction de l'Etat politique est un produit moderne" 3. Dans le contexte révolutionnaire de 1848 Marx esquissa le contour d'une société post-révolutionnaire qui abolirait "l'intolérable distance entre le privé et le public, entre le particulier et le général, entre la nature et l'homme, entre ce qui se passe au niveau du quotidien et ce qui se passe au niveau des instances supérieures et sublimes, l'Etat, la philosophie, l'art" 4. En effet, tandis que Baudelaire subordonnait à l'art les autres connaissances et actions, Marx plaçait la connaissance politique au-dessus de tout. L'échec relatif de 1848 conduisit Marx à réviser ses optiques en prenant en considération d'autres dimensions, notamment l'économique. Henri Lefbvre qui a décortiqué à la loupe les textes en rapport avec la modernité de Baudelaire et de Marx , en arrive à la conclusion suivante :
" La modernité, dans la société bourgeoise, ce sera l'ombre de la révolution possible et manquée, sa parodie" 1.
Si Hegel fut le premier philosophe à développer en toute clarté un concept de la modernité 2, aujourd'hui encore, en Occident, la modernité suscite des interrogations, des débats, des réflexions de la part des spécialistes de compétences diverses (philosophes, anthropologues, sociologues, historiens ...), soucieux de lui donner un sens. Mais c'est un concept qui semble assez vain à l'historien de 1984 3. Modernité est étroitement liée à rationalité d'après Hegel. En élargissant son champ, la modernité se confond avec les "temps modernes" caractérisés par la subjectivité qui comporte avant tout quatre connotations : l'individualisme, le droit à la critique, l'autonomie de l'action et la philosophie idéaliste 4, car elle recouvre de l'intimité à la vie publique, de la philosophie à la religion, de l'histoire à l'économie 5. En d'autres termes Jean Baudrillard dirait "inextricablement mythe et réalité, la modernité se spécifie dans tous les domaines: État moderne, technique moderne, musique et peinture modernes, moeurs et idées modernes...6 Mais en aucun cas, ce sociologue ne définit la modernité comme un concept, que ce soit sociologique, philosophique, politique ou historique. Par conséquent, il n'y a pas de lois de la modernité, il n'y a que des traits de la modernité; il n'y a pas non plus de théorie, mais une logique de la modernité, et une idéologie 7.
"De tous côtés, écrit Roger Pol-Droit, on en a plein la bouche, mais nul ne sait exactement de quoi il retourne 1, un mot ayant plus de valeur que de sens 2".
Idéologie et valeur engendrent nécessairement prise de position et controverse. "La querelle des Anciens et des Modernes" au XVIIIe siècle reste exemplaire. A notre époque, les sources n'ont pas tari. Jean Chesneaux, dans un essai et un article, a mis en relief "les effets pervers de la modernité dont l'immédiat, l'instantané, l'éphémère, le caroussel des artéfacts qui se renouvellent à des cadences toujours plus rapides, et donc la perte de perspective entre présent, passé, avenir" 3. Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, les deux traducteurs de l'ouvrage de Jürgen Habermas cité plus haut, n'hésitent pas à écrire dans l'avant propos que décrire la modernité revient dès lors à décrire le cheminement d'une raison folle, au regard de la réalité contemporaine. Ou Michel Leiris encore, qui la tourne en dérision en la faisant rimer avec "merdonité" 4. A l'opposé, d'autres associent la modernité à l'idée du progrès: progrès scientifique et technique, progrès du confort et du bien-être, progrès économique et social, progrès qui permet à l'individu de s'affirmer, "d'échapper aux pressions des institutions, aux diktats des idéologiess 5. Si le substantif "modernité" appelle une certaine confusion, l'adjectif "moderne" semble un acquis, par opposition à "traditionnel" voire "archaïque". On emploie et on accepte facilement son sens: "la vie moderne", "la famille moderne", "l'homme moderne", "la femme moderne", "l'art moderne"...
Sur l'autre front, la modernité se définit par rapport à la tradition qui ne constitue pas en soi une inertie, car "toute société porte en elle des potentialités alternatives". Ancrées mais non enfermées dans le passé, celles-ci pourraient devenir selon les conditions historiques un leitmotiv de la sauvegarde des valeurs et pratiques sociales, cas du traditionalisme fondamental; ou une inspiration réformatrice, cas du traditionalisme formel; ou bien encore une source de contestation qui alimente les revendications politiques sous couvert des croyances, cas du traditionalisme de résistance; et enfin un moyen de sauver la mise face à une situation chaotique, cas du pseudo-traditionalisme 1.
Quoi qu'il en soit, le passage de la tradition à la modernité ne se fait guère sans heurts, sans remise en cause des pratiques sociales, des habitudes culturelles, des concepts tenus pour acquis. De même, le retour à la tradition s'effectue souvent dans un contexte issu d'affrontements de courants contradictoires. La tradition se positionne plutôt comme une réaction à une vision hégémonique, que comme une force nouvelle arrivée au terme de sa maturité.
De cette esquisse de la modernité, on peut néanmoins tirer quelques remarques:
- la modernité se caractérise par sa propre dynamique qui dépasse les frontières temporelles et spatiales puisqu'elle est sans cesse remise en question;
- quand elle avance elle met en branle des structures sociales; ses effets sont comparables à ceux des conquérants, arrivés en terre nouvelle, qui divisent une communauté en collaborateurs et résistants;
- la faiblesse de la tradition réside dans le fait qu'elle ne se définit que par rapport à une société donnée, cantonnée dans un espace délimité, malgré la diversité des sociétés et des cultures;
- l'image des sociétés traditionnelles traversées par la modernité est celle des villages de pêcheurs situés sur les berges d'un fleuve dont les crues les ignorent.
Pour subsister, se protéger ou se maintenir face aux éventualités dévastatrices, la tradition n'a d'autres alternatives que de dresser un mur assez solide autour d'elle ou de s'interroger sur sa nature et ses raisons existentielles. Dans le deuxième cas de figure, il va de soi qu'elle cherche à savoir ce que la modernité pourrait lui apporter pour combler ses failles. On entre alors dans le domaine de la philosophie. Élaborée ou non, écrite ou orale, la tradition s'appuie sur celle-ci, le référent de toutes pratiques sociales et culturelles.
Transposé aux civilisations et cultures des Tiers Mondes en général et à celles du Vietnam en particulier, le "concept de la modernité", fruit de la civilisation occidentale, garde-il le même sens, le même contenu? "Les affrontements politiques, dit Georges Balandier, des pays d'Afrique noire, s'expriment dans une large mesure, mais non exclusivement, par le débat du traditionnel et du moderne" 1. Qu'est-ce que la modernité représente pour un pays colonisé en lutte pour l'indépendance, pour sa classe dirigeante qui a longtemps vécu dans l'ombre du confucianisme, pour la masse paysanne qui coule sa vie derrière une haie de bambou, frontière séparant le village du territoire national ? Qu'y-avait-il de moderne dans l'engagement et dans l'action des révolutionnaires communistes vietnamiens pendant la colonisation ? La modernité était-elle porteuse d'une solution de rechange ? A quelle date remonte le débat sur la modernité dans la société vietnamienne si débat y avait ? Sur un autre plan, la famille vietnamienne a-t-elle résisté ou succombé aux agents de la modernité et auxquels ? La modernité était-elle pour quelque chose dans l'émancipation des femmes, dans la remise en question de leur rôle dans la société vietnamienne des années 1920 et 1930 ? Quels étaient les effets de cette remise en cause ? Comment les Vietnamiens en tant qu'individu et en tant collectif ont-ils réagi ? D'ailleurs, l'individu existait-il dans les anciennes structures sociales vietnamiennes ? L'individu est-il une notion moderne ?
PRESENTATION DES SOURCES
Tout questionnement sur une époque, sur un événement nécessite des sources pour être éclairci. Quelle approche envisager pour étudier la société vietnamienne de l'époque coloniale dont la littérature vietnamienne n'a laissé que peu d'écrits. Quant à la littérature en langue française, elle la traite de façon sporadique. Si l'ouvrage du prête Nguyên Van Phong 1 présente un certain intérêt, à savoir le cadre traditionnel de la société vietnamienne, ses usages, la période traitée se situe avant celle qui nous intéresse particulièrement d'une part, et d'autre part, l'auteur s'est basé uniquement sur la littérature en langue française. Autrement dit, la société vietnamienne a été étudiée d'une manière statique et non dynamique, et à partir du point de vue colonial uniquement. Il est vrai par ailleurs que la période 1882-1902 étudiée par Nguyên Van Phong ne présente pas un intérêt particulier dans la problématique de transformation sociale. Quant aux récents travaux des historiens de Hà nôi, la question politique a été privilégiée aux dépens de la question sociale. Depuis ces quartes dernières années, à la suite de la proclamation du "Renouveau" (Dôi moi), certains d'entre eux se posent des questions sur cette dimension sociale tout en la considérant plutôt comme résultante de courants politiques différents voire contradictoires, que comme objet d'étude en soi. Cependant, ils reconnaissent que l'histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours reste à revoir pour relativiser la position prise par les dirigeants qui ont négligé les autres champs autre que politique. Le peuple ne reste pas pour autant passif car la tradition populaire dit :"Devient roi celui qui est vainqueur et rebelle celui qui est vaincu" (duoc làm vua thua làm giac).
Ces préliminaires étant posés, l'histoire sociale du Vietnam de l'époque coloniale demeure un terrain vierge qui n'intéresse pas uniquement l'histoire mais aussi d'autres disciplines: anthropologie, sociologie, art, littérature...
Ainsi le recours aux sources diverses et à l'approche pluridisciplinaire s'impose. Gérard Vincent, dans un chapitre traitant du secret de la vie privée, s'est posé la question "Où sont les lieux de mémoire de la vie privée? 1". On pourrait en dire autant des "lieux de mémoire" de la vie paysanne traditionnelle vietnamienne. Nous nous sommes heurtés en effet à une double difficulté.
D'abord, quand les sources écrites existent, elles proviennent sans doute d'une petite minorité de la population qui occupent le sommet de l'échelle sociale et qui prétendent représenter les restants; sinon, il serait possible de chercher dans la mémoire collective transmise par le biais de la littérature orale sous différentes formes : légendes, dictons, adages, proverbes, chansons populaires, etc. Même si des efforts ont été réalisés par des spécialistes de Hà nôi qui avaient cherché à localiser certaines de ces sources orales par région, le problème de datation et d'interprétation reste entier. On peut citer par exemple, Tuc ngu, ca dao, dân ca Hà tây (Adages et chansons populaires de Hà tây), édité en 1975; Tuc ngu, dân ca, ca dao, vè Thanh hoa (Adages et chansons populaires de Thanh hoa), édité en 1983; Phuong ngôn, tuc ngu, ca dao (Proverbes, adages et chansons populaires de Hà nam ninh), édité en 1987; etc. Nous ne disposons pas non plus de sources laissées par "les médecins de campagnes", "les petits fonctionnaires" et "les érudits locaux", les trois grands catégories d'observateurs qui, d'après Edward Shorter, "ont une bonne connaissance de l'expérience des classes populaires tout en étant suffisamment cultivés pour coucher leurs impressions sur le papier" 2. Reste donc l'indispensable expérience de terrain, irremplaçable pour toute enquête à caractère anthropologique afin de combler dans la mesure du possible les lacunes. En effet, si les traditions se maintiennent, c'est grâce à un ensemble de pratiques sociales, de croyances, de modes de vie, de représentations et de systèmes de valeurs qui sont transmis de génération en génération. Cet ensemble constitue la mémoire vivante, sa continuité dans le temps, et sa vivacité dans le quotidien. Cependant le contexte socio-économique, les événements politiques ou tout autre fait extérieur d'une ampleur importante peuvent produire des incidences, faire dévier la marche habituelle ou geler certaines pratiques. On remarque, par exemple, que durant la guerre de libération nationale (1946-1954), certaines traditions populaires ont été bannies (par les dirigeants vietnamiens), des lieux de culte (pagodes, temples, maisons communales) détruits au nom d'une nouvelle conscience politique qui voulait enrayer les croyances et les superstitions, des pratiques sociales à leur tour abandonnées au profit d'une rigueur économique qui ignorait que la cohésion d'une tradition ne pouvait se maintenir que grâce à l'articulation de ses composantes.
Faire du terrain dans notre cas exige des moyens matériels non négligeables. Grâce au concours du Laboratoire Tiers Mondes, nous avons obtenu des sources de financement pour une mission de trois mois au Vietnam. Ce voyage rentrait dans le cadre de la coopération entre Paris 7 et l'Université de Hà nôi par l'intermédiaire du Centre de coopération sur les études vietnamiennes.
Ce séjour au Vietnam avait pour objectifs de compléter la documentation, de faire une enquête sur la culture villageoise, d'échanger des points de vue avec des spécialistes, de recueillir des témoignages sur la confrontation des deux cultures. Deux critères nous semblaient les plus importants concernant les témoignages : l'âge (plus de 60 ans), et le milieu social en rapport avec les questions abordées.
Les entretiens à caractère thématique adaptables à chaque interlocuteur ont été préparés sous forme de guides semi-directif. Parallèlement au dépouillement des Archives nationales de la période coloniale concernant le Tonkin, un travail d'observation de la vie quotidienne a été nécessaire à la mise en relief de la réalité vietnamienne et à la compréhension de la vivacité des traditions et usages.
Le choix du terrain d'enquête a été déterminé par des articles de journaux et à un moindre degré par le recueil des proverbes et chansons populaires de Nguyên Van Ngoc 1. Dans ces lectures, trois villages aux environs de Hà nôi avaient retenu notre attention. D'abord le village La, situé à proximité de Hà dông, dont les moeurs ne semblent pas aussi austères qu'on ne le croit; puis le village Lim, sur la route de Bac ninh, réputé par sa traditionnelle fête annuelle regroupant les artistes du Quan ho de la région, et enfin un autre village qui célébrait le culte du Ong Dùng bà Dà (Monsieur Dùng Madame Dà). Pour des raisons d'ordre pratique, nous n'avons pu nous rendre à ce dernier village, cependant, nous avons fait deux petits séjours au village Hoài thi qui se trouve à deux kilomètres de Lim et qui serait une des origines possibles de la tradition du Quan ho. Cette piste nous a été suggérée par l'ethnologue Diêp Dinh Hoa, spécialiste de la culture populaire vietnamienne. Un autre village de la province de Vinh phu devait faire l'objet d'une enquête sur les cultes de la fécondité, mais les circonstances n'ont pas permis de la réaliser.
Nous regrettons surtout les séjours trop courts dans les villages de l'enquête (5 jours à Hoài thi, 3 jours à Lim, et deux jours à La), car les conditions n'ont pas été réunis pour effectuer des séjours plus longs comme nous l'avions souhaité. A notre avis, il nous aurait fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois de vie commune avec les villageois pour que les contacts fussent vraiment tissés, condition indispensable pour gagner leur confiance, si la confiance finit par s'établir. Nous partageons sans réserve la démarche exposée par Georges Condominas dans son ouvrage L'exotique au quotidien 1, faisant de l'enquêteur une personne intégrée au milieu et à la communauté étudiés. Car c'est souvent au détour d'une conversation sans importance qu'on recueille des propos riches de sens, des allusions donnant matière à réflexion; et par ailleurs, les révélations, les questions touchant aux tabous, ne peuvent voir le jour que devant une personne de confiance dont on ne redoute ni les intentions ni les jugements. Néanmoins nos courts séjours ont été en partie compensés par le sentiment d'appartenance à la même communauté linguistique exprimé implicitement par les villageois, ce qui a facilité les contacts et les échanges.
LES ARCHIVES NATIONALES, 31B Tràng thi, Hà nôi.
Pendant la colonisation il existait cinq dépôts d'archives en Indochine:
- le dépôt central de Hà nôi;
- le dépôt du gouvernement de la Cochinchine à Sài gon;
- le dépôt de la Résidence supérieure en Annam à Huê;
- et deux dépôts, l'un au Cambodge et l'autre au Laos.
Si l'Annam disposait dès 1897 d'un service d'archives bien organisé, le Tonkin a été laissé pour compte car l'effort "s'est borné à la rédaction d'une belle circulaire 2". On était en 1907. Quant à la Cochinchine, le gouvernement a constaté "la nécessité de réorganiser son service d'archives dans la séance du Conseil colonial du 29 septembre 1902 pour supplier aux désordres 1". Mais il fallut attendre 1917, sous le gouvernement d'Albert Sarraut, pour que cette question fût réglée. En effet, c'est grâce à l'impulsion du directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Louis Finot, qui demanda à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres la désignation d'un spécialiste qu'un ancien élève de l'Ecole nationale de Chartes, Paul Boudet, archiviste paléographe, a été ainsi nommé directeur des Archives et Bibliothèques de l'Indochine.
On constate donc que les Archives conservées à Hà nôi ont été classées suivant le même modèle de celles de France. Il existe plusieurs Fonds à Hà nôi:
- Fonds du Gouvernement général (Gougal);
- Fonds de la Résidence supérieure du Tonkin (Résuper du Tonkin);
- Fonds de la Mairie de Hà nôi;
- Fonds de la mairie de Hai phong;
- Fonds de la Province de Hà dông et celui de Phu tho.
Pour des raison d'ordre matériel nous n'avons pu consulter que partiellement les fonds mentionnés. Malgré la lourdeur bureaucratique dans la gestion des Archives, nous avons pu travailler dans des conditions acceptables grâce à l'accueil chaleureux du personnel.
LES BIBLIOTHEQUES
Nous avons surtout exploité les fonds de la Bibliothèque nationale et ceux du Centre d'information des sciences sociales. En dépit des conditions matérielles précaires ces deux bibliothèques disposent des ouvrages difficiles à trouver en France, notamment des travaux des dernières décennies parus au Vietnam. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux écrits récents sur les traditions paysannes, aux pièces de théâtre datant des années 1930. Les albums de photos nous auraient été précieux, mais ils ont tous disparus de la circulation. En effet on constate qu'un nombre non négligeable d'ouvrages se sont évaporés. On apprend par ailleurs que le fonds de la Bibliothèque nationale a été plusieurs fois transféré durant ces dernières décennies sous la menace de la guerre (dans les années 1960 et 1970 et au déclenchement des hostilités avec la Chine). A la section des périodiques de la Bibliothèque nationale, notre attention s'est porté sur la collection de la revue Van su dia (Littérature-Histoire-Géographie) devenue par la suite Nghiên cuu lich su (Recherche historique). En fin de consultation nous nous sommes rendus comptes que ces deux revues ne représentent pas un intérêt particulier pour notre sujet. Sinon, pas de grandes découvertes. Les collections des journaux de l'époque coloniale qui présentent pour nous un intérêt certain sont souvent très incomplètes, beaucoup plus qu'en France. Quant au fonds de l'Institut d'histoire, nous n'avons pu y accéder à cause des travaux d'aménagement en cours.
AUTRES SOURCES EN FRANCE
En matière de moeurs et de traditions ancestrales, nous disposons dans un premier temps des collections de journaux en langue vietnamienne quasiment complètes conservées à l'annexe de la Bibliothèque nationale à Versailles. Phong hoa (Moeurs et traditions) et Ngày nay (Actuel), entre autres, nous fournissent d'innombrables et inappréciables indications pouvant servir d'instrument de mesure de l'évolution sociale et familiale au Vietnam de l'époque étudiée.
Phong hoa (PH) :
PH est un journal d'émancipation sociale à caractère humoristique tenu par des progressistes. Nguyên Tuong Tam, alias Nhât Linh, dirige l'hebdomadaire avec la collaboration de ses frères cadets (Câm, Lân, et Long) et de Trân Khanh Giu, alias Khai Hung. Ce journal qui avait été fondé à l'origine par un groupe d'amateurs était menacé de disparition. Les frères Nguyên Tuong l'ont racheté sans changer de nom pour en faire leur tribune. De grand format (25 x 32, puis 45 x 60 cm à partir du numéro 13), le journal compte de 20 à 24 pages suivant les numéros et paraît le jeudi puis le vendredi, de juin 1932 à juin 1936. Sa durée de vie est relativement longue par rapport aux autres journaux et revues, compte tenu du contexte historique de l'époque. Son contenu se répartit en différentes rubriques : les débats d'opinion autour de l'évolution des moeurs, la littérature sous forme de roman-feuilleton 1 et de nouvelles, la poésie, le théâtre, les actualités régionales et internationales, les reportages, etc. Fait nouveau dans la presse vietnamienne, le journal est illustré de dessins humoristiques et de temps à autre de photos. Son plus fort tirage connu ne dépasse guère 16.000, et le tirage moyen se situe aux environs de 8.000. Son siège, doté d'une ligne téléphonique, se trouve au 1, rue Carnot (actuel rue Phan Dinh Phùng) à Hà nôi.
Ngày nay (NN) :
NN paraît quelques années plus tard mais bénéficie d'une longévité plus signifiante (1935-1945). Étant donné que Phong hoa et Ngày nay sont dirigés par le même comité de rédaction, leur but est identique, à peu de choses près; à savoir, réveiller la conscience collective pour abattre les coutumes et les croyances arriérées, les entraves à la marche du progrès. Sur la forme, le second apparaît comme plus moderne avec des photos dans chaque numéro, du moins dans les premiers. De format moyen, Ngày nay paraît trois fois par semaine puis devient très vite un hebdomadaire. Son tirage varie de 4.000 à 8.000 exemplaires. De même que celui de son aîné, son siège est à Hà nôi, au 55 rue des Vermicelles, mais Ngày nay dispose en plus d'une succursale à Saigon.
Sans être exhaustif, il convient de mentionner quelques autres journaux qui ont pris position pour le "nouveau" dans les débats, par exemple, Phu nu thoi dàm (Chronique de la femme, 1930-1934), Dàn bà moi (Femme moderne, 1934-1936), Tân tiên (Progrès, 1935-1938), Van minh (Civilisation, 1926-1931).
Si la presse vietnamienne était abondante dans les années 1930 et après, - on dénombre facilement une centaine de titres de périodiques comportant le terme "moi" ou "tân", tous deux veulent dire "nouveau" - , dans les années 1920 son nombre était limité à quelques dizaines de titres. Plus on remonte dans le temps, moins on trouve de titres. De ce fait, peu de choses nous sont parvenues de la conquête coloniale à 1907, date de naissance du mouvement Dông Kinh Nghia Thuc qui a placé les débats sur le plan national.
Enfin, nous avons également consulté les différents Fonds d'archives coloniales conservées au Centre des Archives d'Outre-Mer (CEDAOM) à Aix-en-Provence.
C H A P I T R E 1
LES STRUCTURES CULTURELLES
TRADITIONNELLES
Actuellement, un débat ressurgit dans certains milieux intellectuels vietnamiens, à savoir si le Vietnam fait partie du bloc Asie orientale (Chine, Japon, Corée), et continue à en faire partie, ou appartient à l'autre ère géographique nommée Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie, Malaisie,...). Derrière ce débat s'en cache un autre, à caractère politico-culturel : est-ce bien le confucianisme qui caractérise la culture vietnamienne ? Autrement dit, quel est la place du confucianisme dans la culture vietnamienne? Ce débat avait pour antécédent un contentieux politique datant de l'affaire du Cambodge en 1979. C'est le secrétaire général, Lê Duân, qui a déclenché cette controverse en accusant le confucianisme de tous les maux: instrument de pouvoir du mandarinat rétrograde pour opprimer le peuple. Les adversaires de Lê Duân voyaient dans cette doctrine un moyen de maintenir l'ordre moral au sein de la société et de la famille. Si ce débat s'arrêtait à ce niveau, on n'aurait fait qu'effleurer superficiellement le problème. On pourrait dire aussi que si les Vietnamiens posaient cette question, c'est parce qu'ils étaient à la recherche de leur propre identité culturelle. Quel paradoxe donc pour un peuple qui se réclame "d'une culture de quatre mille ans" (bôn nghin nam van hiên)! En réalité, les deux premiers millénaires de l'histoire du Vietnam restent encore à prouver, car les légendes sur les rois Hùng et ceux qui les ont précédés n'ont pas de valeur historique. Il nous reste donc la question de savoir si l'espace de deux mille ans est suffisant pour que la culture d'un peuple puisse prendre forme. A cette question, on ne peut répondre que par l'affirmative.
Qu'est-ce alors que la culture vietnamienne ? S'agit-il de la culture dominante ou de celle des dominés ? Par quoi sont-elles, l'une et l'autre, caractérisées ? Nous nous proposons, dans cette partie, d'étudier d'une part, les traits spécifiques de la culture confucéenne et ceux de quelques cultures paysannes, et d'autre part, le rapport des secondes avec la première.
LA CULTURE COMME INSTRUMENT DE POUVOIR
Il convient de rappeler que l'Asie est subdivisée en deux aires culturelles distinctes dont l'une pour pôle l'Inde et l'autre la Chine. La culture indienne s'est répandue à travers l'hindouisme et le bouddhisme au-delà des frontières de l'Inde, puisqu'elle est parvenue dans toute l'Asie du Sud-Est: Birmanie, Laos, Thailande, Cambodge, Indonésie, Malaisie....
Tandis que l'expansion de la culture chinoise, par le biais du confucianisme, s'est limitée principalement au Japon, à la Corée et au Vietnam. On constate aussi que la sinisation s'est souvent accompagnée de domination, exception faite du Japon; en revanche, l'indianisation s'est imposée sans effusion de sang. Il va sans dire également qu'à l'intérieur de chaque pays d'Asie il y a coexistence, encore jusqu'à nos jours, de la culture dominante et des autres courants culturels représentatifs des communautés issues de l'immigration (la communauté chinoise en Thailande, par exemple). Souvent cette coexistence dépasse les frontières culturelles pour donner une autre forme de culture qui intègre des différents éléments de chaque culture mise en jeu. Le Vietnam présente de ce point de vue un autre cas de figure.
Sans aller jusqu'à retracer l'histoire de l'implantation du confucianisme au Vietnam, ou à faire une étude comparative sur sa place dans différents pays d'Asie (Chine, Japon, Corée), ce qui serait par ailleurs des sujets passionnants, il nous semble important de donner quelques repères au sujet de cette pensée. Ce rappel aura un caractère ahistorique car le confucianisme sera traité comme une constante de l'histoire du Vietnam depuis son indépendance arrachée aux Chinois au onzième siècle jusqu'au vingtième siècle. Avec l'implantation du régime colonial, le confucianisme entre alors dans sa phase descendante sans disparaître complètement.
Quand on étudie le Vietnam on constate qu'au cours de deux mille ans de son histoire il n'a pas produit visiblement un seul penseur, un seul philosophe. Cependant, compte tenu de ses difficultés d'exister pour ce pays, l'emprunt d'une pensée d'origine étrangère, surtout celle sur laquelle s'appuyaient les plus forts ou les anciens dominateurs, pour servir de superstructure, pouvait être le raccourci afin de rattraper le train en marche, un moyen de s'imposer légitimement en tant que dirigeante pour la couche la plus influente. On retombe ici sur la notion de pouvoir, une sorte de "paradoxe de la légitimité" disait Maurice Godelier. D'après lui, "tout pouvoir de domination se compose de deux éléments indissociablement mêlés qui en font la force: la violence et le consentement". Il pousse son analyse plus loin en affirmant " que des deux composantes du pouvoir la force la plus forte n'est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur domination". En clair, la répression, la violence physique et psychologique sont moins efficaces que l'adhésion ou la coopération, pour une raison essentielle, à savoir que la domination est apparue comme un service rendu aux dominés, un échange entre ces derniers et leurs dominants. Les deux parties partagent ainsi les mêmes représentations 1 .
Dans la société vietnamienne, le confucianisme érigé en doctrine politico-sociale illustre parfaitement cette analyse. Etant donné que dans la cosmologie confucéenne, l'au-delà, c'est à dire le Ciel ou Thiên en sino-vietnamien ( ), représente l'harmonie, l'ordre, la perfection, le monde d'en-bas doit le prendre comme modèle afin d'atteindre les résultats probants quant à l'organisation politique et sociale. Dans cette représentation, ces deux mondes communiquent par l'intermédiaire de l'empereur, nommé fils du Ciel ou Thiên tu, le garant de l'ordre chargé d'appliquer la doctrine suprême. L'idéogramme désignant ce personnage ( ) se passe de commentaire. En effet, le long trait horizontal du haut représentant le Ciel est plus long que celui d'en-bas symbolisant le Terre et ces deux traits sont reliés par la verticale.
Sur le plan pratique, cette philosophie s'appuie sur les trois piliers, appelés les trois relations fondamentales (tam cuong), et sur les cinq vertus (ngu thuong). Puisque l'empereur occupe la place centrale, le premier pilier repose sur le comportement, le devoir du sujet envers le souverain: respect, loyauté, appelés "chung" en sino-vietnamien. A l'échelle familiale, cette relation se traduit par la piété filiale, appelée "hiêu", et la fidélité conjugale ou "thuy". Ces rapports sont tous construits sur le même modèle, dans le même esprit. D'un côté on a le sauveur, le protecteur, le garant de l'ordre en la personne de l'empereur au niveau national, du père et du mari au niveau familial; et de l'autre côté le serviteur, le soumis représenté par le sujet, le fils et le femme. La notion d'ordre et d'harmonie apparaît comme une valeur intrinsèque qu'on doit à tout prix préserver. C'est elle qui dicte le comportement de chaque membre de la famille, l'unité de base de la société, qui régule les tensions et conflits inter-personnels. C'est manifestement la famille qui constitue le lieu de prédilection où s'enracine cette règle d'or. Mais ces relations n'ont de la valeur que si les individus sont éduqués dans ce but, même s'ils sont considérés par Confucius lui-même comme purs à leur naissance 1. Ainsi l'être humain doit durant son existence cultiver les cinq vertus:
- Nhân ( humanité );
- Nghia ( bonté et reconnaissance);
- Lê ( politesse );
- Tri (intelligence );
- Tin (confiance).
Cet esprit peut être résumé dans la devise confucéenne "Tu thân, tê gia, tri quôc, binh thiên ha". Même si l'ordre n'est pas indiqué explicitement, on doit comprendre qu'il faut d'abord "s'éduquer soi-même", ensuite "gérer les affaires familiales" avant de "gouverner la pays" puis de "pacifier le monde". La vie est constituée sous cet angle d'étapes successives à franchir, et il n'est pas admis qu'une d'entre elles soit sautée. Autrement dit, un individu mauvais ne peut être un bon père ou une bonne mère de famille, sans parler des étapes suivantes; de même, celui qui a su pacifier le monde apparaît, aux yeux des autres, comme une personne qui avait réussi tout le parcours de la vie, donc une figure légitime. Si d'apparence cette devise concerne tout le monde, en réalité elle ne s'adresse qu'à l'homme et non à la femme, car la société humaine repose de fait sur ses représentants mâles. L'humanité est ainsi privée de la moitié de ses potentiels. L'édifice étant conçu, encore faut-il le construire puis le maintenir en état. Cette question se règle par le contingent de mandarins appelés à servir l'empereur, c'est à dire le pays et la nation. La porte du mandarinat est ouverte à tous sans discrimination, à l'exception de ceux qui ne respectent pas l'ordre étable. Les concours littéraires sont organisés à cet effet. Ce système de formation d'élite, comme tout autre système, vise à cristalliser et consolider les bases théoriques et les pratiques qui en découlent. Dès lors cette vision fermée sur le monde extérieur ne laisse aucune place à un appel d'air nécessaire à la génération des idées novatrices en accord avec un monde en mutations. Cependant, si l'on replace les choses dans leur contexte, en rappelant que Confucius était le contemporain de Bouddha (VIe siècle av. J.C., le temps où le monde apparaissait comme constitué d'îlôts sans rapport les uns avec les autres), elles semblent moins critiquables. Quoi qu'il en soit, cette vision confucéenne du monde a sa propre logique : qu'elle soit juste ou fausse, réductrice ou non, elle est quand même cohérente avec elle-même. A partir du moment où le monde est réduit à un centre et à ses périphéries, celui qui croit occuper la place centrale s'autorise alors à s'ériger en maître, et n'a rien à apprendre des autres puisqu'ils sont considérés comme des sauvages. Cette conviction ne fait que renforcer les représentations de ceux qui croient être le centre du monde; la boucle est ainsi bouclée.
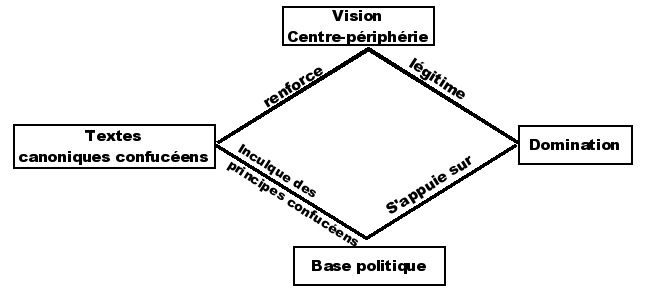
LES QAUTRE ETAPES DE L'ASSIMILATION DU MONDE
EXTERIEUR PAR LA CHINE :
1. La vision "centre-périphérie" incite
la domination sur la périphérie et légitime
cet acte; Pour y établir la domination il faut asseoir
la base politique;
2. Pour asseoir la base politique il faut
inculquer les principes confucéens aux dominés;
3. Ces principes passent par l'étude des caractères;
4. L'étude des caractères basés sur les canons
confucéens renforce la vision "centre-
périphérie". La boucle est ainsi bouclée.
On remarque aussi que dans ce cycle, le maillon le plus faible est l'étude des caractères.
Il nous reste maintenant à voir comment cette doctrine s'est manifestée dans la société vietnamienne en général, et plus précisément dans les couches dirigeantes qui l'ont empruntée puis l'ont fait appliquer à l'échelle nationale. Pourquoi donc celle-ci fut-elle adoptée plutôt qu'une autre? Les raisons sans doute les plus évidentes de cet emprunt sont d'ordre historique. La longue domination chinoise de dix siècles (111 av. J.C. - 938 ap. J.C.) entrecoupée de révoltes et de luttes pour l'indépendance, constitue le cadre de la sinisation du Giao chi annexé à l'Empire du Milieu. La deuxième étape de cette domination allant de l'an 43 à l'an 543, marquée par la volonté de Si Nhiêp, le gouverneur chinois de cette province du sud, pose des jalons d'une intégration aux structures chinoises en démocratisant les connaissances. En effet, les Vietnamiens voient encore en Si nhiêp un grand homme de bonne volonté, un bienfaiteur. Après avoir assis des fondations la Chine poursuit et intensifie sa politique d'assimilation avec l'arrivée des Tang à la Cour impériale (618-907). Grâce à cette base politique, la culture chinoise sous sa forme confucéenne s'introduit et se répand au pays des Viet. L'étude des caractères han, du nom de la dynastie régnante, est encouragée et adoptée chez des Vietnamiens ayant soif de connaissances. Cependant faute d'historiographies vietnamiennes relatives à la domination chinoise on ignore l'étendue de l'expansion du confucianisme au Vietnam. Le manque de sources statistiques (démographie, enseignement, etc.) et de données sociologiques constitue un obstacle à la compréhension et à la description de ce fait. On ignore, par exemple, si les masses paysannes vietnamiennes savaient lire et écrire les caractères chinois, leurs réactions face à une culture d'origine étrangère, etc. On est alors amené à faire des hypothèses à partir des éléments connus qui sont plutôt des cas particuliers. L'envoi en Chine de quelques érudits signifie-t-il que la majorité des Vietnamiens connaissent les caractères? Par contre, si les Vietnamiens devaient partir en Chine pour obtenir des grades universitaires c'est qu'au Vietnam il n'y avait pas de structures comparables à celles existant en Chine à la même époque. L'Administration chinoise ne jugeait, peut-être pas nécessaire d'avoir une telle structure étant donné le nombre insuffisant des élites. Ou bien, comme le fait d'être couronné en Chine constituait une distinction sociale, il fallait maintenir ce rituel pour consolider le mythe de la grandeur de la culture chinoise. De nos jours ce processus de mythification fonctionne encore à merveille. Les pays du Tiers Monde envoient annuellement leurs contingents d'étudiants et cadres se former dans les pays dits développés. La dépendance politique des premiers passe entre autres par la dépendance culturelle.
Quoi qu'il en soit, il fallut attendre l'an 1070, soixante ans après la reconquête de l'indépendance nationale par les Ly, pour que la classe dirigeante vietnamienne édifiât le temple Van miêu pour rendre hommage à Confucius, et encore six ans après pour que les concours littéraires devinssent une institution nationale. Il est à noter aussi que ce monument construit dans la capitale reste l'unique lieu de culte dédié à Confucius. Quelle était la population de Hanoi à cette époque? Nul ne le sait avec exactitude. En tout cas elle ne pouvait dépasser quelques dizaines de milliers, étant donnée la superficie de la ville; et comme Hanoi était avant tout la capitale politique et administrative, ceux qui y vivaient, en dehors de la Cour, ne pouvaient être que l'élite mandarinale avec ses serviteurs. Quant à ceux qui vivaient d'activités économiques et d'artisanat, leur nombre aurait été insignifiant. On peut ainsi en déduire que le Van miêu, avec toutes ses significations, était essentiellement l'oeuvre de la Cour et du mandarinat, un lieu sacré où se déroulaient les rituels liés à l'exercice du pouvoir. En d'autres termes, le confucianisme était surtout le souci des classes dirigeantes qui reprenaient à leur compte le schéma des anciens maîtres pour avoir la haute main sur les affaires nationales, et pour maintenir le statu-quo de l'ordre établi.
L'adoption du confucianisme aurait été une nécessité dictée par les circonstances car les Vietnamiens n'avaient rien d'équivalent sur le plan de la pensée. Le bouddhisme aurait fait l'affaire, étant donnée sa diffusion dans la société vietnamienne à une date relativement avancée (IIe - IIIe siècle de notre ère). Mais à la différence du confucianisme, qui était aussi une doctrine étatiste, le bouddhisme visait à délivrer l'être humain de ses souffrances conditionnées par la vie; les bases politiques n'étaient pas nécessaires à son implantation. Par corollaire, cette doctrine ne pouvait être prise comme instrument de pouvoir. Or, tout pouvoir doit s'appuyer sur la notion de contrat passé entre gouvernants et gouvernés afin de perdurer. Cette composante du pouvoir restait le pivot du confucianisme étatisé. L'empereur, avec l'aide des classes dirigeantes, veillait sur le bien-être du peuple qui, en revanche, devait le payer pour les services rendus, en impôts, corvée et service militaire. C'était bel et bien le confucianisme qui a structuré la société vietnamienne en instituant les règles de conduite morale et sociale en public ou en privé. D'autres explications restent à explorer, néanmoins on pourrait avancer également l'idée que le tempérament et la mentalité des Vietnamiens étaient prêts à recevoir la doctrine confucéenne. Trinh Van Thao qui étudie dans un ouvrage récent 1 le rapport et le passage du confucianisme au communisme à travers trois générations d'intellectuels (1862, 1907, 1925) apporte à cet égard un éclairage inédit. Mais un examen de la culture villageoise permettrait de restituer chaque culture à sa place et d'en dégager ce qui lui est propre.
L E V I L A G E V I E T N A M I E N
O U L A C O N T R E - C U L T U R E
L'une des caractéristiques de la culture populaire villageoise au Vietnam réside dans sa tradition orale. L'organisation sociale s'appuie plutôt sur le village que sur la famille, ce qui représente à la fois sa force et sa faiblesse. La haie de bambou servant autant de défense naturelle que de frontière inviolable en est le symbole. Le centre décisionnelle de toutes les activités relatives à la vie du village n'est rien d'autre que la maison communale ou le Dinh. Étant donné que la riziculture occupe la place principale, les autres activités dépendent du calendrier agricole. L'artisanat (vannerie, tissage, travail de la soie, menuiserie, sculpture sur bois ...) représente une place non négligeable dans certains villages, mais d'autres se contentent uniquement du produit des récoltes. La période de repos est souvent matérialisée par les fêtes, temps indispensable à la régénération, au renouvellement des forces physiques et spirituelles. Si les cérémonies et les réceptions les plus solennelles ont lieu à la maison communale, les fêtes qui sont par ailleurs de hauts lieux de sociabilité et de convivialité s'y déroulent également. L'harmonie de la culture villageoise repose sur l'articulation d'un ensemble de facteurs aussi nécessaires les uns que les autres. Si on en supprime un pour une raison ou une autre, l'équilibre sera rompu et il s'ensuivra des conséquences fastes ou néfastes selon l'interprétation de l'observateur en place.
Nous souhaitons, dans la mesure du possible et sur certains aspects, parvenir à une étude comparative de deux cultures, l'une académique basée sur les textes, et l'autre populaire appuyée sur la tradition orale. Cependant, ce serait simpliste de dire que d'un côté on a la culture confucéenne, et de l'autre, la culture populaire, car cette dernière représente un conglomérat de cultures régionales qui, à degrés divers, sont traversées par la culture dominante avant de se subdiviser en cultures villageoises. Mais pour des raisons matérielles nous ne pourrions traiter en profondeur toutes les cultures régionales du Nord-Vietnam. Nous nous proposons donc de donner un cadre général puis des cas ou des aspects qui nous semblent révélateurs de la tradition populaire. Ce constat nous servira par la suite d'indicateur dans la confrontation entre la modernité et la tradition.
I. Généralités
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser les quelques termes souvent utilisés pour désigner la commune vietnamienne:
Làng : terme vietnamien désignant l'unité de l'espace vital néanmoins complète des paysans;
Xa ( ) : terme sino-vietnamien désignant l'unité administrative dans certaines régions. Dans le delta et sur les hauts plateaux du Nord-Vietnam, un xa peut comprendre un ou plusieurs làng, selon le cas. Quand un làng fait partie d'un xa il prend alors le nom de thôn, terme sino-vietnamien.
Ainsi thôn et làng ont la même signification, mais chacun renferme ses propres couleurs. Làng, chargé d'affectivité, est utilisé surtout dans le langage courant, tandis que thôn avec son côté administratif est surtout employé dans les écrits officiels 1. Une autre caractéristique est à signaler également: chaque village vietnamien possède deux noms, l'un vulgaire (tên nôm), l'autre littéraire (tên chu). Il va sans dire que la tradition orale aime à employer le nom vulgaire et que le nom littéraire est laissé aux bons soins des administratifs.
Bien que le village vietnamien ait fait couler beaucoup d'encre depuis la colonisation, il n'en reste pas moins un sujet difficile à saisir dans sa globalité, et l'intérêt qu'il suscite n'a cessé de s'accroître durant ces deux dernières décennies. Au début des années 1970 il était question d'organiser au Vietnam un colloque sur le thème "La campagne vietnamienne dans l'histoire" mais le climat de guerre a empêché cette concrétisation. Cependant l'acte du colloque, rassemblant des écrits de spécialistes de compétence très diverses, a été publié en deux volumes, le premier en 1977 et le deuxième en 1978 par "l'Edition des sciences sociales" de Hanoi 1. Il n'en demeure pas moins que bien des questions subsistent. Par exemple, celle liée à l'origine du làng, qu'on ignore encore.
Le nom de xa est mentionné, semble-t-il, pour la première fois, dans les annales locales vers la fin de la domination chinoise en Annam. A en croire Nguyen Huu Khang, "Khuc Thua Hao, gouverneur annamite (907-917), divisa le pays en phu (préfectures), huyên (districts) et xa. Mais nous ne savons rien de l'organisation du xa à cette époque" 2. Cependant d'après cet auteur, le premier recensement des inscrits eut lieu au cours de l'année 1082; et sous le règne de Trân Thai Tôn (1225-1258), les deux catégories d'administrateurs communaux étaient recrutés parmi les mandarins appartenant au moins à la 6e classe (administrateur-adjoint) et à la 5e classe (administrateur principal). Quant à savoir si le làng est une institution chinoise, il est de plus en plus difficile de l'affirmer, même si les travaux de Luro et de Ory vont dans ce sens. Ceci au moins pour deux raisons.
- D'abord, la notion chinoise du "village" a toujours été définie comme un groupement de familles, et le conseil communal était formé uniquement de chefs de famille. Au pays d'Annam le làng est lié à l'idée de regroupement d'un certain nombre d'occupants (et non de familles) et à l'existence d'un espace vital qui leur avait été attribué. Le conseil des notables ne se compose pas de chefs de famille mais de représentants du village.
- La maison communale ou dinh dont certains font coïncider le début de l'existence avec la fondation des Trân (XIIIe siècle), mais dont on ignore toujours l'origine, avait une architecture différente de celle de son homologue en Chine, puisque ce bâtiment était construit sur pilotis, d'après les vestiges trouvés par les archéologues vietnamiens, comme l'habitat des minorités ethniques du Vietnam (Muong, Thai... ), et celui des peuples voisins (Lao, Khmer, Thaïlandais, ...).
Pour comprendre la société vietnamienne on ne peut faire l'impasse sur le village vietnamien. L'ethnologue Nguyên Tu Chi dirait, en d'autres termes que " comprendre le làng revient à avoir en main une base minimale et nécessaire pour comprendre la société des Viet, en particulier, et la société vietnamienne en général", puisque le village vietnamien est "la cellule vivante de la société vietnamienne, le produit naturel du passé chez le Vietnamien riziculteur" 1. Il est généralement admis que le village vietnamien bénéficie d'une certaine autonomie interne à l'égard du pouvoir central. "La commune annamite, écrivait Nguyên Van Huyên dans une étude sur ce thème, est reconnue depuis toujours comme impénétrable" 2. Le journal Ngày nay, dans son numéro du 7 mai 1935, allait dans le même sens: "Derrière les touffes de bambou, chaque village vietnamien est un monde à part. Si l'organisation administrative est identique partout, les coutumes et les usages varient d'un village à l'autre".
Il est à remarquer que deux populations de deux villages voisins, séparés seulement par une rizière, ont souvent des accents linguistiques différent 1. A quoi tient ce phénomène ? Les gens du village l'attribuent facilement à la nature de l'eau consommée, c'est à dire trouvée dans le puits du village. Quoi qu'il en soit, ce trait linguistique s'ajoute aux autres particularités de chaque village, qui constituent en somme sa propre identité. Et on peut dire, sans trop prendre de risque, que chaque village vietnamien forme une unité à la fois politique, économique, sociale, culturelle et cultuelle, et que chaque villageois, homme ou femme, enfant ou adulte, a la charge de maintenir cette cohésion et de la perpétuer. On ne peut s'empêcher, à cet égard, de poser la question : "Quelle est alors la place du pouvoir central dans cette forteresse?" Il est indéniable que le village ne peut jouir d'une indépendance totale. L'administration centrale intervient au niveau du contrôle des inscrits qui est jalousement gardé par les autorités villageoises. En fait, elle ont peur des conséquences éventuelles. Nguyên Van Huyên donne l'exemple du village Da nguu dans la province de Bac ninh qui n'avait que 909 inscrits d'après le recensement de 1931, mais une fois la vérification faite, on en comptait 2348 2. En effet, le contrôle des inscrits est un outil redoutable pour le pouvoir central, car il permet de déduire la part des impôts à prélever, le quota des corvéables et enfin le contingent mobilisable pour le service national; ce sont les trois principaux services que le village doit lui rendre. Dans l'ancien temps, la Cour devait recourir à la peine de mort pour punir les responsables du village qui auraient fait des déclarations mensongères sur ces chiffres. (La bataille des chiffres, comme on le voit, ne date pas de l'époque coloniale mais est bien antérieure.) Par ces trois contraintes, l'Etat arrivait à dicter sa politique et à imposer une certaine rigueur économique au village. (Il est à souligner que même à l'heure actuelle l'Etat tire l'essentiel de ses ressources des impôts versés par les villages, puisque le régime de l'impôt sur le revenu n'existe toujours pas pour les citoyens.) Les autres dimensions (culturelles, cultuelles, sociales...) sont prises en main directement par le village.
On a vu plus haut que l'existence du village est étroitement liée à celle de son espace, formé du territoire destiné à l'habitat, et des rizières. L'organisation de l'espace suit un schéma assez commun : l'habitat s'ouvre sur les rizières 1. Si l'espace réservé à l'habitat est fermé par la haie de bambou, en revanche l'intérieur du village est complètement ouvert. En effet, les portes de chaque maison restent ouvertes toute la journée et les maisons communiquent entre elles malgré la séparation apparente que constituent les murets 2. Cette particularité confirme donc l'unité du village face à l'extérieur. D'ailleurs, quand un individu étranger au village franchit pour la première fois la haie de bambou, il se trouve devant une sorte de labyrinthe dont seuls les villageois détiennent le secret. Pour cette raison, en temps de guerre, le village demeure le refuge naturel pour ceux qui veulent échapper au contrôle de l'adversaire. Le sentiment national, l'esprit nationaliste chez les Vietnamiens n'étonnent plus les observateurs, cependant ils sont avant tout "le peuple du village" (dân làng) avant d'être les citoyens, le peuple de la nation (dân nuoc). Fier de ses traditions et de son mode de vie, fort de la solidarité communautaire, le village s'érige en quelque sorte en une autorité de fait pour contrebalancer le pouvoir central. L'expression qui est sur les lèvres de chaque villageois phep vua thua lê làng (l'ordre du roi cède le pas aux coutumes du village) en est la preuve. A l'heure actuelle, on voit, par exemple, à l'entrée de certains villages, un écriteau qui prévient les visiteurs motorisés qu'ils ont à payer une petite "taxe de circulation" qui servira à l'entretien des routes. Cette initiative échappe totalement aux autorités centrales, en l'occurrence le parti. Cependant, en cas de désaccord avec le pouvoir, le village ne cherche jamais à l'affronter, à s'opposer par la force, mais au contraire, il s'efforce de trouver des moyens plus dissuasifs pour ne pas le heurter. Seul le résultat compte, la façon d'agir doit être la plus souple mais aussi la plus efficace possible, quitte à faire des détours, à être lésé en apparence. En un mot, la culture villageoise préfère le consensus, le compromis à tout acte extrémiste.
Hier comme aujourd'hui, l'existence d'un village repose avant tout sur la riziculture. Au Nord-Vietnam depuis fort longtemps les paysans arrivent à avoir deux récoltes par an : le riz du cinquième mois (vers juin) et le riz du dixième mois (vers novembre), plus connus respectivement sous les vocables de "vu chiêm" et "vu mùa". Pour assurer un travail efficace et avoir un bon rendement, les paysans ont recours à une répartition des tâches entre toutes les personnes en âge de travailler. Au niveau d'une famille, la cogestion assurée à la fois par l'homme et la femme témoigne d'une entente et d'une responsabilité partagée. On a tendance à croire que le travail le plus pénible repose sur l'homme, mais en réalité la femme fait preuve d'une endurance inégalée. Prenons le cycle agraire, et nous constatons que la femme fournit des efforts au moins égaux à ceux de l'homme.
Répartition des tâches agricoles entre l'homme et la femme
-
Tâches
homme
femme
Labourage
h
Hersage
h
Semailles
f
Repiquage
f
Irrigation
h
f
Moissons
h
f
Battage
h
f
Décorticag
h
f
Blanchissage
f
Il est vrai que le labourage et le hersage demandent un effort physique de la part de l'homme, mais la grosse part n'est-elle pas déjà fournie par l'animal, en l'occurrence le buffle? Il n'en est pas de même pour le repiquage qui, certes, ne nécessite pas un effort physique incommensurable; cependant la femme doit, à longueur de journée, courber le dos pour effectuer ce travail. Une personne non initiée aurait le dos "cassé" au bout d'une journée de repiquage. La remarque d'un observateur français, en poste à Hanoi, qui travaille sur l'agriculture au Vietnam, en voyant des Vietnamiennes d'un certain âge marcher le dos courbé dans les rues, résume bien cette tâche :"On dirait qu'elles continuent à repiquer leurs plants de riz." Cette étape est considérée par l'ethnologue Nguyen Tu Chi comme la plus pénible de la riziculture. En effet, il s'agit d'un travail de fourmi que seule la main de l'homme, par expérience, peut assurer. A ce jour aucune mécanisation n'a été possible. Le travail de la femme ne s'arrête pas là, on voit encore de nos jours des femmes au visage camouflé pour se protéger contre la chaleur torride de l'été, irriguer les rizières aux heures les plus chaudes de la journée (midi - quatorze heures).
Par ailleurs, si les travaux agricoles s'insèrent étroitement dans le tissu économique villageois, ils s'enracinent aussi profondément dans la tradition. La vie moderne a apporté le calendrier grégorien mais les villageois continuent, même à nos jours, à vivre avec le calendrier lunaire. Les semailles, les récoltes, et diverses activités, qu'elles soient publiques ou privées, reposent encore sur celui-ci. Dans le quotidien c'est encore lui qui sert de repères temporels dans les conversations.
II. L'appareil administratif
Si l'appareil administratif villageois vietnamien a subi des secousses à différentes époques il n'en demeurait pas moins un trait identitaire de la culture villageoise. Son évolution nous importe moins que son enracinement. Pour cette raison précise la présentation qui suit ressemble plutôt à une constante historique qu'à une confrontation avec la modernité.
Décrire l'appareil administratif du village vietnamien revient à identifier ses rapports avec le pouvoir central. Ici, l'appareil administratif répond à deux prérogatives. D'abord, le village, comme identité et unité politique, sociale, culturelle et cultuelle, se doit de se doter d'une règle de fonctionnement interne; d'autre part, l'Etat centralisateur a besoin d'un outil sur lequel il agit afin de pouvoir contrôler l'ensemble du territoire. De là découlent deux logiques, deux modèles ou deux pratiques, parfois antagonistes, qui se heurtent, parfois dépendants, qui s'interpénètrent selon les époques où l'Etat est fort ou faible. Néanmoins ces deux modèles qui ne partagent pas les même intérêts choisissent le même mode de représentation. En effet, le village vietnamien est, dans l'un ou dans l'autre modèle, représenté par une personne, à savoir le chef du village.
De tout temps et à n'importe quelle époque, le village vietnamien reste le pivot de la survie nationale en temps de paix comme en temps de guerre. De tout temps aussi, le village résiste à toute tentative de changement que ce soit sur le plan administratif, politique ou culturel, surtout s'il se sent menacé par la perte d'identité ou d'autonomie qui en découlerait. Tout souverain sait en tenir compte et essaie de l'utiliser à ses fins. Comme tout régime d'inspiration étatique, les monarchies de l'ancien Vietnam devaient compter et s'appuyer sur leurs instruments de pouvoir pour gouverner. Ce prolongement de l'autorité centrale se nommait "mandarinat", et était formé de lettrés reçus aux concours littéraires. C'était parmi ces gradés que le pouvoir central choisissait ses administrateurs communaux. A l'époque des Trân (1225-1400), on distinguait parmi eux deux catégories:
- les dai tu xa, recrutés parmi les mandarins de 5e classe et des classes supérieures;
- les tiêu tu xa, recrutés parmi les mandarins de 6e classe et des classes inférieures 1.
Par la suite, aussitôt arrivé au pouvoir, Lê Loi (1427-1433) a rétabli l'institution des mandarins communaux supprimée sous les Minh. Il en nommait trois dans les grands villages ayant plus de 100 inscrits, deux dans les moyens villages dont le nombre des inscrits était compris entre 50 et 100, et un dans les petits villages ayant moins de 50 inscrits 1. Peu à peu, cette nomination est devenue une attribution des mandarins des phu (préfecture) ou des huyên (district). Les mandarins communaux avaient la charge de "l'administration générale des affaires de la commune, de l'instruction et de la solution des procès, d'instruire et de policer les habitants" 2. De ce fait, l'Etat ne connaissait le village qu'à travers ses hommes, ceci pour deux raisons voulues à la fois par les uns et par les autres. D'un côté, le pouvoir central reconnaissait le village comme une personne morale, une unité sociale représentée par un seul homme désigné par lui, et ne cherchait pas à avoir affaire directement avec les individus. A cet égard, il suffisait que quelques individus sèment le désordre (pillage, révolte...) pour que tout le village fût puni par les autorités supérieures. De l'autre côté, le village se gardait de tout divulguer, de rapporter les activités et les affaires internes au représentant officiel, en qui il n'avait pas entièrement confiance.
Pour se maintenir au pouvoir, les monarques avaient besoin des contributions du peuple entier à qui il faisait appel pour le service militaire, pour la corvée, pour payer les impôts et diverses taxes. Ces trois obligations indiscutables, les mandarins communaux devaient veiller à les faire appliquer. C'était sur eux que pèseraient les menaces si les impôts tardaient à venir, si le contingent pour le service militaire ou la corvée manquait d'effectifs. Ayant la charge de mener à bien les affaires, ils répercutaient les menaces sur le village par l'intermédiaire de son représentant. A l'inverse, pour satisfaire le peuple, l'Etat le payait pour les services rendus en mettant un certain nombre de terres à sa disposition. Rappelons au passage qu'en vertu de la monarchie d'inspiration confucianiste, le territoire national relevait de la propriété du roi, qui déléguait aux mandarins communaux l'attribution des terres cultivables à chaque village, selon le nombre d'inscrits et les règles définies par le cadastre. En général tous les trois ans, la répartition des terres devait être revue et corrigée en fonction des données réelles du moment. L'adage populaire dit aussi à ce propos que "Les terres appartiennent au roi, la pagode au bouddha" (dât cua vua chùa cua but). Mais l'Etat, lui aussi, avait ses devoirs envers le peuple. Il revenait à lui d'assurer la sécurité, la défense du territoire, de faire reculer les risques de calamités naturelles, d'écarter les fléaux et d'entreprendre les grands travaux hydrauliques .
Nous venons de retracer brièvement la logique voulue par l'Etat centralisé pour établir son emprise sur le village. Bien que la nature des rapports, les attributions des tâches soient connues, nous nous heurtons à une zone d'incertitude quant à la pratique décisionnelle, à savoir sur qui reposait le véritable pouvoir au sein d'un village vietnamien. Faute de sources et de travaux approfondis nous nous contentons de donner l'organigramme qui nous paraît le plus vraisemblable et le plus fréquemment rencontré. En d'autres termes, le modèle proposé repose sur un minimum d'organes fonctionnels et qui a survécu jusqu'à l'époque coloniale. Nous obtiendrons un appareil de type "vuong tuoc" (modèle étatique ou littéralement "prestige lié au roi") qui comprend:
- le Tiên chi, personnage le plus gradé du village. C'est à lui que revient le pouvoir de décision sur toutes les affaires du village. Tout acte administratif doit d'abord comporter sa signature. Il occupe la place la plus prestigieuse dans les réunions et dans les repas à caractère public. Il a toujours droit à la "tête du cochon" (thu lon), la partie de l'animal réservée symboliquement à la plus haute hiérarchie.
- le Thu chi, l'adjoint du précédent dans les grands villages. Il le seconde. Sa signature dans les écrits officiels vient juste après celle du Tiên chi; par contre, il n'a pas droit à la "tête du cochon" lors des festivités, à moins que son supérieur veuille bien la partager avec lui.
- Le ky muc, ou conseil des notables formés de gradés, d'hommes d'âge (60 ans ou plus), d'anciens notables, d'anciens représentants et de représentants en exercice du village. Mis à part les gradés, tous les autres membres du conseil doivent, pour être reconnus par tout le village, officialiser leur titre en organisant un grand repas au dinh. C'est le rituel "khao vong". Font partie aussi du conseil ceux qui ont acheté des titres à la Cour. Cette pratique permet à la Cour dans les moments de "vaches maigres", d'avoir des rentrées en nature en vendant un certain nombre de terres. Il va de soi que seuls les riches propriétaires peuvent les acheter.Il semble bien que toutes les affaires du village reposent sur ce conseil présidé par le "Tiên chi". Les hommes âgés, pourtant membres à part entière, n'assistent aux réunions qu'à titre consultatif au mieux, sinon ils sont réduits au rôle de simples observateurs. L'une des attributions du conseil consiste à nommer le "Ly truong".
- Le "Ly truong" est le représentant officiel du pouvoir central devant le village et inversement. Les décisions de l'un ou les réclamations de l'autre passent par lui avant d'atteindre la partie adverse. Etant nommé par le conseil des notables, il a la charge d'exécuter ou de faire exécuter par ses collaborateurs les décisions prises par celui-ci. Cependant son entrée en fonction n'est effective qu'à partir du moment où il est reconnu par le village (les habitants) et par les autorités supérieures au Huyên dont dépend le village. C'est sur lui que pèsent les menaces, les critiques quand l'Etat se juge insatisfait des contributions du peuple; et c'est contre lui que se retourne le village s'il le trouve injuste ou partial dans ses actes. Effectivement, le village a le droit, en principe, d'intenter un procès contre lui devant le mandarin du district. Parmi les collaborateurs du "Ly truong", on trouve en général:
- un "thây tu", lettré ayant pour tâches de rédiger les voeux, les prières dans les cérémonies;
- un "thây thông giang", chargé de traduire et d'expliquer toutes les décisions administratives venant d'en-haut au village;
- un "thu bô", responsable des registres des inscrits et du cadastre;
- un "lang cai", gardien de tout acte de vente, d'achat, de changement de propriétaire, etc.;
- un "thây sa nam", responsable des rites
- un "ông tu", gardien de la maison communale;
et enfin, un personnage marginalisé, au service aussi de tout le monde, appelé "thang mo", à qui on demande d'annoncer des nouvelles au village, de convoquer/inviter les intéressés aux réunions, etc. Ce jeune homme indésirable parcourt alors le village en tapant sur son "mo" 1 pour attirer l'attention de chacun.
ORGANIGRAMME DE L'APPAREIL ADMINISTRATIF
DU VILLAGE VIETNAMIEN
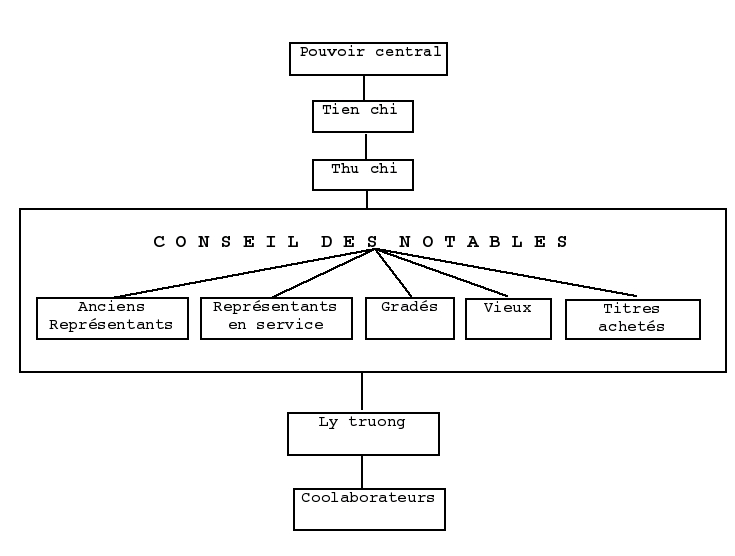
Nous avons signalé plus haut qu'il y avait concurrence de deux modèles de représentation du village: l'un de type "vuong tuoc" (prestige lié au roi) et l'autre de type "xi tuoc" (prestige lié à l'âge). On se doute bien que ces deux modèles se distinguent par le fond et non par la forme. En effet, l'appareil administratif institué par le pouvoir central ou celui mis en place par la tradition villageoise restent quasiment identique. Par exemple, la nomination du "ly truong" relève toujours du conseil des notables. Par contre, selon la tradition villageoise, le "tien chi" doit être issu du peuple, c'est à dire doit être né et avoir grandi dans le cadre du village. Ce rôle ne peut revenir qu'à l'homme le plus âgé et le plus respectable par son intégrité et par sa vision juste des choses (dao duc). On comprend alors les réactions du village quand arrive le mandarin venu d'ailleurs, même s'il est nommé par le pouvoir central, car pour le village il s'agit d'un acte d'immixtion dans ses affaires internes. Cependant les affrontements avec les autorités supérieures sur cette question sont toujours évités étant donnée la culture villageoise qui recherche avant tout le compromis. En effet, il y a bien coexistence de deux réalités entièrement indépendantes sans que l'une ou l'autre soit complètement anéantie. Cherchant à définir les rapports entre le village et l'Etat vietnamiens, Nguyên Dông Chi écrit: " Même si ceci (le village) est la base de cela (le pouvoir central), le premier respecte le second (...). En revanche, même si cela domine ceci, en définitive il n'arrive pas à le maîtriser totalement" 1. Mais quand l'Etat est fort, les exactions deviennent une pratique courante. Sous les Trân (1225-1400), pour se prémunir contre toutes dissimulations du nombre des inscrits, l'Etat prenait des mesures oppressives concernant les obligations. Il choisissait arbitrairement le nombre d'inscrits déclarés d'une certaine année pour servir de base intangible aux années ultérieures; alors qu'en principe, il devait tenir compte à chaque échéance du nombre de naissances et de décès dans la répartition des terres, les prélèvements d'impôts, etc. 2. A ce caractère tyrannique, le village opposait une résistance active dictée par sa tradition défensive, en pratiquant la stratégie "dông không, nhà trông" (rizières abandonnées, maisons vidées). Dans la première phase, les villageois laissaient leur logement tomber en ruine et ne s'occupaient plus de leurs rizières. Ensuite ils s'enfuyaient petit à petit dans d'autres localités et s'y installaient pendant quelques années, en laissant les autorités de faire ce qu'elles voulaient des terres abandonnées. Enfin, un petit groupe de familles regagnait le village et demandait aux autorités de reconsidérer la nouvelle situation. Si cela ne suffisait pas, le groupe n'hésitait pas à les corrompre. La corruption vue sous cet angle devenait une arme pour lutter contre les exactions. En fin de compte, l'Etat a dû céder et procéder à la nouvelle réglementation en diminuant les impôts pour montrer sa "générosité" 1. Par contre, quand l'Etat et le village arrivaient à coexister sur la base d'un certain respect mutuel, ceci se traduisait concrètement dans la vie pratique. Afin d'éviter que le modèle étatique l'emporte sur le modèle villageois dans la nomination du "Tiên chi", tout le monde s'accordait sur le principe d'"avancement modéré". Par exemple, les lettrés possédant le titre de "tu tài" (bachelier) étaient avancés de 10 personnes, les "cu nhân" (licencié) de 15, les "pho bang" (docteur de 2e catégorie) de 20 et les "tiên si" de 30. Ce système permettait aux tenants des titres d'accéder à la place du "Tiên chi" avant leur âge, c'est à dire avant les autres inscrits dépourvus de titre sans détruire le modèle coutumier. Ou encore, lors des repas à caractère public, on partageait la tête de cochon en deux, une moitié allait aux vieux et l'autre aux lettrés attitrés.
Quoi qu'il en fût, le nombre exact des inscrits constituait une affaire confidentielle du village, gardée jalousement de génération en génération. Seule la dénonciation, à la suite de conflits inter-personnels, pouvait révéler ce chiffre au grand jour. Situation dont l'adage populaire dirait : "Quand les lèvres sont entrouvertes les dents ont froid." (môi ho rang lanh). Ainsi, le rapport du village à l'Etat était ambigu, à le fois "pour et contre, respect et entêtement" 1.
Que s'est-il passé sous l'administration coloniale? Le village vietnamien a-t-il changé d'attitude face à elle? La colonisation a-t-elle réussi à le mettre à genoux?
De la conquête à la fin de la "pacification", marquée par l'arrivée de Paul Doumer à la tête du gouvernement général de l'Indochine, l'Administration coloniale n'a pas eu le temps de s'attaquer à la "commune annamite", car cette question ne constituait sans doute pas une urgence. Il fallut attendre 1921 pour qu'une tentative de réforme puisse aboutir avec les arrêtés du 12 août signés de la main du Résident supérieur du Tonkin. Effectivement, ces réformes portant sur la réorganisation du conseil administratif des communes visaient "à utiliser toutes les capacités communales et à grouper dans les conseils administratifs les anciens ky muc, et les éléments de bonne volonté plus évolués". Cette réforme s'inscrivait, certes, dans le cadre de la modernisation administrative amorcée par Paul Doumer, mais elle permettrait aussi aux colonisateurs d'atteindre les affaires locales pour mieux les contrôler. Six ans après, René Robin, résident supérieur du Tonkin, a reconnu, dans une circulaire adressée aux administrateurs-chefs de province, que "ce but n'a pas été atteint" 2. L'échec de cette tentative est à chercher du côté des coloniaux qui voulaient imposer un nouveau mode de fonctionnement sans avoir le consentement des anciens notables. Autrefois nommés, le "Tiên chi" et le "Thu chi" devaient désormais être élus par les électeurs avant d'être choisis par les membres du conseil pour les représenter. La suspicion à l'égard de l'Administration coloniale, animée du sentiment de préserver la tradition, a fait des notables des opposants "sourds" à la réforme, "s'abstenant de solliciter un mandat". Il en résultait que le conseil élu se trouvait souvent à contre-courant de la tradition. Placée devant cette situation inconfortable, la Résidence supérieure du Tonkin a pris la décision d'abroger les réformes de 1921 en en instituant une nouvelle, par l'arrêté n°785-I du 25 février 1927. Cherchant à récupérer les mécontents, l'Administration coloniale a instauré un autre conseil nommé "conseil de ky muc" pour assister le conseil d'administration dit "conseil de Tôc biêu", déjà mis en place en 1921, qui supervisait et continuait à superviser l'édifice communal. Réduit au simple rôle consultatif, le conseil de Ky muc donnait cependant "obligatoirement son avis par écrit sur les principales décisions prises par le conseil d'administration" 1. De toute façon il fallait remplir certaines conditions pour pouvoir faire partie du conseil de Ky muc : avoir au moins 30 ans, être titulaire des titres de l'enseignement traditionnel ou de l'enseignement moderne (au moins du brevet élémentaire ou du diplôme d'études primaires supérieures), ou d'un grade de mandarin soit civil, soit militaire. En cas de désaccord entre les deux conseils, la question devait être soumise à nouveau au conseil d'administration. Le Résident-Administrateur-chef de province trancherait s'il y avait toujours divergence après la deuxième consultation 2 . Le conseil de Tôc biêu ne jouissait pas pour autant d'une autonomie totale, car les autorités supérieures ne perdent pas le nord. En effet, "Le Résident pourra, en outre, par décision spéciale, charger temporairement le conseil d'administration de l'exécution de missions particulières de police ou d'administration" 1. De même, les décisions du conseil contraires aux intérêts de l'administration ou de la commune pouvaient être annulées par l'Administrateur-chef de province qui prononcerait la suspension ou la dissolution du conseil. Une fois élu par le scrutin majoritaire et par les inscrits âgés de 18 ans et plus, le conseil de Tôc biêu choisissait dans son sein un président (chanh huong hôi) et un vice-président (pho huong hôi). Contrairement au mandat de Ky muc qui était illimité, tous les six ans ce conseil devait être renouvelé en bloc mais ses membres, limités au nombre de 20 (4 élus pour 100 électeurs) restaient indéfiniment rééligibles 2. Ce conseil s'adjoint de même un Ly truong qui servait d'intermédiaire entre l'administration et la commune. Ce représentant avait la garde du cachet de la commune et des archives autres que celles du conseil d'administration. Il s'occupait particulièrement du recouvrement des impôts et de la perception des taxes communales qu'il versait au trésorier.
Les réformes coloniales ont fait apparaître un nouveau type de notable dans le paysage communal en la personne du secrétaire. Des écoles crées spécialement au chef-lieu de province pour les futurs candidats à ce poste ont été confiées aux fonctionnaires indigènes désignés par le Résident. Ces derniers leur enseignaient des connaissances liées à la fonction de secrétaire sans oublier "l'instruction de la réforme". La durée des études était fixée à six mois durant lesquels les élèves-secrétaires percevaient une allocation mensuelle dans la limite des moyens de leur village respectif.
Mais les réformes ne s'arrêtaient pas là. Elles touchaient cette fois le coeur de la tradition en codifiant les rites et les pratiques de la vie quotidienne sous la rubrique "Coutumier". A titre d'exemple, le "tiên cheo" ou "redevance dûe par la famille de l'époux au village de l'épouse" doit être compris entre 0$50 et 5$, l'enterrement, entre 1$ et 30$, le "khao vong" ou droit d'accession à un grade, entre 5$ et 50$. Tous ces droits/taxes faisaient partie des recettes réglementées du budget de la commune. Au-delà de son aspect financier, la portée de ces réformes aurait atteint les pratiques traditionnelles, désorganisé une structure culturelle basée sur la solidarité parentale, les rapports de voisinage et l'observation des pratiques ancestrales. Le simple fait d'introduire la taxe d'enterrement qui "exempte la famille de tout repas obligatoire offert à la commune" pourrait faire se disloquer tout un tissu social. Cette taxe, bien que limitée à 30$ ne constituait pas inévitablement une dépense supplémentaire pour la famille en deuil. Cependant elle n'avait pas la même fonction car l'unique souci des administrateurs consistait à renflouer la caisse de la commune. Alors que "le repas obligatoire" qui nécessitait, certes, des dépenses renfermait d'autres dimensions qu'on ne pouvait pas manipuler comme de simples écritures comptables. Quand on connaissait l'importance du culte des ancêtres, traduit concrètement par des rituels, ne pas offrir un repas à la communauté signifiait nécessairement un acte de désinvolture à son égard, un manquement au devoir envers les ancêtres. Bref, un reniement des normes sociales, de la tradition tout simplement. Cette substitution d'une mesure administrative, ayant pour unique fonction la fonction budgétaire, à une pratique sociale chargée de sens, pouvait engendrer des effets incalculables. Les administrateurs qui voulaient moderniser le fonctionnement de "la commune annamite" ont-ils pensé à cette portée ?
Quoi qu' il en fût, les villageois fortement attachés à leurs terres et par conséquent, à leurs traditions, tenus de maintenir les pratiques sociales sous le regard vigilant de la communauté, ne pouvaient pas renoncer facilement à leurs coutumes. Placés à la fois devant une obligation d'ordre civique et administratif, et devant un devoir d'ordre culturel, ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient éviter des ennuis avec les autorités et garder de bons rapports avec la communauté. Il est tout à fait concevable et vraisemblable que d'un côté, les villageois aient acquitté la taxe d'enterrement, et que de l'autre côté, ils aient continué à offrir des repas à la communauté. Dans ce cas, la taxe constituait un surcroît de dépenses familiales. Du coup, elle contribuait à appauvrir les paysans qui avaient juste de quoi se maintenir en vie. L'Administration coloniale n'avait pas non plus pour vocation de faire du social bien qu'elle ait prévu dans la réforme de dispenser cette taxe pour les familles les plus pauvres 1. Du moment que les colonisés accomplissaient leurs obligations et ne semaient pas de troubles, elle n'interviendrait pas dans d'autres domaines de la vie. Pour cette raison, tout laisse à croire que la colonisation, quoiqu'elle ait pesé sur la vie sociale vietnamienne, n'a pas transformé de fond en comble les traditions ancestrales. Cependant la campagne vietnamienne n'arrivait pas pour autant à sortir de son cadre quelque peu autarcique du temps de l'ancien régime qui, par souci de sécurité, avait freiné certains essors. L'Etat monarchique, qui avait voulu réduire les écarts trop importants des richesses, afin d'éviter des révoltes et des troubles sociaux, avait privilégié les agriculteurs aux dépens des commerçants, restreint la libre entreprise et l'accumulation des biens personnels. La distribution des terres aux familles d'agriculteurs devait respecter cette logique. On se trouvait donc devant une société paysanne formée quasi-exclusivement de petits riziculteurs. L'absence de grandes propriétés terriennes, imposée par le régime cadastral interdisait tout développement, qu'il fût économique ou technique. De ce fait, les recettes nationales fournies pour l'essentiel par le travail agricole venaient sans doute à leur tour limiter le développement de l'agriculture. L'absence de culture intensive, d'insecticides, de voies de communication et de marché de dimension régionale ou nationale pour résorber le produit agricole et pour inciter au négoce, faisait de l'agriculture vietnamienne plutôt un moyen de subsistance qu'un véritable secteur économique au sens moderne du terme.
Tous ces facteurs incitent à tirer un bilan globalement négatif de l'action coloniale en milieu rural vietnamien même si par ailleurs une certaine rigueur administrative a bien été introduite dans le fonctionnement de la commune : contrôle non sans difficulté des inscrits, levée des impôts et des taxes diverses, déclaration des naissances, mariages et décès, etc. Si l'Administration a modifié sans vraiment y parvenir le mode de représentation de la commune, les villageois vietnamiens restaient attachés à leurs traditions et continuaient à les observer dans toutes les manifestations de la vie sociale. Un exemple type de la confrontation entre la tradition et le versant pratique et concret de la modernité, appelé encore "modernisation".
III. Le giap
Si le village vietnamien arrive à subsister, à garder sa relative autonomie, c'est grâce en partie à son organisation sociale. L'un des aspects de cette forme d'organisation se traduit par le giap, institution quelque peu informelle de contribuables mâles à caractère d'entraide.
Quel est le rapport du giap avec la modernité ? A proprement dit aucun. Cependant comme le giap fait partie intégrante de la structure villageoise, il s'impose de fait comme une donnée difficilement contournable si l'on veut comprendre le fonctionnement d'un village vietnamien. A ce titre, le giap peut être assimilé à un trait identitaire de la culture populaire vietnamienne, autrement dit, une constante de l'histoire puisqu'il a survécu à toutes les épreuves de l'histoire du Vietnam depuis son apparition.
Il convient par ailleurs de signaler que le giap reste un sujet peu abordé jusqu'à présent. Nguyên Van Huyên, dans "Recherche sur la commune annamite", l'a évoqué sans épuiser la question. Le travail le plus fourni est celui de l'ethnologue Nguyen Tu Chi, sous le pseudonyme de Trân Tu 1. L'origine exacte du giap reste à déterminer, cependant d'après l'historien Trân Quôc Vuong, le giap serait une institution chinoise apparue au plus tard sous les Tang dans la période du VIIe au Xe siècle 2. A son origine, le giap était une unité administrative, une sorte de subdivision du village. L'institution du giap a été appliquée au Vietnam, mais il a perdu son contenu avec le temps, et il ne reste plus que le contenant, c'est à dire le nom. Pour mieux s'adapter aux réalités locales le giap a été vietnamisé.
Si les relations liées au sang et au lieu d'habitation par proximité sont palpables et visibles, le giap reste une notion "invisible". Il se situe quelque part entre ces deux premières. Deux voisins ou deux personnes portant le même nom de famille (cùng ho) peuvent ne pas être dans le même giap, et inversement deux membres du giap ne sont pas forcément des voisins ou n'ont pas obligatoirement le même nom. Cependant, l'enfant mâle et son père s'inscrivent toujours dans le même giap. Le nombre de giap varie selon des villages, néanmoins on remarque des constantes: il n'est jamais inférieur à deux, et très souvent ce nombre est pair (2, 4 ou 6). Chaque giap porte d'autre part un nom en rapport avec l'orientation : giap thuong (giap en amont), giap ha (giap en aval), giap dông (giap de l'Est), giap doài (giap de l'Ouest), etc. Nguyên Tu Chi a bien relevé durant son enquête que les villageois, pour une raison encore inconnue, substituaient les "affaires du giap" (viêc giap) aux "affaires du village" (viêc làng). Cette substitution, consciente ou nom, ne fait que compliquer l'identification du rôle du giap au sein de l'appareil administratif d'une part, et de sa place dans les pratiques coutumières d'autre part. Quoi qu'il soit le giap reste une institution respectée qui façonne la vie de ses membres : "Le paysan mâle du Nord-Vietnam vit et grandit dans le cadre du giap" 1.
En fin de compte, qu'est-ce qu'un giap concrètement?
L'une des façons de répondre à cette question consiste à suivre pas à pas la vie d'un paysan de sa naissance à l'âge de sa "retraite sociale" à 70 ans, comme l'a fait Nguyên Tu Chi.
Dès la naissance d'un enfant mâle, le père doit en faire part à son giap (trinh làng) 1 en s'adressant au conseil du giap ou à défaut à son responsable. En effet, le père vient avec un plateau de chiques de bétel et d'alcool, deux produits indispensables à toute cérémonie. A partir de ce moment-là, le responsable ou le conseil du giap inscrit officiellement le nom de l'enfant dans le registre d'état civil du giap. Désormais l'enfant devient membre potentiel du giap. Cette notion se traduit concrètement dans la vie quotidienne, car même en bas âge l'enfant a droit à sa petite part des festivités : à la fin des festins, on remet une part symbolique du repas (viande, riz, fruits...) au père pour l'enfant absent. A partir de 3 ou 4 ans et jusqu'à l'âge de 17 ans, il peut suivre son père dans toutes les réunions et festivités pour "prendre part" aux cérémonies, même s'il ne participe pas encore réellement aux activités et n'a encore aucune responsabilité au sein du giap. En fait, c'est le temps de l'apprentissage. La fréquentation des réunions, le contact avec le monde adulte permettent à l'enfant de bien assimiler les pratiques puis de les intégrer et de se sentir solidaire du groupe. A la "maturité", 18 ans, le jeune homme doit de nouveau se présenter au giap (trinh làng) pour passer au statut supérieur, c'est-à-dire en devenir membre actif ou contribuable (dinh) du village. Étant membre à part entière du giap, il connaît dorénavant sa place exacte dans la hiérarchie, et celle qu'il occupe à chaque festivité ou réunion. Dans cette hiérarchie, seul l'âge est pris en compte et rien d'autres. En vietnamien on parle de xi tuoc (prestige lié aux dents, c'est à dire à l'âge) en ce qui concerne le giap, par opposition à quan tuoc (prestige liée au mandarinat) quand il s'agit de l'appareil administratif.
Si immuable soit-elle, cette hiérarchie à l'intérieur du giap ne constitue nullement une barrière sélective. En principe tout membre du giap peut parvenir un jour à occuper la place suprême et prestigieuse dans l'institution, car d'une année à l'autre le jeune membre passe à l'échelon supérieur. Mais en réalité tous ceux qui appartiennent à la même classe d'âge ne parviendront pas à représenter le groupe pour la simple raison de principe que l'avancement ne tient pas compte uniquement de l'âge, mais aussi de la date d'inscription au registre voire de l'heure. Dans cet esprit, parmi ceux qui sont potentiellement aptes à représenter le groupe, c'est-à-dire qui ont le même âge et qui ont fait le tour des autres responsabilités, c'est celui dont le nom a été inscrit le premier au registre qui sera désigné pour assurer cette fonction.
Revenons maintenant aux étapes précédentes qui caractérisent les activités du giap. Au fur et à mesure que le jeune homme avance en âge, il passe systématiquement à la "table supérieure" (bàn trên) ou à la "natte supérieure" (chiêu trên) 1. Chaque "table" ou chaque place correspond bien à un certain nombre de tâches et de responsabilités réelles. Prenons un exemple concret: le giap décide de fêter les cinquante ans de ses membres, l'âge symbolisant le début de la vieillesse (lên lao, littéralement "monter en vieillard"). Cette cérémonie demande un minimum d'organisation et de préparation: voeux de longévité, cuisine, mettre la table.... Admettons qu'il y ait neuf membres ayant le même âge, 20 ans par exemple. L'une des répartitions possibles consiste à les répartir en trois groupes appelés lênh : le premier s'occupe de répartir le travail aux deux autres et de les surveiller afin de mener à bien le travail collectif; le second prend à sa charge de faire les courses et le troisième s'occupe de la cuisine. Le temps de rotation de ces tâches est d'un an. Dans cet exemple, l'année d'après le troisième groupe passera second et le second premier; sachant que premier groupe a déjà accompli toutes les tâches, il passera donc aux autres activités. Ainsi au bout d'un certain temps, tout membre du groupe aura accompli toutes les responsabilités définies. Se voir attribuer une responsabilité, dans la vie d'un membre du giap, signifie aussi avoir droit à certains avantages. Or avantages et investissements vont de pair pour que l'équilibre puisse se maintenir. C'est pourquoi, dès qu'un jeune homme est reconnu comme membre actif du giap à ses dix-huit ans, il est de son devoir aussi de cotiser périodiquement à la caisse commune, sans parler des dépenses imprévues ou occasionnelles. Des sanctions sont même prévues à l'égard de celui qui manque à ses devoirs.
"Celui qui ne paie pas trois fois de suite ses cotisations est rétrogradé à la "table inférieure". La quatrième fois, il est rayé du groupe et mis à l'index par toute la communauté. Personne ne se mettra à côté de lui dans les réunions publiques. Personne ne mangera à sa table. Et ce qui est le plus grave, c'est que, quand il mourra, personne ne s'occupera gratuitement de son enterrement." 1
Il est à remarquer que dans la société villageoise vietnamienne, le fait d'être conduit à son dernier repos gratuitement par la communauté représente un honneur. On comprend alors que nul individu n'a intérêt à transgresser les règles ou à négliger ses devoirs. Le giap en tant qu'institution d'entraide a parfaitement saisi cette importance puisqu'une de ses fonctions consiste à s'occuper gratuitement de l'enterrement de ses membres: creuser le fosse, porter le cercueil et les objets de culte, etc.
En dehors des activités tournées vers l'extérieur, tout groupe d'humains a pour tâche de maintenir sa cohésion, qui ne peut être assurée que grâce à l'adhésion de ses membres aux idées et principes fondateurs. Le représentant du groupe, en l'occurrence du giap, a une lourde responsabilité à cet égard. Ce rôle ne confère pas que des honneurs et des avantages, il implique aussi des devoirs envers le groupe. Pour cette raison, personne ne le fuit, sinon cela signifierait manquer à ses responsabilités et à ses devoirs, une attitude peu glorieuse. Il arrive souvent que le responsable du giap avance des dépenses à caractère occasionnel avant d'être remboursé par les contributions du groupe. Il lui arrive aussi de cotiser le premier et le groupe complète les dépenses. Il en ressort que la tenue de ce rôle n'est pas à la portée de tout le monde, et en particulier des gens de condition modeste. Dans la pratique, celui qui ne jouit pas d'une condition sociale acceptable se doit de décliner cette responsabilité en la confiant à un autre confrère, plus apte et appartenant à la même hiérarchie, ceci avec le consentement du groupe. Par ailleurs, Si on est membre du giap de la naissance à la mort, la vie active en son sein s'arrête à l'âge de 70 ans, ceux qui parviennent à cet âge sont nommés thuong lao (littéralement "vieillard supérieur"). Ce rite de passage nommé ra lao (sortir de la vieillesse) dégage l'intéressé de toute responsabilité. En effet, le terme "ra" (sortir) employé ici veut dire "sortir" de la vie sociale, de la vie communautaire, pour prendre sa retraite. Désormais, dans les réunions publiques, les thuong lao occupent la place la plus prestigieuse et deviennent les conseillers les plus écoutés.
Nous avons voulu retracer ici l'itinéraire d'un membre du giap de sa naissance à sa mort. Ce choix nous a été imposé par la rareté de la documentation. Faute de travaux et de sources, certaines questions demeurent sans réponse. Nous ignorons par exemple le rôle exact du giap dans les rouages administratifs villageois, ou plutôt ses rapports avec les autorités locales. Dans la réalité, il arrive que celles-ci confient au giap le soin de répartir les terres à ses membres, de rassembler le contingent destiné à la corvée ou au service militaire. Ceci prouve que les autorités connaissent parfaitement les compétences du giap et ne cherchent pas à l'ignorer, mais au contraire qu'elles l'utilisent avec habilité. Le giap ne serait-il alors qu'un simple outil de l'administration? Ou au contraire une institution parallèle pour contrebalancer le pouvoir officiel ? Quelle serait sa principale fonction, mis à part le maintien de la tradition à perpétuité ? Car il est tout à fait concevable et vraisemblable qu'à son origine, toute tradition répondait à un besoin réel, qu'il fût d'ordre mythologique ou symbolique, social ou politique, moral ou matériel. Si on accepte l'idée sur l'origine du giap avancée par Trân Quôc Vuong, cette institution aurait été mise en place pour le besoin de la cause: servir l'administration. Mais au fil du temps, les administrés l'auraient détournée en leur faveur, puis vidée de son contenu avant de la transformer en simple pratique coutumière pour servir la collectivité. Cette hypothèse semble à notre avis défendable, car elle répond entre autres questions à celles de la recherche de l'autonomie, de la volonté de s'affirmer comme personne morale, d'élargir les bases unificatrices afin de consolider les facteurs identitaires de la communauté villageoise. On comprendra ainsi pourquoi cette pratique a obtenu l'adhésion de tout individu mâle vivant au sein du même village, sans parler de sa principale fonction apparente qui demeure la convivialité et l'entraide. Par ailleurs, le caractère ségrégatif lié au sexe a visiblement été maintenu. On pourrait l'expliquer de deux manières, soit en le mettant sur le compte du confucianisme qui a pénétré profondément dans la mentalité des Vietnamiens jusqu'à ce qu'ils intériorisent complètement cette notion; soit en l'attribuant au souci de sauvegarder la façade pour ne pas attirer l'attention des autorités, qui verraient en cela un élément de trouble ou de contestation. Étant donné que le village en tant que personne morale et unité de base sociale ne cherche pas l'affrontement ouvert avec les autorités centrales, mais que sa devise reste la recherche de compromis en cas de conflits avec ces dernières, ce caractère "sexiste", dirons nous aujourd'hui, dans le fonctionnement du giap, illustre le compromis entre gouvernants et gouvernés : les premiers peuvent toujours faire pression sur les seconds à travers le giap, et ces derniers affichent un respect formel à l'égard des premiers. Un véritable jeu du chat et de la souris.
IV. Le Dinh
De même que celle du village vietnamien, l'origine du dinh reste obscure. Certains supposent que le dinh existe depuis la dynastie des Trân voire depuis celle des Ly, en se basant sur l'idéogramme qui le désigne ( ), et qui veut dire aussi "habitation" 1. Si les Français se sont intéressés à cette question dès le début du siècle, il a fallu attendre les années 1960 pour que les Vietnamiens commencent les recherches; elles ont été confiées à l'Institut des Beaux Arts. Une dizaine d'années après, ces travaux ont connu un certain écho, grâce notamment à la mise en lumière de la sculpture populaire trouvée sur le dinh. A ce jour, parmi les inscriptions qui sont en quelque sorte les "cartes d'identité" du dinh, on en a recensé 4 qui remontent à l'époque des Mac au XVIe siècle, 166 du XVIIe siècle et 300 du XVIIIe siècle. La plus vieille date de l'époque des Lê, 1472. Cependant tous les dinh n'avaient pas leur inscription car celles-ci étaient l'oeuvre des riches du village, qui voulaient laisser leur nom, en tant que bienfaiteurs, à la postérité; par conséquent, les villages qui ne comptaient que des paysans pauvres ne pouvaient pas faire faire des inscriptions sur le dinh. Par ailleurs, les fouilles et les vestiges trouvés attestent que l'architecture du dinh, comme nous l'avons signalé plus haut, présentait une certaine similitude avec celle des peuples d'Asie du Sud-Est, à savoir, la construction sur pilotis. Ce qui a fait dire aux chercheurs vietnamiens que, peut-être dans les temps reculés, les ancêtres des Vietnamiens vivaient aussi dans des maisons sur pilotis, et que le dinh serait le vestige, le témoignage d'un mode de vie qu'on connaît très mal de nos jours.
Toutefois, les inscriptions révèlent que chaque dinh porte un nom qui est différent de celui du village. Bien que le nom du dinh soit en sino-vietnamien, sa signification reflète le caractère populaire, l'aspect vivant et agréable de la vie, par exemple, "Tu muc dinh" (le dinh de la joie), "Tho khang dinh" (le dinh de la longévité), "hoà lac dinh" (le dinh de la convivialité), "Nhân tho dinh" (le dinh de la longévité humaine), etc. Ces noms s'opposent donc à ceux des lieux de cultes (temples, pagodes) qui ont tous un caractère religieux. Ce qui nous ramène à poser la question : "quelle est la fonction ou quelles sont les fonctions du dinh ?"
Contrairement à ce qu'on peut croire, le dinh n'était pas uniquement le lieu de culte du génie tutélaire, car toutes les activités relatives à la vie communautaire avaient lieu à la maison communale. Il est vrai qu'on y célébrait annuellement le culte du génie protecteur, qui souvent avait d'ailleurs son propre autel, installé en général à l'entrée du village et qui était sa demeure au cours de l'année; c'est seulement le jour du culte qu'on l'invitait à regagner la place honorable qui lui était réservée dans le dinh. Une fois que les cérémonies étaient terminées alors on le raccompagnait à son autel. Donc, pour le reste de l'année, le dinh servait aux autres activités. C'est là qu'on recevait les autorités provinciales ou centrales. Le conseil des représentants du village s'y retrouvaient pour débattre et prendre des décisions. Les affaires de justice qui ne dépassaient pas les compétences du village se réglaient également dans ce lieu. Dans certains villages, la cour du dinh servait aussi de marché. C'est encore au dinh qu'avaient lieu les fêtes et les festivités diverses. Toutes ces activités, qu'elles fussent sociales ou religieuses, judiciaires ou festives, étaient très souvent accompagnées de festins (cô), le rituel qui allait de soi dans les moeurs villageoises. On peut dire sans trop prendre de risque que tout était prétexte au festin: du mariage à la mort, de la promotion sociale à l'avancement en âge (tous les dix ans), sans parler des cérémonies dédiées aux ancêtres de chaque corps de métier, ou des anniversaires divers. Mis à part le festin à caractère de promotion sociale, les autres étaient financés par les contributions villageoises. Vus sous l'angle économique, ces rituels comportaient des facteurs de gaspillage et de ruine. Cependant ils étaient toujours en rapport avec la richesse de chaque village. Si on replace les choses dans leur contexte, on s'apercevra que tout ceci formait bien un ensemble cohérent et logique. D'abord, les activités économiques au sein d'un village étaient très réduites. Les produits trouvés au marché étaient constitués pour la majorité du surplus de l'agriculture et de l'élevage à dimension familiale. D'autre part, l'absence de grandes voies de communication et de moyens de transport limite les échanges. De plus, l'esprit commercial chez les Vietnamiens n'était, et n'est toujours pas très développé, car ils sont avant tout des agriculteurs et des artisans. S'ajoutent à cela la superficie des rizières et la forme d'exploitation agricole, qui ne pouvaient dépasser la dimension familiale étant donnée la répartition des terres au départ. A de rares exceptions près, la propriété privée ne permettait que de survivre. Ces différents éléments faisaient que l'accumulation de la richesse ne se réalisait que dans des cas extrêmement rares, et ils empêchaient la vision économique à long terme. A quoi bon se serrer la ceinture quand on sait qu'on ne sera jamais riche ? Sans parler de la crainte d'être dépouillé par les impôts. Par contre, s'il n'y avait pas de festin, il n'y aurait plus de cérémonies, plus de fêtes, plus de vie sociale, et donc plus de vie au sein du village tout simplement. L'adage populaire dit aussi "miêng trâu là dâu câu chuyên" (la chique de bétel est le début de la conversation). C'est dans ce sens là que le fait de manger sert de prétexte à toutes les activités (sociales, religieuses, politiques...) Rien d'étonnant! On remarque que de nos jours, même en Occident, les prises de contact, les négociations se font souvent à table, autour d'un café, d'un repas ou lors d'une réception. On ne peut donc supprimer cette dimension de la vie villageoise sans provoquer de graves conséquences.
V. La question des cultes
A. Le culte des ancêtres
On a vu plus haut que le confucianisme a été introduit au Vietnam pendant la domination chinoise, puis repris et érigé en culte surtout par les classes dirigeantes après l'indépendance. Le bouddhisme a été reconnu comme religion d'Etat sous les Ly sans enrayer les croyances populaires. Le christianisme, arrivé au Vietnam dès le XVIIe siècle, sous l'impulsion des Jésuites d'abord, puis sous celle de la Mission étrangère de Paris, a aussi trouvé sa place dans des communautés villageoises. Les conflits qu'il a connus aux XVIIIe et XIXe siècles n'étaient pas d'ordre religieux, mais étaient plutôt des conflits de pouvoir entre le clergé local et les autorités vietnamiennes qui n'acceptaient pas le fait que certains villages échappaient à leur contrôle. L'une des questions qu'on peut se poser est de savoir comment les grandes religions sont arrivées à s'insérer dans le milieu villageois qui avait déjà ses propres cultes. On pourrait dire aussi que le peuple vietnamien en général, et les paysans en particulier, ne sont pas fanatiques sur le plan de la croyance; en revanche, ils sont assez superstitieux dans l'ensemble. Leurs génies prennent des forment très variées.
Chez les Vietnamiens, la vie et la mort ne représentent pas un antagonisme mais plutôt une dualité, le prolongement de l'une dans l'autre. L'expression "sông gui thac vê" (la vie n'est qu'un passage, la mort c'est le retour pour toujours) illustre cette conception. Pour cette raison chez ce peuple la mort est omniprésente dans la vie.
Quand on rentre dans une maison vietnamienne, on voit que l'endroit le plus dégagé et le plus haut dans la pièce principale est réservé à l'autel des ancêtres, sur lequel on trouve un encensoir (lu), en cuivre chez les familles aisées, en bronze ou en porcelaine chez celles qui sont moins fortunées, et des bougeoirs. Le premier et le quinzième jour du mois lunaire, jour de la pleine lune, on y apporte des fruits de saison, et à la tombée de la nuit, avant le repas du soir, le chef de famille (en l'occurrence le père, ou bien la mère si celui-ci vient à décéder, ou bien le fils aîné s'il est majeur) allume les bougies, brûle de l'encens et commence la prière (khân) en demandant aux disparus de bien veiller sur les vivants, de les protéger et de leur apporter de la chance.
Chaque année on célèbre aussi les anniversaires de la mort des parents (au sens large). A chaque anniversaire, on prépare un festin (cô) et on invite tous les membres de la famille, et éventuellement quelques amis ou alliés (les parents de la bru ou du gendre, par exemple) à être présents en ce jour solennel. Pour ce culte, on ne dépasse généralement pas la deuxième génération au-dessus, ce qui donne : les grands-parents, les parents, les oncles et tantes... Parmi ces anniversaires, ceux des parents et surtout celui du père sont les plus importants. On dirait que dans cette conception, dans cet agencement spirituel, les vivants essaient de garder dans leur entourage le plus longtemps possible ceux qui étaient les plus proches d'eux et les plus respectés, jusqu'au jour où leur place sera prise par leurs descendants directs. En d'autres termes, aussi puissante soit-elle, la mort ne peut enlever ce que chacun représentait de son vivant au sein de sa famille.
La présence du mort peut être aussi perçue à travers du deuil que portent les membres de la famille (deuil des parents et des grands-parents, 3 ans; deuil des oncles, des tantes, 1 an, etc.). De même que l'anniversaire de sa mort, le deuil du père doit être strictement respecté. Le corps du défunt est gardé en famille pendant au moins trois jours avant d'être enterré. Dans l'ancien temps le cimetière comme lieu commun n'existait pas, chaque famille enterrait ses morts dans sa propre rizière; et de nos jours cette pratique n'a pas encore complètement disparue. Elle vient ainsi renforcer les facteurs qui font des Vietnamiens un peuple attaché à sa terre natale. De plus, c'est aussi à la rizière qu'on enterrait le placenta après la naissance. La rizière a de ce fait une triple fonction: lieu matriciel à la naissance, lieu de culture durant la vie et lieu de repos spirituel à la mort. Bref, la rizière représente tout un symbole dont l'une des deux composantes concerne l'aspect matériel: la rizière produit la denrée de base, elle alimente la vie; et l'autre, le côté spirituel, le lieu de passage de la vie à l'au-delà. On comprend donc pourquoi quitter son village pour un Vietnamien était un acte inconcevable. Cependant, durant leur vie bien des Vietnamiens étaient amenés à quitter leur terre natale par nécessité vitale. Autrefois, les cérémonies d'enterrement ne marquaient la clôture des pratiques funéraires. En effet, trois ans après la mort, la famille avait pour charge de nettoyer les os du défunt avant de les remettre dans le cercueil. Cette fois, les familles aisées pouvaient élever les tombeaux en dur, les autres moins fortunées ne se contentaient que d'un monticule de terre 1.
L'objet de culte le plus symbolique demeure le gia pha (registre généalogique). Entre autres renseignements relatifs à la famille paternelle on y inscrit la date de la mort de chaque membre et non celle de sa naissance. Cet objet est précieusement gardé par la famille, et si par malheur elle doit quitter le village pour toujours, elle l'emporte avec elle. Pour toutes ces raisons, quitter son village ou perdre son registre généalogique constituent un délit moral. D'où les insultes dô bo làng (espèce d'apatride, littéralement: espèce, quitter, village), dô mât gia pha (espèce de sans-racines, littéralement: espèce, perdre, registre généalogique).
Contrairement aux autres cultes qui se pratiquent dans les lieux publics réservés à cet effet, le culte des ancêtres s'observe en famille. Son lieu ne dépasse pas le lieu d'habitation, exception faite des funérailles. C'est donc la famille tout entière, mais surtout le père, qui a pour tâches de le perpétuer en le transmettant à ses enfants, qui à leur tour le transmettront à leurs enfants une fois devenus adultes et parents. Mais il n'est pas exact non plus de dire que le culte des ancêtres est uniquement une affaire de famille, car le non-respect des principes sera remarqué par la communauté tout entière qui n'hésitera pas à faire des commentaires à l'occasion. Cette pression sociale constitue de fait un facteur dynamisant de la perpétuité. Par conséquent, même la famille en tant qu'organisation sociale ne peut se soustraire de la communauté villageoise, puisqu'elle ne constitue qu'un membre de celle-ci, qui est la véritable cellule de base de la société avec ses propres règles, ses propres pratiques, sa morale, son génie tutélaire.
B. Le culte du génie tutélaire
Les cultes et les religions abritent le sacré. Le culte du génie tutélaire n'échappe pas à cette règle, mais de plus, il s'en distingue par le côté secret qui, au cours du temps, s'est transformé en légende ou en mythe. La mythification ne constitue pas nécessairement une fin en soi, mais se révèle plutôt comme un processus d'autodéfense eu égard au contexte socio-historique. Elle ne peut se maintenir et perdurer que s'il existe une audience qui, à son tour, l'alimente en rituels. Elle répondrait ainsi à un besoin. Or, la recherche de la satisfaction des besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels, politiques ou culturels, affectifs ou moraux, ne constitue t-elle pas déjà un moteur de l'existence? Par conséquent, si les besoins ne sont pas assouvis, l'existence se trouvera en danger. On comprendra dans ce cas, que ceux qui cultivent un mythe, quel qu'il soit, essaient par tous les moyens de le sauver s'il se trouve exposé aux menaces. Car la disparition d'un mythe entraînera simultanément la perte d'identité de la communauté d'idées. Si on admet que les rapports au mythe de ceux qui y croient, s'établissent à partir des liens identitaires, la mythification signifiera alors la sauvegarde de l'identité, la préservation de la particularité, le besoin de se singulariser, de s'affirmer. Le culte du génie tutélaire reste à cet égard exemplaire. Comme chaque village vietnamien est une identité et une unité en soi, et qu'il se distingue des autres par ses traditions, ses pratiques sociales, ses règles morales et son génie tutélaire qui représente son protecteur et qui incarne son âme, l'observation du culte dédié à ce génie devient alors l'affaire de toute la communauté. Il constitue effectivement le facteur d'identité sans doute le plus important de la culture villageoise. De l'avis de Lê Minh Ngoc, dans un article consacré à ce sujet, "le culte du génie tutélaire est le plus remarquable des cultes populaires pratiqués dans les villages traditionnels du Vietnam, il illustre et focalise le mieux la conscience collective paysanne" 1. A ses yeux, "Le génie tutélaire représente le destin commun d'une société d'hommes vivant sur le même territoire" (le village) 2.
Comme nous l'avons signalé plus haut, l'une des particularités du génie tutélaire réside dans sa diversité qui vient confirmer la singularité de chaque village. Par conséquent, il y a, en principe, autant de génies différents les uns des autres que de villages au Vietnam. A l'époque coloniale, le Tonkin comptait 9697 villages d'après les statistiques fournies par l'Annuaire général de l'Indochine en 1919. Il s'agissait là sans doute du nombre de xa qui regroupe chacun plusieurs villages et non celui du village proprement dit, car rien que dans le Delta du Fleuve rouge Pierre Gourou a dénombré plus de 7.000 villages 3. En réalité, le nombre de génies tutélaires peut être inférieur au nombre de villages car, très souvent, plusieurs villages vénèrent le même génie. Cependant chaque village construit son propre autel et célèbre le culte à sa façon. A titre d'exemple, Nguyên Van Huyên dénombre aux alentours de 1940, 770 génies dans la province de Bac ninh 4; plus près de nous l'ethnologue Diêp Dinh Hoa avance un chiffre de 179 génies locaux dans un district de la province de Thai binh 5.
Contrairement à l'être suprême, considéré comme parfait, omnipotent et incorruptible par les grandes religions, le génie titulaire peut être un personnage quelconque allant du pauvre mendiant au héros national, en passant par des objets inanimés. Si ce génie est puissant par ses capacités surnaturelles que reconnaissent les villageois, il n'incarne pas toujours la moralité. En effet, le génie titulaire ou Thành hoàng de certains villages s'identifie à un simple voleur. On ne peut pas pour autant manquer à l'observation du culte. Le non-respect engendrera inévitablement des fléaux, des désastres pour le village: le génie se fâche et punit ses adorateurs négligents. Il faudra alors racheter la faute en célébrant solennellement le culte comme il se doit.
Quelle est l'attitude des autorités centrales devant ce culte ? Elles ne le regardent pas toujours d'un bon oeil, surtout si le génie n'a rien de glorieux ni de respectable. Autant elles cherchent à "moraliser" la vie publique, autant les villageois respectent leur génie sans se soucier des règles morales, et ce, quoi qu'il advienne; car il y va de leur survie. La prospérité ou la misère liées aux bonnes ou aux mauvaises récoltes, la santé physique et morale ou les épidémies, dépendent de la protection du Thành hoàng. Ainsi entre la morale et la survie, entre le risque de voir venir tous les malheurs en satisfaisant le pouvoir central, et le respect de la tradition, même si elle le scandalise, les villageois savent faire leur choix: leur choix, à eux, consiste à ignorer le regard de l'extérieur, d'où qu'il vienne. Ausi sacré soit-il, ce culte ne cesse de choquer les esprits soucieux de probité. Dans une localité dont on tait le nom, le génie du village est réputé pour sa salacité. Quand une femme passe devant son autel, elle doit s'incliner en soulevant sa jupe pour le contenter. Cette opposition à la morale des classes dirigeantes provoque parfois des mesures de rétorsion. Sous les Lê postérieurs (1427-1527), le ministère des Rites obligeait tous les villages à déclarer leur génie tutélaire en fournissant l'origine et la légende correspondantes à chaque divinité. Les génies à caractère immoral devenaient objet de prohibition. Mais cette "décision du roi" n'arrivait pas à franchir la barrière des coutumes du village.
Au-delà de l'attachement à la tradition, de la croyance populaire, les villageois arguent que le pouvoir central n'a pas à intervenir dans la vie privée du village du moment qu'ils ont acquitté tous les devoirs de citoyen. Mais quand l'Etat a les moyens de faire appliquer ses décisions, surtout quand il jouit de sa puissance, les paysans en tiennent compte sans pour autant renoncer à leur génie. Leur subtilité consiste à "adopter" un héros national (le fondateur des Trân obtient souvent ce mérite et devient Duc Thanh Trân, ou le génie des Trân), puis à l'habiller en génie tutélaire afin de le déclarer officiellement aux autorités centrales qui, dans ce cas, ne peuvent que se féliciter de l'heureuse issue de cette querelle. Cependant notre héros national se trouve au milieu d'une armée de serviteurs, de gardes "nécessaires" à sa grandeur. Le nom et le rôle de chacun d'entre eux sont également présentés aux autorités compétentes, lesquelles, encore une fois, ne peuvent que se flatter de la bonne conduite civique du peuple qui a pensé à tout 1. Mais l'histoire a montré que la puissance n'arrivait pas toujours à évincer la détermination. C'est parmi ces serviteurs du héros national que se glisse le véritable génie tutélaire interdit de vénération. Pour le village la bataille est terminée, et bien terminée pour lui. Non seulement il n'a pas renoncé au culte, mais il est arrivé à faire avaliser son génie, par ailleurs interdit, par le pouvoir central.
Ceci constitue un des aspects du secret qui protège le culte du génie tutélaire. Un autre aspect du secret ou une autre caractéristique de la culture villageoise se traduit par la mythification du génie.
Écoutons la légende du génie tutélaire du village La qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Hanoi, sur la frontière de la province de Hà son binh. Ce récit a été recueilli par nos soins lors de notre voyage au Vietnam durant l'été 1990. Ce village, qui fait partie du district de Tu liêm, regroupe actuellement plus de dix mille personnes. Ses fêtes, qui ne durent pas moins d'une semaine, du 7e au 14e jour du premier mois lunaire, sont entrées dans la légende 1. Monsieur Dông Van, alors âgé de 83 ans, et considéré comme le dépositaire de la mémoire du village, connaissait les caractères chinois et le nôm. Fils d'une famille de lettrés, il a passé le Certificat d'études primaires franco-indigène; ce qui lui a permis d'enseigner par la suite. Ses capacités intellectuelles n'étaient pas affectées par le temps. Vivant seul dans sa petite maison entourée d'un jardin aux plantes potagères et ornementales, il se livrait aussi à la sculpture et à la poésie. Après avoir saisi l'intérêt de notre enquête, monsieur Dông Van nous a raconté la légende du Thành hoàng de son village.
"L'histoire du génie tutélaire, qui porte le nom de Duong Canh Công, 2 remonte à Hùng Duê Vuong, c'est à dire Hùng vuong XVIII (dernier roi de la lignée, IIIe siècle av. J.C.). Il est le fils d'une teinturière qui, originaire de Hai duong, est restée mère célibataire.
Un beau jour, elle passa devant le Dinh où avait lieu une grande fête. Elle s'arrêta alors pour y participer. Tard dans la soirée, fatiguée, elle somnolait dans la cour du Dinh devenue déserte. Tout à coup, elle vit une sorte d'auréole qui se projeta sur elle.
Le lendemain, elle raconta ce qu'elle avait vu aux gens du village. Elle tomba alors enceinte. La teinturière rapporta ensuite son aventure à sa mère qui lui conseilla de garder l'enfant. Ce fut un garçon. A l'âge de 14 ans, il demanda à sa mère pourquoi il n'avait pas de père. Malgré les explications, il ne crut pas au récit de sa mère. Il quitta alors sa famille pour aller demander des éclaircissements au génie de la montagne, qui demeurait sur le mont Tan Viên 1. Le génie lui expliqua qu'autrefois, le pays avait eu une centaine de génies (bach thân) qui, de temps à autre, étaient apparus pour sauver la nation des malheurs et des fléaux. Cette réponse convainquit le jeune homme qui décida de rester auprès du génie comme élève. Il acheva son éducation en lettres et en armes, et il reçut un fusil sacré qui lui permettait de chasser.
Un beau jour, pendant qu'il chassait, deux fées apparurent et lui promirent de le suivre comme femmes. Il demanda l'avis du génie qui lui conseilla de se marier avec elles. Le mariage fut alors célébré."
Arrivé ici, monsieur Dông Van ralentit son rythme pour nous faire remarquer qu'il y avait toujours deux statuettes, à côté du génie tutélaire dans son autel, représentant "La grande dame" (bà lon) et "La petite dame" (bà be), respectivement nommées Tuyên et Chinh. Puis il poursuivit son récit.
"Quelque temps après, Duong Canh Công demanda l'autorisation au génie d'aller rendre visite à sa mère avec ses deux femmes. Ce furent les retrouvailles, mais la mère mourut peu de temps après. Duong canh Công resta au village pendant trois ans, le temps de porter le deuil, avant de regagner la montagne.
En ce temps là, le pays était menacé par une armée de tigres. Le roi envoya des messagers pour chercher des gens braves capables de vaincre ces bêtes redoutables. Ils ne tardèrent pas à trouver en la personne de Duong Canh Công, le futur héros de la chasse aux tigres. Il se présenta au roi avec deux cents hommes, tous courageux. Le roi le décora d'un titre élogieux et ordonna à un mandarin militaire et à cinq cents soldats de le suivre. Les deux femmes de Duong Canh Công participaient aussi aux batailles. Elles tissaient des hamacs et des filets, lesquels leur permirent d'attraper le "seigneur des tigres" (chua hô). La peau de cet ennemi fut transformée en tapis et son squelette exposé à la vue des tigres qui finirent par s'enfuir de peur de risquer le même sort.
A la suite de cette épisode, Duong Canh Công créa un domaine et s'y installa; celui-ci deviendrait le village La par la suite. Il remit un souvenir aux villageois et leur raconta son histoire. Puis il se déclara génie, le fils de celui qui avait rendu sa mère enceinte dans le temps. Il célébra ainsi une fête en invitant toutes les personnes âgées du village. Tandis que le repas se déroulait, deux franges de lumière apparurent, comme deux écharpes en soie qui flottèrent dans l'air. Les deux fées se montrèrent et disparurent aussitôt, c'était le deuxième jour du douzième mois lunaire. Le dixième jour du mois suivant (premier mois du calendrier lunaire) Duong Canh Công partit à cheval vers l'Ouest et n'est jamais revenu."
Au-delà de son côté rocambolesque, cette légende, riche de renseignements qui pourraient servir d'indicateurs de la vie sociale, des moeurs..., nous intéresse à plusieurs égards. Nous laisserons de côté son caractère irrationnel et anachronique. Par contre, notre curiosité porte sur des aspects mystificateurs, et sur les détails que l'on peut considérer comme révélateurs de la culture villageoise.
Tout d'abord, les habitants de ce village n'ont pas hésité et continuent à vénérer leur génie tutélaire, vraisemblablement le fondateur du village, qui n'était que le fils d'une simple teinturière; autrement dit, une personne du bas peuple sans prétention aucune. De plus, ce génie n'était même pas un enfant né du mariage. Son statut de fils naturel n'a pas scandalisé la famille (la grande mère), ni le village La. cette situation s'oppose manifestement à la morale conventionnelle des classes dirigeantes pour qui le confucianisme incarne l'ordre indiscuté de la société; par conséquent, une femme qui enfante sans être mariée ne peut être qu'une femme de moeurs légères, une honte pour la famille. Il est saisissant de constater, par ailleurs, dans la légende, comment l'instant décisif de la procréation "Tout à coup, elle vit une sorte d'auréole qui se projeta sur elle") a été habillé d'éléments mystificateurs. Dans cette version légendaire, la femme est présentée comme une personne passive qui subit des évènements contre lesquels elle ne peut rien. Ne cherche t-on pas des circonstances atténuantes pour protéger cet acte contre la morale dominante? "L'auréole qui se projeta sur elle" ne sert-elle pas à traduire tout simplement en langage imagé et mystique le moment déterminant de la procréation? Ici la mythification d'un fait social coïncide strictement avec l'interdit de la morale. Est-ce un hasard? Sans doute pas. Une des fonctions de la mythification serait alors de mettre à l'abri un événement en le plongeant dans un bain d'énigmes afin qu'il en ressorte méconnaissable et qu'il puisse échapper à tout blâme, d'où qu'il vienne. Par contre, d'autres détails ou faits de la légende n'ont pas été mythifiés. Par exemple, le deuil de trois ans que porte le fils à la suite de la mort de sa mère. On peut penser que ce détail, cet épisode, comme tant d'autres, a été ajouté pour brouiller les pistes, pour noyer les faits réels, de sorte que l'histoire garde une apparence de cohérence. Si c'était un fait authentique, "le deuil de trois ans" répondrait parfaitement aux exigences de la morale; donc on n'avait pas besoin de l'habiller en mythe. Ceci constitue le deuxième aspect troublant de la construction de la légende. Un peu plus loin du récit, le futur génie se présente au roi comme une personne dotée des capacités nécessaires à vaincre les tigres, et le roi le décore d'un titre élogieux. Ne cherche t-on pas, par ce détail, à gagner le confiance du pouvoir central, en l'occurrence le roi régnant, afin qu'il avalise la vénération de ce génie qui, dans le passé, a déjà été reconnu par le roi? Une sorte de "génie modèle" tout à fait conforme aux règles morales, un héros national au service du roi dans les situations de troubles. Trouve t-on encore quelque chose à reprocher à ce génie qui, à certains égards, s'est comporté comme un roi? En effet, il s'est déclaré génie comme tous les rois qui se sont déclarés rois en arrivant au trône. Par ailleurs, à un autre niveau, on ne voit pas comment les autorités centrales pourraient s'opposer à une légende populaire, la nier, alors que l'existence de la nation repose également sur une autre légende que cultivent tous les pouvoirs en place. Les livres d'histoire de nos jours, même les plus appréciés et les plus sérieux, n'oublient pas de relater la rencontre du couple légendaire Lac Long Quân, descendant des dragons, et la fée Au co qui a donné naissance à cent oeufs, devenus cent garçons, considérés comme ancêtres des Vietnamiens. A cet égard, une autre fonction de la mythification dans la culture villageoise consiste à vaincre l'adversaire, par subterfuge, en se servant de ses propres armes. En cinq mots l'adage populaire résume ce détour : Gây ông dâp lung ông (succomber sous son propre bâton).
Si on l'admet l'idée que toute légende puise ses fondements dans la réalité, que l'imaginaire ne constitue qu'un prolongement, sous une forme ou sous une autre, du réel soumis aux pressions existentielles (philosophiques, religieuses, politiques, sociales, artistiques...), on devra trouver des indices, des enseignements sur la réalité du passé, en remontant la légende et en la séparant de ses artifices. Cette démarche pourrait nous révéler quelques indicateurs des moeurs du village La. Nous pourrions risquer l'idée que l'attitude des villageois vis à vis des femmes en général et du plaisir en particulier, est plutôt tolérante et humaine. La femme peut très bien aller seule à une fête sans avoir à subir les préjugés ou les regards méprisants. Libre à elle aussi de disposer de son corps si elle trouve un homme à son goût. Que faire de l'enfant si par hasard il vient témoigner de cette liaison? La famille l'accueille à bras ouverts sans blâmer quiconque. Une attitude inadmissible pour la morale confucéenne des classes dirigeantes. Même dans nos sociétés actuelles de l'âge moderne, cette vision ne semble être une règle unanime.
Pour terminer, chaque village vietnamien, à notre avis, trouve toujours de "bonnes raisons" pour ériger son personnage "élu" en génie tutélaire. Dans le cas du village La, ce qui paraît vraisemblable, c'est que le vainqueur des tigres a sans doute bien existé dans le passé. En ce temps reculé, le cloisonnement des villages d'une part, et une certaine cohabitation entre l'homme et la nature, y compris la faune, non encore touchée par le développement, d'autre part, faisaient des tigres une réalité menaçante pour la société humaine. Jusqu'aux années 1930 encore, les portes de Hanoi étaient visités par les tigres (l'emplacement de l'actuel mausolée de Hô Chi Minh et ses environs, plus précisément). Dans l'imaginaire populaire, le tigre était aussi représenté comme une force surnaturelle ou un personnage respectable dont il fallait tenir compte dans la vie. Les expressions chua hô (seigneur des tigres) ou ông cop (monsieur Tigre) en témoignent. Par conséquent, sortir vainqueur d'une bataille avec des tigres méritait le respect et la distinction. Et pourquoi pas la vénération? Le seul détail qui risquait de choquer les autorités centrales serait le fait que le personnage admiré était un fils naturel. Qu'à cela ne tienne, on trouverait une solution: bâtir une légende et concevoir des rituels pour la solenniser, la sacraliser.
Traditionnellement, les villages vietnamiens célèbrent annuellement leur génie tutélaire. Mais au village La, la périodicité de cette célébration n'est pas déterminée. Cela dépend. Une certaine année où les récoltes sont particulièrement bonnes, peut décider le village à rendre hommage au génie protecteur, ou à l'inverse, celui-ci peut être invoqué, au bout de quelques années de difficultés que connaît le village, afin que la bénédiction lui soit accordée. Cependant la date dans l'année est toujours respectée.
Le rituel consiste essentiellement à reconstituer l'histoire ou l'épisode le plus évocateur de la vie du génie. Ce rappel historique est connu sous le nom de hèm. La diversité de ce rituel constatée dans les villages vietnamiens témoigne de la diversité des génies adorés. La fête commence le premier jour avec la procession du génie de son autel, sa demeure habituelle, au dinh où il séjourne durant les fêtes. Le soir du dernier jour on assiste donc au hèm qui se déroule dans la cour du dinh. Ici, on reconstitue la bataille du génie avec des tigres. Et pour clore la fête, on invite le génie à regagner son autel. Les objets de culte, entre autres, le "souvenir" que le génie a offert au village de son vivant qui était la peau du "seigneur des tigres" abattu par les deux fées, véritable relique qu'on garde jalousement, font partie du cortège; mais ils seront placés dans un endroit sûr une fois que les festivités seront terminées. On remarque au passage que le culte du génie tutélaire et les manifestations diverses qui l'accompagnent ont bien lieu au dinh, centre d'activités publiques du village. Mais le restant de l'année, le génie reste dans son autel qui se trouve en général à l'entrée du village. Il ne quitte sa demeure que quand on l'invite à venir siéger au dinh pendant les fêtes.
Si le génie tutélaire symbolise l'âme du village, son "adoption" par celui-ci se décide généralement lors de la fondation. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Lorsqu'à la suite de conflits, un groupe quitte le village d'origine pour aller en fonder un autre, il emporte avec lui le génie tutélaire, et en même temps il adopte un nouveau génie en lui construisant un autel. Mais la rupture avec le village ancestral, et donc avec le génie aussi, n'est effective qu'à partir du moment où le groupe s'estime autonome sur tous les plans; et par conséquent, seul le nouveau génie adopté sera le véritable protecteur du village. Dans cette configuration, le village nouvellement fondé vénère pendant une période transitoire deux génies: l'ancien et le nouveau.
Il arrive aussi qu'à l'issue de la décision prise d'un commun accord par toute la communauté villageoise, un groupe volontaire pour le départ accepte d'aller créer un autre lieu de vie afin d'éviter des problèmes démographiques ou économiques du village. Dans ce cas, les volontaires partent avec le génie tutélaire et gardent des liens étroits avec leur village d'origine 1. Ce génie aura aussitôt droit, bien entendu à un autel, mais les rituels qui lui seront consacrés pourront être différents de ceux traditionnellement célébrés. Cela dépend de la sensibilité du nouveau groupe.
Il n'est pas rare, sur un autre plan, de voir d'autres divinités siéger à côté du génie tutélaire dans son autel. Ce caractère non exclusif du culte est illustré par plusieurs cas de figures:
- soit le cas que nous avons évoqué plus haut, qui consiste à "adopter" un génie officiel pour contenter le pouvoir central, mais le véritable génie du village c'est celui qui se dissimule parmi d'autres divinités moins importantes;
- soit le village a érigé en divinité un bienfaiteur de son vivant. Il n'a pas le statut de génie tutélaire, mais il continue, par ses actions généreuses, à protéger le village;
- ou bien encore, on constate l'indispensable présence des personnages qui étaient proches du génie de son vivant, par exemple, dans le village La, les deux femmes du génie. Ceci sans parler de la période transitoire, lors de la fondation du village, où on vénère deux génies à la fois.
Étant donné que chaque village adore son propre génie, il convient de souligner le caractère strictement local de celui-ci. Aussi puissant qu'il soit dans son territoire, son autorité s'arrête à la frontière de son village. Au-delà de cette limite, il devient inexistant pour les autres villages voisins qui comptent sur leur propre génie pour les protéger et pour veiller sur leur espace vital. Cela signifie sans doute qu'il n'y aurait aucune place pour les génies à vocation dominatrice ou hégémonique. Pris dans ce système de croyance, les génies sont condamnés à se respecter mutuellement, à reconnaître leurs pouvoirs sur le monde réel et leurs limites à ne pas dépasser. En d'autres termes, malgré le caractère primitif de ce culte, aucun village ne cherche à faire rayonner son génie au-delà de ses frontières. Au sein du même village, le génie ne fait pas partie des sujets de conversation quotidienne. On ne l'évoque qu'à des occasions exceptionnelles: les fêtes, le venue de visiteurs qui souhaitent s'informer sur ce sujet... Bien qu'intégré dans la conscience collective et intériorisé au niveau de l'individu, ce culte ne devient pas pour autant une question de fierté pour le village. En effet, on ne cherche pas à dévaloriser ou à ridiculiser les génies des villages voisins, dans le cas contraire, l'on assisterait à des conflits ouverts entre les deux villages. Les villageois préfèrent rester dans leur ignorance, dans leur superstition et qu'on ne vienne pas les embêter avec la morale, avec d'autres dieux tout-puissants, les seuls prétendus porteurs de vérité ou de bonheur.
Quoi qu'il en soit, la fête annuelle dédiée au génie tutélaire prend pleinement le caractère de la fête du village, la plus importante et la plus grandiose, connue sous le terme de hôi làng. Cette occasion coïncide souvent avec la fin des travaux agricoles et le retour du printemps. Il arrive aussi que plusieurs villages célèbrent en commun leur fête, mais chacun d'entre eux s'occupe d'un aspect différent. Par exemple, le village Phù dông et quatre autres villages voisins célèbrent le 9e jour du 4e mois lunaire leur génie, "Monsieur Giong", un garçon attardé de 3 ans qui se métamorphosa subitement en géant après avoir entendu l'appel de la Cour à la défense de la nation contre les envahisseurs. "Monsieur Giong" a été nommé général d'armée et a vaincu les ennemis. (Légende du Phù dông Thiên vuong, le roi céleste de Phù dông). Cependant, seul le village Phù dông s'autorise à trouver quelqu'un pour incarner "Monsieur Giong", tandis que les autres villages associés doivent se contenter de fournir les contingents de soldats. Cette fête porte le nom du génie, autrement dit Hôi Giong.
Au terme de cette évocation, et faute de moyens d'ordre matériel, nous ne pouvons donner qu'un petit échantillon de génies tutélaires existant dans la culture villageoise vietnamienne. En effet, un "recensement" complet de tous les génies tutélaires vénérés dans les villages vietnamiens reste à faire à ce jour. Ce travail permettrait sans doute de mieux comprendre l'imaginaire populaire, l'évolution des cultes à travers l'histoire, et de mieux saisir la culture villageoise.
Villages/localités Génies
Les objets inanimés
* Quy mông - Ba vi * un puits
* Kiên xuong - Thai binh * une sorte de grande
bassine pour géant,
faite d'écorce.
* Plusieurs villages à * le mont Tan viên.
proximité du mont Tan Viên
Les personnages
légendaires :
* Hiên luong - Vinh phu * la fée Au Co,
génitrice des Viets.
* Kham - Hà bac * Lac Long Quân, le mari
de Au co.
* Phù dông et ...- Hanoi * "Monsieur Giong" ou
Phù dông Thiên vuong.
Les personnages
historiques:
* Mê linh * La mère des deux
soeurs Trung.
* Hat môn * Les deux soeurs Trung
Les gens du peuple :
* xxxx * Le voleur.
* Lê mât - Gia lâm * le chasseur de serpent
* Dao an - Hung yên * Ong Dùng-Bà Dà,
un couple incestueux.
VI. Les moeurs villageoises à travers les fêtes
Compte tenu du climat tropical qui est une véritable épreuve, de la dureté du travail agricole qui occupe la majeure partie de l'année, et de la pression de la culture dominante qui cherche à étouffer les sentiments, les fêtes deviennent un occasion privilégiée pour les villageois vietnamiens de se décharger de leur fardeau et de s'exprimer. Les fêtes, ici, constituent réellement un facteur d'équilibre de la culture villageoise, au même titre que le travail agricole ou les cultes. Elles sont entièrement intégrées dans la tradition et prennent leur pleine signification dans la vie sociale. Les chansons et adages populaires ne manquent pas de les évoquer. Nous avons par exemple:
"Giô cha không bang ba ngày têt."
(L'anniversaire du père est moins important que le
nouvel an.)
"Ai oi mông chin thang tu
Không di hôi Dong cung hu mât doi."
(Le 9e jour du 4e mois, qui ne va pas à la fête Dong
sa vie n'en sera pas moins gâchée.)
"Dù ai buôn ban tram nghê
Nho dên thang chap thi vê buôn tranh."
(Quoi qu'on fasse dans la vie -quelque soit le métier,
Penser à revenir au douzième mois pour commercer les
tableaux.)
Cette dernière chanson populaire est originaire du village Dông hô, réputé pour ses tableaux peints sur du papier de riz. Durant tout le douzième mois, juste avant le nouvel an, on ne trouve rien d'autre sur le marché du village que des tableaux peints; cette atmosphère prend pleinement le sens d'une fête. Quant au Hôi Giong dont parle la deuxième chanson, il s'agit de la commémoration de la vie légendaire de "Monsieur Giong", évoqué dans le chapitre précédent. La première chanson, quant à elle, vient relativiser la place du culte des ancêtres dans la vie sociale. Effectivement, pour ceux qui doivent aller travailler loin du village, une absence est tolérée à l'anniversaire de la mort de leur père; par contre, s'ils ne reviennent pas pour le nouvel an, surtout les trois premiers jours, la famille considéra cela comme un acte de désinvolture.
Au Vietnam comme ailleurs, les fêtes ont aussi une fonction compensatrice au niveau mental pour l'individu. Elles rétablissent une certaine égalité en supprimant les barrières qui séparent les différentes catégories sociales. Le repos ou l'arrêt de toute activité liée au travail d'une part, et le statut unique de participant à la fête d'autre part, rapprochent les uns des autres, sans parler de l'intérêt collectif à maintenir les traditions, de l'enthousiasme procuré par le sentiment d'appartenir à la même communauté d'idées, et de l'excitation occasionnée par la fierté de vouloir montrer, -aux villages voisins, - ce qu'on a de mieux. Dans un ouvrage assez récent, Thu Linh et Dang Van Lung pensent que "les conditions du moment, les buts concrets ou le besoin de se reposer ou de s'amuser, ne suffisent pas à expliquer l'origine des fêtes", car "la plupart d'entre elles ont une profondeur historique" 1. Et ces deux auteurs font remarquer, avec justesse, que "nul individu ne peut, à son inspiration, organiser une fête" (qui aurait les mêmes significations et la même ampleur que celles de la fête du village). En clair, les fêtes ne peuvent être qu'une oeuvre collective.
Par ailleurs, si les fêtes sont l'expression d'une culture, on ne s'étonne pas qu'elles prennent des formes aussi diverses que singulières. Dans la terminologie vietnamienne, on distingue bien des Têt (fête célébrée sur tout le pays, par exemple, le nouvel an, la fête de la mi-automne, la fête des morts, etc. 2) des Lê (cérémonies rituelles), des Hôi (fête du village) des Dam (rassemblement lors d'un événement survenu dans la vie de quelqu'un). Lê Thi Nhâm Tuyêt suggère, dans son article consacré aux fêtes du village, une classification plus rigoureuse:
- les fêtes liées aux travaux agricoles;
- les fêtes de la fécondité;
- les fêtes à caractères artistiques;
- les fêtes basées sur les concours
- et les fêtes à caractère historique 1.
Nous nous intéresserons particulièrement aux fêtes du village, lesquelles nous semblent, à la fois, être la libre expression la plus riche et souligner les mieux le particularisme de chaque village. Car les fêtes constituent également un élément porteur de l'autonomie sur le plan culturel. Ainsi lorsqu'un village célèbre sa fête cela signifie aussi qu'il marque sa volonté de maintenir ses traditions face à celles des autres, et particulièrement à celles des classes dirigeantes.
En quoi la fête du village se distingue t-elle de tout autre rassemblement? En tant qu'oeuvre collective, cette fête est l'affaire de tout le monde, ce qui n'est pas le cas des cérémonies ou des autres fêtes. On peut aussi reconnaître la fête du village à travers la tenue vestimentaire de ses habitants et leurs attitudes. Autant, dans la vie quotidienne, ils s'habillent sans se préoccuper de l'esthétique, se déplacent à pas pressés, se comportent sans trop se soucier de la courtoisie, autant, lors des fêtes, ils mettent les habits les plus distingués, adoptent une démarche qui laisse entrevoir une certaine grâce, et se donnent une attitude de bienveillance. Enfin, la fête du village a lieu indiscutablement au dinh où l'on reconstitue le passé légendaire du génie tutélaire. Par ailleurs, au-delà de son caractère ritualiste, cette fête laisse une large place aux divertissements, lesquels ne distinguent pas les jeunes des vieux, les hommes des femmes, les humbles des notables.
Laissons-nous emporter et bousculer dans la fête du village Ngà qui a lieu du 6 au 15 du premier mois lunaire. Ce village porte le nom littéraire de Nga-hoàng, une localité du district de Quê vo de la province de Hà bac. La fête de ce village se nomme Hôi chen ou "fête de la bousculade". Le matin du premier jour des fêtes ont lieu les rituels dédiés au génie tutélaire. En pleine cérémonie, les hommes, sans distinction d'âge, se ruent vers les femmes et les bousculent avec les épaules. Petit à petit les tranches d'âge se séparent: les garçons bousculent les filles et les messieurs les dames. Cet amusement dure un bon moment avant que ne reprennent les cérémonies. On se retourne alors vers le génie pour lui demander la bénédiction:
"Que les vieux soient en bonne santé,
Que les jeunes soient résistants,
Que la prospérité déborde de la maison et de la
rizière. 1"
Arrive maintenant le temps de la procession qui va faire le tour du village. Cette fois, les femmes prennent l'initiative et bousculent les hommes pendant toute la procession. Et elles n'hésitent pas à bousculer certains jusqu'à ce qu'ils tombent dans la mare. Elles poursuivent même, par petits groupes de cinq à six, ceux qui sont allés se cacher dans leur maison, pour les faire sortir, toujours par bousculade. Ceux qui n'arrivent plus à tenir debout, elles les relèvent pour pouvoir continuer à les bousculer. Et ce, jusqu'à la fin de la journée. Ces divertissements reprennent de la même façon le sixième jour et surtout le dernier jour de la fête (11e et 15e du mois) où ont lieu de nouveau les cérémonies qui marquent la fin des fêtes et qui durent de l'après-midi jusqu'à minuit 1.
Que peut-on tirer de cette fête comme enseignements? Quelques remarques s'imposent. En premier lieu, les cérémonies et les rituels qui reflètent l'aspect spirituel de la fête, ne prennent pas le pas sur les divertissements qui rythment la vie culturelle ou la vie tout court. Tandis que le maître de cérémonies, aidé de ses confrères, invoque le génie par des éloges ou par des prières à l'intérieur du dinh, à l'extérieur, les villageois en tant que participants à la fête, eux, s'amusent, et ce en toute liberté, même pendant la procession. Ces deux manifestations d'apparence antagonistes et anachroniques, ne traduisent-elles pas tout simplement une certaine souplesse d'esprit, chez les villageois à l'égard des cultes, ne relativisent-elles pas la place du spirituel dans la vie ? Imaginons une scène semblable et ses suites qui auraient lieu dans une église, dans une mosquée ou dans une pagode !
Un autre aspect de cette fête, et non moins riche d'indices de la culture villageoise, vient marquer l'empreinte de liberté dans le domaine des moeurs face à la morale confucéenne qui prêche le puritanisme. Les contacts physiques par bousculade, entre jeunes ou moins jeunes de sexes opposés ne préjugent absolument pas de leur provocation ou du laisser-aller. Au contraire, ces divertissements constituent le véritable reflet de la fête puisqu'elle se nomment familièrement "fête de la bousculade". Dans cette ambiance de fête, personne n'aurait le temps de veiller sur les jeunes afin qu'ils ne fassent pas de "bêtise". Mais ce genre de bêtise n'est certainement pas l'apanage des jeunes. Existe-il des barrières pour dissuader des "dérapages"? Apparemment non. Si, par hasard, les bousculades servent de prétexte à une rencontre ou à une meilleure connaissance mutuelle, pour certains ou certaines, cela fera partie intégrante du mouvement de la vie. Car les fêtes de cette nature sont des moments privilégiés pour les jeunes en âge de découvrir les secrets de la vie. Lesquels peuvent être dissimulés sous la forme des jeux que proposent les fêtes de plusieurs villages des districts Yên phong, Quê vo et Thuân thành.
Attardons-nous quelques instants pour participer à la joie et à l'excitation des jeunes, formés par couples sous le regard des spectateurs qui envahissent la cour du dinh. Chacun de couples participants se place devant une jarre à moitié remplie d'eau et dans laquelle on a mis une espèce d'anguille (chach). Garçons et filles se tiennent par les épaules ou par le cou, et la main libre de chacun s'introduit dans la jarre. Le jeu consiste à attraper le poisson. A la question "pourquoi organise-t-on ce jeu de telle sorte?", les vieux du village n'hésitent pas à répondre, et avec quelle poésie, que "le printemps ne peut se réaliser qu'avec la présence des deux sexes" 1. Les jeunes arrivent-ils à attraper l'animal innocent, et au bout de combien de temps ? Sous couvert des coutumes qui autorisent ces défoulements, seules peut-être les âmes pures pensent à remporter la victoire. Les plus taquins, ne cherchent-ils pas plutôt à faire durer ces moments de délice que procurent les contacts de leur corps avec celui du coéquipier ou de la coéquipière? Préfèrent-ils vraiment prouver l'habileté de leur main en oubliant le langage gestuel servant de prélude à la déclaration de leurs sentiments ? Quoi qu'il en soit, pour sauver l'apparence de jeu, ils ne se permettent pas de s'imaginer sur une île déserte, car ils jouent aussi le rôle d'amuseur qui procure des rires et des agacements au public.
Vus sous l'angle ethnologique, ces jeux représentent aussi le parcours initiatique de la vie des jeunes qui arrivent à l'âge de la palpitation du coeur, l'âge où leur corps réclame une certaine chaleur que seul possède l'autre. Cours & Parcours initiatique pour les timides qui n'auraient peut-être pas osé risquer cet affrontement du moi s'adressant à l'autre, cet événement de leur vie, sans l'approbation du public. Savoir que certaines choses sont permises et se font en toute impunité constitue pour eux un encouragement. Cours & Parcours initiatique également pour ceux qui sont déjà plus sûrs d'eux: qu'ils sachent aussi qu'il existe des limites quant à l'intimité en public. Enfin, pour les jeunes, ces jeux ont une valeur éducative qui vient compenser l'absence de dialogue ou de communication au sein du foyer, étant donnée la pudeur en matière sexuelle qui règne encore chez beaucoup de Vietnamiens. Par la suite, ces expériences vont servir aux jeunes de sujet de discussions qui leur permettront de mieux appréhender l'inconnu ou de remettre les choses à leur place.
Revenons à la fête du village La que nous avons évoquée plus haut. Qu'y a-t-il de particulier et de jouissif dans cette fête? Ce village est surtout réputé pour les moments qui marquent la fin des festivités. Le dernier jour des fêtes, vers minuit, on rend le dernier hommage au génie tutélaire en reconstituant la scène héroïque de la chasse aux tigres. Avant de clore les cérémonies, on procède à l'extinction de toutes les lumières (bougies, flambeaux, lanternes...) qui est prononcée par trois roulements de tambour suivis de battements de cymbales. Le maître de cérémonie décide, en vertu de la tradition, de la durée de l'extinction. En général cela peut durer d'un quart d'heure à une demi-heure. Pourquoi éteint-on la lumière? Les vieux du village avancent plusieurs explications en ordre dispersé : "C'est pour rendre la reconstitution aussi fidèle que possible à la réalité historique. On tend un piège aux tigres: ils vont être surpris et désorientés quand la lumière revient brusquement après un moment d'obscurité" 1. Mais l'obscurité permet aussi aux officiants de ranger les objets de culte dans un endroit secret sans que personne ne le sache. Sans attendre les autres questions liées à ce sujet, les vieux du village nous opposent une fin de non recevoir aux bruits qui courent, à tout ce qui laisse entendre que cette fête cautionne des moeurs légères. "Ce sont des calomnies pures et simples". Au-delà de la médisance, on ne s'étonne pas que ces moments de fête attirent une frange de la jeunesse curieuse qui cherche à s'initier aux relations amoureuses. Cet espace de "liberté" viendrait combler l'absence quasi-totale d'intimité dans la vie quotidienne, compte tenu de l'organisation spatiale et sociale en milieu villageois, voire urbain, chez les Vietnamiens. En effet, autant le village est souvent isolé du reste du monde sur le plan spatial, autant la maison, comme lieu d'habitation, s'ouvre sur l'espace extérieur (et ce, à l'intérieur du village). Les portes des maisons ne se ferment que rarement. Les nuits d'été on les laisse ouvertes et il arrive aussi qu'on installe un lit de camp sur la "terrasse" (hiên) pour y dormir. A n'importe quel moment de la journée, on peut passer voir ses voisins pour leur demander un service, un renseignement, ou pour bavarder autour d'une tasse de thé. Dans ce contexte, l'individu est constamment exposé au regard du village. L'espace du privé, au sens qu'on lui donne dans les sociétés modernes occidentales, se réduit ainsi à une peau de chagrin. Ceci sans parler de l'exiguïté et de la promiscuité qui viennent repousser l'intimité au sein de la famille à la frontière du néant. Cet aspect n'est pas propre à la société paysanne vietnamienne. En France rurale, jusqu'à la fin du siècle dernier encore, on vivait dans les mêmes conditions. A. Prost nous fait remarquer qu'"on a peine aujourd'hui à imaginer la pression qu'exerçait sur ses membres le groupe familial. Pas moyen de s'isoler. Parents et enfants vivaient les uns sur les autres pour tous les actes de la vie quotidienne.(...) Quant aux rapports sexuels, ou bien ils se situaient aux marges et de l'espace privé et de l'espace public, dans la pénombre autour du bal, par exemple, derrière les buissons, etc., ou bien ils n'échappent pas à une publicité au sein du groupe familial" 1.
Dans ces conditions, on comprend pourquoi les jeunes, et pas seulement eux, attendent ces moments de fête avec impatience. De l'avis de Phan Thi Dac, la fête du village "inaugure une période de fêtes, de jeux ou de licence sexuelle". Et elle précise dans la note de la même page, qu'"il s'agit soit des rites d'initiation sexuelle (extinction momentanée de la lumière), soit des unions libres après les fêtes dans les champs. (...) Ces coutumes sont pratiquées plus ou moins en secret pour ne pas encourir les foudres mandarinales. Les lettrés confucéens doivent s'incliner eux-mêmes devant la coutume. Ce sont eux, sans doute, qui ont obtenu que les unions libres hors de la période de licence sexuelle soient punies très sévèrement" 2.
On retombe ici sur l'interdit social. Si l'absence de l'espace du privé, de l'intimité, conjuguée avec les tabous, constitue une barrière pour l'expression de l'individu, on ne s'étonne pas que les fêtes deviennent une réaction aussi violente que le sont les forces de persécution. Vues sous cet angle là, les fêtes remplissent tout à fait la fonction compensatrice et régulatrice au niveau de l'individu en proie à ses tourments.
Puis, le maître de cérémonie fait rallumer la lumière et donne rendez-vous au public pour la prochaine fête, à la même heure et au même lieu. Les fêtes sont donc terminées.
Rappelons-nous que dans beaucoup de villages les génies tutélaires peuvent incarner les personnages les plus controversés quant à leur moralité. Dans certains cas, le pouvoir central intervient énergiquement et d'une façon autoritaire pour faire cesser l'inadmissible et punir les coupables. C'est le sort qui a été réservé aux deux génies du village Dao-an dans la province de Hung yên. La légende fait remonter leur existence au règne de Ngô quyên (Xe siècle).
Il était une fois un frère et une soeur, nommés Ong Dùng et Bà Dà (monsieur Dùng et madame Dà), en âge de se marier, mais qui n'y pensaient pas. Un beau jour, ils eurent l'idée burlesque de faire le tour d'une montagne, chacun dans un sens, en convenant de prendre comme époux ou épouse celui ou celle que chacun d'entre eux rencontrerait sur son chemin. Ils finirent par se croiser sur la route, et ainsi ils se marièrent. Quelques jours après cette union, le roi en fut informé. Il ordonna de les châtier pour conduite incestueuse. On leur creva les yeux, on leur coupa les oreilles avant de les décapiter et jeter leur corps dans la mare.
La fête du village Dao an débute le 6 et se termine le 10 du troisième mois lunaire. Le soir du dernier jour des fêtes, on reconstitue cette légende. A minuit, on procède au châtiment auquel seuls le maître de cérémonie et les officiants assistent.
Cette légende a été recueillie puis retranscrite par un reporter du journal Ngày nay dans le numéro du 23.05.1935. A l'en croire, le journaliste a eu beaucoup de mal à faire ses investigations, à percer ce secret du village Dao an. Quatre mois après la parution de cet article, le journal Phong hoa publia la réponse du conseil de Ky muc de ce village, destinée à rectifier les "erreurs commises" par le reporter. D'après ces notables, les deux mannequins qu'on voit dans la procession ne représentent pas Ong Dùng-Bà Dà, mais deux génies bienfaiteurs nommés Dông vuong phu et Tây vuong mâu (le roi père de l'Est et la reine mère de l'Ouest), d'une part, et d'autre part, il ne s'agit pas du châtiment à la fin de la reconstitution, mais d'une opération d'ordre pratique: on récupère les yeux et les oreilles qui serviront pour les années suivantes, avant de laver le corps des deux mannequins au puits qui se trouve à l'entrée du village 1.
On assiste ici à deux interprétations complètement différentes des faits. Néanmoins, toutes les deux relèvent de la vision moderne: le journaliste voulait caricaturer les traditions jugées arriérées, et affirmait la volonté de les combattre; le conseil des notables rejetait les calomnies à l'égard du village. L'une et l'autre partie étaient donc d'accord pour dire, soit que ces traditions ne devraient plus exister, soit qu'elles n'ont jamais existé. Toutefois, les rectifications faites par le conseil des notables, conseil qui représentait l'autorité et le garant de l'ordre moral, n'étaient pas aussi convaincantes qu'ils le souhaitaient. N'ont-ils pas réagi par pure forme pour sauvegarder les apparences ? Au fond d'eux-mêmes, ne reconnaissaient-ils pas qu'ils n'y pouvaient rien ? D'un autre côté, en cherchant à se défendre, ne se sont-ils pas laisser trahir par leurs propres arguments ? L'"Est" et l'"Ouest" dans "le roi père de l'Est et la reine mère de l'Ouest", ne rappellent-ils pas les directions opposées prises par Ong Dùng et Bà Dà en faisant le tour de la montagne ? Par ailleurs, le journaliste n'aurait peut-être pas eu le don d'inventer une légende de toutes pièces pour la circonstance. Encore une fois, on est frappé par les éléments mystificateurs qui viennent se greffer juste là où il y a l'interdit social. La mythification invente sans doute des circonstances atténuantes et cherche à protéger les actes jugés immoraux. Les traditions villageoises diraient par là que si Ong Dùng et Bà Dà se sont mariés, c'était la conséquence de leur rencontre hasardeuse quelque part sur la montagne. Ils auraient pu croiser n'importe qui ! Ce qui vient les décharger de toute responsabilité, les innocenter afin qu'ils puissent avoir une vie comme les autres. Par ailleurs, la légende mentionne bien que le mariage de ces deux personnages a eu lieu. Ne faut-il pas comprendre, par ce détail, que le village Dao an tolère même l'union incestueuse ? Si oui, on ne voit pas pourquoi il se serait opposé à un mariage ordinaire fondé sur l'amour. Dans ce cas, la culture de ce village va à l'encontre des principes confucéens qui font du mariage une affaire de famille, prenant en compte avant tout le critère social (môn dang hô dôi), et qui relèguent les sentiments aux oubliettes; ceci sans parler de l'autorité des parents qui considèrent leurs enfants à marier comme de simples figurants obéissants. Effectivement, les parents nourris de l'ordre confucéen éduquent (sic) leurs enfants de telle sorte "qu'ils s'assoient là où on leur dit de s'asseoir" (dat dâu ngôi dây). Aussi puissant soit-il, cet ordre moral devient caduc en milieu villageois, du moins pour le village Dao an.
Comme chaque village forge ses propres moyens de défense face à la culture dominante, en usant de son passé traditionnel, on se retrouve de fait devant une avalanche de contre-culture qui, venant de toutes parts, balaie sur son chemin élément par élément l'édifice confucéen. La fête du village Lim constitue de ce fait une autre composante de cette avalanche.
Lim se trouve à une vingtaine de kilomètres de Hanoi, sur la route nationale 1 menant à Bac ninh. A l'époque coloniale, Lim faisait partie de cette dernière province mais depuis 1963, à la suite des découpages administratifs, les deux provinces de Bac ninh et Bac Giang devinrent la province de Hà bac. La région de Bac ninh est réputée pour la tradition du Quan ho 1. La fête du village Lim devient en quelque sorte la fête du quan ho de la région.
Si les fêtes occupent une place non négligeable dans les activités sociales du village, la région de Bac ninh en fournit ici une illustration exemplaire. Du 4e au 30e jour du premier mois lunaire, on dénombre au moins une fête du village par jour. (Plusieurs villages peuvent célébrer leur fête le même jour.) Pour cette région, les fêtes occupent tout le premier mois de l'année, et elles se poursuivent, bien que plus espacées, au deuxième mois. Lim, quant à lui, célèbre ses fêtes le 13e jour du premier mois. Bien que ce jour ait un rapport avec le culte du génie tutélaire du village, il n'en présente pas moins des atouts manifestes. Le nouvel an à caractère familial est bien terminé, ce qui libère les villageois des tâches et des devoirs envers leur cercle intime d'une part, et le cadre naturel devient plus séduisant, ce jour-là, avec le clair de lune d'autre part. Ces deux aspects conjugués à la réputation de ce village contribuent à faire de la fête de Lim la plus grande et sans doute la plus célèbre de la région. Elle attire non seulement les habitants des villages avoisinants, et en particulier les chanteurs et chanteuses quan ho, mais aussi toute une frange de jeunes de Hanoi. A l'époque coloniale, dans les années 1930, cette fête était considérée comme une des occasions privilégiées pour les jeunes citadins de montrer leur charme aux jeunes filles du village. Mais ces jeunes, quelque peu arrogants, qui méconnaissaient cette tradition, étaient balayés dans cette course à l'amour. En effet, le quan ho constitue le cadre dans lequel seuls les initiés peuvent s'exprimer à travers le chant.
Comme toutes les autres fêtes du village, cette grande manifestation culturelle et artistique se compose de deux versants : les rituels, et les divertissements qui ne se limitent pas au chant mais s'étendent aux jeux de la balançoire, à la lutte.... Une fois que les cérémonies au dinh puis à la pagode sont terminées, le chant quan ho occupe l'espace le plus manifeste. En fin de journée, quand la fête officielle se termine, ceux et celles qui souhaitent avoir plus de temps pour échanger leurs idées, pour mieux se comprendre, invitent leurs partenaires à continuer à chanter chez eux ou chez elles; et ce jusqu'au lendemain matin avant d'aller à une autre fête.
Une autre variante de la fête liée à la tradition du quan ho se célébrait au village O (Xuân ô) ou plus précisément au marché de ce village. O se trouve à environ deux kilomètres de Lim vers le nord sur la même route nationale 1. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace de ce marché autrefois illustre. A en croire une chanson quan ho qui décrit le climat de ce marché, il devait être très fréquenté au jour de fête:
Le cinquième jour, jour du marché O
Les "bandes" quan ho se ruent (vers le marché)
La fête est très amusante.
(Je n'ai) pas le temps de me laver,
(Je n'ai) pas le temps de me laver les cheveux,
Les chiques de bétel ne sont pas encore préparées,
Les noix d'arec ne sont pas encore coupées,
Les unes bien faites, les autres non,
D'autres encore n'ont pas de chaux.
Si tu m'aimes
Garde-la (la chique de bétel).1
La fête du village O avait lieu le 5e jour du premier mois lunaire, mais elle commençait la veille avant la tombée de la nuit avec le marché, appelé encore "marché aux poulets", (hôi cho ban gà). La tradition de ce village voulait qu'on offrît du poulet à la peau noire au génie tutélaire. Ceux qui avaient cette espèce de poulet l'emmenaient ce jour là au marché pour le vendre à prix sacrifié. On pensait que la famille dont le poulet serait choisi comme offrande au génie aurait de la chance au cours de l'année qui allait venir. Ce marché avait une autre particularité : on bradait tous les vieux objets. Pour ce jour spécial, côté acheteur, on ne marchandait pas, côté vendeur, on bradait à bas prix et on ne comptait pas la monnaie donnée. Tout était question de chance. Celui qui aurait gagné serait content, mais celui qui aurait perdu, aussi, car par la même occasion, il aurait fait plus de charité au monde de l'au-delà. Le marché se terminait vers 19 heures, l'heure où le jour se retirait en laissant la place à la nuit.
La fête prenait alors la relève du marché. En l'espace de quelques instants, les buvettes s'illuminaient de lumière colorée. C'était l'unique jour où on les éclairait. Les vieilles dames qui tenaient ces buvettes vendaient aussi les indispensables chiques de bétel. Les jeunes étaient déjà là et s'invitaient mutuellement à chiquer le bétel et à chanter le quan ho. Les vendeuses chantaient aussi pour leur souhaiter une bonne année, pour les inviter à boire et à chanter. On s'assemblait autour d'une buvette et le chant résonnait de partout. Faute de place dans une buvette, on n'hésitait pas à poser une natte par terre pour s'y asseoir et chanter. D'autres se mettaient d'accord pour aller chanter à la rizière. Ainsi les jeunes passaient la nuit à chanter avant de rentrer chez eux. En effet, les garçons et les filles de O invitaient séparément leurs partenaires venu(e)s d'autres villages à rester chez eux ou chez elles pour y passer le jour de fête. Le matin on célébrait le culte dédié au génie tutélaire, puis le chant quan ho occupait de nouveau le terrain, et ce jusqu'à minuit, l'heure où les uns et les autres se disaient au revoir (en chantant) avant d'aller se fondre dans une fête des environs 1.
Le quan ho se manifeste dans bien d'autres circonstances de la vie, par exemple, le mariage, la mort, la promotion sociale, etc., il s'impose comme une véritable culture régionale. Cependant chaque village de cette région le fait vivre à sa façon selon ses intérêts et ses traditions. Il peut être vivace ici mais moins riche que là-bas. On assiste donc à toute une panoplie de variantes d'un village à un autre. Néanmoins, le quan ho a au moins le mérite de créer des conditions favorables au rapprochement des deux sexes et particulièrement des jeunes, sans parler de sa richesse artistique.
Par ailleurs, bien que pudique dans les gestes, cette forme d'expression affiche sans retenue les sentiments. L'individu s'épanouit au rythme de ses chansons, à la mélodie que lui adresse le ou la partenaire. Si par hasard, l'estime réciproque conduit au mariage, sauf pour ceux et pour celles déjà lié(e)s par une "amitié spéciale" (kêt nghia), cela fait aussi partie de l'ordre des choses. Et il n'y a pas de quoi scandaliser qui que ce soit. La tradition du quan ho, dans le contexte villageois, s'érige de fait comme une contre-culture pour s'opposer à la culture dominante chargée de principes et de préceptes confucéens qui répriment toute forme d'expression liée au sentiment.
Nous venons d'esquisser un panorama restreint des fêtes de village dans le Nord Vietnam à l'époque coloniale. Ce choix nous a été dicté par les sources existantes et le caractère représentatif de ces fêtes dans les régions respectives. D'autres régions avaient bien entendu d'autres fêtes non moins révélatrices de la culture villageoise, mais l'absence d'une documentation complète nous a contraint soit à laisser de côté, soit à ne faire que les évoquer sans avoir la possibilité de les traiter avec précision. Par exemple, la région de Vinh phu (ex. Vinh yên et Phu tho), considérée comme le territoire le plus ancien des Vietnamiens, là où la dynastie légendaire Hùng avait établi son royaume sous la dénomination de Van lang, témoignait de l'existence des fêtes liées aux rites agraires, et ce jusqu'aux années 1940. La fête de beaucoup de villages de cette région mettait l'accent sur la fécondité. On fabriquait un phallus et un sexe féminin, et le jour de la fête on simulait les actes sexuels 1. Ces actes symboliques invoquaient à la fois la fécondité et la prospérité pour le village. (En effet, quand les Vietnamiens se rencontrent après une longue absence, une des premières questions qu'ils se posent mutuellement est "Combien d'enfants avez-vous?", car la progéniture est assimilée à la richesse dans la culture vietnamienne.) Le folklore de Vinh phu n'était, certes, pas moins riche que celui de Hà bac, par exemple. D'autres modes de chant d'amour similaires au quan ho existaient, cependant pour une raison non encore connue, ils n'arrivaient pas à franchir les frontières régionales. Dans ce domaine, on est frappé de constater que le Vietnam avec ses "4000 ans d'histoire" n'a pas su ou n'a pas pu produire une seule danse qui aurait pu devenir une danse populaire comparable au Lam vong du Laos ou du Cambodge qui sont pourtant considérés par le Vietnam comme des pays arriérés. Quel paradoxe! Cette remarque s'applique aussi à la Chine, au Japon et à la Corée qui, par hasard, ont tous un point commun avec le Vietnam, d'avoir érigé le Confucianisme comme superstructure. En réalité les danses populaires ont bien existé dans le milieu villageois, mais les classes dirigeantes de toutes les dynasties confondues, nourries de préceptes confucéens, dédaignaient cette forme d'expression et la considéraient comme une distraction de mauvaise goût, et elles ont fini par interdire cette manifestation "sauvage" sur les lieux publics. (Avec le recul, on voit qui sont les vrais incultes.) Contraints de subir cette injustice, les villageois n'abandonnaient pas pour autant leur tradition. Là encore, la culture villageoise ne manquait pas de subtilité mais qui avait ses limites. Pour sauver leur patrimoine artistisque, les villageois ne faisaient que déplacer le cadre. Au lieu de danser sur les places publiques, désormais on dansait dans les lieux sacrés. Ainsi certaines danses sont devenues un rituel lors des cérémonies dédiées aux génies. Par exemple, sur le plan artistique, la transe ou lên dông en vietnamien, dans le culte dédié au fondateur des Tran et autres génies, ne se distinguait guère du chèo, une forme de théâtre populaire dansé et chanté à la fois. Frappées d'interdiction, privées de leur cadre naturel, les danses populaires perdaient leur vitalité, cessaient de se développer et étaient réduites à leur plus simple expression. La transe prenait alors une connotation superstitieuse et le chèo était relégué aux mains de spécialistes qui essayaient tant bien que mal de le faire vivre.
On a ici un exemple de confrontation de deux cultures qui s'ignorent, l'une étant l'émanation des classes dirigeantes qui cherchent à imposer leurs valeurs, et l'autre représentant le produit de la tradition orale du bas peuple acculé à la défensive. Les exemples de luttes d'influence ne manquent pas de par le monde, et le Vietnam ne constitue certainement pas un cas isolé. A cet égard, nous illustrons ici par quatre exemples trouvés hors des frontières du Vietnam : en France, en Chine, au Japon, et en Scandinavie.
En ce qui concerne le France, "L'un des objectifs de la réforme catholique dans les campagnes, écrit Jean Louis Flandrin, fut d'imposer la séparation des filles et des garçons où ils avaient coutume d'être ensemble" 1. Cette campagne de moralisation visait particulièrement la "mixité des écoles de village", "la mixité des jeux puérils", les veillées bien entendu, mais elle dénonçait aussi "la fréquentation des sexes dans les pèlerinages". Les sociétés traditionnelles avaient leurs propres cadre et mode de vie dans lesquels s'intégraient les rencontres et les initiations à la vie amoureuse. "Partout, dans l'ancienne France, ces occasions étaient nombreuses: pèlerinages, foires, louées de domestiques, et toutes sortes de fêtes. Dans certaines régions on allait courtiser les bergères aux champs; et partout on rencontrait les filles à marier dans les veillées d'hiver 2." Petit à petit ces coutumes tombaient en désuétude et laissaient la place au bal du village, lieu qualifié par "excellence de l'apprentissage sexuel" ou de "grand marché d'amour" 3.
On est frappé de voir qu'un peu partout dans le monde, les moeurs paysannes n'avaient rien à voir avec celles des classes dirigeantes. En Chine, Michel Cartier a aussi relevé ce contraste:
"A la différence des nobles, pour lesquels il était indispensable que les fiancés ne se connaissent pas avant leur mariage et que les jeunes filles soient remises vierges à leur belle-famille; les paysans auraient vécu selon une morale plus libérale 4".
Dans cette société rurale, le mariage ne servait qu'à ratifier les unions seulement après que la fille fût enceinte. Pour P. Beillevaire, dans la société paysanne japonaise d'avant Meiji, les moeurs jouissait d'une grande liberté car les relations pré conjugales étaient autorisées, sauf chez les plus riches. Un exemple dans la région ouest de Kyûshû et dans le Chûgoku en témoigne:
"Les jeunes villageois organisés en classe d'âge disposaient des dortoirs (neyado) dans lesquels régnait une grande liberté sexuelle. Dans ces conditions le mariage ne faisait bien souvent qu'entériner une relation déjà établie et rendue patente par une grossesse ou la venue d'un enfant 1."
Cette permissivité pré conjugale, certes, à un degré moins prononcé, se rencontrait aussi en France, en Corse et en Vendée plus précisément:
"La cohabitation pré conjugale est un effet direct de l'accord passé entre familles.(...) Ailleurs les jeunes peuvent se fréquenter et même vivre ensemble, le temps que leurs familles poursuivent leurs négociations; l'accord est souvent conclu et le mariage célébré à l'église quand la fille est enceinte 2."
En Scandinavie, les relations préconjugales prenaient le forme de rituels appelés encore "la cour nocturne", que les jeunes suivaient en toute impunité avant leur mariage.
"Le samedi soir, un groupe de jeunes gens, âgés peut-être de dix sept à vingt quatre ans, se réunissaient sur la place du village et (....) se mettaient en route pour faire la tournée des maisons des filles. Arrivés devant la grange ou le grenier attenant à la maison (...), ils récitaient divers "défis" rimés, prescrits par la tradition, et mettaient la jeune fille en demeure d'ouvrir sa porte au garçon qu'ils avaient choisi pour passer la nuit avec elle.(...) Ensuite, le groupe amputé de l'un de ses membres se rendait à la maison suivante qu'ils quittaient en y laissant un autre de ses compagnons, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les membres du groupe aient été abandonnés à la porte d'une jeune fille. (...)
En théorie, chaque samedi de la saison, un garçon différent voyait une fille différente, jusqu'à ce que tous les candidats au mariage de la communauté aient fait connaissance. De telle sorte qu'une fille pouvait avoir eu de 40 à 50 jeunes gens dans son lit avant d'arrêter son choix sur un mari 1."
Ces exemples, y compris ceux du Vietnam, montrent tous la vitalité et la force des traditions populaires paysannes qui n'avaient pas attendu l'exemple d'un autre mode de vie pour agencer toutes les questions liées à leur propre vie intime. Par contre, quand il y avait une intervention extérieure, qu'elle fût l'oeuvre des autorités politiques ou religieuses, visant à "moraliser" des moeurs, elle ne faisait que déstabiliser, désorganiser voire anéantir les pratiques sociales qui n'avaient rien de débauchées ou de régénérées, car elles étaient avant tout le produit naturel, la résultante d'une culture placée dans un contexte particulier de l'histoire, qui avait obtenu l'approbation de la communauté concernée. Il n'en demeure pas moins que les villageois du Vietnam ou d'ailleurs ne se permettaient pas de dicter leur morale aux autres catégories sociales, ils n'avaient pas l'attitude arrogante de considérer les moeurs mandarinales comme désuète ou arriérée. En revanche, quand les autorités centrales intervenaient dans les affaires internes du village et au nom de la morale, pensaient-elles vraiment au bonheur du peuple, ou ne cherchaient-elles pas plutôt à étouffer les pratiques sociales qui les dérangeaient, en usant de leur pouvoir? L'ordre moral ne servait que de prétexte, un moyen de justifier leurs actes. Plus les répressions étaient disproportionnées par rapport aux "délits" ou aux "crimes", plus il fallait des justifications incontestées, rôle que jouait la morale. Mais le souci de tout pouvoir n'est-il pas de faire régner et de maintenir "l'ordre social" ? Dans cette logique, toute manifestation ou tout phénomène douteux doivent être réprimés, car "l'ordre social" ne peut se maintenir sans le contrôle étatique dans les domaines aussi bien privés que publics de la vie.
L'inceste constitue t-il en soi un délit, un crime ? D'après Françoise Zonabend, "L'interdit de l'inceste (...) n'est pas le résultat d'un réflexe de tendances physiologiques ou psychologiques propres à l'individu, quelque chose qui lui viendrait de ses instincts biologiques, mais au contraire le premier acte d'organisation sociale de l'humanité 1." Sur ce sujet, Margaret Mead remarque que chez les premiers occupants de la Nouvelle-Guinée, si on ne se marie pas avec sa propre soeur mais avec celle d'un autre, c'est pour avoir des beaux-frères, pour élargir le réseau familial, pour avoir une compagnie lorsqu'on va à la chasse 1." Quant aux Luo du Kenya, les hommes "vont prendre femmes" dans les ethnies ennemies afin de normaliser leurs relations de voisinage 2. En d'autres termes, dans beaucoup d'actes de vie, l'ordre social l'emporte sur l'instinct individuel. Plus l'ordre social est vigoureux plus l'instinct individuel est refoulé ou réprimé. Le cas de Ong Dùng-Bà Dà ne fait qu'illustrer ce modèle social.
Après avoir brossé le tableau de deux structures culturelles du Vietnam, l'une académique et l'autre populaire, nous pouvons remarquer les contrastes qui en résultent.
Le premier contraste réside dans le mode de transmission. Tandis que la culture confucéenne des classes dirigeantes se transmet à travers les textes, la culture villageoise se propage par la voie orale. Y-a-t-il une supériorité absolue d'un moyen sur un autre? Nous ne pouvons trancher ce débat. Néanmoins la tradition orale manifeste une certaine vivacité, témoigne de la vitalité du mouvement de la vie alors que la tradition écrite semble se cantonner dans des préceptes, se figer devant les différents aspects de la vie; elle ne vit pas et elle ne fait pas vivre non plus. Par ailleurs cette tradition orale, comme toutes les autres dans le monde, pose problème à certains égards. Si on arrive à localiser certains adages ou certaines chansons populaires, on ignore toujours qui en était les auteurs. S'agissait-il d'une oeuvre collective qui rassemblait les pensées, les attitudes et les remarques incisives sur chaque circonstance de la vie, et qui se perfectionnait avec le temps sous la forme d'un ou plusieurs vers successifs et bien rimés, ou de l'effort individuel des lettrés qui, en rupture de ban avec les classes dirigeantes, se sont investis dans la vie communautaire du village dont ils étaient membres? Il n'est pas exclu non plus que cette richesse soit l'oeuvre commune des uns et des autres: des paysans, avec leurs expériences, s'expriment à travers des images concrètes empruntées à la vie quotidienne, et des lettrés y contribuaient par leur apport dans le choix des termes, dans la rime et dans la mise en forme 1. Si on parcourt un recueil de chansons populaires, on s'apercevra que tous les thèmes touchant à la vie y sont abordés, et apparemment la tradition orale ne se préoccupe guère des tabous, contrairement à la tradition écrite qui les cultive. Par exemple, les chansons populaires suivantes n'auraient jamais droit de cité dans la culture académique:
Lang lo chêt cung ra ma
Chinh chuyên chêt cung khiêng ra ngoài dông 2.
(Fidèle ou frivole, fantôme à la mort;
littéralement: Frivole, on devient aussi fantôme à la mort
Fidèle, à la mort on est aussi enterrée à la rizière.)
Lôn rang lôn chang so ai
So thang say ruou deo giai dau lôn 3.
(Ce con n'a pas peur de personne, sauf de l'ivrogne
qui baise longtemps et qui le fait mal.)
Chông nguoi chang muon duoc lâu,
Muon duoc hôm truoc hom sau nguoi doi 1.
(Le mari d'autrui on ne peut pas emprunter longtemps
On le prête ce jour, on le réclame le lendemain.)
Con oi, nho lây câu này
Cuop dêm là giac, cuop ngày là quan 2.
(Mon enfant, rappelle-toi ceci
Ceux qui pillent la nuit ce sont les truands,
Ceux qui pillent le jour ce sont les mandarins.)
On remarque ici, que dans les deux premières chansons populaires c'est la femme qui parle sans aucune ambiguité. (Cet aspect n'a pas pu être mis en relief par la traduction.) Il est inconcevable que la femme puisse prendre la parole dans la culture confucéenne, et encore moins pour parler des tabous. L'opposition des deux cultures à propos de la place de la femme devient ainsi une évidence.
La deuxième dissension est à chercher du côté de la famille, et plus précisément de sa place respective dans chaque tradition. Si le confucianisme considère la famille comme la cellule de base de la société, le lieu de témoignage par excellence des préceptes par lequel l'essentiel de l'apprentissage passe, la famille ne représente pour la culture villageoise qu'un élément constitutif et numératif de la force physique du village qui s'identifie lui-même à l'unité de base et à l'entité sociale, avec ses propres coutumes, ses caractéristiques (par exemple, l'accent linguistique), ses fêtes, ses génies, etc. Par corollaire, si l'harmonie est rompue dans une famille de conviction confucéenne, c'est le confucianisme lui-même qui sera mis en cause. Autrement dit, il suffirait de désorganiser la famille si on voulait s'attaquer au confucianisme. Or cette règle deviendra inopérante si on l'applique au contexte villageois, car l'équilibre du village ne repose pas sur la famille mais sur un certain nombre de facteurs aussi importants les uns que les autres comme nous l'avons vu. Par contre, le village perdrait de son âme si on supprimait un de ces facteurs, il pourrait tout simplement périr sans activités agricoles, par exemple. Par ailleurs, on constate aussi un autre aspect sous-jacent à cette dissension. Tandis que le confucianisme vénère un maître unique, le fondateur de cette philosophie, le village n'en a pas; le génie tutélaire qui ne remplit pas le même rôle que ce dernier représente plutôt le produit de son histoire, les expériences accumulées du passé, et à un moindre degré les moeurs. Tout sépare ces deux cultures, l'une hégémonique, l'autre localiste.
Bref, le village vietnamien est un tout indissociable. Les éléments identificateurs ou les facteurs qui le composent fixent les villageois à leur terre natale. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent décider de leur départ, par exemple, la guerre, les calamités naturelles, les épidémies, la famine... L'attachement à la terre natale fait sans doute des Vietnamiens le peuple le moins explorateur et le moins navigateur qui soit, comparé aux autres peuples installés en bordure de la mer. D'après les enquêtes non publiées et dirigées par l'ethnologue Nguyên Tu Chi, les marins pêcheurs vietnamiens installés dans les villages maritimes ne se sont jamais allés au-delà de vingt kilomètres au large. Les techniques navales peu développées ne permettaient, certes, pas d'effectuer de longs voyages, mais elles n'étaient pas la cause principale. En revanche, c'est justement le caractère quelque peu autarcique du village vietnamien qui fait sa force et son autonomie relative face au pouvoir central, mais aussi sa faiblesse dans un monde en mutations.
C H A P I T R E 2
T R O I S A G E N T S
D E
M O D E R N I S A T I O N
Parmi les tâches urgentes pour la colonisation afin de s'installer durablement au Vietnam, il faut citer l'enseignement, affiché comme instrument "civilisateur". Dès la conquête, l'Amiral Charner créa en 1861 le Collège franco-annamite dans le but de diffuser le quôc ngu. Bien que cette nouvelle transcription du vietnamien en caractères latins eût été inventée au XVIIe siècle par des missionnaires, qui la considéraient par la suite comme "la propriété exclusive des communautés chrétiennes", il fallut attendre une décision politique pour que le quôc ngu pût se propager dans les différentes couches sociales. C'était une question grave, même pour les colonisateurs qui, animés, certes, de motivations et de sensibilités différentes, se sont livrés à une véritable bataille de la langue véhiculaire. L'année 1882 marqua le début de l'adoption de cette transcription dans les actes administratifs adressés à la population; cette décision a été prise par l'Amiral Lafont en 1878 1. Sous le gouvernement de Klobukowski(1908-1911) cette mesure était devenue un critère de sélection de collaborateurs subalternes vietnamiens qui travaillaient pour le compte de l'administration coloniale, puisque "tous les employés des mandarins qui ne seront pas parvenus à lire et à écrire le "quôc ngu" seront privés d'avancement".
A son début, l'enseignement comme moyen de diffuser les connaissances répondait à l'urgence et à la nécessité de former des interprètes qui serviraient de prolongement de la machine administrative pour atteindre les colonisés. L'Ecole normale de Saigon fondée en 1874, devenue plus tard le Collège Chasseloup-Laubat, illustrait cette volonté. Léon Archimbaud, qui fut député et sous-secrétaire d'Etat des colonies dans les années 1920, estimait que "l'enseignement est la clef de voûte de toute politique coloniale"; mais à cet égard, les colonisateurs ne se trouvaient pas sur un terrain vierge, car il existait déjà au Vietnam, un autre type d'enseignement et un véritable système de formation d'élites. Qu'a apporté la colonisation par le biais de l'instruction publique aux peuples colonisés? En quoi cet enseignement se distinguait-il de l'enseignement traditionnel? Quelles étaient les réactions des lettrés confucéens acculés à la défensive? Enfin, quels étaient la portée de cet enseignement dit moderne et ses effets sur la société vietnamienne?
Mais l'enseignement n'était pas le seul agent de modernisation, les sciences et les techniques, et la santé publique faisaient partie intégrante de l'entreprise colonisatrice.
I. L'ENSEIGNEMENT
A. LES REFORMES OU L'ENSEIGNEMENT FRANCO-INDIGENE
Rappelons au passage qu'avant l'arrivée des Français au Vietnam, ce pays avait son propre système d'enseignement qui était calqué sur le modèle chinois, et qui s'appuyait sur l'étude des textes canoniques confucéens légués par Confucius lui-même, ses disciples et d'autres penseurs de la même Ecole. La maîtrise des caractères chinois, sanctionnée par des concours littéraires organisés dans certaines provinces, à la capitale et à la Cour, demandait des années d'études si ce n'était pas toute la vie. Voyant des pères de famille d'un âge certain passer périodiquement des concours, un Résident supérieur du Tonkin les surnommait "des étudiants éternels". Au-delà de cette ironie, l'enseignement a toujours été considéré par nombre de Vietnamiens comme un but en soi dans la vie. Mais on pourrait se demander si cet acharnement n'était pas inculqué par la morale confucéenne pour qui l'enseignement occupait une place privilégiée dans la formation de l'esprit. Effectivement, les conseils à cet égard ne manquaient pas. Dans le "Livre des trois caractères" (Tam tu kinh), qui traite de la nature de l'homme, des différentes dynasties de la Chine, des rites, du devoir de l'enfant, de l'exemple des élèves studieux...., on trouve, par exemple, Au bât hoc, lao hà vi (si on ne s'instruit pas quand on est jeune, que fera-t-on quand on est vieux ?), Nhân bât hoc, bât tri ly (l'homme non instruit/éduqué, ne connaît pas la raison/la vérité). A cela s'ajoute aussi la place du "maître" qui vient juste après celle du roi et qui devance celle du "père", lequel représentait déjà un personnage-clef de la société. On peut se demander aussi comment un édifice de cette importance a pu être démantelé, puis remplacé par un autre en si peu de temps. La colonisation y est, certes, pour quelque chose mais on n'abat pas un arbre de la même façon qu'on arrache une herbe, et pas avec le même outil en tout cas. La faiblesse de l'enseignement traditionnel réside dans sa sclérose, dans son mépris à l'égard d'un monde qui ne cesse d'évoluer, dans son complexe de supériorité fondé uniquement sur la subjectivité. Bref, quand une pensée devient un dogme, on peut s'attendre à des surprises. A un autre niveau, cet enseignement ne mobilise pas toutes les potentialités de l'esprit, car il fait appel surtout à la mémoire en oubliant la critique,la libre expression et l'ouverture sur le monde extérieur dont les connaissances scientifiques constituent la base. L'apprentissage des caractères chinois se limite à connaître par coeur les textes anciens, à les commenter et il est hors de question de remettre en doute une idée ou un principe millénaires, considérés comme des vérités absolues, sans parler de son côté purement littéraire et philosophique.
Comme nous l'avons signalé plus haut, l'étude des caractères chinois constitue le maillon le plus faible dans la chaîne qui incarne le monde confucéen; il suffit alors que ce maillon se brise ou qu'on le brise, pour que tout l'édifice s'écroule. Un aperçu sur les effectifs des candidats aux concours littéraires au début du siècle montre que l'enseignement traditionnel était appelé à disparaître. Le nombre de candidats est passé de 6121 en 1906 à 1330 en 1912, soit cinq fois moins en l'espace de six ans. Dans un rapport de Simoni, Résident supérieur du Tonkin, au Gouverneur général de l'Indochine en 1911, il était question aussi de limiter le nombre de lauréats de ces concours en le ramenant de 60 à 30 cu nhân (traduit abusivement par "licencié") et de 150 à 90 tu tài ("bachelier") 1. L'arrêt de mort de ce système de formation d'élites a été signé le 14 juillet 1919 par ordonnance royale 2, mais les vrais commanditaires de cette décision n'étaient autres que les colonisateurs eux-mêmes qui affichaient plus ou moins ouvertement leur volonté de le détruire. Il suffit de lire des propos des Gouverneurs généraux pour évacuer toute ambiguïté à ce sujet. Par exemple, Paul Beau reconnaissait que "la conquête détruisit brusquement et définitivement cet enseignement" 3, Albert Sarraut, quant à lui, pensait qu'il s'est évaporé tout seul: "on ne l'a pas supprimé mais il n'existe plus" 4, et enfin Klobukowski n'y allait pas par quatre chemins en disant que "la réorganisation de l'enseignement aura une grande portée politique. Elle nous permettra d'abord de faire disparaître assez rapidement la classe de vieux lettrés orgueilleux et incapables qui jugent indigne d'eux tout autre travail que l'étude des caractères chinois" 5.
En somme, si l'enseignement traditionnel a disparu au bout de cinquante ans de présence coloniale au Vietnam, c'était pour deux raisons: la principale émanait de la politique coloniale, et la secondaire provenait de la faiblesse de cet enseignement qui n'a pas pu résister aux idées modernes contenues dans l'enseignement franco-indigène que l'Administration coloniale a mis en place dans le but d'éloigner les Vietnamiens de leur passé culturel en apportant un nouveau souffle. Cette faiblesse, selon Léon Vandermeersch, s'explique surtout par le fait qu'au Vietnam "la culture chinoise a été absorbée de façon plus scolaire, avec moins d'originalité" que dans les autres pays sinisés (Le Japon, La Corée) 1. Néanmoins "La classe de vieux lettrés" n'a pas pour autant baissé les bras, mais des révoltes répétitives et réprimées à chaque fois témoignaient de son incapacité de mobilisation face à un nouvel adversaire qui n'avait plus ni les mêmes méthodes ni les mêmes armes. L'arrestation à Shanghai en juin 1925 de Phan Bôi Châu, qui avait été condamné à mort par contumace puis amnistié par le Gouverneur général Varenne par la suite, et la mort de Phan Châu Trinh en 1926 marquaient la fin de la résistance et des révoltes des lettrés de l'ancienne Ecole. Il fallut attendre les années 1930 pour voir apparaître la nouvelle génération d'intellectuels qui, formés en partie dans les écoles "franco-indigènes", allaient prendre la relève de leurs aînés.
Sans aller jusqu'à retracer l'historique de l'organisation de l'enseignement franco-indigène 2, il convient de donner ses grandes lignes et ses innovations par rapport à l'enseignement traditionnel. Soucieux de doter l'Administration d'un outil efficace pour légitimer les idées de la colonisation d'une part, et d'éloigner les colonisés de l'influence culturelle chinoise, et de la Chine d'autre part, les administrateurs ont procédé à une véritable refondation du système d'enseignement en le baptisant "enseignement franco-indigène", calqué grossièrement sur l'enseignement français et saupoudré de quelques couleurs locales. Sous l'impulsion du gouverneur général Beau, cette volonté a été concrétisée par l'arrêté du 27 avril 1904 1, une sorte de synthèse des travaux de la commission chargée de cette affaire. Cependant, le Service de l'enseignement ne constituait pas pour autant un Service général au sein de l'Administration, car ses dépenses étaient imputées aux budgets locaux et non au budget général de la colonie. Ce Service était dirigé par un directeur aidé d'un inspecteur, placés tous les deux sous l'autorité directe du Gouverneur général. Au niveau local, le Conseil de l'instruction publique veillait "aux intérêts matériels de l'école", aux applications des règlements et des programmes et donnait son avis sur les "réformes éventuelles qu'il serait utile d'introduire dans l'organisation".
En réalité, à ses débuts, cette réforme ne touchait que l'enseignement primaire et le premier cycle du secondaire dit enseignement complémentaire. L'espace non défini était ainsi occupé par l'enseignement indigène et l'enseignement privé. Les études primaires, d'après l'arrêté de 1904, comportaient quatre niveaux:
- le cours préparatoire;
- le cours élémentaire;
- le cours moyen;
- le cours supérieur.
Ce cycle était sanctionné, à la fin de la 4e année par l'examen du "Certificat de fin d'études de l'enseignement primaire franco-indigène". A en croire les statistiques de l'année 1906 2, cet enseignement n'en était encore qu'à l'état embryonnaire. En effet, pour tout le Tonkin, il n'existait que 19 établissements, quatre à Hanoi et le restant au chef-lieu de province, qui dispensaient les cours primaires sans parler de certaines provinces dont Hà dông, Quang yên et Yên bai, qui n'avaient pas ce type d'école. L'effectif des quatre niveaux de ce cycle ne dépassait pas 3000 élèves. Quant à l'enseignement complémentaire qui s'étalait également sur quatre ans, et sanctionné par l'examen du Diplôme de fin d'études de l'enseignement complémentaire, que seuls les candidats ayant au moins 18 ans pouvaient passer, ses chiffres n'étaient guère meilleurs. Le nombre d'établissements s'est limité à quatre dont trois à Hanoi, et l'effectif des élèves à 487 pour la même année scolaire 1905-1906. Le taux de réussite aux examens attirait aussi l'attention: sur 448 et 65 candidats présentés respectivement aux "Certificat d'études primaires" et "Brevet d'études complémentaires", 185 et 37 ont été reçus, soit 41% et 57% .
Si l'enseignement du cycle primaire se faisait en vietnamien, la langue véhiculaire dans le cycle complémentaire n'a pas été précisée par l'arrêté du 27 avril 1904. Parmi les matières enseignées en primaire, il faut noter l'introduction des notions modernes, inexistantes dans l'enseignement traditionnel, par exemple, l'arithmétique, la géométrie, les sciences naturelles, la géographie et l'hygiène. Le cycle complémentaire visait à consolider ces notions et introduisait par la même occasion la physique et la chimie, la mécanique, et leurs applications à l'agriculture, au commerce et à l'industrie. L'histoire comme matière enseignée, s'est limité aux notions générales et au "rôle civilisateur de la France". Quant à l'histoire du pays d'Annam, elle devait attendre encore quelques modifications réglementaires avant d'avoir droit de cité.
Consciente des limites de cet enseignement encore au stade d'expérimentation, l'Administration a procédé à une nouvelle réforme. L'oeuvre d'Albert Sarraut, de retour en Indochine en 1916, Le Règlement général de l'instruction publique, a vu le jour le 21 décembre 1917 1. Contrairement à celle de 1904, cette fois la réforme réglemente l'enseignement supérieur. L'Université de Hà nôi, ouverte pour la première fois par l'arrêté du Gouverneur général du 16 mai 1906, n'avait connu qu'une existence éphémère. Les troubles politiques avaient provoqué sa fermeture en 1907, année charnière riche d'événements : déposition du roi Thành-Thai taxé d'insanité puis remplacé par son fils, Duy Tân, âgé alors de 7 ans, l'âge idéal pour régner et gouverner le peuple, révolte de Dê Tham traité de "pirate" ou de "bandit", création sur les conseils de Phan Châu Trinh, puis fermeture au bout de quelques mois du Dông kinh nghia thuc, un établissement libre d'enseignement mutuel servant de couverture aux activités politiques anti-coloniales.
Conçue plutôt comme "une école pratique qu'un établissement d'enseignement supérieur" 2, la section de Hà nôi de l'Université regroupait à son début cinq établissements:
- l'Ecole de médecine qui s'est diversifiée avec deux nouvelles sections: "vétérinaire" et "sages-femmes";
- la Faculté des lettres;
- la Faculté des sciences;
- l'Ecole de Droit et d'Administration;
- l'Ecole du Génie civil.
Le nombre d'étudiants recensé en novembre 1907 dépassait à peine 200. Dix ans après, l'arrêté du 8 juillet 1 fixait le cadre de l'enseignement supérieur, placé sous le contrôle de la Direction du même nom. Cette fois l'enseignement supérieur s'est quelque peu diversifié. On remarque la création:
- de la section "Pharmacie" qui s'adjoignait à l'Ecole de
médecine;
- de l'Ecole de commerce;
- de l'Ecole de navigation et de pêche;
- de l'Ecole normale;
- de l'Ecole d'agriculture et de sylviculture, fondée il est vrai un peu plus tard en 1918 par l'arrêté du 18 mars 2.
La Faculté des Lettres, quant à elle, a disparu tandis que l'Ecole vétérinaire ne dépendait plus de l'Ecole de médecine et devenait un établissement à part entière. Par ailleurs, on note aussi le changement des appellations de ces établissements qui, désormais, portaient le nom d'Ecole; il n'était plus question de "faculté". L'université ne remplissait complètement son rôle, et ceux qui la fréquentaient étaient appelés "élèves" et non "étudiants" 3. Pourquoi donc ces appellations? Correspondaient-elles à une idée précise? Les successeurs de Paul Beau n'ont pas changé d'avis sur cette question qui devait aussi, par ailleurs, contribuer à favoriser "l'influence française et les intérêts français en Extrême-Orient"; ce gouverneur avait défini l'enseignement supérieur en médecine en ces termes:
Il ne s'agit pas de donner aux élèves le dernier mot de la science, mais de former des médecins indigènes qui seront de bons auxiliaires des médecins européens. Cette institution ne doit pas être un centre d'études supérieures affecté aux recherches scientifiques de l'ordre le plus élevé, mais un établissement d'instruction en quelque sorte professionnelle 1.
N'étant soumise à aucune menace ni à aucune contrainte extérieures, cette déclaration vient pourtant contredire les idées généreuses de la France qui s'attribuait la mission civilisatrice dans ses colonies. Quant à l'enseignement dans ces Ecoles, il n'était mentionné ni dans le Règlement général de l'instruction publique ni dans l'arrêté instituant la Direction de l'enseignement supérieur; les programmes devaient rester les mêmes que ceux fixés dans la décennie d'avant. Quant à l'effectif, le nombre d'"élèves" de ces Écoles a sensiblement augmenté par rapport aux années précédentes, cependant il atteignait à peine 500.
Évolution de l'effectif de l'enseignement supérieur 2:
-
1919
1920
1921
1922
1923
1924
476
433
492
448
451
44
Pour les autres niveaux, les réformes de 1917 apportaient quelques modifications. L'enseignement était réparti en deux degrés correspondant à deux catégories d'établissements:
- 1er degré : le cycle primaire;
- 2nd degré : les cycles complémentaire et secondaire local.
La durée du 1er degré était portée de quatre à cinq ans, correspondant à cinq cours; le Cours enfantin, dont l'âge requis était de 7 ans, venait s'ajouter aux quatre autres cours déjà existants. L'enseignement se faisait dans les écoles élémentaires pour les deux ou trois premières années, et dans les écoles primaires de plein exercice, pour les Cours moyen et supérieur. Dès le primaire, la question de la langue véhiculaire a aussi été réglementée avec plus de précisions sans pour autant atteindre le but attendu: "En principe, le véhicule commun à toutes les matières de l'enseignement doit être la langue française" 1. Mais dans la pratique cette mesure n'a pu être réalisée partout par manque, sans doute, de personnels qualifiés. Il appartenait ainsi à l'Administration locale d'apprécier la situation; l'usage de la langue indigène devait céder "au fur et à mesure des possibilités du service" à celui de la langue française 2. De toute manière, les Cours moyen et supérieur se faisaient intégralement en français sans aucune exception. Cette règle d'or se poursuivait dans le second degré dont la durée des études s'étalait sur six ans, quatre pour le cycle complémentaire et deux pour le cycle secondaire local. L'enseignement d'histoire faisait une place d'honneur à l'histoire de France, du XVIIe siècle à Napoléon pour la troisième année. L'histoire de l'Annam, enseignée dans ces écoles du second degré, s'arrêtait à l'avènement des Nguyên, le Protectorat prenait ensuite la relève. Les matières scientifiques occupaient quasiment la moitié du programme, 10 sur 20 ou 21 heures de cours hebdomadaire, le français arrivait en deuxième position avec 8 heures; quant à l'enseignement du quôc ngu, on l'a tout simplement oublié. Ce choix illustrait bien la politique coloniale qui considérait l'enseignement plutôt comme une question de sécurité que comme une question de progrès. Ainsi l'enseignement a acquis de nouveau sa pleine signification pour devenir un instrument de domination, un outil de maintien de l'ordre du pouvoir. A chaque fois que l'ordre est menacé on procède alors au peaufinage de l'outil afin de le rendre plus efficace ou du moins on l'espère. Ce mécanisme s'appliquait, à cet égard, d'une façon religieuse en Indochine: la réforme de 1924 fut exemplaire. Sur le plan intérieur, l'année 1924 était effectivement marquée par des agitations politiques et l'émergence de nouvelles forces politiques contestataires qui s'affirmeraient dans les années postérieurs. A titre d'exemple, on peut citer l'assassinat manqué du Gouverneur général Martial Merlin en visite à Canton le 19 juin 1924 par Pham Hông Thai, un militant d'origine ouvrière du groupe Tâm Tâm Xa, apparenté à l'extrême-gauche chinoise, ce geste a coûté la vie à l'auteur de l'attentat; la nomination d'Alexandre Varenne pour remplacer Martial Merlin échappé de l'attentat, à la suite de la victoire de la Gauche aux élections de mai 1924; la fondation la même année du groupe Phuc viêt (Restauration du Vietnam) dans la région de Vinh; la création en 1925 par Nguyên Ai Quôc (le futur Hô Chi Minh) du Viêt Nam thanh niên dông chi hôi (Association de la jeunesse révolutionnaire du Viêtnam) qui disposait d'un organe de propagande, le Thanh niên (Jeunesse); la fondation du journal de luttes anticoloniales La cloche fêlée par Nguyên An Ninh, un intellectuel de formation juriste, en décembre 1923; sans parler du retour de Phan Bôi Châu et de la mort de Phan Châu Trinh en 1926, deux figures patriotiques des années 1920.
Comme l'enseignement ne constituait pas un but en soi, la réforme de 1924 n'apportait que quelques aménagements sur la forme. Le primaire se subdivisait désormais en deux cycles distincts: le cycle élémentaire qui regroupait les Cours enfantin, préparatoire et élémentaire, et le cycle primaire proprement dit se composait des Cours moyen et supérieur. Quant au secondaire, l'enseignement complémentaire devenait l'enseignement primaire supérieur et l'enseignement secondaire local l'enseignement secondaire franco-indigène. L'enseignement supérieur, lui, était amputé, par l'arrêté du 18 septembre 1924, de l'Ecole de Droit et d'Administration remplacée par l'Ecole des hautes études indochinoises, destinée à répondre aux besoins de l'Administration et aux voeux de l'élite locale. La seule innovation de cette réforme consistait en la création de l'Ecole des Beaux-Arts par l'arrêté du 27 octobre.
Quoi qu'il en soit, on remarque un progrès sur la publication des manuels scolaires. Jusqu'à cette date, les établissements en avaient manqué terriblement et ce qu'on avait trouvé s'adressait aux élèves français de la métropole. Bref, il n' y avait pas eu de manuels adaptés aux petits Indochinois dont les ancêtres n'étaient pas les Gaulois. En 1925, L'imprimerie d'Extrême-Orient a sorti 80.000 livres de lecture pour le Cours enfantin. Cet effort se poursuivit jusqu'à la fin de la décennie. En 1929, rien que pour les trois Cours du primaire, et toutes disciplines confondues, le nombre de publications atteignait presque trois millions; l'année d'après, il frôlait les cinq millions. Ces outils pédagogiques étaient préparés et rédigés d'abord en français sous la vigilance de la Commission de réception et des administrations locales avant d'être traduits en quôc ngu. Parallèlement à cette action, la Direction de l'instruction publique éditait le Bulletin général de l'instruction publique destiné au corps enseignant qui y trouverait des leçons-types. La revue en bilingue Hoc bao (Journal pédagogique), éditée par les Services locaux, a aussi fait son apparition au Tonkin.
B. QU'AS-TU APPRIS A L'ECOLE ?
Au-delà de l'instruction proprement dite, l'Ecole comme institution véhiculait aussi un certain modèle d'élève, une certaine idée de la modernité concernant le corps, à commencer par la coiffure. Traditionnellement, les Vietnamiens, de l'enfant au vieillard, portaient les cheveux longs noués en chignon qui représentait avant tout le symbole de la piété filiale. Cette manière de se coiffer ne convenait plus à l'esprit de l'Ecole, laquelle n'y voyait apparemment que sa fonction liée au corps. Nguyên Vy, homme de lettres et journaliste, apporte à cet égard un témoignage saisissant dans son ouvrage intitulé Tuân, chàng trai nuoc Viêt (Tuân, jeune homme du Viêtnam) 1 . L'événement s'est produit à la rentrée de l'année scolaire 1911-1912 dans une petite province du Nord. Le petit Thanh, âgé d'environ 12 ans, se rendit pour la première fois à l'école et le directeur lui donna la première leçon:
Tu dois te faire couper les cheveux. Ne garde plus le chignon et le turban sur la tête. Une fois que tu auras la coupe "carrée", l'Etat te donnera un chapeau blanc.
Ayant appris les recommandations de l'école, le père du petit écolier, un notable du village, consterné, s'est mis dans tous ses états:
Dans la tradition annamite, les enfants doivent garder les cheveux (longs). C'est le symbole de la vénération et de la piété envers les parents. Se couper les cheveux signifierait renoncer à ses parents. J'ai cinquante ans et je garde encore les cheveux alors que tes grands-parents ne sont plus là. Aujourd'hui, tu veux te faire couper les cheveux de mon vivant? (...) Tu diras à l'école ceci!
Après cette réplique, et le père et la mère et l'enfant se mirent à pleurer. Bref, se couper les cheveux constituait un véritable blasphème au respect de la tradition. Mais devant le règlement prescrit par l'école, le père du jeune Thanh consentit, la mort dans l'âme, à couper les cheveux de son enfant. Cet acte symbolique ne se passait pas d'un rituel explicatif. Le père prépara ainsi des offrandes composées de feuilles de bétel, du noix d'arec, d'un régime de bananes et d'un poulet cuit, aux ancêtres pour leur demander le pardon. Après avoir allumé des bâtons d'encens il adjura devant l'autel:
Aujourd'hui, le fils ingrat, Lê van Thanh, obéissant aux ordres du mandarin doit se faire couper les cheveux pour pouvoir aller à l'école 1.
Ainsi, la confrontation de la tradition avec la modernité était déchirante. Placée dans ce contexte, la tradition n'avait pas d'alternative, elle devait se soumettre ou se démettre. Mais on pourrait se demander si l'Administration a établi ce règlement en toute conscience de ces risques d'affrontement ou par pure volonté d'uniformisation vestimentaire. De toute manière, on voit mal un maître se comporter en égal de son esclave. C'est le plus faible qui doit admettre les "valeurs" du plus fort s'il veut éviter des répressions ou des affrontements, et surtout quand il n'a pas les mêmes armes pour s'affirmer.
Comme l'enseignement servait aussi à faire passer les idées de la France coloniale, à faire admettre la présence française comme une oeuvre bienfaitrice et non comme un acte de violation de l'espace d'un autre peuple, il fallait que les petits Vietnamiens fussent instruits dans ce sens. Un coup d'oeil sur les "leçons de morale" enseignées en Cours supérieur de l'année scolaire 1924-1925, d'après la réforme, nous ramène à cette réalité historique. Parmi les thèmes généraux comme Devoirs envers les autres, Devoirs envers le corps, L'alcoolisme, dangers de l'opium, de l'abus du tabac, Le jeu, effets funestes da la passion du jeu, L'usure, les dettes, L'épargne et l'économie, Le travail manuel: honorons tous les travailleurs, La dignité humaine, Le respect de soi-même, La justice, etc., s'en sont glissés d'autres à caractère colonialiste. Ainsi le programme du mois de mai, le dernier mois de l'année, comporte les thèmes suivants: "Devoirs envers la France, L'impôt, Respect des lois, Affection et reconnaissance. Dans le "résumé" de Devoirs envers la France, nous pouvons lire ces lignes évocatrices:
L'oeuvre française dans notre pays est immense. Grâce au développement intellectuel et matériel, à la prospérité commerciale, industrielle et agricole qu'elle nous apporte, l'Indochine française devient un des grands pays de l'Extrême-Orient. Ces bienfaits nous créent des obligations envers la France. (...) D'autre part, nous nous soumettrons aux lois, nous payerons régulièrement l'impôt, et nous aimerons la France comme notre seconde patrie". Et la leçon se termine par la maxime "Tout homme a deux patries: la sienne et la France" 1.
Parmi les bienfaits de la France, on citait les grandes et nobles idées de liberté, d'égalité, de fraternité, ce qui entraînait d'importants devoirs envers la France. L'emprunt habile du proverbe vietnamien "En mangeant le fruit, on se souvient du jardinier" (an qua nho ke trông cây), servait de maxime pour la leçon. Bref, se montrer reconnaissant envers un bienfaiteur, c'est prouver qu'on est digne de sa bonté, maxime de la leçon sur l'affection et la reconnaissance.
La leçon sur "L'impôt" rappelle que: "Les fraudeurs, les contrebandiers d'alcool, frustrent le pays d'une somme qui lui est nécessaire, ils gagnent au détriment de leurs compatriotes. La loi les punit avec raison. Profiter des impôts sans vouloir en payer sa part selon ses moyens, c'est une injustice et une lâcheté". La leçon se termine aussi par une maxime: "Voler l'Etat, c'est voler tout le monde 2". La leçon d'après explique le rôle de la loi qui est parfois dure, mais c'est la loi.
Cet agencement n'a pas laissé de place au hasard. Si ces leçons de morale arrivaient en fin d'année scolaire et en fin de cycle primaire c'est sans doute pour deux raisons. Comme les enfant commençaient à aller à l'école, au plus tôt, vers l'âge de sept ou huit ans, à la fin du cycle primaire, ils auraient quatorze ou quinze ans. C'est l'âge où on commence à s'intéresser au monde extérieur, à se poser des questions, donc c'est le moment opportun pour les "maîtres" de faire germer certaines idées chez leurs élèves. D'autre part, la fin d'année du Cours supérieur servait aussi de transition à un autre cycle, le secondaire, où l'enseignement se faisait intégralement en français; c'était donc une façon de préparer les jeunes à un autre univers dans lequel le rôle de la France et ses valeurs formaient le tronc commun de l'enseignement.
Par ailleurs, ces leçons de morale étaient soutenues par des cours d'histoire qui marquaient la fin du premier degré. En effet, au programme du mois de mai du Cours supérieur figurait, à la quatrième semaine, Oeuvre de la France en Indochine qui venait clore la partie Histoire d'Annam. Quant à l'Histoire de France, elle se terminait dans la même semaine par Le loyalisme des colonies françaises. La concentration de ces thèmes, à la fois en histoire et en morale, sur le mois de mai et surtout sur la dernière semaine de cours ne constituait-elle pas un certain "bourrage de crâne" ?
Nous avons signalé plus haut que les matières à caractère scientifique (il fallait les comprendre au sens large, toutes celles qui n'existaient pas dans l'enseignement traditionnel) occupait une plage prépondérante dans le cycle secondaire. Non seulement les disciplines comme l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, la physique, la chimie, les sciences naturelles et la géographie, constituaient en elles-mêmes une innovation dans l'enseignement, mais elles faisaient aussi appel à une nouvelle méthode pédagogique, à de nouveaux outils intellectuels, inconnus jusqu'à cette date des Vietnamiens. En effet, ces derniers devaient désormais passer de la méthode "apprendre par coeur" à une autre qui demandait à la fois le sens de l'observation, l'esprit d'analyse, le raisonnement logique et l'esprit critique, éventuellement. Ce passage ne s'effectuait pas sans un effort d'attention qui faisait défaut, d'après les enseignants français, chez la plupart des élèves. Dans un article sur L'enseignement des sciences, le directeur du Lycée franco-chinois de Cho lon, L. Charvet, exposait son point de vue:
Un enseignement scientifique bien compris doit tendre surtout à donner au disciple l'habitude de l'observation. (...) On commencera d'abord par poser à l'enfant des questions très simples, par exemple: avez-vous songé à observer combien il y a de fenêtres, de tables dans cette salle? (....)
En même temps que l'esprit d'observation, nous devons chercher à développer chez nos élèves l'esprit critique. (...) Le raisonnement scientifique fait ressortir des dépendances réciproques des choses; il nous fait remonter des effets aux causes, comparer entre elles des expériences pour en dégager les principes; puis, des principes, déduire les lois et les hypothèses qui les appuient; à ces lois correspondent des expressions analytiques que les mathématiques nous permettent de développer et d'appliquer à des cas particuliers et, par là, nous redescendons des causes aux effets, des lois aux expériences et c'est ainsi que nous vérifions nos lois et que nous voyons le degré de certitude de nos principes 1.
Dans la deuxième partie de cet article, notre directeur mettait en garde l'excès de la conscience professionnelle en ces termes :
N'oublions pas que nos disciples ne doivent pas être des techniciens et qu'ils doivent plus simplement comprendre les grandes lois naturelles de façon à voir leurs applications dans la vie courante et à se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux; montrons l'esprit des méthodes plutôt que les détails d'exécution. (...) Il ne faut pas trop chercher la précision, ni prétendre initier les élèves aux secrets du métier, car, encore une fois, nous ne devons pas former des techniciens 1.
Mais pour conclure, l'auteur de ces lignes s'intéressait également à une certaine morale:
Enfin, notre enseignement doit avoir un côté moral, nous devons montrer que toutes ces découvertes que nous exposons, dont nous profitons, sont dues à la patience admirable et au labeur acharné de nos savants. (...) Nous devons susciter chez nos élèves non seulement une sincère reconnaissance mais encore une profonde admiration pour la grandeur morale dont les savants font preuve par leur dévouement à la science. (...)
L'enseignement "franco-indigène", à cet égard, touchait à un point important dans la formation de l'esprit car il allait droit au coeur du l'univers mental des Vietnamiens. L'apprentissage d'une nouvelle méthode de penser, de réfléchir, à partir d'éléments nouveaux devait provoquer, sans doute, des désorientations, des remises en cause de tout ce qui était tenu pour acquis jusqu'alors chez l'étudiant. Cela est d'autant plus plausible que durant les trois premières années du cycle primaire, l'enseignement des caractères chinois, réduit certes à une heure par semaine, faisait encore partie du programme. Quand on sait que l'apprentissage de ces caractères avec la méthode traditionnelle mobilisait surtout la mémoire, on ne s'étonne pas que les élèves préféraient "apprendre par coeur" leurs leçons plutôt que les comprendre. Cette préférence était tellement ancrée dans l'esprit des Vietnamiens qu'ils accueillirent avec un certain enthousiasme la parution du manuel Phap tu diên âm ca (Prononciation du vocabulaire français) aux environs de 1910. L'auteur, un certain Nguyên Ngoc Xuân, empruntait la méthode, jadis employée pour apprendre les caractères chinois, du manuel Tam thiên tu (Les trois mille mots). Le principe consistait à transcrire la prononciation d'un mot français, suivie de son orthographe mise entre parenthèses, puis de sa signification, de telle sorte que la succession des mots devînt des vers de six et de huits pieds, la forme la plus connue de la poésie vietnamienne. Par exemple, le manuel débute par:
" Pe-ro (père) tiêng goi là cha,
Me-ro (mère) là me ông bà e-o (aïeux)".
Il suffit de remplacer ces mots français par les caractères chinois et on retrouve la version originale de Tam tu kinh :
" Thiên ( ) troi, dia ( ) dât, vân ( ) mây,
Vu ( ) mua, phong ( ) gio, tru ( ) ngày, da ( ) dêm.
Il s'agit d'une méthode mnémotechnique composée de deux fascicules: le premier regroupe les mille mots usuels de la langue française, et le deuxième s'adresse à un niveau plus avancé puisqu'il comporte du vocabulaire technique classé par centres d'intérêt (croyances, progrès, qualités morales, professions, agriculture, produits chimiques, industrie, commerce, transport, etc.). Malgré son imperfection, cette méthode aurait connu un certain succès puisque l'éditeur l'a rééditée au moins quatre fois, 40.000 fascicules en 1918. En 1916, pour répondre aux besoins du contingent d'ONS (ouvriers non spécialisés) 1 envoyés en France pour servir la "Mère-patrie", 25.000 exemplaires de plus que son tirage prévu étaient sortis des presses. La Bibliothèque nationale de Hà nôi doit se contenter de l'édition de 1927 pour le premier fascicule, et de celle de 1918 pour le deuxième 2.
L'enseignement moderne, malgré ses limites, aurait dépassé ses propres objectifs puisque ses effets se faisaient sentir dans la société vietnamienne de l'Entre-deux Guerres. Au-delà de l'instruction proprement dite, il véhiculait en même temps la culture matérielle occidentale représentée par les progrès scientifiques et techniques et à un moindre degré par la supériorité de l'arsenal de guerre qui avait permis aux conquérants de s'imposer. Un de ces effets s'est traduit par la prise de conscience du monde moderne, par la prise en considération et la reconnaissance de l'Occident comme une force. Ce pas ne pouvait être franchi sans remettre en cause le fonds culturel traditionnel qu'incarnaient les vieux lettrés de la vieille génération qui s'obstinait à rejeter les idées de la modernité.
C. LA RUPTURE.
Grâce à la formation de base acquise à l'école franco-indigène, la nouvelle génération a découvert certaines idées de la modernité sous-jacentes à l'enseignement: l'idée du progrès (scientifique et social) d'une part et les idées politiques modernes d'autre part; ce qui a donné, sans doute, naissance par la suite à deux courants, non antagonistes en soi, mais deux choix politiques différents qui viendraient s'affirmer dans les années 1930, l'un révolutionnaire et l'autre réformiste. On peut considérer que cette rupture était amorcée par le Dông kinh nghia thuc fondé en 1907. Le rôle qu'a joué le quôc ngu dans cette rupture n'était, certes, pas déterminant, néanmoins, on peut attribuer à cette nouvelle transcription de la langue vietnamienne le rôle de facilitateur dans les transformations sociales et culturelles. Le quoc ngu présente effectivement des avantages manifestes par rapport aux idéogrammes chinois: acquisition rapide au bout de quelques mois pour un Vietnamien, effort de mémoire réduit, diffusion élargie possible sans recourir aux grands moyens, apprentissage autodidacte sans grande difficulté. Cette adoption d'une nouvelle écriture pour la langue maternelle allait marquer une époque, une nouvelle génération qui ne s'intéressait plus aux caractères chinois, lesquels véhiculaient les principes confucéens délaissés à leur tour par la génération montante. Puisque la langue constitue une identité culturelle, réflète tout un système de concepts, formalise le fonctionnement du mental de chaque peuple, l'écriture qui y contribue occupe une place déterminante. Du point de vue du docteur Pierre Huard, la langue "se compose de deux éléments imbriqués l'un dans l'autre, mais que l'analyse peut dissocier: les images acoustiques et les concepts. Acquérir les images acoustiques sans s'approprier des concepts dont elles sont le véhicule, serait se condamner à ne point comprendre le peuple dont on étudie la langue. (...) Chaque langue a une structure particulière, en rapport étroit avec la mentalité de ceux qui la parlent 1 ". En dépit de nombreux emprunts au vocabulaire chinois, surtout dans les domaines philosophique et littéraire, le vietnamien et le chinois ne font pas partie ni de la même famille ni du même groupe linguistiques. Cependant, l'usage quasi-exclusif des caractères chinois au Vietnam, jusqu'à l'aube du XXe siècle, a façonné les Vietnamiens selon le monde chinois avec sa philosophie, sa morale et son modèle d'organisation sociale, du moins chez les classes dirigeantes. L'écriture chinoise forme un système complexe qui dépasse l'appellation courante d'idéogramme. En effet l'analyse linguistique permet de distinguer dans ce système cinq classes différentes:
- la représentation figurative, consiste à "noter" la forme des objets inanimés; par exemple, des caractères (porte), .....(montagne),(soleil);
- le symbole, c'est la notation d'une idée abstraite : .....(trois), (empereur);
- le complexe logique, sert à combiner deux ou plusieurs caractères dont le sens de chacun d'eux contribue à exprimer l'idée voulue. Par exemple :
* (clarté), est formé d'une part de (soleil) et d'autre part de (lune). Dans cet esprit, la combinaison du "soleil" et de la "lune" donne la clarté permanente, puisque le soleil éclaire le jour et la lune éclaire la nuit.
* (civilisation), formé de (clarté) et de (Lettres);
- le complexe phonétique;
- l'emprunt homophonique 1.
Le quôc ngu, quant à lui, transcrit les mots à l'aide de l'alphabet latin qui forme un tout autre système, notant uniquement les sons des mots d'une langue. Par conséquent, le sens ou le symbole intégrés ou cachés, dans les caractères chinois, restent une autre affaire, dans ce système, qu'il faut aller chercher ailleurs que dans les mots eux-mêmes. Par exemple, la "forêt" se dit en vietnamien rung ou en sino-vietnamien lâm et qui s'écrit. Ce caractère est formé par la juxtaposition de deux caractères identiques qui signifient "arbre". On voit dans cette construction une logique: plusieurs arbres forment la forêt, ou autrement dit, la forêt est formée de plusieurs arbres. En revanche, si on écrit lâm ou rung à l'aide des caractères latins, cette logique infuse disparaît, il ne reste plus que l'écriture qui représente ce mot car son sens a disparu, et pour le retrouver, il faut passer par une deuxième étape: la recherche du sens. On retombe ici sur le problème commun de toutes les langues transcrites par l'alphabet latin ou par un autre système similaire: savoir lire un mot ne veut pas dire connaître son sens; seul l'emploi répétitif permet de le fixer dans la mémoire. Quoique la mémoire ou à l'inverse, l'oubli, qui mettent en jeu d'autres mécanismes mentaux dont l'affectif, restent encore difficiles à saisir. La substitution d'une écriture à une autre, en l'occurrence, le quôc ngu aux caractères chinois, provoque sans doute des désorientations dans l'apprentissage de la langue; ceci est d'autant plus grave que ces deux systèmes tendaient, dans le contexte historique du Vietnam au début du siècle, à s'exclure l'un l'autre (conflit sur le plan social, politique ou culturel, intériorisé par les individus).
L'apprentissage de la langue maternelle, par le biais de l'écriture latine, et celui du français, prédominant dans l'enseignement, repoussent de fait les caractères chinois et tout ce qu'ils véhiculent aux oubliettes. On comprend alors pourquoi les lettrés, pour qui les caractères chinois représentent leur identité culturelle, leur morale, leur philosophie, bref, leur système de valeurs, voire celui du peuple tout entier, ont contesté jusqu'au début du siècle le quôc ngu, considéré comme un instrument de neutralisation du passé culturel, et ont résisté à l'adopter comme l'écriture nationale. Mais cette résistance a fini par s'affaiblir, laissant ainsi la voie ouverte à cette transcription pour se propager dans la société. En réalité, ce retournement de situation n'allait pas de soi, car les lettrés les plus ouverts au changement ont décidé de plein gré de s'adapter au nouveau contexte politico-social. Convaincus des avantages manifestes du quôc ngu, et profitant du balbutiement des réformes scolaires qui ne pouvaient pas encore répondre aux besoins de l'enseignement, ils s'emparaient du quôc ngu pour en faire un instrument de libération du vieux monde désuet, un outil permettant d'acquérir de nouvelles connaissances venues de l'Occident. Bref, cet outil servait de tremplin vers une vie moderne, vers une société moderne. Ces intentions affichées se sont traduites par des actions du Dông kinh nghia thuc qui cherchaient à mobiliser la population et l'encourageaient à apprendre le quôc ngu.
Le Dông kinh nghia thuc est un mouvement patriotique qui, fondé en mars 1907 à Hà nôi, par Luong Van Can et Nguyên Quyên, sous la couverture d'un établissement d'enseignement mutuel, regroupe des lettrés en rupture de ban avec l'enseignement traditionnel. Nguyên Van Vinh, de formation semi-moderne, et homme de "confiance" de l'Administration figure dans la liste des membres fondateurs sans jouer un rôle majeur. L'ouvrage fondamental du mouvement, Van minh tan hoc sach (Manuel moderne de la civilisation), affiche les six objectifs à atteindre:
- employer le quôc ngu;
- revoir et corriger les manuels d'enseignement;
- réformer les concours;
- promouvoir les talents;
- rénover l'industrie;
- et développer la presse.
Cette école, qui dispense un enseignement gratuit, réparti en cours du jour et cours du soir afin de permettre à toutes les classes d'âge de les suivre, attire des milliers d'auditeurs. L'"Ecole" bénéficie de son influence dans certaines provinces limitrophes de Hà nôi par l'implantation des sections locales. Cette volonté de transformer la société vietnamienne en une société moderne par la voie pacifique et culturelle, doublée d'une détermination cachée de lutter contre le colonialisme, a valu au Dông kinh nghia thuc la fermeture de son "Ecole" par les autorités coloniales en décembre de la même année. Luong Van Can, Nguyên Quyên, Duong Ba Trac et quelques autres leaders ont été arrêtés, les manuels et documents, saisis et leur propagation interdite.
En dépit de cette brève existence, ce mouvement de pensée a essayé de rattraper le train de la modernité en popularisant et vulgarisant les connaissances. Cependant, le dernier wagon rattaché à la locomotive était encore chargé de nostalgie du passé. La rupture ne faisait que commencer à cette date, en effet, le titre, sur la couverture du manuel de base de cette "Ecole" 1, portant le même nom que le mouvement (Dông kinh nghia thuc), était écrit en quôc ngu et en caractères chinois, par ailleurs, l'"Ecole" dispensait encore des cours de caractères chinois. Ce manuel, entièrement rédigé en quôc ngu et à la main, comportait 19 leçons composées en vers, appelées "chansons" (bài hat), et la table de multiplication, sans parler des quelques pages d'initiation à la lecture. On remarque au passage que les signes de ponctuation n'avaient pas encore d'appellation en vietnamien, ainsi les auteurs se contentaient de transcrire leurs noms à partir du français.
Les thèmes abordés dans ces "chansons" ont avant tout pour vocation émancipatrice, pour but de réveiller la conscience collective, de sensibiliser le peuple à prendre conscience de l'état politique et social du pays. Si on s'arrête aux titres, sur les 19 "chansons", trois ont une résonnance patriotique, et les 16 restantes évoquent des problèmes de société, dont trois parlent de la famille (conseils aux femmes, aux enfants, aux maris); trois autres, de la jeunesse; quatre, des vices (opium, alcool, jeu, femmes); deux, des bonzes. Cette disproportion entre les "chansons" à caractère politique et celles à caractère social s'explique, sans doute, par la semi-clandestinité de ce mouvement politique qui devait se doubler d'une couverture sociale pour pouvoir exister légalement. L'intention des fondateurs de cette "Ecole" s'affiche dès la première "leçon", intitulée Bài hat khuyên hoc chu quôc ngu 1 (Chanson conseillant d'apprendre le quôc ngu). Les premiers vers d'introduction incitent les jeunes garçons à faire de leur pays une image reconnue, lui trouver une place respectable dans le monde:
Étant garçon dans ce monde,
(Il faut) faire en sorte que le pays soit reconnu.
Un peu plus loin, le thème central apparaît avec détermination; le quôc ngu permettrait d'entrer en contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire les pays lointains, un moyen, par la même occasion, d'atteindre le progrès:
Le quôc ngu est l'âme du pays,
Que le débat soit porté sur le plan national.
Les livres des différents pays, ceux de la Chine,
Seront traduits clairement mot à mot.(...)
Quand les intérêts et les droits seront dans nos mains
Un jour viendra, avec le progrès et la civilisation.
Et la "chanson" se termine par une allusion à l'indépendance:
Le son de cloche annonçant l'indépendance résonnera en
discours.
Effectivement, il fallait avoir du courage pour oser évoquer l'idée de l'"indépendance" dès cette époque. Ce terme faisait partie des mots tabous que même la nouvelle génération engagée politiquement évitait, par peur de répression, d'employer explicitement. A une autre échelle, faut-il rappeler qu'au début des négociations franco-vietnamiennes dans la période 1945-1946, Hô Chi Minh lui-même, n'a pas parlé de l'indépendance mais de l'autonomie; même si on attribue cela à la souplesse et à l'habileté de "l'oncle Hô", le fait n'en est pas moins là.
Quant à la deuxième "leçon", malgré son titre évocateur de "chanson patriotique" (Bài hat yêu nuoc), son contenu et son ton restent neutres. Il n'était question ni de révoltes, ni de désobéissance civique, ni de haine ; la France comme puissance dominatrice n'y a même pas été évoquée. Après avoir fait l'inventaire sommaire des richesses et des avantages du pays, la chanson se termine par un vers qu'on ne peut vraiment pas qualifier de subversif:
(Il faut) être patriote pour être digne d'être vietnamien 1.
Si l'idée d'incitation à la révolte est absente dans cette chanson, on la retrouve pourtant, certes diffuse, implicite et encore timide, dans bien d'autres "chansons" dont le titre n'a rien à voir avec cette idée. Ce procédé constitue, sans doute, une clef, un secret qu'il fallait détecter pour saisir l'idée essentielle exprimée à travers ces "conseils". Le secret, dans ce cas, n'est rien d'autre que la métamorphose de la contrainte subie, l'impossibilité d'exprimer ouvertement les idées sans risque de répression; ce même procédé a permis au Dông kinh nghia thuc d'exister légalement. Une fois qu'on aura saisi cette clef, on comprendra que les différents thèmes traités ne servent que de prétexte pour faire passer l'idée du patriotisme, du devoir d'un homme dans un pays colonisé; bref, un des buts de ces "chansons" consiste à réveiller la conscience nationale. Ainsi, dans Les conseils de la mère à l'enfant, plus précisément, à son fils, on trouve les vers suivants:
En tant que garçon de qualité, on aime son pays et on oublie sa famille,
Quand le pays sera libéré, la famille aura sa paix 1.
Bien que moins explicite, "la femme" n'oublie pas d'évoquer le patriotisme dans "Les conseils à son mari":
Sois utile à la patrie, à la famille.....
Fais en sorte que le Lac hông soit célèbre 2.
Ainsi, on retrouve aussi sans surprise cette idée diffuse dans "Les conseils aux bonzes":
La pagode Civilisation (souligné par nous) est fondée,
Le pont Liberté (souligné par nous) rassemble déjà
beaucoup de monde...
Brûlons ensemble les bâtons d'encens,
Autonomie, Indépendance, c'est la vraie voie religieuse 3.
Un peu plus loin, il est aussi question de solidarité, d'un appel à la population, que les uns rassemblent les forces, les autres, les contributions. Il s'agit, sans doute, d'un appel déguisé à se joindre au mouvement par des contributions dont parlait Parera, l'Administrateur-Chef de cabinet. Dans une lettre marquée du sceau "très confidentiel" de la Résidence supérieure du Tonkin, du 6 décembre 1907, adressée aux Résidents-chefs de province, Parera écrit:
On m'a, d'autre part, signalé que certaines sociétés, sous le masque officiel de l'assistance mutuelle ou de l'enseignement, se livraient à une active propagande dirigée contre nous. Réunions et commentaires des brochures à "double sens".
Chaque affilié serait invité à rechercher des adhérents et verserait même, comme preuve de sa sincérité, 2 ou 3 $ par adhérent promis.(...) Ces chefs de groupe auraient des signes de ralliement et des termes conventionnels.
De nombreuses présomptions et certains faits, qui font actuellement objet d'une enquête, permettent de croire que le "Dông kinh nghia thuc" dont l'école à Hà nôi vient d'être fermée, est un des principaux centres de propagande 1. (...)
Dans la deuxième "chanson" adressée aux bonzes, on retrouve effectivement la même évocation patriotique:
Cette fois, je me coupe les cheveux pour me faire bonze,
Je fais la prière Indépendance à la pagode Duy Tân...
Etre bonze pour que le pays soit prospère et puissant,
Le coeur sincère, j'allume de l'encens,
Et prie le bouddha fondateur du Hông bàng d'en être
témoin 2.
On ne peut être plus clair. Dans cette "chanson", les auteurs ont vidé le contenu à caractère religieux pour lui en substituer un autre à caractère politique tout en gardant la forme d'une prière. Duy Tân fait allusion au mouvement de même nom, fondé par Phan Châu Trinh en mai 1906, sous la présidence du prince rebelle, Cuong Dê; l'appel à la rébellion devient ici plus implicite. L'emploi du terme "bouddha" peut être interprété de deux manières, soit pour garder une apparence de prière, dans ce cas, son usage devient complètement abusif, soit on a érigé le fondateur de la dynastie légendaire Hông bàng en bouddha, ce qui viendrait sacraliser cette dynastie, considérée comme une référence de l'identité nationale. La deuxième interprétation semble plus plausible, car elle a l'avantage de s'adresser à la fois aux croyants et aux non croyants pour les mobiliser tous autour de la solidarité. Le recours à l'histoire du pays, à ses pages héroïques, vient compléter cette idée de solidarité, sensibiliser et exalter le sentiment national face à la domination et aux invasions étrangères. Ceci constitue le thème central de la "chanson traçant l'état du pays" 1.
Sur le plan social, le rôle de la femme est aussi évoqué dans une "chanson" sous le titre de Conseils aux femmes". Ceci reflète une véritable évolution de l'esprit, évolution d'autant plus significative que les auteurs étaient des lettrés formés à l'ancienne école, laquelle n'accordait aucun rôle social particulier à la femme. La "leçon" débute par Dans le monde, le yin et le yang font un. Yin et Yang ici désignent respectivement l'homme et la femme. Ces auteurs reconnaissent dans la suite de la "leçon" qu'il ne faut pas considérer que les femmes sont démunies sur le plan intellectuel; la faute en incombe aux hommes eux-mêmes, qui ne les ont pas éduquées dans le sens du bien. La "chanson" conseille ensuite aux femmes de cesser de voir les petits intérêts immédiats et personnels au profit de l'intérêt général: Quand le pays n'est plus, qu'est-ce qu'il reste dans la maison? 1 Bien que significative, l'évolution a ses limites. Dans la "chanson" traitant des "femmes" en tant que vice, cette génération de lettrés n'a pas complètement rompu avec la morale confucéenne, puisque les "trois principes" (tam cuong) et les "cinq vertus" (ngu thuong) demeuraient, pour eux, la seule voie juste qui permettrait d'éviter ce vice 2.
Par ailleurs, les auteurs de ce manuel conseillaient aux jeunes de partir à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, les pays de la civilisation, pour s'instruire, puis de rapporter des connaissances, des techniques, mais aussi la liberté et l'égalité. Ceci constitue le thème central des "chansons" sur les jeunes, sur le voyage à l'étranger et sur le rôle des journaux 3.
S'il faut qualifier l'attitude de cette génération de lettrés devant les valeurs anciennes, on dirait alors qu'ils avaient une attitude "mi-figue mi-raisin". Ils étaient, à la fois, pour la modernité et sans vouloir rompre les amarres avec les valeurs traditionnelles confucéennes; cet état d'esprit s'est traduit par leur prise de position sur la question de la femme. Oui à la femme moderne, mais qu'elle ne dépasse pas le cadre de la morale ancienne. Pour ce qui est du monde moderne avec sa culture matérielle, là, il n'y avait aucune ambiguïté de leur part. L'Europe et les États-Unis étaient maintes fois évoqués et pris comme modèle de développement pour le pays. Les techniques modernes, fruit de la science, ont attiré leur attention. Leur espoir ? De voir un jour les jeunes revenir de l'Occident avec pour bagages, des connaissances modernes, des métiers modernes, puis de les voir fonder des écoles afin de propager le nouveau savoir, le nouveau savoir-faire. Enfin, un symbole de ce ralliement à la modernité matérielle est la coiffure, ces lettrés se sont résolus à abandonner leurs cheveux longs au profit de la coupe occidentale. Pour cette génération, l'échelle des valeurs s'est renversée. Pour la plupart des gens encore, si les cheveux longs symbolisaient la piété filiale ils devenaient, pour eux, le symbole de l'ignorance; se couper les cheveux signifiait ainsi jeter l'ignorance dans la corbeille.
La main gauche tient le peigne,
La main droite, les ciseaux,
On coupe! on coupe!
Abandonner cette ignorance,
Abandonner cette bêtise.
On dit la vérité,
On apprend le nouveau, désormais. 1
Comment cette évolution a pu s'opérer, pourquoi ce ralliement de ces lettrés à la modernité à une date relativement avancée pour la société vietnamienne ? Un retour au contexte historique permettrait d'en dégager des facteurs, des éléments qui ont précipité cette évolution, et de comprendre leur articulation. La naissance de ce mouvement est précédée par toute une série d'événements et de troubles politiques. A la mort du roi Tu Duc, le 17 juillet 1883, qui n'avait pas de descendant, survinrent des querelles de cour sur la nomination de son successeur. Le pouvoir apparent était dans la main du conseil de régence dont faisait partie Tôn Thât Thuyêt, ministre des Armées, l'homme le plus influent, hostile à la présence française. Un mois après, fut signé le "traité de paix" du 25 août, ratifié par celui du 6 juin 1884 entre les représentants de la France et la Cour de Huê, qui reconnaissait le Protectorat français sur l'Annam. En désaccord avec cette idée de soumission, le ministre Thuyêt organisa la résistance et fit attaquer la garnison française dans la nuit de 5 juillet 1885. Mais le général De Courcy, muni des pleins pouvoirs pour mettre en place le Protectorat, envoya ses troupes et fit repousser la résistance vietnamienne. Tôn Thât Thuyêt, voyant la situation devenir critique, prit alors la fuite avec son jeune roi Hàm Nghi, âgé de 13 ans. Cet événement a donné naissance au mouvement Cân vuong (Royalisme) qui regroupait les mandarins de la Cour et des lettrés hostiles au Protectorat, sans pouvoir renverser la situation. Parallèlement à ce mouvement d'obédience royaliste, les révoltes anti-françaises faisaient irruption un peu partout, surtout dans le Centre et au Nord. Les plus représentatives, les révoltes de Yên thê (1885-1913), étaient menés par Hoàng Hoa Tham dit Dê Tham, traité de "pirate" par les autorités coloniales. Il s'appelait, de son vrai nom, Truong Van Tham et, issu d'une famille de paysans, il était originaire de Hung yên qu'il a quitté pour Son tây avant de s'établir à Yên thê, une localité de Bac ninh, point de départ de ses révoltes. Officier de l'armée royale, Tham bénéficiait de la confiance des paysans qui l'ont rejoint dans cette résistance armée. Il a réussi à repousser plusieurs fois l'armée d'occupation française et a fait prisonnier Chesnay, le propriétaire foncier gérant du journal L'avenir du Tonkin. La remise en liberté de Chesnay en échange d'une somme de 15.000 $ annonça une trêve d'une année entre les belligérants 1.
Cette période de troubles prit fin petit à petit avec l'arrivée de Paul Doumer en 1897 à la tête du gouvernement général. Celui-ci a assuré les autorités en Métropole que la "pacification" était arrivée à son terme. Désormais l'Indochine était placée sous le régime d'administration directe, ce qui a réduit la marge de manoeuvre du mandarinat. L'oeuvre de Doumer, sans parler de la restructuration des Services publics, se concentrait surtout dans le domaine des Travaux publics: constructions des voies ferrées, des ponts dont un portait son nom, l'actuel pont Long biên à Hà nôi. Cette modernisation se poursuivait avec l'arrivée de son successeur, Paul Beau, en 1902, qui gouverna la Colonie jusqu'à 1907.
La période qui va de l'arrivée de Paul Doumer (1897) jusqu'à la Première Guerre mondiale (1917) est qualifiée aujourd'hui par les historiens de Hà nôi de Première exploitation coloniale. L'exploitation des ressources économiques implique des investissements en vue de la mise en valeur de la Colonie par la création d'infrastructures, par l'appropriation de moyens de production et le contrôle des forces productives; bref, la mise sur pied du tissu économique tout entier pour qu'il puisse s'intégrer dans le circuit des échanges mondiaux, car à l'époque tout reste à faire dans ce domaine. Ce nouveau paysage du capitalisme naissant en Indochine ne se dessine pas sans provoquer des interrogations chez les colonisés. L'échec du royalisme, face aux forces coloniales appuyées sur leurs bases politiques mais aussi économiques, laisse la voie ouverte aux lettrés patriotes à la recherche d'une autre solution adaptée à la nouvelle situation. Un appel d'air semble nécessaire, ainsi leur regard se tourne dorénavant vers l'extérieur, vers un pays non colonisé, moderne et suffisamment fort, susceptible de mettre en échec l'entreprise coloniale. Le modèle japonais, à cet égard, répond à ces critères: c'est le point de vue de Phan Bôi Châu qui prône la lutte armée et le progrès sans remettre vraiment en cause la monarchie. D'après ses écrits vers 1907, il était question d'un Parlement constitué de trois Chambres de représentants qui décideraient du maintien ou de l'abolition de la monarchie 1. Son départ au Japon le 20 janvier 1905 marque le début du mouvement Dông du (Voyage à l'Est) qui va durer jusqu'en 1908. Dông du est l'expression, la mise en oeuvre de Duy tân hôi (Association du Renouveau) sous la présidence du prince Cuong Dê, qui regroupe les lettrés patriotes et progressistes. Ainsi, plusieurs centaines d'étudiants et lettrés gagnés par ce courant de pensée suivent cette voie, avec le soutien d'une fraction des dirigeants japonais, pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques industrielles et d'armement en vue d'un soulèvement général contre le colonialisme. La victoire du Japon sur la Russie en 1905 enflamme bien des Vietnamiens: voilà une nation asiatique plus forte qu'une puissance occidentale! Mais leur enthousiasme ne dure que l'espace d'une illusion. Le victorieux Japon ne trouve pas d'intérêt à soutenir des représentants d'un pays colonisé, et traite les affaires directement avec leur maître. Après un arrangement avec le gouvernement de l'Indochine, le ministère de l'intérieur japonais renvoie en septembre 1908 les ressortissants vietnamiens parmi lesquels figure Phan Bôi Châu. Le bateau de ce périple vers l'Est se heurte ainsi aux frontière du pays du "soleil levant".
Tandis que Phan Bôi Châu prônait la lutte armée en espérant un soutien du Japon, son confrère Phan Châu Trinh envisageait plutôt des réformes culturelles et sociales qui serviraient de base à un soulèvement, lequel ne pouvait constituer que l'étape ultérieure, car d'après lui, la disproportion dans les rapports de force, à l'avantage de la France, interdisait tout soulèvement prématuré; par ailleurs, il désapprouvait aussi l'idée de compter sur un autre pays. Ces deux figures patriotiques du début du siècle se séparent ainsi sur la stratégie à prendre face à l'ennemi. Le mouvement Duy Tân fondé en 1906, incarne cette deuxième voie, laquelle rassemble les inévitables lettrés gagnés à l'idée du progrès dont les plus connus sont Hùynh Thuc Khang et Trân Quy Cap, condamné à mort en 1909. L'arrestation de Phan Châu Trinh et de ses compagnons en 1908, à la suite des mouvements de contestation contre les impôts et les corvées dans la région de Quang nam, Quang ngai, Binh dinh, sonne le glas du Duy Tân. L'année suivante, Phan Châu Trinh et ses compagnons prennent aussi le bateau vers l'Est, mais celui-ci est piloté par un capitaine français en direction du bagne où ils purgent leur peine jusqu'en 1911. Après sa libération, grâce à l'intervention de la "Ligue des Droits de l'homme", Phan Châu Trinh gagne la France où il poursuit des activités politiques en compagnie de futurs leaders des mouvements de libération nationale comme Phan Van Truong, Nguyên Ai Quôc, etc. 1
C'est dans ce contexte de tâtonnements, de recherches de nouvelles idées pour pallier aux anciennes devenues inopérantes, que le Dông kinh nghia thuc a vu le jour. D'inspiration progressiste, ce mouvement bénéficiait des expériences d'autres mouvements de la même époque, des leçons de leur échec, en prenant en compte de nouvelles données politiques, culturelles et sociales. Ses actions, basées sur l'enseignement, devenaient l'expression d'une volonté de changer ce qui lui semblait anachronique et inadapté au nouveau paysage façonné par la colonisation; bref, la remise en cause d'un passé jugé révolu. Si cette tentative de transformer la société a pris forme c'est grâce aussi à un appel d'air de l'extérieur, car les principes fondateurs de la tradition, entendons par là, de la tradition confucéenne, constituaient un système fermé et ne portaient pas en eux de "potentialités alternatives", pour reprendre les termes de Georges Balandier dans Le détour. Cet appel d'air venait paradoxalement d'abord de la colonisation elle-même, et malgré elle, par son entreprise de modernisation: introduction d'un enseignement moderne et adoption du quôc ngu, création des secteurs économiques pour faciliter l'éclosion de l'économie de marché par l'implantation d'un tissu industriel, fondation des centres d'observations et de recherches à caractère scientifique; le mode de vie occidental accompagnait cette présence coloniale. Puis, c'est par les contacts d'une frange de lettrés, à la recherche de nouveaux horizons, avec le monde extérieur, par leur désir de le comprendre et par leur courage à remettre en question le passé, qui était aussi le leur, que cet appel d'air a pu pénétrer dans les milieux progressistes avant d'atteindre la société elle-même. Parmi ces éléments, la rupture avec les valeurs anciennes, une condition indispensable aux transformations, jouait le rôle de déclencheur qui allait entraîner les autres à graviter autour d'elle. Plus concrètement, cette rupture s'opérait par l'adoption du quôc ngu comme écriture nationale, et par effet de boule de neige, cette nouvelle transcription abandonnait les caractères chinois et tout ce qu'ils représentaient à leur triste sort.
A cet égard, le Dông kinh nghia thuc peut être assimilé à un laboratoire qui brasse des idées et des formules qui permettraient de sortir le pays de l'impasse. Or, un passé millénaire ne peut être effacé comme une simple tache d'encre. Les fondateurs de ce mouvement se sont ainsi heurtés à cette force d'inertie qui délimitait leur volonté de changement. Malgré cette limite, sans parler de sa brève existence, le Dông kinh nghia thuc a le mérite d'avoir cherché des solutions de rechange à une société bloquée, bâti les fondations d'une nouvelle école de pensée sur la voie du progrès, éveillé la conscience collective à la mobilisation pour couper court à certains aspects de la tradition arriérée. La fermeture de l'"Ecole" par les autorités coloniales marque la fin de cette tentative, mais les idées semées vont être reprises par d'autres dans les années suivantes.
En l'espace de deux décennies, l'Administration coloniale a procédé à trois réformes de l'enseignement, cependant cette oeuvre ne touchait vraisemblablement qu'une frange des jeunes d'âge scolaire. En 1935, seulement 15 à 20% des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés 1, ce qui représentait déjà un progrès par rapport à la décennie précédente où ce chiffre n'avait pas atteint les 5%. En 1925, "... dans les régions les plus favorisées, l'école reçoit, écrit Pierre Blanchard de la Brosse, directeur de l'Agence économique de Paris, à peine un garçon sur douze, une fillette sur cent, dans certaines contrées, elle ne reçoit pas la vingtième partie de la population d'âge scolaire" 1. Les statistiques officielles de l'année scolaire 1938-1939 n'étaient guère brillantes. Pour tout le Tonkin, il n'existait qu'un établissement secondaire, 8 "Ecoles primaires supérieures" et 2.815 écoles du premier degré, ce qui regroupait respectivement 188, 2.053 et 169.179 élèves 2. Ce faible taux de scolarité signifie sans doute que l'enseignement franco-indigène aurait été dispensé surtout dans les centres urbains; la campagne, de ce fait, aurait été mise à l'écart puisqu'il y avait au Tonkin au moins 10.000 villages contre 2.815 écoles du premier degré à la même époque.
Quoi qu'il en soit, cet enseignement moderne a quelque peu changé la physionomie urbaine de la société, par le port de la tenue occidentale dans les Ecoles dites supérieures, par l'adoption d'un certain mode de vie moderne, par la fréquentation des bibliothèques, ouvertes dans le but de propager la culture française. En 1931, la bibliothèque de Hà nôi possédait 60.000 volumes et celle de l'EFEO, 50.000. Les lecteurs vietnamiens ont emprunté en 1933 à la première 60.775 titres différents dont 40.029 romans et 11.746 ouvrages de fond 3. Ceci sans parler des journaux qui ont fait leur apparition, certes encore timide dans les années 1920, mais qui ont attiré un certain nombre de lecteurs. Là aussi, la portée de cet outil culturel et d'information n'atteignait pas directement la campagne, et ceci pour deux raisons: l'absence d'un réseau de distribution, conditionnée par l'insuffisance des voies et des moyens de communication, et le faible taux d'alphabétisation. Ainsi, la campagne n'était au contact avec la ville qu'à travers ce que rapportaient les nouveaux citadins originaires de la campagne qui faisaient des allers et retours lors des occasions exceptionnelles. Certes, la transmission orale des nouvelles et des connaissances avait son importance mais elle restait limitée.
Sur un autre plan, on peut dire que l'enseignement franco-indigène a dépassé ses propres buts, puisqu'il a contribué d'une façon indirecte mais réelle, à moderniser la société vietnamienne. Mais cette modernisation ne s'est pas faite sans heurts ni sans conflits, car les effets de la modernité touchaient aussi à la conscience, à la mentalité, au mode de vie. Bref, la modernité a traversé tous les champs de la vie. Cependant l'enseignement n'était pas le seul responsable, l'introduction des sciences et des techniques a, sans doute, contribué à précipiter ces transformations.
II. LES SCIENCES ET LES TECHNIQUES
Qu'a apporté la colonisation au Vietnam dans le domaine des sciences? Dans quelle mesure celles-ci constituaient-elles un facteur de progrès pour les Vietnamiens qui les découvraient? Comment cette dimension a-t-elle été intégrée dans leur conception du monde, dans leur société et quels étaient les effets qui en découlaient? Bref, quelles étaient leurs attitudes devant les sciences et les techniques et par quels moyens se les appropriaient-ils, compte tenu du poids de la tradition? L'influence du confucianisme sur la société vietnamienne était-elle responsable de ce retard dans le domaine de la science ? La mentalité propre aux Vietnamiens et l'absence d'une tradition scientifique issue du contexte historique ne constituaient-elles pas manifestement des obstacles à la pensée rationnelle.
Nous essaierons ainsi, dans la mesure du possible, de retracer l'introduction de ces dimensions dans la société vietnamienne pour dégager des éléments de réponse à ces questions.
A. LE PARADOXE DE LA COLONISATION
A en croire Maurice Durand et Pierre Huard, les premiers contacts de la société vietnamienne avec les sciences remontent au XVIIe siècle et ne dépassent pas le cercle restreint de la Cour qui employait des mathématiciens, astronomes, physiciens, géomètres venus de l'Occident. La médecine moderne semblait occuper une place privilégiée, car chaque souverain avait son propre médecin européen qui, souvent, était de confession catholique, et ce durant les XVIIe et XVIIIe siècles 1. Le R.P Langlois (1640-1700), médecin de la Cour, a même fondé un hôpital à Huê en 1680. A l'instar de la Chine, "La connaissance de la culture occidentale fut réservée à l'élite et rigoureusement interdite à la masse du peuple". Cette "formule du despotisme éclairé" fut appliquée jusqu'à Gia Long qui, à la différence de ses prédécesseurs, s'appuya sur l'Occident pour restaurer son empire. La porte de l'Annam était désormais ouverte à l'Occident. Conscient du retard du pays sur celui-ci dans la culture matérielle, l'empereur Tu Duc essaya d'y introduire les sciences et les techniques par la création d'un centre d'enseignement moderne en faisant appel aux spécialistes étrangers. Mais cette tentative de modernisation n'a pu aboutir à cause de l'hostilité de la Cour à toute innovation 1.
Certes, la colonisation n'avait pas pour but de réduire ou rattraper le retard de la Colonie sur la Métropole dans le domaine de la science au profit du peuple colonisé. "Mais il ne faut jamais dissocier, écrit Joseph Needham dans un essai, la pensée philosophique et morale de son fondement matériel 2". Un aperçu sur les réalisations à caractère scientifique et technique, du début jusqu'à la fin de la colonisation, permet de voir que ces "fondements matériels" servaient de base à l'expansion d'une certaine idée du progrès, mais aussi à consolider ce qui était tenu pour acquis.
DATE DE CREATION ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES 3
1885 Ouverture de la ligne de chemin de fer Phu lang thuong-Lang son (98 km), Ouverture de la ligne Saigon-My tho
1889 Mise en service des câbles téléphoniques sous marins reliant Hà nôi à Saigon en passant par Vinh, Huê et Tourane
1890 Institut Pasteur de Saigon
1892 Premières distributions publiques d'énergie électrique en Indochine (Hà nôi, Haiphong)
1894 Institut Pasteur de Nha trang
1902 Observatoire de Phu liên
10.03.1902 Institut bactériologique de Nha trang
16.09.1902 Observatoire central magnétique et météorologique
01.04.1903 Ouverture de la ligne Ha noi-Hai phong
30.12.1903 Ouverture de la ligne de chemin de fer Ninh binh-Hàm rông
24.01.1904 Ouverture de la ligne de chemin de fer
Saigon-Biên hoà-Khanh hoà.
25.10.1904 Création d'un réseau téléphonique à Haiphong
31.12.1904 Ouverture de la ligne de chemin de fer Hàm rông-Thanh hoa
19.04. 1906 Exploitation du réseau interurbain de
la ligne téléphonique reliant Hà nôi à Haiphong
19.10 Institut bactéorologique de Huê
31.12.1918 Institut scientifique de l'Indochine
01.01.1921 Institut ophtalmologique à Huê
1925(?) Institut Pasteur de Hà nôi.
A titre d'indicatif, en 1900 le réseau ferré de la France avait une longueur totale de 38.109 kilomètres, celui de l'Angleterre, 30.079 kilomètres, celui de l'Inde, 40.396 kilomètres, alors que les chemins de fer au Vietnam n'en étaient qu'à leur début avec une centaine de kilomètres. Bien entendu, les chiffres sont à relativiser en prenant en compte les superficies de chaque pays. Le Japon, lui, inaugura sa première ligne ferroviaire, reliant Tokyo à Yokohama d'une distance de 29 kilomètres, en 1872 1. Ces faits illustrent en quelque sorte le retard du Vietnam sur l'Occident, au sens large, dans le domaine d'innovations scientifiques et techniques, facteur du progrès matériel, et d'évolution sur le plan des idées. En revanche, l'énergie électrique fut introduite au Vietnam relativement tôt, puisque les villes de Hà nôi et de Hai phong en bénéficiaient à partir de 1892, et que la lampe à incandescence avait été découverte seulement en 1878. Dans le domaine des télécommunications, l'Indochine fut reliée au réseau câblé mondial en 1871 1. Dès 1911, il était question d'équiper l'Indochine d'une station radiophonique suffisamment puissante pour permettre à celle-ci de communiquer directement avec la Métropole, mais ce plan était renvoyé sans cesse aux calendes grecques. Las de cette situation, Maurice Long, Gouverneur général de 1920 à 1922, prit l'initiative de contacter, sans passer par les PTT qui avaient droit de regard sur les télécommunications entre la Métropole et les Colonies, la Compagnie générale de télégraphie sans fil, chargée des liaisons internationales, pour faire construire un émetteur-récepteur d'une puissance de 1250 kilowatts à Saigon. Cette station pouvait capter des émissions dès août 1922 et commençait à émettre en janvier 1924. Quatre ans plus tard, Albert Sarraut, alors ministre des Colonies, inaugura la ligne radio-téléphonique intercontinentale en ondes courtes en conversant avec Pierre Pasquier, gouverneur général de l'Indochine 2. Cette volonté de moderniser la colonie s'étendait dans d'autres domaines. A cette effet, le Service météorologique a été créé, dont un des rôles principaux était l'organisation parfaite des avertissements en cas de typhon. Ce Service dotait l'Indochine dès 1904 de 12 "stations principales dites météorologiques" et de 29 "stations secondaires dites climatologiques". En 1930, le nombre de ces dernières atteignait 97 à quoi s'ajoutaient 294 stations pluviométriques 3. En dépit de son nom, l'Institut scientifique de l'Indochine, inauguré le 19 mai 1919 à Saigon, avait des activités qui se limitaient à "l'étude, le développement et l'utilisation des productions du sol et des eaux". Six ans après cet institut fut supprimé et ses activités étaient reprises par l'Institut des recherches agronomiques 1. Quant aux Instituts Pasteur, au nombre de trois en 1925, ils étaient "placés sous la direction scientifique et administrative de l'Institut Pasteur de Paris" par contrat "qui rentrait dans le cadre de convention entre ce dernier et le gouvernement général de l'Indochine".
Quoi qu'il en fût, il s'agissait avant tout d'établissements de recherches appliquées ou de centres d'observations. Déjà, à ce niveau, l'idée de la science n'avait plus le même contenu car les recherches pures nécessitaient d'une part des infrastructures appropriées, et d'autre part, l'existence et la reconnaissance d'une communauté scientifique, ce qui n'était pas le cas du Vietnam pendant la colonisation. Par contre, l'Inde qui était une colonie anglaise à la même époque, bénéficiait déjà d'une infrastructure, et d'un potentiel humain, issu de sa tradition, permettant un développement de la science. A cet égard, on ne peut passer sous silence l'effort et l'intérêt pour la science de la famille Tata qui, par des actions de mécénat, a décidé de fonder, entre autres industries, une université des sciences en 1898. Cependant cette idée ne s'est concrétisée qu'en 1914, après de multiples tractations et péripéties dues à la situation coloniale de l'époque. Cette volonté de faire de la science un facteur privilégié du progrès marqua l'entrée de l'Inde dans la communauté scientifique. Lors de l'indépendance cet intérêt était soutenu au plus haut niveau ; en effet, Nehru, premier Premier ministre à cette date, s'attribua aussi le portefeuille du ministère de la Science. Lors d'une visite à l'Institut des Sciences de Bangalore, il déclara :
Les laboratoires de recherche sont des symboles qui permettent d'attirer notre attention sur des choses toujours nouvelles et de construire notre pays comme un tout. Je les considère comme des temples de science construits pour le service de notre terre natale 1.
A l'heure actuelle, la communauté scientifique indienne compte des millions de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens associés, et elle mène dans certains domaines des recherches à la pointe des recherches internationales. Plusieurs prix Nobel sont venus couronner cette réussite qui cependant n'arrive pas à sortir l'Inde de la pauvreté et de la misère quotidienne. Ce contraste frappant résulte d'une part du poids de la tradition et d'autre part de l'insuffisance des bases matérielles, indispensables relais de la modernisation et du progrès. Ces handicaps sont accentués par l'immensité du pays, et la diversité des langues régionales servant de véhicules officiels dans la transmission du savoir. Comme l'anglais demeure la langue officielle de la communauté scientifique, ceux qui ne la possèdent pas s'en retrouvent de fait écartés.
La situation du Vietnam pendant la colonisation était complètement différente. Cependant on peut déceler deux principaux facteurs défavorables à l'introduction de la science et à son développement, en prenant l'Inde comme repère. Le premier réside dans le fait que les établissements à caractère scientifique ou technique constituaient plutôt des "propriétés privées" de l'Administration coloniale. La conception du colonialisme français qui privilégiait les échanges commerciaux aux dépens de l'industrialisation, à la différence du colonialisme anglais qui, plus dynamique, considérait les colonies comme un partenaire économique à part entière, a privé l'Indochine du développement industriel et scientifique. Cette vision n'a pas beaucoup évolué au cours du temps, car au lendemain de la crise de 1929, les milieux d'affaires français, d'après Jacques Marseille, préféraient encore la conception "autarchique" au libéralisme 1.
Le second facteur relève directement de la société vietnamienne elle-même, qui avait tout à apprendre dans ce domaine, car d'une part, les activités intellectuelles se limitaient à l'apprentissage et à la compréhension des textes confucéens, à une certaine forme de littérature, et plus précisément à la poésie selon les règles strictes élaborées sous les Tang, par conséquent le potentiel humain était quasiment nul; et d'autre part, les activités économiques ne dépassaient pas le cadre de l'agriculture et de l'artisanat. Si le langage peut traduire un certain état d'esprit, les mots utilisés à cet effet sont évocateurs de la place qu'occupe le commerce dans la vie sociale. Le terme mua (acheter) s'emploie pour des objets courants de la vie quotidienne, tandis que tâu (qui veut dire acheter aussi) s'applique à des choses bien précises et plus particulièrement à une maison ou à un buffle : on pourrait dire que le plus gros achat pour un Vietnamien ne peut être qu'une maison ou un buffle. En effet, le commerce, facteur de développement qui nécessite une vision à long terme et un certain état d'esprit, n'intéressait pas particulièrement les Vietnamiens, pour qui le fait d'être mandarin était considéré comme le couronnement de la vie aux dépens des activités de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce. Comme toutes ces activités, qu'elles fussent intellectuelles ou économiques, ne s'inscrivaient que dans le cadre du maintien de la tradition littéraire ou de celui de la lutte pour la survie, elles constituaient de fait un obstacle au développement d'autres activités, une barrière à l'exploitation du potentiel cérébral. Par exemple, le passage du concret à l'abstrait qui reflète l'une des formes de la pensée scientifique, et le sens de l'observation qui est son outil de base, ne constituent pas le point fort pour les Vietnamiens, sans parler de l'esprit analytique et d'un certain type de raisonnement. Tous ces éléments façonnaient en fin de compte la mentalité vietnamienne peu encline à l'aventure et à la découverte. On peut se demander s'il y a un lien de cause à effet entre les voyages et les activités scientifiques, cependant les scientifiques voyagent souvent beaucoup. Même au moyen âge, où Cordoue, alors capitale de l'Occident musulman, et représentée comme un centre intellectuel de haut niveau, attirait et accueillait bon nombre de savants venus enrichir leurs connaissances, en mathématiques particulièrement. Descartes ,lui, a passé "douze ans de sa vie à voyager" avant de se fixer en Hollande où régnait une plus grande liberté d'expression qui faisait défaut ailleurs 1. Le rattachement à la terre natale venait s'ajouter à cet ensemble qui maintenait la société vietnamienne dans l'immobilisme. Bref, il n'existait pas au Vietnam une tradition scientifique comparable à celle de L'Inde ou à celle de la Chine, pour ne citer que ces deux pays. Malgré la tradition littéraire, il n'existait pas au Vietnam, avant la colonisation, une littérature d'observation ou descriptive, il a fallu attendre les années 1930 pour voir apparaître dans la société vietnamienne cette nouvelle forme de littérature. Pour résumer cette situation de fait, Pierre Huard et Maurice Durand diraient en d'autres termes que:
La mentalité traditionnelle (vietnamienne), fruit des concours, se heurtait, en ce qui concerne la science, à des obstacles importants:
- tendance à repousser l'abstraction, la généralisation, le résultat lointain mais meilleur au profit du concret, de l'utilitaire et de la réalisation médiocre mais immédiate et payante;
- adaptation difficile des structures profondes de la personnalité aux exigences impérieuses de l'esprit scientifique;
- liaison étroite entre la diffusion de la science et le contexte politique et économique de la colonisation 1.
Comme la science, par ses applications dans divers domaines, constitue un savoir ultime, elle ne peut se dissocier du pouvoir. Cet "ensemble de la connaissance des lois des processus naturels" se trouve donc prisonnier d'institutions étatiques qui sont les véritables centres décisionnels sur la stratégie à mener ou sur le choix à prendre. L'Indochine n'a pas échappé à cette règle, le contexte peu favorable et aggravé par une tradition peu ouverte a empêché la science de se développer au Vietnam comme elle a pu le faire ailleurs. Par conséquent, les sciences en Indochine étaient représentées à leur début uniquement par des scientifiques français travaillant pour le compte de la colonisation, et il a fallu attendre les années 1930 pour voir apparaître une prise de conscience de l'importance de cette dimension chez des Vietnamiens. A en croire Henriette Chandet, les sciences ont exercé une certaine attirance sur les étudiants vietnamiens venus en France, car ils voulaient entre autres "surprendre les "secrets" de la science occidentale 1". David Marr dirait en d'autres termes que "la facette des expériences historiques occidentales qui excitait le plus l'intelligentsia vietnamienne (des années 1920 et 1930) était le développement de la science 2. Mais curieusement cette fascination n'a produit aucun homme de science ou savant vietnamien depuis la colonisation jusqu'à nos jours comme par ailleurs l'histoire du Vietnam n'a accouché aucun penseur. Si certains Retours de France ont déçu la société vietnamienne par leur arrogance, par leurs apports futiles en matière de divertissements ou de plaisirs à la place des connaissances modernes porteuses de progrès, d'autres sont revenus avec une certaine idée de la science et se sont mis à la populariser, en la vulgarisant, il est vrai, dans la limite de leurs connaissances. Cet effort constitue la tentative de la nouvelle génération qui a fait paraître deux revues de vulgarisation technique dans les années 1930.
B. LES SCIENCES ET LES TECHNIQUES A TRAVERS LA REVUE
KHOA HOC TAP CHI (KHTC)
Pour des raisons méthodologiques nous laisserons de côté la revue Khoa hoc phô thông (La science populaire), parue à Saigon de 1934 à 1942 au profit de Khoa hoc tap chi (Revue scientifique) qui était implantée à Hà nôi dans la même période. Car d'une part, ces deux revues paraissaient à la même époque, poursuivaient les mêmes buts et leurs contenus étaient sensiblement les mêmes, et d'autre part, Khoa hoc phô thông aurait sans doute touché plus de lecteurs du Sud que ceux du Nord, étant donné son siège à Saigon.
Par ailleurs, nous ignorons à quelle date remonte l'apparition du terme "khoa hoc" dans le langage vietnamien, utilisé par la suite pour traduire le mot "science", comme discipline venue de l'Occident. D'après le dictionnaire sino-vietnamien (Han viêt tu diên) élaboré par Dào Duy Anh, le terme "khoa hoc" désigne un ensemble d'études formant un système, sans d'autres précisions. Le vocabulaire scientifique pose donc problème pour des Vietnamiens, adeptes de cette discipline en particulier, et pour la langue vietnamienne en général, dépourvue de termes pour désigner des concepts, des lois, des théories et des matériaux de base liés à la science. Nous y reviendrons.
Le numéro 1 de KHTC parut le 1er juillet 1931. Bimensuelle pendant les cinq premières années, la revue est devenue trimensuelle à partir du 1er janvier 1936, et ce jusqu'à 1940, ce qui fait en tout 232 numéros. Cette durée de vie relativement longue, par rapport à celle des autres périodiques de la Colonie de la même époque, s'explique par deux principales raisons :
* la teneur de son contenu qui ne touchait pas à tout ce qui était politique, ce qui a permis à KHTC d'échapper à la censure de la presse en vigueur;
* l'intérêt qu'elle suscite chez les lecteurs qui finirent par devenir une clientèle fidèle.
De format A4 approximativement, la revue contient 20 pages à son début et 30 à partir du numéro 13. Son tirage vacille autour de 2.000, exception faite de celui du premier numéro qui est de 5.000. Quant au financement, la revue fait appel à ceux qui s'intéressent à la science pour y contribuer par leur abonnement "pour ne pas déranger les capitalistes". Si le nom du fondateur-gérant-rédacteur en chef est mentionné sur la couverture, on ignore la composition du comité de rédaction; la plupart du temps les rédacteurs signent par leur pseudonyme, ce qui ne nous a pas permis de les identifier. La revue est donc dirigée par le fondateur Nguyên Công Tiêu, ingénieur-agronome de formation. Après avoir présenté ses travaux au "Congrès scientifique du Pacifique" qui les a reconnus puis les a fait publier, il a été admis comme membre de l'Institut scientifique de l'Indochine. Le 22 décembre 1931, à l'issue du remaniement du Conseil scientifique de l'Indochine dont le directeur de l'Instruction publique, Thalamas, devient président, assisté de Georges Coedès, directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Nguyên Công Tiêu est élu membre de cette instance de même que Pierre Pasquier, Gouverneur général de l'Indochine. La même année, Tiêu expérimente un engin, formé d'une hélice en verre contenant de l'alcool, et basé sur le principe de l'évaporation et des vases communicants. Exposé au soleil, l'alcool s'évapore et crée un déséquilibre autour de l'axe central de l'hélice qui se met alors à tourner. Cet engin a été baptisé "turbine solaire" (voir illustration en annexe 2). Par la suite, Tiêu a envoyé un texte explicatif du mécanisme à l'Académie des Sciences à Paris, qui apparemment n'a pas daigné lui répondre. Mais son nom est aussi lié à la propagande de l'engrais vert dit "azolle" 1.
Quel était le but de la revue? La rupture avec le fonds culturel traditionnel a-t-il été nécessaire pour accéder à la culture scientifique? L'éditorial du premier numéro répond à ces deux questions en ces termes:
Le but de la revue KHTC est l'expression de la volonté de créer une culture spécifique pour les Vietnamiens en conciliant la science avec le confucianisme.
Hier, les Chinois ont apporté le confucianisme au Vietnam, aujourd'hui les Occidentaux y diffusent la science.
Dans la phase conflictuelle, le nouveau et l'ancien semblent en contradiction, mais en réalité, il n'en est peut-être pas ainsi.(...) Nous avons déjà les fondations confucéennes, les matériaux scientifiques sont nombreux, efforçons-nous de construire une nouvelle école pour former sans tarder l'homme civilisé et chevaleresque (quân tu). La revue Khoa hoc tap chi se propose d'être un bâtisseur 2.
Comme programme d'actions, KHTC propose les dix axes suivants:
1. les inventions utiles des Vietnamiens;
2. les recherches utiles aux Vietnamiens;
3. la biographie des hommes de science dans l'histoire;
4. la traduction des revues et des livres scientifiques;
5. les informations sur les sciences;
6. les informations générales;
7. les nouvelles et romans à caractère scientifique;
8. Les questions-réponses sur les sciences;
9. un lexique des termes scientifiques avec explications;
10. et enfin, l'aide à la recherche d'emploi.
Malgré la bonne intention de vouloir "concilier la science avec le confucianisme", et malgré le titre de la revue, KHTC se propose plutôt de "diffuser les leçons de choses (cach tri)" aux Vietnamiens que de traiter les sciences en tant que telles. Cela s'explique d'une part par l'insuffisance du nombre de lecteurs potentiels ayant acquis une formation scientifique, et d'autre part, par la formation limitée des rédacteurs eux-mêmes en matière de science.
Quoi qu'il en fût, le terme khoa hoc était entré dans le langage courant à la même époque que d'autres comme phong trào (mouvement), tu do (liberté), khiên thiêt (développer)... Cependant le vocabulaire scientifique devenait une véritable difficulté, un obstacle à la compréhension, même pour ceux qui avaient une formation scientifique, sans parler des lecteurs non initiés. Les raisons étaient multiples, néanmoins on peut citer les principales: la nouvelle situation a révélé que la langue vietnamienne ne possédait pas de termes adéquats pour traduire les termes scientifiques et le peu qui existait n'a pas été uniformisé pour que tout le monde pût comprendre la même chose à partir d'un même mot. Compte tenu de ces difficultés deux tendances se sont dégagées:
- soit s'appuyer sur le chinois, comme l'avaient fait les générations précédentes, pour traduire les termes nouveaux;
- soit les transcrire directement du français.
Si la première méthode avait l'avantage de rapprocher les traductions à l'univers sonore vietnamien, elle perdait en revanche en termes de précision. Comme il n'y avait pas de commission ni de groupe de travail chargé de cette question, chaque auteur traduisait, à partir d'un même mot français, à sa façon. Par exemple, le terme "résistance" (électrique) était traduit tantôt par can diên luc, tantôt par tro diên luc, ou bien encore par khang diên luc. Un auteur de la revue a fait remarquer que ces termes faisaient appel tous trois plutôt à la notion d'"opposition" qu'à celle de "résistance 1". Tandis que la deuxième méthode pouvait éliminer cette confusion car chaque terme français aurait une traduction et une seule, mais l'inconvénient résidait dans le fait que les mots transcrits directement du français n'évoqueraient rien chez les Vietnamiens, aussi bien sur le plan sonore que sur le plan conceptuel. On en était là avant de voir apparaître plus tard, dans les années 1940, la tentative plus globalisante de Hoàng Xuân Han, polytechnicien de formation, qui a fait un effort de classification et de traduction, et surtout il a proposé une méthode de traduction du vocabulaire scientifique en vietnamien. C'est le contenu de son ouvrage édité pour la première fois en 1942 sous le titre Danh tu khoa hoc (Vocabulaire scientifique). D'après Hoàng Xuân Han, la traduction du vocabulaire scientifique en vietnamien doit respecter les règles suivantes:
- Chaque idée doit avoir un terme pour la désigner;
- ce terme ne s'utilise que pour désigner cette idée;
- chaque idée ne doit pas être désignée par plusieurs termes différents;
- le terme utilisé doit faciliter la mémorisation de l'idée;
- les termes communs aux différentes disciplines doivent être homogènes;
- le terme doit être aussi court que possible;
- il doit comporter une consonance vietnamienne;
- et enfin, il doit être formé de la même façon que les autres mots courants et avoir un caractère national 1.
Ceci constitue les conditions générales, mais en pratique Hoàng Xuân Han voit trois possibilités pour former un mot nouveau:
- soit en utilisant ou en combinant les termes courants pour désigner de nouveaux concepts, ce qui entraînerait certaines confusions et un manque de précision et de clarté. Par exemple, le mot chay en vietnamien peut avoir plusieurs significations suivant son contexte: nuoc chay veut dire l'eau coule, sat chay, "le fer fond", thùng chay, "le tonneau fuit"; si on utilise ce même terme (chay) pour traduire "la fusion" (d'un métal de l'état solide à l'état liquide), ce ne serait pas commode du fait de son imprécision. Par ailleurs, ce procédé présente un autre défaut, car souvent, on confond un mot avec sa signification; certains mots hors contexte peuvent encore passer, mais quand ils sont utilisés dans une phrase ou dans un contexte précis, ils deviennent une entrave à la compréhension et parfois ils introduisent même des contresens 2.
- soit en se servant de la transcription (du français éventuellement). Ce procédé répond aux plusieurs conditions posées dans le préambule, cependant il présente tout de même des inconvénients: on aura des mots trop longs et qui n'ont aucune consonance vietnamienne. Il est donc conseillé de ne pas en abuser. Par contre, la transcription aurait l'avantage de rapprocher les Vietnamiens de la communauté scientifique par l'emploi des termes communs 1.
- ou bien en se basant sur le chinois, procédé que l'auteur trouve le plus commode car il remplit toutes les conditions posées. Cependant il conviendrait de faire un effort pour éliminer les risques de confusion éventuels 2.
Ce problème du langage scientifique n'étant pas résolu dans les années 1930 ne fait que contribuer à retarder l'introduction de la science dans la société vietnamienne. D'ailleurs l'idée de la science était encore très confuse et le terme khoa hoc a été employé parfois à n'importe quelle "sauce". Dans le numéro 12 du 15 décembre 1931, une certaine dame, sous la signature de "Mme P.C.P. Thai binh", a proposé une recette appelée tiêt canh khoa hoc (le sang caillé scientifique). Il s'agissait d'ajouter du citrate de soude dans la préparation de ce plat pour empêcher le sang de cailler, puis pour précipiter la solidification il était conseillé d'ajouter quelques gouttes de chlorure de calcium; et on obtenait un plat "scientifique". Dans un autre numéro, Nguyên Tuân Anh a assimilé les sciences à un pouvoir surnaturel dans un article sous le titre de Duoi ngon duôc cua thân khoa hoc (Sous le flambeau du dieu la science) 3. Quant à Hoài Giang Thuy, auteur d'un article qui défendait la science à tort et à travers, il critiquait toutes les autres formes d'activités au Vietnam sous prétexte qu'elles n'étaient pas scientifiques: l'agriculture à cause de son bas rendement, le commerce à cause du marchandage des parties concernées et de leur manque du savoir-faire, la littérature romanesque qui ne cherchait qu'à réveiller les émotions, etc.1.
L'effort de vulgarisation de KHTC, dans les 27 premiers numéros, se traduit aussi par l'approche biographique des scientifiques qui ont laissé leur nom dans l'histoire; dans chaque numéro KHTC publie une photo de l'homme de science en question pour illustrer l'article qui rappelle l'oeuvre principale de chacun. Ont été évoqués dans l'ordre donc Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur, Lavoisier avec son principe de conservation de la matière, Henri Poincaré qui a découvert les fonctions fuchsiennes, l'agronome Parmentier, le promoteur de la culture de la pomme de terre, les chimistes Berthollet et Berthelot, Galilée, Newton, Thomas Edison, Louis Pasteur, Niepce, Nobel, Léonard de Vinci, etc. Figurent aussi dans cette liste de scientifiques des personnalités vietnamiennes comme Nguyên Công Tru pour sa mise en valeur des terres de la région de Nam dinh, Lê Thanh Tôn, le souverain que la tradition considère comme humaniste et Lê Nhu Hôc qui a introduit l'imprimerie au Vietnam au XVIe siècle à son retour de Chine. Par ailleurs, la revue cherche également à vulgariser les techniques modernes en expliquant le principe de fonctionnement de l'électricité, de la mécanique, de la TSF, du cinéma, de la photo ... sans oublier les techniques artisanales vietnamiennes comme la teinturerie, le travail du bois, la papeterie, la riziculture... La revue a lancé aussi un appel dans l'éditorial du n°10 (15 novembre 1931) en vue de la création d'un cercle scientifique, et de la fondation d'une bibliothèque de documentation au service du progrès, mais cet appel n'a pas eu d'écho et ce projet n'a pu être concrétisé. Enfin, KHTC voulait encourager la jeune génération à se destiner à la science par l'attribution de bourses d'études en Occident, en France particulièrement. Compte tenu du tirage qui n'a pas dépassé les deux mille exemplaires, à 0,15$ l'unité, la revue n'aurait peut-être pas fait beaucoup de bénéfices permettant de réaliser ce voeu. Néanmoins KHTC s'est félicitée d'être qualifiée de revue à caractère pédagogique par le Conseil de contrôle des publications, qui l'a autorisée à être utilisée dans les établissements scolaires 1.
Qu'a apporté la revue KHTC à la société vietnamienne sur le plan des idées pendant ses neuf ans d'existence? Quelles ont été sa portée et ses limites?
Si on s'en tenait au ton de cette revue, on dirait que la société vietnamienne de cette époque était partagée en deux camps: ceux qui croyaient à la science, et les autres. Une certaine fascination a inhibé les autres visions de la société. La science avait droit à tous les honneurs et on ne cherchait pas à comprendre les rouages dans lequel elle était insérée, ni à avoir une idée claire sur ses enjeux dans un monde en mutations, sans parler du contexte colonial qui fixait les limites de toute entreprise; elle représentait une sorte d'évasion vers un autre univers en abandonnant le monde réel avec ses complexités et ses contradictions. Ainsi, la science était considérée comme un but en soi, le salut, et non comme un moyen pour atteindre le progrès. Par ailleurs, aucun débat sur la place du confucianisme, qui demeurait encore une des assises de la société, n'a eu lieu. Cette absence de débat de fond résultait sans doute du parti pris de la revue qui voulait "concilier la science avec le confucianisme", annoncé comme devise dès la parution du premier numéro. Cette "voie" devenait alors un signe de ralliement qui regroupait ceux qui s'y reconnaissaient. On remarque par ailleurs la critique de certains aspects de la société traditionnelle qui se laissait bercer par la superstition. Cependant, les auteurs se contentaient de conseiller aux autres (le peuple) de se servir des idées de la science pour abandonner leurs pratiques superstitieuses sans leur donner les moyens. Dans la foulée, les traditions ancestrales ont été mises à l'index, par exemple, celle du dung nêu, qui consiste à planter la veille du nouvel an une sorte de perche dont le bout est orné de plumes ou de bande de tissu coloré, cet objet symbolique permettant d'éloigner les mauvais esprits du lieu d'habitation; celle du xông nhà, qui est la première visite du nouvel an, où chaque famille choisit quelqu'un de gentil, de vertueux et de généreux dans son entourage pour qu'il soit la première personne à venir souhaiter la bonne année, cela pour pouvoir profiter de ses qualités et pour éloigner les ennuis; le dông thô (littéralement "bouger la terre"), c'est le rituel du premier sillon de la nouvelle année, cette tradition obéit à des règles de concordances des jours. "L'attente d'un jour faste, conclut Huu sào, pourrait ruiner toute une récolte 1".
Est-ce par manque de pédagogie ou par manque de réalisme? Quoi qu'il en fût, ces conseils ne constituaient que des actes isolés sans aucun suivi et ils ne faisaient partie d'aucune campagne précise contre ces superstitions. Sans l'affirmer explicitement, les partisans de cette "voie" préféraient plutôt le statu quo social à tout autre changement. Dans un article sur la science et l'égalité entre l'homme et la femme, les deux auteurs présentaient cette question ainsi:
Maintenant nous allons voir si la science et l'égalité peuvent rester en harmonie. Certainement, au sens large, la science est nécessaire pour arriver à l'égalité.(...) Mais au sens strict, la science et l'égalité, ou garçon et fille ne peuvent cohabiter. Comment tout le monde, dans une nation, dans un village, dans une famille pourrait-il se comprendre parfaitement et sur tout? Ainsi au sens strict, garçon et fille ne peuvent être en harmonie 1.
Cependant la nouvelle que la première Vietnamienne, Hoàng Thi Nga, fille du mandarin de province de Hà dông, qui avait obtenu le "doctorat ès sciences physiques", a été acclamée par la revue. Après avoir passé la première partie du baccalauréat au Vietnam, Hoàng Thi Nga s'est destinée à l'enseignement en suivant les cours de l'école normale de Hà nôi. Une fois obtenue la deuxième partie du baccalauréat en France, elle s'est inscrite à la Faculté des sciences à Paris en 1928. Elle n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers durant sa scolarité puisque trois ans après elle a eu sa licence. En 1935, Nga, alors âgée de 32 ans, soutint sa thèse dont le titre était "Propriétés photovoltaïques des substances organiques"; son travail lui a valu la mention "très honorable avec félicitations du Jury". Cet événement était une fierté à la fois pour la micro-société "scientifique" naissante, et pour les femmes, ou plutôt pour une certaine catégorie de femmes, au Vietnam.
D'autres auteurs prenaient leurs désirs pour la réalité, comme celui qui signait "Jât", auteur d'un poème humoristique qui racontait le conflit entre le ventilateur et l'éventail dont le contenu peut être résumé de la façon suivante:
Depuis l'arrivée du ventilateur, l'éventail se plaint d'être délaissé et intente alors un procès contre celui-ci devant l'Académie des Sciences. Le ventilateur se défend en avançant l'argument du progrès :"Qui n'avance pas, recule! Personne n'empiète personne". Le tribunal déclare donc que c'est l'éventail qui cherchait des histoires et le condamne à trois mois de prison et 20.000$ de dommages et intérêts au bénéfice du ventilateur 1.
Bien que limités, les effets de la culture matérielle et, sans doute, un certain mode de vie occidental en milieu urbain ont amené des Vietnamiens à réfléchir sur leur propre mode de vie, sur leurs pratiques sociales jugées désormais non conformes à la vie moderne qui présentait un certain bien-être. Parlant de l'hygiène des repas, l'auteur d'un article faisait référence aux usages européens: chacun a ses propres couverts à table, tandis que les Vietnamiens se servent d'une paire de baguettes pour tout faire, à la fois pour se servir dans les plats communs à tous et pour porter les aliments à la bouche. Cet usage était jugé contraire aux règles d'hygiène, surtout s'il y avait un malade parmi les gens autour du repas. L'auteur proposait ainsi de réformer cet usage en se servant d'un bout des baguettes pour prendre des aliments et de l'autre bout pour les porter à la bouche. Il a bien pensé à l'adoption éventuelle de l'usage des Européens, mais cette solution ne lui semblait pas appropriée à la société vietnamienne, car elle "nécessiterait, selon lui, la présence d'un boy" dans la famille 2. Cette idée de l'hygiène du repas a suscité des réactions de la part des lecteurs qui continuaient à chercher une solution acceptable pour les Vietnamiens. L'un d'entre eux a suggéré de se servir des cuillers pour prendre des aliments et des baguettes pour les porter à la bouche. Un autre pensait qu'il faudrait d'une part, avoir deux paires de baguettes, l'une pour prendre des aliments, et l'autre pour les porter à la bouche, et d'autre part qu'il conviendrait de manger à table avec des tabourets comme les Chinois et non sur le meuble qui servait à la fois de lit et de table à manger 1. Thuân long, quant à lui, abordait l'usage du mom com qui consiste à donner à manger aux nourrissons par le bouche à bouche, en distinguant bien les aspects positifs des aspects négatifs de cette tradition. Quand la mère est en bonne santé et qu'elle entretient l'hygiène de sa bouche, les sucs digestifs mélangés aux aliments bien mâchés facilitent la digestion chez les nourrissons, dans le cas contraire, l'enfant risquerait fort d'être contaminé par les maladies de sa mère 2. Dans le même ordre d'idées, un autre auteur critiquait la façon dont on coupait le cordon ombilical du nouveau-né. Les matrones se servaient souvent d'un simple morceau de verre cassé non aseptisé pour le faire, ce qui représentait un risque énorme pour la survie de l'enfant. Cette pratique a provoqué, selon l'auteur de l'article, le décès de beaucoup d'enfants sans parler des accidents, des infections, des maladies 3.
D'autres se lamentaient sur le manque d'hygiène dans le mode de vie rural, comme l'éditorialiste du numéro 85 qui racontait une anecdote dont il avait été témoin. En rendant visite à des amis dans un village, il a eu des discussions avec certains, dont un septuagénaire qui parlait de l'incompatibilité des âges, des jours, des mois... Au moment où quelqu'un voulait aborder le problème des microbes, ce vieillard rétorqua qu'il ne connaissait ni l'hygiène, ni les microbes et pourtant qu'il avait survécu jusqu'à son âge. L'éditorialiste reconnaissait qu'il s'était retrouvé coi devant cette argumentation 1.
Certes, le milieu qui avait les premiers contacts avec les sciences, dans le contexte du Vietnam d'avant la colonisation, ne pouvait être que la Cour qui, par méfiance, n'a pas cherché à approfondir la question. Ces contacts étaient sans doute très limités, d'une part, et très peu de dignitaires dans l'entourage de la Cour se donnaient la peine d'y réfléchir pour savoir s'il fallait et comment il fallait intégrer ces nouvelles connaissances dans leur conception du monde, d'autre part. En fait, depuis l'arrivée des Occidentaux du XVIIe siècle au XIXe siècle, les classes dirigeantes vietnamiennes avaient du mal à voir les sciences comme un facteur de progrès du monde moderne, un sous-ensemble porteur d'une civilisation qui puisait ses bases non dans la morale mais dans l'esprit critique et rationnel orienté vers la recherche de la compréhension des phénomènes du monde extérieur. Bref, les sciences, à leurs yeux, n'avaient pas de fondements philosophiques comparables au confucianisme. Mais cette question était d'autant plus importante qu'elle touchait à l'identité culturelle nationale. Reconnaître la supériorité de la culture scientifique sur le confucianisme reviendrait à reconnaître, soit les lacunes de ce dernier, soit l'infériorité de sa culture sur celle des autres, une situation peu confortable car elle remettrait en cause sa propre identité culturelle. De tout temps, cette opération mentale constitue une des plus difficiles choses à faire pour un être humain, et ce indépendamment de son milieu. La colonisation se passait de ces questions qui ne regardaient que les colonisés, et a introduit progressivement la culture scientifique, dans la mesure de ses besoins, pour asseoir les bases matérielles de la conquête et du rayonnement de l'Occident. Cependant la conception du colonialisme français a freiné l'essor du développement industriel dans les colonies au profit d'une vision plus utilitaire et plus prudente incarnée par les échanges commerciaux de biens de consommation fabriqués en Europe contre les produits qui ne nécessitaient pas une infrastructure lourde dans la Colonie. Pour cette raison, après près de cent ans de présence au Vietnam, la colonisation n'a pas laissé de traces d'industries de biens de consommation, mises à part quelques brasseries. Cette absence d'industries privait, à leur tour, les sciences d'un relais essentiel pour se développer. D'un autre côté la culture scientifique était encore trop étrangère aux Vietnamiens qui n'avaient pas de tradition comparable à celle des grands pays d'Asie. Si l'initiation aux sciences et aux techniques avait lieu à l'école au cours du secondaire puis dans l'enseignement supérieur, il a fallu du temps aux Vietnamiens, et pas tous, pour assimiler les connaissances modernes. On a vu aussi que celles-ci ne constituaient pas nécessairement un facteur de changement radical de la société dans la mesure où ceux qui les avaient adoptées ne voulaient pas remettre en cause la culture confucéenne. La revue KHTC et son audience en fournissent à cet égard une illustration exemplaire. Sur le plan des idées ou l'assimilation des idées modernes, les fondateurs du Dông kinh nghia thuc sont allés plus loin que ceux de la revue Khoa hoc tap chi, alors qu'il y avait un écart d'une génération entre eux à l'avantage de ces derniers. Tandis que les premiers avaient amorcé une véritable rupture avec les traditions, les derniers se contentaient de ménager l'ancien et le nouveau de façon à préserver l'ordre social établi. Quant à savoir si la revue Khoa hoc tap chi a réussi à sensibiliser ou à éveiller la conscience pour que les sciences eussent une place d'honneur dans la société, on peut émettre quelques doutes à ce sujet. Si on se base sur le tirage de la revue qui ne dépassait pas 2.000, la diffusion ne pouvait se faire que dans un cercle d'initiés ayant acquis des connaissances modernes au Vietnam ou en France. Ce handicap privait la revue d'une base sociale, relais indispensable à toute propagation d'idées. La campagne vietnamienne demeurait, de ce fait, hors de la portée de cette tentative de modernisation. Le manque d'esprit pédagogique qui s'ajoutait aux connaissances limitées des auteurs constitue un autre point faible de Khoa hoc tap chi, sans parler du problème du vocabulaire scientifique resté sans solution. Enfin, le parti pris de la revue qui séparait les sciences et les techniques du débat politique peut n'avoir pas incité les autres milieux, lesquels privilégiaient les actions politiques aux autres réformes, à inclure la culture scientifique dans leur programme. La société vietnamienne de l'époque, comme celle d'aujourd'hui, était formée de groupes hétéroclites qui cherchaient plutôt à s'ignorer mutuellement qu'à unir leurs forces ou à répartir leurs rôles respectifs dans la même perspective. Au mieux, la revue a peut-être réussi à maintenir le niveau des connaissances acquises à l'école par les auteurs ou par ses lecteurs une fois entrés dans la vie active. Si une certaine frange de la jeunesse vietnamienne se laissait fasciner par les sciences, elle n'a pas trouvé d'infrastructure qui pût l'accueillir, une fois de retour au pays. D'un autre côté le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur scientifique ne suffisait pas non plus à former un milieu dynamique capable de donner à la science son véritable rôle. Pour toutes ces raisons, si les sciences et les techniques exerçaient une certaine fascination sur des Vietnamiens qui, par la suite, ont essayé de les intégrer dans leur monde conceptuel, cela passait plutôt par le relais colonial, aussi limité fût-il dans les activités, que par une véritable prise de conscience de la part des Vietnamiens eux-mêmes. Un peu moins d'un siècle après avoir raté le train de la modernité que le Japon a su prendre à temps, le Vietnam se cherchait et se demandait encore si c'était bien son train.
III. LA MEDECINE
"La science chinoise est la science du dedans;
La science européenne est la science du dehors"
Tchang Tche Tong (1898).
Contrairement à la science qui était absente dans le cursus de formation traditionnelle vietnamienne, puisqu'elle ne figurait pas dans le monde conceptuel des Vietnamiens, la médecine en tant que connaissances liées à la santé, faisait bien partie de leur univers. Cette discipline, comme tant d'autres, les Vietnamiens la devaient à leurs grands voisins du Nord. Si les historiens chinois font remonter la médecine par "les plantes fondamentales" (Pen ts'ao ) vers le IVe siècle av. J.C., la période des États combattants, et le premier livre de médecine vers le IIe siècle av. J.C. 1, on ignore toujours à quelle date la médecine chinoise fut introduite au Vietnam qui, par ailleurs, a produit deux grands médecins au cours de son histoire. Bien qu'elle fût limitée à l'entourage de la Cour, la médecine occidentale a pénétré au Vietnam dès le XVIIe siècle à travers des missionnaires ou des laïcs qui exerçaient cette pratique. La Seigneurie du Sud (Les Nguyên) étaient particulièrement ouverte à la médecine moderne: le premier médecin occidental admis au rang de médecin du Seigneur Hiên Vuong en 1648 fut le R.P. Bartholomeu Da Costa, quant à Vo Vuong (1708-1745), il a connu trois médecins européens successifs de son vivant. Cependant une certaine diffusion de ces connaissances modernes dans la société vietnamienne n'a pu se faire qu'avec la colonisation. Nous chercherons, de même que pour l'enseignement et les sciences, à savoir la portée de la médecine moderne et ses effets sur la société vietnamienne. En d'autres termes quelle était l'attitude des Vietnamiens face à ces nouvelles connaissances, étant donné qu'il existait une autre tradition médicale basée sur les plantes ?
A. L'ASSISTANCE PUBLIQUE
L'assistance publique fut un domaine qui a très tôt profité aux Vietnamiens car au-delà de sa mission qui consistait à mener des actions préventives et curatives pour répondre aux besoins de la colonisation contre un climat hostile, elle s'adressait aussi à la population locale. Bien que le nombre de médecins et auxiliaires fût restreint, ceux-ci disposaient tout de même d'une infrastructure leur permettant d'exercer leur science. L'Institut Pasteur de Saigon fut créé dès 1890 par le docteur Albert Calmette, celui de Nha trang par le docteur Alexandre Yersin en 1894, et celui du Tonkin en 1925. Dépendant du Service de la Santé à leur début, les deux premiers instituts ont été réunis comme filiales directes à l'Institut Pasteur de Paris par contrat, à partir de 1904 pour celui de Nha trang et à partir de 1905 pour celui de Saigon, sous la direction du docteur Yersin nommé mandataire de l'Institut Pasteur en Indochine. Ce projet a été présenté à Paul Beau en ces termes:
Parmi les institutions dont l'Indochine est dotée, il n'en est point qui ait rendu et qui puisse rendre de plus précieux services que les établissements bactériologiques de Nha trang et de Saigon. En dehors de la préparation des vaccins et sérums contre la peste, la variole, la rage, ces instituts concourent encore brillamment et utilement au progrès de la science par les savantes recherches qui se poursuivent dans leurs laboratoires et qu'ont déjà couronné de remarquables succès. (...)
Aussi a-t-il semblé que les sacrifices consentis par la Colonie pour l'entretien de ces établissements bactériologiques pourraient être plus féconds encore, si ces fondations étaient placées sous la direction immédiate de l'Institut Pasteur de Paris, centre scientifique où se coordonnent les résultats des travaux de microbiologie entrepris dans le monde entier 1".
En vertu de ces deux contrats, le Gouvernement général de l'Indochine fournit une aide subventionnelle de 75.000 francs à chacun de ces deux instituts, à charge de satisfaire la Colonie 100.000 francs de sérums et vaccins gratuits, pour l'Institut Pasteur de Nha trang, et d'assurer gratuitement la fourniture du vaccin jennerien (antivariolique), le traitement antirabique, les recherches et enquêtes épidémiologiques demandées par le Service de Santé, pour l'Institut de Saigon.
Au Tonkin, l'Institut vaccinogène fondé en 1903, a commencé à fonctionner en janvier 1905 et il a fourni la même année 400.000 doses; les succès obtenus étaient estimés entre 80 et 90% 1. Dans la même année 1903 l'Institut antirabique de Hà nôi a été créé sur le modèle des instituts Pasteur. Tous ces instituts dépendaient du Service de Santé de la Colonie. En 1904 le Tonkin disposait de 9 hôpitaux indigènes et de 7 postes médicaux, mais d'année en année ces nombres augmentaient d'aune façon sensible.
ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
POUR LES 3 REGIONS 2.
|
|
1914 |
1915 |
1916 |
1917 |
1918 |
1919 |
1920 |
1921 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mixtes Hôpitaux Indigènes |
8 |
7 |
10 |
10 |
19 |
20 |
12 |
12 |
|
71 |
64 |
69 |
72 |
71 |
76 |
87 |
101 |
|
|
Maternités isolées |
21 |
21 |
21 |
23 |
47 |
55 |
62 |
63 |
|
Postes médicaux, cliniques, dispensaires |
42 |
62 |
68 |
65 |
87 |
100 |
128 |
93 |
De 1906 à 1912 les consultations dans ces établissements (dont le nombre était beaucoup moindre que dans la période 1914-1921), passaient de 75.000 à 120.000; grossièrement 1,25 à 2 pour cent de la population ont été concernés. Comme l'effectif des médecins provinciaux ne dépassait pas le seuil d'un médecin par province pendant de longues années, leurs actions n'étaient ainsi efficaces que dans un rayon allant de 20 à 25 kilomètres aux alentours de leur résidence 1. Le rapport d'inspection sur l'organisation de l'Assistance médicale au Tonkin en 1936, après l'arrivée du Front populaire au pouvoir, mentionne 48 hôpitaux et infirmeries disposant d'un total de 8.161 lits, 161 maternités dans les zones rurales, 4 léproseries, 3 stations estivales, 113 dispensaires ou salles de consultations, 1 pharmacie d'approvisionnement général, 1 asile d'aliénés. Le personnel de l'assistance médicale se compose de :
- 5 médecins et 2 pharmaciens militaires;
- 1 officier d'administration;
- 16 médecins européens, des cadres locaux;
- 2 médecins contractuels européens;
- 2 médecins libres européens;
- 2 dentistes;
- 2 docteurs en médecine indochinois;
- 63 médecins indochinois;
- 13 pharmaciens indochinois;
- 20 infirmières et infirmiers européens;
- 2 agents sanitaires européens;
- 439 infirmières et infirmiers indochinois;
- 62 sages-femmes;
- 726 bà mu (matrones);
- 416 agents divers 2.
Malgré ce contingent non négligeable, l'Assistance publique n'arrive pas à satisfaire les besoins de la population. Car si on compare d'une part le nombre total de médecins (européens et indochinois) qui est de 90, et d'autre part, celui des infirmiers et sages-femmes qui est de 521, avec la population totale du Tonkin en 1936 qui s'élève à 8,7 millions, on obtiendra un rapport d'un médecin et de cinq infirmier(e)s pour 100.000 habitants. Sans vouloir se faire l'avocat du diable, on pourrait dire qu'il n'y avait aucune chance qu'un médecin et cinq infirmier(e)s eussent à soigner en même temps les 100.000 malades. Par contre, il est fort probable que certaines localités, par leur situation géographique, ne se trouvant pas trop loin des centres de soins, pouvaient profiter plus que d'autres des actions médicales et sanitaires. Cette disparité des soins incombe à une infrastructure en voie de développement qui ne permettait pas à tout le monde d'obtenir la même attention. Justin Godart n'a pas oublié de mentionner cette situation dans son rapport de mission:
La pénurie des médecins en Indochine ne permet point d'établir une assistance médicale satisfaisante. (...)
Le peuple reste attaché à la médecine et à la pharmacie sino-annanmite traditionnelle. Cela ne le rend point hostile à la médecine moderne et il va, lorsqu'il le peut, au dispensaire avec la plus grande confiance 1.
Cette venue d'émissaires du Front populaire fut l'occasion pour bon nombre de villages de présenter leurs voeux en matière de santé publique. On réclamait partout une meilleure assistance par la création d'un centre de soins dans chaque village ou à défaut dans chaque huyên, par la distribution gratuite des médicaments, pour pallier à l'insuffisance des services offerts jusqu'alors dans des hôpitaux de province qui étaient trop loin du lieu d'habitation des villageois. Le conseiller provincial du village de Hac tri (Phu tho), n'a pas hésité à demander un "contrôle sur les médecins chinois et annamites" dans leur exercice afin de limiter les effets néfastes éventuels 1. A titre d'exemple du manque d'infrastructure et de personnel médical, la province de Hai duong ne disposait en 1932 que de 2 hôpitaux, de 6 infirmeries maternités et de 8 infirmeries rurales; et le personnel médical se limitait à 1 médecin européen, 2 médecins indochinois, 7 sages-femmes, 23 infirmiers et 75 bà mu (matrones) 2.
Quoi qu'il en fût, si les Vietnamiens ne manifestaient pas une hostilité particulière à l'égard de la médecine moderne, cela était dû à son caractère utilitaire et à son efficacité dans un délai sensiblement plus court que celui de la médecine traditionnelle qui, visiblement, n'avait pas trouvé de solutions préventives contre les épidémies qui sévissaient depuis fort longtemps dans la population tout entière, comme le choléra, la variole, la peste, la rage... On ignore les ravages causés en 1902 par ces épidémies sur le territoire du Tonkin, cependant rien que pour la ville de Hà nôi, le service destiné à l'examen de tous les corps des individus décédés a enregistré 857 décès, dont 326 de choléra, 213 de la peste, 79 de dysenterie et 239 de paludisme, ce qui représentait 44% de la mortalité totale de la ville; parmi ces victimes il y avait 51 Européens 3. Les vaccinations, à cet égard, apportaient des preuves manifestes de l'efficacité de la médecine moderne. Dès 1895 1, au plus tard, des campagnes de vaccinations contre certaines de ces épidémies ont été organisées dans le Nord. Le rapport de la Résidence de Bac giang au Résident supérieur du Tonkin de 1908 mentionne que des séances de vaccinations avaient lieu tous les trimestres à l'hôpital indigène de la province, et que chaque semaine 200 à 500 vaccinations ou revaccinations ont été pratiquées 2. En 1909 dans la région de Cao bang, les vaccinations ont été opérées dans quatre secteurs, dont l'un à Cao bang-ville, elles ont touché au deuxième trimestre 1040 personnes, au quatrième trimestre 815 enfants et 1689 autres ont été revaccinés; ce qui a permis de constater 517 cas de réussite pour les unes et 664 pour les autres 3. La même année, le médecin vaccinateur de la province de Kiên an s'est rendu successivement dans sept centres les plus importants des cinq huyên: 17.064 personnées ont été vaccinées durant cette tournée, parmi lesquelles 17 cas de variole ont été constatés 4. Faute de statistiques démographiques et d'une série de chiffres d'une année à l'autre pour chaque province au cours de cette période d'une part, et à cause des complications dues aux découpages administratifs successifs au début du siècle d'autre part, il nous est difficile de comparer ces chiffres rapportant la population vaccinée à la population totale de chaque province. Néanmoins, en ce qui concerne la province de Kiên an, si on se basait sur les statistiques de 1919 qui fournissent le chiffre de 235.000 hommes 1, on obtiendrait le rapport de 85 pour mille après avoir introduit un coefficient correcteur dans le calculs. Si on procédait de la même façon pour la région de Cao bang dont la population en 1921 était de 124.000 habitants, on pourrait dire que 25 pour 1.000 des habitants ont été vaccinés. Ce qui nous semble plus important ici, ce serait un ordre de grandeur et non la précision mathématique qui n'aurait pas plus de signification. L'Administration était bien consciente que ces actions de prévention restaient à poursuivre et à généraliser puisqu'en 1909, une réorganisation de Service du la vaccination était à l'étude en vue de les étendre dans tout le territoire 2.
En dépit des efforts entrepris, et sans doute faute de moyens matériels et humains, les épidémies persistèrent encore pendant de nombreuses années. L'été 1914, Hà nôi fut le théâtre du ravage causé par le choléra. A en croire Nguyên Công Hoan, les familles des décédés n'avaient même pas le temps de les mettre dans le cercueil, certains contaminés encore vivants étaient enterrés en même temps que des morts au cimetière de Bach mai 3. En 1930, on enregistre 355 décès dûs à la peste, 1794 dûs à la variole et 2430 dûs au choléra 4. D'autres endémies, dues au manque d'hygiène et au climat, persistaient également comme le trachome qui touchait 50 à 60% des habitants des villages du Tonkin, d'après le rapport de Justin Godart en 1936 5. Cette maladie n'entraîne pas nécessairement la cécité mais le trachomateux, avec une vision réduite de 1/20e à 1/10e, se retrouve "incapable d'effectuer une tâche lui permettant de gagner sa vie". La mortalité infantile était encore plus effroyable. Dans la période 1925-1936, sur 1.000 naissances on comptabilise 230 à 480 décès de moins d'un an et 25 à 190 décès de moins d'un mois 1. Visiblement, ce fort taux de mortalité n'a ému personne ou du moins il ne constituait pas un axe prioritaire dans le cadre des actions médicales et sanitaires.
Mortalité infantile dans la ville de Hà nôi
|
Année |
Naissances |
Décès de -1 an |
Pour 1000 |
Décès de – 1 mois |
Pour 1000 |
|
1925 |
2780 |
1210 |
435 |
490 |
175 |
|
1926 |
3120 |
1500 |
481 |
590 |
188 |
|
1927 |
2960 |
1280 |
433 |
470 |
160 |
|
1928 |
3580 |
1440 |
404 |
440 |
123 |
|
1929 |
3790 |
1600 |
424 |
510 |
134 |
|
1930 |
3970 |
1070 |
230 |
110 |
24 |
|
1931 |
4190 |
1460 |
368 |
440 |
110 |
|
1932 |
4400 |
1470 |
350 |
500 |
119 |
|
1933 |
3150 |
1740 |
396 |
400 |
91 |
|
1934 |
5230 |
1960 |
380 |
460 |
89 |
|
1935 |
4890 |
1710 |
330 |
390 |
74 |
|
1936 |
4600 |
1410 |
290 |
170 |
35 |
SOURCE : NGUYEN Van Ung, Evolution démographique du Vietnam,
thèse de doctorat, 1953.
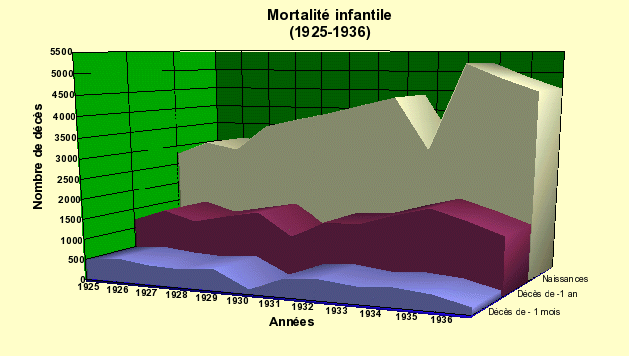
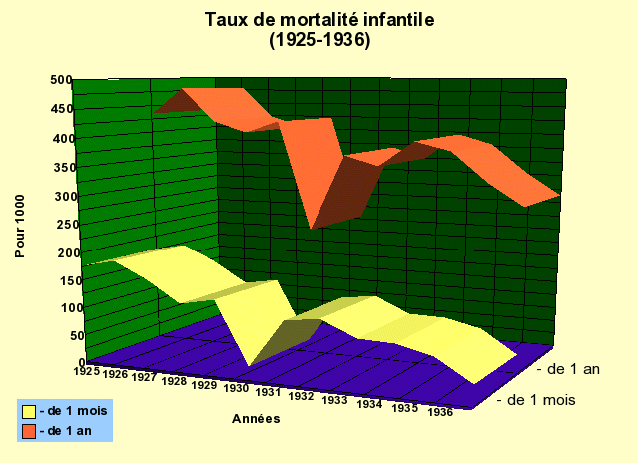
Quoi qu'il en soit, l'Assistance publique continuait à vacciner, en 1930, 1.828.000 personnes contre la variole, 90.000 contre le choléra et 9.000 contre la tuberculose. En 1935 ces chiffres s'élevaient respectivement à 3.843.000, 8.000 et 14.000, et aucune vaccination contre la peste n'a été opérée 1; ce qui laisse à penser que, sans doute, la peste a progressivement disparu du Tonkin au début des années 1930. Il n'en était pas de même pour les autres épidémies, car dans la même période, pour lutter contre le choléra, 14.633 vaccinations et 30.266 revaccinations ont été faites annuellement dans la région de Son la 2.
Le choléra était sans doute l'épidémie la plus difficile à maîtriser. Dans la période 1937-1938, plusieurs foyers ont été repérés: Hai phong, Kiên an, Thai binh, et les environs de Hà nôi. Du 22 au 25 septembre 1937, plus de 100 décès dûs au choléra ont été recensés 3. Des mesures ont été prises rapidement dans la région de Hà nôi où des milliers de vaccins ont été pratiqués chaque jour: au 6 octobre, 113.267 vaccinations ont été réalisées. Mais ce mal persistait dans certaines régions limitrophes de Hà nôi comme au village de Da sy faisant partie de la province de Hà dông. La Mairie de Hà nôi a même reçu un appel de détresse en date du 31 mars 1938 provenant d'un village des environs en ces termes:
Nous sommes des voisins du village Da sy où le choléra sévit depuis plus d'un mois. Chaque jour une dizaine de personnes en sont mortes. Apparemment le Ly truong de ce village n'a encore fait aucune déclaration, ou il l'a peut-être fait mais aucune mesure n'a été encore prise. Au contraire les gens se mettaient à prier, et à faire des offrandes aux génies; et plus on prie plus il y a des morts.
Ayant peur d'être contaminés nous nous sommes rendus au dispensaire mais on nous a répondu qu'il n'y avait plus de vaccins. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Vous avez épargné la population de Hà nôi de cette épidémie, faites en sorte que nous puissions bénéficier des mêmes protections 1.
Les mesures de prévention continuaient à être prises encore dans les années 1940. Pour la ville de Hai phong, le rapport d'inspection de 1943 fait état de 6.109, 1.059, et 1.045 vaccinations antivarioliques, respectivement pour les trois années 1940, 1941 et 1942, et de 37 vaccinations contre le choléra en 1942 2.
Pour des raisons d'ordre matériel (l'éloignement des lieux de dépôts d'archives, par exemple) nous n'avons pu approfondir ces questions comme nous le souhaitions. En effet, nous ignorons, à part la peste qui semble disparaître vers le fin des années 1930, si les autres épidémies ont complètement disparu par la suite. Nous aurions voulu, dans le même ordre d'idée, établir une comparaison entre les différentes divisions administratives du Tonkin sur la portée des actions médicales préventives ou curatives mises en place par le Service de santé pour refouler les fléaux. Ceci n'aurait été possible qu'avec l'existence de données chiffrées sur chaque province et sur une longue période, ce qui n'était pas le cas, car les rapports d'une résidence provinciale à une autre, quand ils nous parviennent, ne fournissent pas les mêmes données, ou ne mentionnent pas les mêmes aspects de la vie. Par exemple, dans la Notice de la province de Hai duong sur la période 1929-1932 datée du 24 octobre 1932, il était bien mentionné le nombre d'établissements médicaux et l'effectif du personnel soignant sans indiquer si des campagnes de vaccinations avaient lieu dans la même période 1. Est-ce que cela signifie qu'aucune vaccination n'a été faite dans la province durant ces années? Nous ne le pensons pas, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, Hai duong, située seulement à 55 kilomètres de Hà noi, était déjà un grand centre urbain à cette époque, et la population totale de la province s'élevait en 1919 à 602.000 habitants, dont 100 Européens, et en 1936 à 752.000. Kiên an qui, situé encore plus loin de Hà nôi à 76 kilomètres, était une province moins importante sur le plan démographique et où vivaient en 1919 seulement 76 Européens contre 235.000 Vietnamiens au total, et 418.000 en 1936, qui ont bien bénéficié des mesures de protection contre les épidémies. Cao bang, qui se trouve à la frontière chinoise, et dont la population en 1936 ne comptait que 171.000 habitants, faisait également partie des secteurs couverts par les vaccinations. Ainsi, il est fort vraisemblable que toutes les provinces du Tonkin s'inscrivaient, tôt ou tard, dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Ceci ne signifie pas que la population entière du Tonkin était vaccinée et régulièrement, car le pourcentage de la population vaccinée reste un autre problème.
Dans la période d'avant, le Rapport politique et économique du deuxième trimestre de 1909 fait par la Résidence de Kiên an 2, donne un chiffre global de 17.064 vaccinations effectuées sans préciser s'il s'agit de la prévention contre la peste, ou contre le choléra ou bien contre la variole. Ce qui présente une difficulté de plus si on veut étudier de façon détaillée les actions de l'Assistance publique.
Le souci des chiffres ne date pas d'aujourd'hui, les gouvernants du début du siècle se sont trouvés déjà confrontés à ce problème, certes, pas pour les mêmes raisons. Et quand les chiffres existent il convient de les prendre avec précaution, surtout ceux du début du siècle où le Service des statistiques n'existait pas encore. Le 5 février 1902 l'attaché du cabinet de la Résidence du Tonkin envoya un télégramme aux résidents-chefs de province pour leur réclamer des données chiffrées sur la population en ces termes:
Très urgent.(...) Gouverneur général se rend bien compte qu'il n'est pas possible de faire au Tonkin un recensement comme il en a été fait un dernièrement en Cochinchine. Aussi me charge t-il de vous demander de fournir ces données approximatives (souligné par nous) sans que la population s'en aperçoive. (...) Prière répondre à cette demande du Gouverneur général dans le plus bref délai. Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre hommes, femmes et enfants sauf pour les Français et les Européens que vous pouvez connaître très facilement 1.
Plus de deux ans après, le ministère des Colonies n'a toujours pas reçu ce qu'il avait demandé. Ainsi le ministre Doumergue se fâcha et envoya une lettre, datée du 27 juillet 1904, à son subordonné direct en Indochine:
(...) Si certaines Colonies m'ont envoyé les résultats des recensements qu'elles avaient effectués, il en est d'autres, au contraire, pour lesquelles le Département ne possède aucune donnée.
J'ai pensé qu'il était absolument urgent de faire cesser cet état de choses, la connaissance du mouvement de la population étant un des éléments les plus nécessaires à posséder pour juger de l'état économique d'un pays. Et dans ce sens, estimant qu'il y aurait intérêt à publier annuellement les statistiques de la population, je vous envoie ci-joint 12 modèles de tableaux. (...) 1 .
En dépit de cette insistance du ministre des Colonies, il fallut attendre 1921 pour qu'un recensement général de l'Indochine fût effectué, et 1929 pour voir fonctionner normalement le Service des statistiques en tant que rouage administratif. Pour toutes ces raisons, les chiffres fournis par l'Administration avant cette date ne constituaient que des estimations car elle avait du mal à établir des statistiques rigoureuses. En effet, les méthodes de collecte étaient laissées au libre choix des administrations locales qui confiaient à leur tour aux chefs de village le soin de recenser. Quand on sait combien les villages vietnamiens étaient méfiants des autorités centrales sur cette question, on peut se douter de la fiabilité des chiffres officiels, sans parler du mouvement de la population, de la migration des paysans vers les centres urbains et du fait qu'ils continuaient à payer leurs impôts dans leur village respectif et non dans les villes où ils travaillaient. Le recueil des statistiques de la période 1913-1922 mentionne bien une marge d'erreur possible de 5% sur les données chiffrées de la population 1. Par contre, il n'y a pas lieu de remettre en doute le nombre de vaccinations faites par l'Assistance publique qui devait tenir des registres, lesquels n'avaient rien à voir avec des recensements; et elle n'avait aucun intérêt à fausser les chiffres. Par ailleurs, les Instituts Pasteur étaient tenus de fournir des vaccins à l'Administration en vertu des contrats passés entre l'Institut Pasteur de Paris et le gouvernement général de l'Indochine.
Tous ces éléments nous permettent de supposer qu'il y avait plusieurs phases dans les actions médicales et sanitaires en général, et dans la lutte contre les épidémies en particulier. La première décennie du siècle aurait été la mise en place d'une structure d'accueil dont seuls profitaient les grands centres urbains. La décennie d'après aurait été caractérisée par l'élargissement de cette structure au niveau local avec plus de moyens humains et matériels. La phase de généralisation du dispositif médical se serait située dans les années 1930. Certes, au début du déclenchement de la 2e Guerre mondiale, toutes les épidémies n'ont pas complètement disparu du Tonkin, cependant un progrès énorme a été réalisé, permettant ainsi de sauver un nombre incalculable d'être humains. Est-ce que cela veut dire pour autant que la médecine moderne a étouffé la médecine traditionnelle? Une rétrospective de la rencontre de ces deux pratiques permettrait de relativiser la place qu'occupait chacune d'elles dans la vie quotidienne vietnamienne.
B. LA MEDECINE TRADITIONNELLE A L'EPREUVE
Si la médecine traditionnelle est connue depuis fort longtemps et rentre dans le cadre des pratiques sociales, elle n'a jamais été érigée en institution, à une courte période près, en un véritable système de formation et de transmission des connaissances. Ce qui explique que l'organisation de la santé publique au Vietnam n'a jamais été mise sur pied sauf sous Gia Long qui a ébauché une première organisation sur le plan administratif. Quant à l'enseignement de la médecine, il fallut attendre 1850 pour qu'il fût officialisé sous le règne de Tu Duc. Mais ces tentatives n'ont pas survécu, en effet les connaissances liées à la médecine et à la pharmacopée ne dépassaient guère le cercle restreint des lettrés qui, la plupart du temps, par motivations personnelles, se sont consacrés à les acquérir d'une façon autodidacte. Il convient de rappeler aussi que ces connaissances font partie intégrante du monde conceptuel, de la vision cosmogono-philosophique sino-vietnamiens; d'après lesquels le macrocosme (l'univers) comme le microcosme (l'être humain) sont formés de cinq éléments de base, appelés ngu hành, et obéissent aux mêmes principes fondamentaux, à savoir le métal, l'eau, le feu, le bois, la terre d'une part, et le yin et le yang (duong et âm en vietnamien) d'autre part. Au niveau du microcosme, c'est l'association de ces éléments et de ces principes qui détermine l'état mental et physique de l'individu. Autrement dit, la santé ou la maladie ont deux causes possibles: les causes externes comme le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse, et des causes internes comme la joie, la colère, le chagrin, l'affection, la haine, la sensualité 1. Il va sans dire qu'un déséquilibre dans l'association de ces éléments entraîne obligatoirement un déséquilibre dans l'état mental ou physique de l'être humain. Le médecin intervient et essaie de trouver les causes exactes de ce malaise.
Contrairement au médecin de formation moderne qui diagnostique avec des procédés scientifiques dans lesquels "l'interrogatoire" ne joue qu'un rôle mineur, le médecin traditionnel se renseigne systématiquement par un "interrogatoire" détaillé qui constituera pour lui une source importante d'informations sur le malade. Ce type de relation satisfait à la fois le malade qui trouve qu'on s'intéresse à lui et le médecin qui obtient des renseignements nécessaires à la déduction des causes de la maladie, lesquelles ne peuvent être que le résultat d'un déséquilibre plus ou moins important des principes cosmogonies-philosophique-médicaux. Les cinq éléments de base forment un ensemble qui obéit au principe portant le même nom, thuyet ngu hành (principe des cinq éléments), lequel se subdivise en deux lois:
- luât tuong sinh ou "la loi de concordance" établit les rapports selon lesquels les cinq éléments de base s'appuient les uns sur les autres pour coexister. On a par exemple, "l'eau" engendre "le bois", "le bois" engendre "le feu" qui, à son tour, engendre "la terre" laquelle engendre "le métal", et "le métal, "l'eau" et ainsi de suite. Par ailleurs, dans ces liens de causalité, l'élément qui engendre est appelé "l'élément-mère" et celui qui est engendré, "l'élément-enfant";
- Luat tuong khac ou "la loi d'opposition" précise les relations suivant lesquelles ces éléments s'opposent les uns aux autres: "le bois" s'oppose à "la terre", "la terre" à "l'eau", "l'eau au "feu", "le feu" au "métal" et "le métal" au "bois", etc.
Il ressort de cette conception une sorte d'auto-régulation entre les éléments de base d'une part et entre les principes d'autre part. La nature ne peut se dispenser ni de la loi de concordance ni de celle d'opposition pour la simple raison que l'une existe dans l'autre et vice-versa. Sans engendrement il n'y aura pas de développement et sans opposition, le sur développement deviendra nuisible. Ainsi, ces deux lois donnent naissance à une autre, appelée "la loi de transformation" qui viendra réguler l'ensemble:
- "le bois" s'oppose à "la terre" qui engendre "le métal" lequel viendra à son tour s'opposer au "bois";
- "l'eau" s'oppose au "feu" qui engendre la "terre" laquelle s'oppose à "l'eau, et ainsi de suite. L'interprétation de cette loi peut être assimilée à la "vengeance". Si on prend ce dernier exemple, on dira que quand "l'eau" s'oppose trop au "feu", son fils, "la terre" viendra lui porter secours en s'opposant à "l'eau" pour rétablir l'équilibre 1.
Le corps humain, lieu que régissent ces lois et ces principes, est donc assimilé aux cinq éléments de base, par exemple, le foie est assimilé au "bois", le coeur au "feu", les reins à "l'eau", les poumons au "métal" et l'abdomen à "la terre", etc. L'inspection minutieuse des organes externes, lesquels correspondent à des organes internes, vient compléter "l'interrogatoire" du malade pour déterminer les parties défaillantes et les causes respectives des défaillances. Le résultat final guide donc le médecin dans la préparation des médicaments qui ont pour rôle de rétablir l'équilibre général de l'organisme humain. Contrairement au traitement occidental moderne qui s'attaque localement aux maux, les médicaments traditionnels qui forment un sous ensemble de la conception cosmogono-philosophique, agissent sur l'ensemble de l'organisme. Effectivement, un remède se compose généralement de quatre substances, ayant chacune une ou des fonctions spécifiques, telles que:
- quân (le roi) qui est la substance principale dont la fonction consiste à attaquer directement le mal:
- thân (le génie) qui a pour rôle de renforcer la substance quân;
- ta (l'officier) s'emploie pour deux raisons: L'une sert à réduire les effets des constituants nocifs en surplus dans la substance quân, l'autre à renforcer celle-ci dans le cas où elle doit faire face aux autres maux subsidiaires;
- su (l'émissaire) possède également deux fonctions: la première consiste à faciliter l'acheminement des constituants vers les endroits où ils sont destinés, et la seconde à aider les autres substances à accomplir leurs fonctions 1.
En dépit de son approche globale, la médecine traditionnelle n'en demeure pas moins une discipline empirique. Bien que la tradition vietnamienne distingue la médecine du Nord (thuôc bac), celle qui vient directement de la Chine, de la médecine du Sud (thuôc nam), inspirée de celle du Nord mais enrichie par l'apport des plantes et des produits locaux, ces deux filières obéissent aux mêmes principes et se fondent sur les mêmes procédés empiriques, à l'opposé de la médecine européenne qui se base sur l'expérimentation. Les deux grands médecins vietnamiens, Tuê Tinh et Lan ông n'ont pas non plus révolutionné leurs méthodes. Le premier, un bonze qui a vécu vraisemblablement au XVIIe siècle, a décrit 650 médicaments spécifiquement vietnamiens préférables, selon lui, à ceux de la Chine, et a fait preuve d'une réelle originalité 2. Tandis que le second vivant au XVIIIe siècle, a laissé une encyclopédie médicale en 10 volumes que les docteurs Pierre Huard et Maurice Durand qualifient "d'oeuvre remarquable par ses tendances rationalistes, sa clarté et son éthique élevé 1". Quoi qu'il en fût, ces deux écoles qu'on qualifie aujourd'hui de médecine douce, sont entrées dans la tradition et dans les pratiques sociales vietnamiennes, en effet les masses populaires connaissent des recettes médicinales, transmises empiriquement, contre les maux courants. Il existait très vraisemblablement dans chaque village vietnamien un médecin traditionnel plus ou moins expérimenté à qui on faisait appel pour des soins qui dépassent les connaissances populaires. Ce personnage jouissait d'un respect réel et qu'on érigeait au rang de "maître"; le terme vietnamien qui le désigne en témoigne: on l'appelait thây thuôc ou thây lang (le maître de la pharmacopée). Le contact qu'il entretenait avec les malades renforce sa popularité. Il se rendait effectivement, à chaque fois qu'on avait besoin de ses connaissances, au domicile du malade, puis s'entretenait avec lui de longues conversations afin de lui permettre d'induire les origines de la maladie et de préparer les remèdes correspondantes. Si sa visite n'était pas payante il ne réclamait qu'une somme symbolique pour dédommager les frais de préparation des remèdes, et dans les cas graves les médecins réputés n'acceptaient d'être payés qu'après que le malade fût guéri. En revanche, la modeste "rémunération" était souvent compensée par des cadeaux que la famille du malade offrait au médecin lors des fêtes du nouvel an en signe de reconnaissance. C'était bien cette base sociale qui permettait à la médecine ancestrale de s'insérer dans les pratiques traditionnelles. Cette institution informelle venait de fait à pallier à l'absence d'une structure de santé publique. En somme l'autorité politique n'avait aucune prise sur le corps de métier des médecins sauf en cas d'erreur grave dans l'administration de produits pharmaceutiques ayant entraîné la mort des patients.
A l'inverse, la médecine moderne introduite au Vietnam a été très vite soutenue par une infrastructure, laquelle relevait de l'autorité politique. L'implantation des établissements médicaux dans les centres urbains ou dans les chefs-lieux de province et la pénurie des médecins de formation moderne, d'une part, et le tarif prohibitif des consultations et des médicaments qui dépassait les moyens de la majorité de la population, d'autre part, interdisaient la diffusion de la médecine moderne à toutes les couches sociales, car le vivier de la population vietnamienne demeurait la campagne. Les vaccinations (gratuites) dont bénéficiaient les Vietnamiens dès le début du siècle rentraient plutôt dans le cadre des campagnes prioritaires contre les épidémies, par conséquent, elles constituaient, sans doute, la seule possibilité leur permettant d'accéder à la médecine moderne. Pour les autres soins, ils faisaient ainsi appel plutôt aux recettes traditionnelles. "Quand l'Annamite tombe malade, écrit Nguyên Van Huyên, il se contente le plus souvent des recettes médicales qui ont été transmises oralement depuis de nombreuses générations. Ces recettes sont extrêmement nombreuses et sont encore suivies docilement par la grande majorité des Annamites qui ne sont pas encore touchés par la médecine européenne 1". Le journal Blanc et Jaune, dans sa critique périodique de la pharmacopée sino-annamite, donne l'écart des prix pratiqués entre les médicaments modernes et les recettes traditionnelles:
Un rhume, une bronchite légère vous coûtent, pour le moins trois flacons de sirop, soit un minimum de 7 piastres.
Le médicastre sino-annamite vous délivrera un produit presque identique à base de gaïacol également, pour 0,50 piastre.
Et l'auteur de ces lignes de s'élever pour désapprouver les pratiques de la médecine moderne, dans le débat qui oppose celle-ci à la médecine traditionnelle:
Oui, je sais, il faut beaucoup de courage pour défendre les pauvres car de l'autre côté s'étale la puissance de l'argent, mais je le fais parce que c'est un devoir que de défendre la santé publique 1.
Depuis que la médecine moderne a fait preuve d'une certaine notoriété et sans que le nombre de médecins et de pharmaciens de formation moderne ait sensiblement augmenté durant les années 1920 et 1930, la pharmacopée et les pratiques traditionnelles en matière de santé ont été remises en cause. L'Administration a procédé à plusieurs réformes limitant la fabrication et la vente des produits médicaux traditionnels sans arriver à les faire appliquer. L'origine de ces réglementations des toxiques remonte à 1919, date à laquelle a été stipulé le décret du 16 juillet sur l'importation, le commerce, la détention et l'emploi des substances vénéneuses en Indochine. Ce texte n'était rien d'autre que la copie-conforme des dispositions du décret du 14 septembre 1916 portant règlement d'administration publique dans la métropole 1. Après avoir subies diverses modifications au fil des années, ces réglementations ont été purement et simplement abrogées le 26 mars 1935. C'est dans ce contexte que la commission de la médecine sino-annamite a confié, au terme du procès verbal de la réunion du 26 avril 1938, une mission à une sous-commission d'étudier la réglementation des toxiques, des textes légaux existants ou à proposer pour parer aux abus actuels 2. Cette sous-commission déplore la non application des textes législatifs en ces termes:
En fait qu'en est-il advenu? (...) On se trouve dans cette situation irrégulière que sans être expressément autorisés par un texte réglementaire analogue à celui qui régit la pharmacie française, les marchands de médicaments ou les médecins sino-annamites emploient des toxiques et livrent à leur clientèle des produits toxiques, en violation de la législation sur cette matière 3.
Au terme de cette étude, la sous-commission préconise qu'"il convient logiquement d'ordonner l'interdiction de l'emploi et de la vente des produits toxiques généralement quelconques en matière de pharmacopée indigène 4 ". Cependant la décision finale appartient à la "commission de la pharmacopée indochinoise". Cette volonté de réglementer les pratiques relatives à la pharmacopée traditionnelle a ainsi donné lieu à une polémique opposant les anciens aux modernes sur le terrain de la santé. La presse indochinoise en langue française, surtout, n'a pas laissé échapper cette question touchant à un point sensible de la tradition. Le journal Blanc et Jaune, sous la plume de J. Scientia, s'élève pour prendre position en faveur de la médecine traditionnelle en apportant des arguments irréfutables sans pour autant condamner la médecine moderne:
Tous les ans la même campagne revient sur l'eau: il faut réglementer sinon interdire la pharmacopée sino-annamite. Pourquoi?
Parce qu'elle est capable des pires méfaits.
Pensez donc elle est composée d'arsenic, de mercure, de strychnine, et autres poisons violents.
La conclusion coule de source sous prétexte de contrôle la supprimer.
Mais les grands défenseurs de la santé publique ne nous disent pas par quoi le pauvre annamite remplacera ces médicaments qui, s'ils ne soulagent pas toujours, n'ont par contre jamais tué personne.
Car il faut bien le dire le jour où les pharmaciens aux titres "longs comme ça" cesseront de vendre selon un tarif exorbitant, la pharmacopée indigène disparaîtra.
Pareillement pour les dentistes: quand l'extraction d'une dent ne coûtera plus que 10 piastres, eh bien, les arracheurs de molaires n'auront plus de clients. (...)
On a l'air de croire, -c'est là le grand argument que les thây thuôc indigènes se servent de l'arsenic, du mercure, de la strychnine au petit bonheur.
Mais rien n'est plus faux: le mercure, l'arsenic, la strychnine sont connus depuis fort longtemps. Il suffit de prendre l'histoire de Chine pour voir que Huê dà employait le mercure et l'arsenic pour soigner la syphilis. (...)
Il n'y a pas que des ânes chez les médicastres. S'ils sont en retard sur la thérapeutique moderne du moins restent-ils indispensables à la population pauvre.
Au lieu de les combattre on ferait mieux d'émettre des produits bon marché ou encore de collaborer pour créer une pharmacopée modernisée par un mélange harmonieux des produits chimiques avec les végétaux locaux. (...)
Hippocrate avait raison de dire que celui-là seul est médecin qui sait guérir, or la population annamite affirme que la pharmacopée sdino-annamite la guérit. Que veut-on de plus? 1
Dans la même période, La tribune indochinoise, sous le titre de "Plaidoirie en faveur de la médecine sino-annamite", apporte un autre éclairage sur le débat:
Un point interrogatif se pose de prime abord: par qui est réclamée cette réglementation, parfois si draconienne qu'elle constituerait l'assassinat pur et simple de son objet?
Réponse: par divers organismes et syndicats de médecins et de pharmaciens de l'école moderne, c'est-à-dire occidentale. (...)
Pour l'immense majorité du public impartial, il est naturel que nos docteurs et pharmaciens diplômés des facultés françaises souhaitent la disparition de rivaux gênants et tendent leurs efforts conjugués pour y parvenir. Mauvais calcul, ajouterions-nous.
De la disparition des guérisseurs qu'en langage courant on appelle charlatan ne s'ensuivrait pas forcément l'accroissement numérique des partisans de la méthode pasteurienne. (...)
Maints obstacles s'opposent encore, et pour longtemps, à la propagation intensive de la thérapeutique européenne dans la masse de nos compatriotes, surtout ceux des campagnes et des couches sociales modernes.
Eussent-ils une confiance aveugle dans les disciples de Claude Bernard et de Marcelin Berthelot, nos humbles secrétaires à 40 ou 60 $ par mois se refusent à payer 3 ou 5$ une simple consultation.
De même, les broussards ne s'imposeront jamais un déplacement d'une cinquantaine de kilomètres, aller et retour, pour le plaisir de se faire soigner par des compétences qu'on ne trouve guère, à l'heure qu'il est, que dans les chefs-lieux de province, sinon dans les capitales de Saigon ou de Hà nôi 1.
La commission de la pharmacopée indochinoise devait trancher cette question qui n'a que trop durer. Cependant, une autre étude dont on ignore l'origine lui a été soumise à la même période. Ce texte allait à l'encontre des travaux de la sous-commission chargée de faire des propositions à ce débat. Le dernier texte prenait effectivement en compte des données objectives et suggérait des mesures nettement plus constructives:
Dans l'étude de tous les problèmes se rapportant à la pharmacopée sino-annamite, un certain nombre de principes ne doivent pas être perdus de vue:
1. La très grande majorité de la population a recours actuellement aux méthodes de la thérapeutique traditionnelle et même dans la population annamite évoluée. (...)
3. Le recours aux méthodes de traitement et aux produits de la pharmacie occidentale est actuellement hors de la portée des Indochinois moyens. Le prix prohibitif des consultations et actes médicaux, le prix élevé des médicaments occidentaux et leur conditionnement non approprié aux goûts et aux possibilités de la population constituent un obstacle insurmontable actuellement à la généralisation et à la protection officielle de la pharmacie occidentale.
4. L'utilisation par la plus grande masse de la population de la pharmacopée traditionnelle répond donc à un besoin devant lequel il faut s'incliner. (...)
Schématiquement, la question se présente de la façon suivante:
Les pharmaciens européens ou de formation européenne demandent à être protégés par application du décret du 16 juillet 1919. (...)
D'un autre côté se placent les représentants de la pharmacopée sino-indochinoise dont les intérêts ne sauraient être négligés 1 ".
Les auteurs de ce texte préconisent donc:
- l'incorporation de certains produits et de certaines plantes dans la pharmacopée occidentale;
- le développement de la culture et de la production des plantes médicinales sous forme industrielle pour en faire une nouvelle ressource de l'Indochine qui importait alors 80% de ses besoins à la Chine;
- l'étude systématique de la pharmacopée sino-vietnaienne avec l'objectivité scientifique nécessaire, afin que les étudiants en médecine ou en pharmacie puissent profiter des possibilités ou des dangers de cette pharmacopée;
- la traduction des livres de médecine chinoise, le rassemblement des travaux existants sur ce sujet en une bibliothèque centrale qui sera mise à la disposition des chercheurs, bref, la constitution, dans langage de nos jours, d'une véritable banque de données; etc.
C'était donc un vaste programme. Nous ignorons cependant si la commission compétente a approuvé ces idées ou non car aucun autre texte officiel nous est parvenu. De toute manière, le climat d'Avant-Guerre n'aurait pas permis la mise en oeuvre de ce projet dans de bonnes conditions. Ce qui nous semble plus important ici est de connaître la place qu'occupait chacune des deux médecines et leur impact sur la société vietnamienne. En d'autres termes l'introduction de la médecine moderne a-t-elle suscité des réactions de la part des Vietnamiens et lesquelles?
Sans pouvoir approfondir les aspects particuliers de cette confrontation entre la modernité et la tradition, nous sommes en mesure de formuler quelques remarques, à partir de cette esquisse de la place qu'occupaient respectivement la médecine moderne et la médecine traditionnelle pendant la colonisation.
En premier, nous constatons que la mise sur pied de la santé publique n'était pas une affaire urgente par apport aux autres tâches; par exemple, les colonisateurs ont pensé à réorganiser le système d'enseignement avant de s'attaquer à ce problème. Si l'enseignement traditionnel a été purement et simplement supprimé et remplacé par l'enseignement franco-indigène, bien que les tentatives n'aient pas manqué, les pratiques de la médecine traditionnelle n'ont pas subi ce triste sort. Tandis que l'enseignement était conçu comme un instrument "civilisateur" qui devait en principe s'adresser à toutes les couches sociales, la santé publique s'occupait avant tout du bien être du contingent colonial présent dans des grands centres urbains. Peut-on parler d'oeuvre humanitaire de la colonisation, le fait que les Vietnamiens ont pu profiter des vaccinations contre les épidémies? Il est difficile de défendre cette idée car, d'une part, la colonisation n'a pas pour but de veiller au bonheur et au bien être des colonisés, et d'autre part, les épidémies ne connaissent pas les frontières raciales; cependant, il convient de distinguer les intentions des faits.
En deuxième lieu, contrairement à l'enseignement, l'introduction de la médecine moderne n'a pas provoqué des remises en cause profonde des pratiques ancestrales, ni créé une rupture avec la tradition. Ceci s'explique par le fait que ce dernier obéissait à la volonté politique tandis que la santé publique échappait plus ou moins à cette situation, du moins jusqu'aux années 1930. C'est sans doute pourquoi les Vietnamiens ne manifestaient pas d'hostilité particulière à l'égard de la médecine moderne qui ne faisait que prendre la relève dans les cas où leurs recettes traditionnelles se trouvaient dans l'impasse. Par ailleurs, comme la santé ne constituait pas politiquement un axe prioritaire, sa diffusion ne pouvait que se limiter dans les zones où elle était implantée, car les résultats dépendent toujours des moyens mis en oeuvre. On pourrait dire que c'est l'absence de volonté politique qui a permis à la médecine traditionnelle de survivre, autrement il aurait fallu plus de moyens et l'instauration des mesures répressives pour pouvoir la remplacer par la médecine moderne. Dans ce cas la répression aurait provoqué des réactions de rejet et sans doute des remises en cause profonde avant d'aboutir à une rupture. Des trois agents de modernisation, l'enseignement, les sciences et les techniques, et la médecine, cette dernière était sans doute la mieux accueillie par les Vietnamiens, parce qu'elle répondait aux besoins réels de la population et parce qu'elle n'était pas accompagnée d'actes politiques répressifs.
Les années 1920 et surtout la décennie d'après marquaient la modernisation de la société vietnamienne, du moins dans les centres urbains, mais aussi l'émergence de la nouvelle génération formée à l'école occidentale, l'émergence des milieux culturels et des forces politiques qui allaient reposer la question fondamentale de la dépendance, chercher des solutions à cette issue.
CHAPITRE 3
LES FORCES ET LES MILIEUX
PORTEURS DE MODERNITE
A quelle date remonte le premier débat sur la modernité de la société vietnamienne et à l'initiative de quelle force ou de quel milieu? La modernité a-t-elle été prise en compte dans les discours politiques des révolutionnaires qui s'attribuaient le rôle d'émancipateur et les tâches de libération nationale? Quels étaient les forces et les milieux porteurs de modernité ?
Nous avons vu que sous le règne de Tu Duc (1847-1883), l'étude de la médecine a été introduite dans l'enseignement comme une filière à part. Les tensions politiques et le climat de guerre qui traversaient ce règne n'ont, sans doute, pas permis à ce projet de se concrétiser: on était en pleine conquête coloniale qui s'accélérait avec la disparition de Tu Duc. Sous ce règne est apparu un dignitaire qu'on peut qualifier de hors du commun, en la personne de Nguyên Truong Tô (1828-1871). Comme il était de confession catholique, l'accès au concours mandarinal lui a été interdit. Sa fréquentation du milieu ecclésiastique lui a permis d'apprendre la langue française avec l'évêque Gauthier, son protecteur. En 1960 celui-ci l'a ramené à Paris où il a séjourné pendant deux ans en se consacrant aux études. De retour au pays, il a rédigé ses voeux adressés à la Cour. Après un deuxième séjour en France, Nguyên Truong Tô est revenu avec trois professeurs, un technicien, du matériel pédagogique et des instruments d'expérimentation scientifique afin de permettre à la Cour de créer une école technique 1. Ses voeux consistaient à faire du Vietnam un pays modernisé sur le plan matériel: renouvellement de l'arsenal, réformes des impôts, résolution de la question alimentaire, etc. Sur le plan politique, il suggéra à la Cour d'exploiter le différend anglo-français afin de forcer les Français à partir. Indécis devant cette situation difficile, le roi Tu Duc sonda alors l'opinion en posant comme sujet de réflexion aux candidats au concours impérial: "Que pensez-vous de l'ouverture du pays vers le monde occidental? 2" La réponse de la Cour fut quasi unanime contre l'ouverture. L'opinion de Phan Thanh Gian, le mandarin conservateur de la Cour qui a voyagé en France fut l'illustration de cette prise de position: "Là-bas (en France), c'est la civilisation mais malgré tout ils (les Français) sont restés sauvages car ils n'ont pas de fondements culturels comme nous (allusion au confucianisme) 3. Les idées de Nguyên Truong Tô lui ont coûté la vie, car peu de temps après, en 1871, il a été empoisonné au cours d'un repas non à la Cour mais chez ses "amis" et l'idée de la modernisation, elle aussi, a été enterrée avec lui. Ainsi la Cour a raté son rendez-vous avec le monde moderne par méconnaissance et par conservatisme.
LES FORCES
Le danger mortel
pour l'intellectuel révolutionnaire est de vouloir pousser tout le monde.
TA THU THAU
Il convient, dans un premier temps, avant de chercher à répondre à ces questions, d'identifier les forces politiques en tant que telles et de les situer dans le temps afin d'en dégager l'évolution, si évolution il y a. Être révolutionnaire au Vietnam au temps de la colonisation et être révolutionnaire tout court, cela recouvre-il les mêmes analyses, les mêmes démarches? Ces deux attitudes débouchent-elles nécessairement sur la même voie à prendre?
Un retour dans le passé permet de constater que parmi les dignitaires de la Cour de Huê, il y en avait qui étaient résolument opposés, à son début, à la présence française avalisée par des traités de protectorat. Cette hostilité s'est traduite par une résistance armée conduite successivement par Nguyên Tri Phuong et Tôn Thât Thuyêt, pour ne citer que les plus connus. Cette tradition de lutte contre les envahisseurs étrangers a été reprise par les lettrés de la fin du XIXe siècle. Mais leur échec face à l'entreprise de la colonisation marquait la fin de la première époque de résistance, et par là même, le début de la fin de l'autorité des lettrés dans la société vietnamienne qui les avait toujours considérés comme les guides de la nation. Durant cette période, être révolutionnaire équivalait à être contre le colonialisme français, autrement dit, il s'agit uniquement de sauver la souveraineté nationale et la monarchie. Par ailleurs, les masses populaires n'étaient pas impliquées dans cette épreuve de force qui opposait les lettrés patriotes aux occupants étrangers; ce qui explique en partie l'échec des premiers. Sur un autre plan, être révolutionnaire pour un Vietnamien ne signifiait pas nécessairement remettre en cause les fondements de la société, car le champ politique occupait l'avant-scène de la question du jour. Cependant, de ces échecs cuisants une certaine frange de lettrés ont su tirer des leçons qui devaient s'imposer, ce qui viendrait nuancer l'attitude révolutionnaire prise par les générations à venir. L'école du Dông kinh nghia thuc apporte, à cet égard, une illustration sans précédent. Les fondateurs de cette "école" ont fini par comprendre que dans le contexte du monde moderne, lutter sur le plan politique ne suffisait plus, et qu'il fallait aussi mener des combats sur d'autres terrains, parmi lesquels les problèmes de société devaient être inscrits à l'ordre du jour. Poser le problème de la révolution en termes de transformations sociales reviendrait à remettre en question les fondements de la société. Bref, la tradition a été mise à l'index par cette génération de lettrés, formés pourtant à l'ancienne école. La brève existence de Dông kinh nghia thuc ne permet de mesurer ni la portée de ses idées ni les limites des changements préconisés. Cependant cette manière de poser le problème ouvre de nouvelles perspectives, jette de nouvelles bases à une réflexion qui ne demande qu'à être approfondie. Celle-ci n'a été reprise que deux voire trois décennies plus tard. Entre temps, l'idée de la colonisation a fait son chemin, et le problème ne se limite plus à celui qui oppose les antagonistes entre eux, mais se complique avec les nouvelles données de la scène internationale. La France ruinée par la Première Guerre en sort affaiblie, la victoire des Bolcheviks donne de l'espoir aux mouvements ouvriers qui vont se consolider dans les années et décennies à venir, les effets de la crise de 1929 qui bouleversent l'Indochine révèlent les failles du capitalisme. La vision marxiste devient alors pour les pays colonisés une clef pour sortir de l'impasse. La jeune génération, formée à l'école occidentale, et pour certains en Occident même, essaie ainsi de s'intégrer dans le nouveau contexte de lutte opposant cette fois le prolétariat au capitalisme afin de porter le problème de la colonisation sur la scène internationale. Être révolutionnaire pour un Vietnamien signifie alors être contre l'impérialisme. Ceci ne constitue pas seulement un état d'esprit mais doit se traduire également en actes concrets qui prennent en compte à la fois une analyse et des moyens modernes à la hauteur des difficultés. Le communisme, à cet égard, apparaît alors comme une solution de rechange. Il permettrait de prendre en considération ces prérogatives tout en évitant de tomber dans la voie tracée par le capitalisme. Pour beaucoup, être révolutionnaire signifie alors devenir communiste. La clandestinité des mouvements révolutionnaires de l'époque a donné naissance à un langage codé. Souvent, quand deux jeunes Vietnamiens gagnés à la cause nationale se rencontraient, ils s'interrogeaient mutuellement pour situer l'interlocuteur en lui demandant: "Tu es en quelle classe? Au Cours moyen ou au Cours supérieur ?" En fait les initiales du Cours moyen (C.M.) désignaient le terme cach mang (révolutionnaire), et celles du Cours supérieur (C.S.) font allusion à công san (communiste). Dans cette hiérarchie, être communiste (C.S.) est considéré comme supérieur à être révolutionnaire (C.M.), puisque le Cours supérieur (C.S.) est plus élevé que le Cours moyen (C.M.) 1. Il s'agissait bien entendu de la version communiste de l'époque.
L'interconnexion du mouvement communiste naissant au Vietnam avec le mouvement communiste international par l'intermédiaire de la jeune génération gagnée aux idées de Marx et d'Engels, et ayant séjourné en Occident et en France particulièrement, donne un nouveau souffle au mouvement de libération nationale. Un aperçu sur la presse anti-coloniale des années 1920, et surtout celle des années 1930, apporte un éclairage sur le climat et sur les questions qui dominaient les débats de cette époque. Pour ne prendre que le journal La Lutte comme exemple, en se référant aux travaux de Daniel Hémery 1, on s'aperçoit que les thèmes les plus fréquemment abordés demeuraient la politique internationale suivie de près par la question sociale en termes nouveaux, par exemple, la condition ouvrière, les grèves, le syndicat, etc. 2. La question nationale est liée aux revendications pour la libre expression et pour les libertés démocratiques. Ainsi le combat de libération nationale se double d'un autre combat axé sur l'idée de démocratie et plaçant la Colonie sur le même plan que la Métropole. Cependant, ce combat pour la démocratisation ne peut s'improviser car cela suppose l'apprentissage d'une nouvelle forme de lutte. Dans un premier temps, pour la concrétiser, il faut propager ces nouvelles idées auprès des autres couches sociales, puis dans un deuxième temps s'organiser en mouvement social, le faire reconnaître en tant que force légale, et contraindre le pouvoir colonial à négocier à défaut de pouvoir le renverser. Dans son numéro 8 du 1er janvier 1937, le journal Quân chung (Les masses) qui se posait comme "organe de diffusion du communisme" (co quan truyên ba chu nghia công san), adresse une lettre ouverte aux camarades de l'Indochine en ces termes:
"Notre devoir fondamental consiste à créer un parti révolutionnaire de classe au service du prolétariat en Indochine, ainsi actuellement tous nos efforts sont concentrés sur cette tâche. La réalité en Indochine et les documents en notre possession permettent de constater qu'il n'existe pas à l'heure actuelle un parti communiste clandestin qui serait à l'avant-garde du prolétariat sur le champ de la lutte. S'il en existe un, les idéaux ne sont pas encore fondés, l'organisation laisse à désirer. (...) Ainsi le prolétariat n'a pas encore en main l'arme nécessaire dans le combat décisif contre l'impérialisme et le capitalisme. (...) Nous pensons que le devoir fondamental pour les camarades en Indochine est de lutter pour créer le parti et les organisations de masse pour le soutenir, d'une façon clandestine ou non selon les conditions réelles et les forces révolutionnaires existantes". (...)
Ces tâches devaient absorber une part trop importante des énergies des jeunes révolutionnaires pour qu'ils eussent le temps de se pencher sur d'autres thèmes, non moins importants d'ailleurs, mais qui se sont vus déclassés, compte tenu du contexte de l'époque.
Est-ce que ce schéma s'appliquait au Nord qui ne pouvait bénéficier d'une certaine liberté d'expression comme ce fut le cas du Sud ? D'une manière générale les révolutionnaires du Nord n'avaient pas d'autre choix que celui de se livrer à la clandestinité. La répression sans réserve qui a frappé en 1930 l'insurrection du parti nationaliste Viêt Nam Quôc Dân Dang (VNQDD) et les soviets du Nghê Tinh, explique la voie choisie par les mouvements politiques. Cependant, l'apprentissage d'une nouvelle forme de combat se poursuivait sur les lieux de travail. Du 1er mai 1929 au 1er mai 1930, l'Administration a signalé des dizaines de journées de grève dans le Nord dont 5 en juin 1929 1. Ces grèves sont concentrées surtout dans les zones d'exploitation des entreprises de transformation: à Hai phong, la Verrerie d'Extrême-Orient, la Société cotonnière, la Société franco-asiatique des pétroles, la Cimenterie; à Nam dinh, la Société cotonnière, l'usine électrique, etc. Quoi qu'il en fût, ces actions traduisaient plutôt le mécontentement par rapport à la condition ouvrière qu'une véritable volonté de changement social qui n'exclurait pas les fondements de la société vietnamienne elle-même. A cet égard, le communisme apparaît comme une solution qui permettrait de rompre à la fois avec la colonialisme et avec l'ancienne conception de l'Etat et de la société. Pour les raisons évoquées liées au contexte, les communistes considéraient que la révolution culturelle ne pouvait se réaliser qu'une fois que la révolution politique serait terminée. Il ne nous appartient pas de déprécier une voie par rapport à une autre, néanmoins on s'aperçoit que quarante ans après la révolution politique, la révolution culturelle reste à faire au Vietnam. Ceci s'explique en partie par le fait que les révolutionnaires vietnamiens (communistes ou autres) sont avant tout des patriotes voire des nationalistes. Or, le contexte le plus favorable pour qu'un individu se situe dans son pays comme patriote ou révolutionnaire, c'est quand il se trouve face à l'étranger, et lorsque l'étranger n'y est plus, l'idée de la révolution s'estompe d'elle-même. Par conséquent la révolution vue sous cet angle est orientée uniquement vers l'extérieur (le pays étranger) et non vers l'intérieur (son propre pays). Cependant, on constate que le fait d'être révolutionnaire revient de fait à rompre avec la tradition. Car dans le contexte du Vietnam de cette époque, quand on est révolutionnaire, on doit quitter sa famille, son village, c'est à dire tout son environnement culturel dans lequel on était baigné en renvoyant la piété filiale, chère au confucianisme, aux oubliettes. Par ailleurs, quand on sait que seules les circonstances exceptionnelles et dramatiques (guerre, famine, misère...) peuvent décider un vietnamien à quitter son village, s'engager dans la voie révolutionnaire relève alors du défi à sa propre tradition. A cet égard, la cas du jeune Phan Bôi Châu est riche d'enseignements. Ce patriote du début du siècle raconte dans ses mémoires que les liens familiaux l'ont empêché de s'engager dans le mouvement Cân Vuong (Restauration de la monarchie) contre le colonialisme. La place qu'occupait son père dans la famille était déterminante, car si le jeune Châu s'engageait dans la clandestinité il manquerait au devoir envers son père 1. En ce sens que les révolutionnaires ont rompu avec leur culture d'origine sans que le problème se pose explicitement. Ceci explique, sans doute, pourquoi la modernité en tant que telle est absente dans les discours politiques des révolutionnaires vietnamiens, et dans les programmes de développement socialiste qui, en théorie, aurait permis d'atteindre l'abondance des biens matériels et le bien-être sans passer par le stade de développement capitaliste. On connaît le résultat. Mais par ailleurs les révolutionnaires communistes vietnamiens représentaient bien une force porteuse de modernité sur le plan politique.
Privé de liberté d'expression, le Nord ne pouvait mener la lutte sur le terrain de la légalité. Pour exister, les formations politiques devaient soit choisir la clandestinité, soit abandonner le champ politique au profit d'un autre à caractère non subversif. Ainsi les réformateurs ou progressistes n'arrivaient pas émerger comme une force politique comparable au parti constitutionnaliste dans le Sud qui regroupait la petite bourgeoisie naissante. Pour les Vietnamiens de cette époque, les trois capitales du pays ont chacune une fonction particulière: Saigon, la capitale économique, Huê, la capitale royale et Hà nôi, la capitale culturelle.
II. LES MILIEUX
La rencontre avec l'Occident est la plus grande transformation dans l'histoire du Vietnam... Le pétrole, les allumettes, le tissu, les aiguilles, les clous viennent tous de l'Occident. Ce sont justement ces nouveaux objets qui conduisent aux nouvelles idées.
Hoai Thanh - Hoai Chân
Si les procédés techniques d'imprimerie sont connus depuis fort longtemps au Vietnam, la presse n'y a fait son apparition qu'avec la colonisation. La première imprimerie fut installée à Saigon en 1862 et à Hanoi en 1883. Le premier journal colonial (Le bulletin officiel de l'expédition de la Cochinchine) apparut en 1862 au temps de l'Amiral Bonard, et le premier journal en quôc ngu, Gia dinh bao (Le journal de Gia dinh) en 1865; le Vietnam, dans ce domaine, était en retard de deux siècles sur l'Occident.
En retard sur le plan technique et sur le plan de la diffusion des connaissances et des informations, la presse vietnamienne connaissait encore des restrictions sur le plan de la liberté. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse en métropole fut promulguée deux mois après en Cochinchine, avec cependant quelques restrictions. Le décret du 30 décembre 1898 sur le régime de la presse en Indochine fut promulgué le 30 juin 1899, mais les milieux coloniaux l'ont jugé trop libéral et ont refusé de le faire appliquer en laissant le régime de la presse indochinoise dans un vide juridique qui ne profitait qu'au libre arbitre des gouvernants.
Avec l'émigration vietnamienne en France, la presse clandestine ou légale est devenue un outil indispensable au réveil intellectuel et à la prise de conscience du fait colonial. L'école du journalisme allait donc de pair avec la voie révolutionnaire ou avec tout mouvement progressiste.
LES JOURNALISTES
Il convient de signaler qu'il nous est difficile, dans le contexte colonial, d'identifier le journalisme comme milieu (porteur de modernité), de le distinguer clairement des forces politiques ou des autres milieux, car tout journaliste professionnel, surtout s'il avait séjourné en France, était ou avait été, à des degrés divers, un politicien. Par ailleurs le métier de journaliste a souvent débouché sur d'autres activités intellectuelles comme la littérature, la poésie, le théâtre, etc. Cet état de fait nous impose un choix arbitraire, néanmoins nous retenons quelques critères pour compenser la difficile inséparabilité des forces et les milieux qui se servaient du même outil d'information. Les années 1930 apparaissent naturellement comme le premier critère, car durant cette décennie la presse vietnamienne a connu une floraison sans précédent 1, ce qui signifie, par ailleurs, que les journalistes sont devenus un véritable milieu. Le deuxième critère découle du premier, à savoir le professionnalisme des rédacteurs qui n'avaient pas une appartenance politique "officielle" ou reconnue comme telle. En d'autres termes, leur journal ne constituait pas l'organe de lutte d'un parti quelconque. Enfin, le troisième critère tient compte du caractère progressiste et des idées novatrices des journalistes qui mettaient en cause les fondements culturels traditionnels en apportant des solutions de rechange.
Avec cette restriction méthodologique, les rédacteurs des principaux journaux :
- Phong hoa (La tradition en mutations);
- Ngày nay (Actuel);
- Phu nu thoi dàm (Chronique de la femme);
et leurs audiences, apparaissent incontestablement comme un milieu qui préconise des changements socio-culturels. Il existait bien naturellement d'autres journaux ayant plus ou moins ces mêmes tendances, mais pour des raisons pratiques ils ne peuvent pas être pris comme références: soit il est difficile d'identifier le comité de rédaction de chaque journal (le pseudonyme était à la mode et cela permettait aux auteurs de garder l'anonymat), soit la durée de vie des journaux était trop courte pour être prise en compte, ou bien encore, certains étaient édités dans le Sud (leur écho parvenait au Nord mais restait cantonné dans un cercle restreint). Citons tout de même Dàn bà moi (La femme moderne), hebdomadaire dirigé par la rédactrice Thuy An, qui a paru du 1er décembre 1934 au 28 décembre 1936 à Saigon. Ce journal, de tendance réformiste à caractère féministe, abordait des problèmes de fond sur la place de la femme dans la famille et dans la société et faisait souvent référence à Phong hoa et Ngày nay. Par ailleurs, l'hebdomadaire est enrichi de dessins humoristiques et d'articles consacrés au cinéma (résumé des films qui passent sur les écrans). Sur le plan littéraire, Dàn bà moi encourage les jeunes talents en publiant des nouvelles ou des feuilletons à caractère social, des pièce de théâtre: le plus souvent il s'agit de comédies qui reflètent le conflit des générations ou le conflit culturel. Son tirage ne dépasse guère les deux mille exemplaires.
On peut se poser au préalable la question : "Pourquoi ces journaux ont-ils choisi le terrain social et culturel comme expression de leur émancipation?" Au-delà de la situation coloniale qui restreignait les activités politiques ouvertes, ce sont les transformations profondes d'une partie de la société vietnamienne qui, au contact avec la nouvelle culture matérielle et les idées modernes venant de l'Occident, ont donné matière à réflexion à cette génération de journalistes. Sur cette question les observateurs, aussi bien Français que Vietnamiens, étaient unanimes pour dire qu'il y avait quelque chose de changé depuis les années 1920 et que ce changement se poursuivait d'une façon plus démonstrative dans les années 1930. La notice Hà dông de 1933 décrit ce climat général en ces termes:
Ils (les Vietnamiens) prennent conscience d'eux-mêmes, et s'insurgent contre la discipline que leur impose leur organisation sociale. Les vieilles coutumes leur paraissent d'un autre âge, l'autorité du père est trop lourde, les traditions leur semblent désuètes. C'est ainsi que peu à peu un esprit nouveau se crée 1.
Le rapport de Bélisaire en 1936 souligne le même constat:
L'antique règle mandarinale est renversée: tout ce qui n'est pas interdit par la loi, ou par un règlement légalement fait, est licite. (...) L'homme et la femme se sont sentis comme délivrés d'un habit trop étroit. (...) En effet, les trois grands liens sociaux de l'Annam se relâchent: le sujet n'est plus la chose de l'Etat, les enfants s'émancipent de la lourde autorité du père, la femme jadis privée de biens propres et de toute part de succession se voit reconnaître ses droits. Elle prend au foyer une place de plus en plus grande et déjà s'esquisse un mouvement en faveur de la prohibition de la polygamie 2.
En 1934, la revue Nam phong, sous la plume de Nguyên Van Hiêu, écrit:
Sur le plan moral, il nous faut reconnaître que c'est à cause de la rencontre de deux cultures, l'une orientale et l'autre occidentale, dans ce pays que nous avons connu une période de crise... A l'égard de nombreux problèmes, beaucoup ont des opinions qui vont à l'encontre de celles de leurs anciens. Tout d'abord on constate que la majorité des jeunes ont une tendance à suivre l'individualisme 3.
Dans l'ouvrage consacré aux poètes modernes, les deux auteurs Hoai Thanh et Hoai Chân décrivent l'influence et la pénétration de la culture occidentale chez la jeune génération ainsi:
L'Occident a profondément pénétré notre âme. Nous ne sommes plus capables de nous réjouir des jouissances d'antan, nous ne nous attristons plus pour les mêmes raisons.(...) Nous préférons le bleu au rouge qu'aimaient nos vieux, pour qui regarder une jolie fille, c'est déjà commettre une faute grave, alors que pour nous, cela est rafraîchissant comme quand on se trouve devant une rizière verdoyante 1.
Effectivement, la période 1925-1935, approximativement, est considérée par les Vietnamiens de l'époque comme une période transitoire. Dans la presse, le terme buôi giao thoi (période de transition) apparaît souvent pour la désigner. D'après David Marr, deux raisons expliquent cette révolution culturelle:
- la déstabilisation de la société à partir de 1914. Les principaux facteurs de ce changement décisif sont: le renforcement de l'appareil mandarinal par le pouvoir colonial qui représente une efficacité sans précédent, la prolétarisation qui affecte la paysannerie, et la pénétration de l'économie monétaire dans tout le pays.
- le renouvellement de l'élite intellectuelle. La vieille génération des lettrés a transmis à la nouvelle intelligentsia la prise de conscience de la crise. Cependant les intellectuels de formation moderne sont prisonniers de la culture occidentale, ils sont suspendus entre deux univers (le passé traditionnel et le présent moderne) et cherchent une troisième voie 2.
Dans un climat de flottement et de désarroi semblable, il est difficile de ne pas parler de ces problèmes de société, surtout si on devient un journaliste ayant pour conviction qu'il faut diffuser les idées porteuses de changements. C'est dans ce contexte que sont apparus les journaux comme Phu nu thoi dàm, Phong hoa, Ngày nay et Dàn bà moi.
Phong hoa puis Ngày nay ont été sans doute les journaux qui ont contribué le plus au débat touchant au fondement des structures culturelles vietnamiennes dans la période de transition. Sur le plan de la forme, ils ont rompu avec le caractère austère de la revue Nam phong 1 qui employait un vocabulaire littéraire à dominante sino-vietnamienne, et faisait des allusions historico-confucéennes, en créant un style journalistique clair, simple, humoristique et sans vernis littéraire académique, afin de pouvoir toucher le maximum de public. Leur but s'affichait clairement: la modernisation de la vie culturelle et matérielle de la société vietnamienne tout entière. Ces lourdes tâches constituaient le moteur d'impulsions pour une équipe acharnée qui analysait des situations jugées aberrantes auxquelles il fallait des solutions de rechange.
Le plus dynamique de cette équipe était sans conteste Nguyên Tuong Tam, sous les pseudonymes de Nhât Linh, et Dông Son pour les illustrations humoristiques. Troisième d'une famille de sept enfants, il a commencé ses études au collège du protectorat, plus connu des Vietnamiens sous l'appellation "Truong Buoi" (Ecole de "Pamplemousse", du nom du village où elle était implantée en bordure du lac Hô tây -le Grand Lac-). Ses études secondaires terminées, il s'est inscrit à l'Ecole des Beaux-Arts de Hà nôi. Il a dû, par la suite, pour subvenir aux besoins de sa famille, entrer dans la vie active, dans un premier temps comme fonctionnaire à la Direction des finances. Grâce à sa femme qui a su mener à bien des affaires dans le petit commerce, il a pu partir en France en 1930. Après deux ans d'études à la Faculté des Sciences à Toulouse, il en sortait avec la licence en sciences physiques. D'après les mémoires de son frère cadet, Nguyên Tuong Bach, le seul survivant de la famille et actuellement résidant en Chine, ce qu'il a le mieux assimilé en France ce n'était pas les sciences mais plutôt les idées démocratiques, l'organisation sociale sous la IIIe République 1. Nourri des idées progressistes, il fonda, à son retour au Vietnam, le journal Phong hoa avec la collaboration de Khai Hung (pseudonyme de Trân Khanh Giu), de ses frères: Nguyên Tuong Long( alias, Tu Ly et Hoàng Dao), et Nguyên Tuong Lân (alias Thach Lam, et Viêt Sinh pour les reportages), le seul de cette équipe qui n'a pas participé aux actions politiques clandestines; et de deux dessinateurs Nguyên Gia Tri et Nguyên Cat Tuong, alias Lemur; ce dernier avait été membre du comité de rédaction du journal Viêt Nam Hôn (L'âme du Viet Nam), publié à Paris sous différents titres dans la période 1925-1927, et animé par deux figures du patriotisme, Nguyên Thê Truyên et Nguyên Van Luân. Parallèlement au travail journalistique, Nguyên Tuong Tam enseignait à l'école privée Thang long dont le directeur, Pham Huu Ninh, était aussi le gérant du journal Phong hoa. Cette école canalisait de fait toute une jeune génération d'intellectuels de tendances politiques diverses en son sein: Dang Thai Mai, Hoàng Minh Giam, Tôn Thât Binh, Vo Nguyên Giap, pour ne citer que les plus connus. En octobre 1934, le directeur de l'école présenta à la Résidence supérieure du Tonkin la candidature du futur vainqueur de Diên Biên Phu comme professeur. Quatre mois plus tard, le chef de service de l'enseignement au Tonkin signa l'autorisation, sous couvert de la Résidence et contre l'avis de la Sécurité qui avait émis la mention "défavorable" après avoir fait une enquête sur "la conduite et la moralité" de ce candidat, comme elle le faisait pour tous les autres 1.
Parmi les membres de cette équipe, Khai Hung reste un personnage des plus discrets. On ignore tout sur son enfance à part qu'il était originaire d'une famille aisée dont le père était le mandarin de district dans la province de Thai binh. Avant de se lancer dans le journalisme il avait commencé dans la vie active comme grossiste de pétrole à Ninh giang. Sans sa pipe on aurait eu du mal à le reconnaître comme journaliste et romancier de talent de cette époque 2. Il habitait avec sa femme au siège même du journal. N'ayant pas d'enfant, le couple finit par adopter le troisième fils de Nhât Linh. Son engagement politique resta secret jusqu'en 1945 où il rejoignit ce qui restait du VNQDD en Chine. On ignore de même dans quelles circonstances il a disparu par la suite dans le climat de guerre de libération nationale.
Hoàng Dao, le quatrième de la famille Nguyên Tuong, apparaît comme un intellectuel idéaliste qui manipulait la pensée aux dépens de la connaissance du terrain. Comme son frère aîné, il a travaillé comme fonctionnaire, au tribunal de Hà nôi après avoir fini ses études à l'Ecole de Droit. Déterminé dans son attitude qui passait d'abord par le combat sur le plan des idées, il déclinait le poste de chef de district pour se lancer dans le journalisme.
Nguyên Tuong Lân, plus connu sous son pseudonyme de Thach Lam, était le plus sensible de la famille. Contrairement à ses deux frères qui fréquentaient des milieux intellectuels, il liait amitié avec les autres couches sociales plus défavorisées. Romantique dans l'âme, il s'abandonnait facilement dans les lieux de plaisir comme les fumeries, les maisons de chanteuses, etc.
En dehors de la lecture, quelles ont été les distractions de cette génération d'intellectuels ? Exception faite du cas de Thach Lam, les autres menaient une vie calme et sans histoires. Ils se retrouvaient pour jouer à la belote et au jeu d'échecs (co tuong), ou autour d'une tasse de café pour discuter sur des poèmes puis les chanter (ngâm). Nhât Linh jouait aussi de la clarinette et son morceau favori était Rêverie de Schumann. Hoàng Dao aimait à aller se baigner à la plage Sâm son. Quand les conditions le permettaient, ils faisaient aussi des tournées touristiques en province lors des fêtes, pour observer les pratiques locales qui viendraient alimenter leurs réflexions et leurs écrits.
Ce cercle de journalistes s'agrandit petit à petit avec l'arrivée de jeunes poètes, écrivains, dramaturges qui se retrouvaient le plus souvent chez le poète Thê Lu, de son vrai nom Nguyên Thu Lê. Ils étaient tous plus ou moins marqués par le romantisme et admiraient en particulier Rimbaud et Verlaine. Ce réseau relationnel allait dominer la vie intellectuelle de l'époque par sa nouveauté et par ses prises de position à l'égard de la tradition culturelle. Ce qui explique sans doute pourquoi ce groupe n'avait pas de contact avec les autres milieux journalistiques tels que les rédacteurs de la revue Khoa hoc tap chi et leur audience, qui prônaient la conciliation du passé traditionnel avec les sciences occidentales. On peut dire que la ligne de partage a été dictée par l'attitude à l'égard de la tradition de chaque milieu.
Quelles étaient les idées et les propositions de cette génération de journalistes en rupture de ban avec son passé? Ils ont commencé par critiquer ce qui était considéré comme les valeurs de la vieille génération: de la piété filiale à la soumission de la femme, de la coiffure à la tenue vestimentaire, de la superstition au mode de vie paysan. En somme, la famille comme structure sociale a été violemment critiquée. Or toucher à la famille c'est toucher aux fondements mêmes de la culture traditionnelle, et particulièrement la culture confucéenne. Bref, aussi bien la culture matérielle que la culture idéelle ont été mises à l'index. Un thème central qui traversait toutes ces critiques résidait dans la mise en évidence de la notion d'individu. Certes, ces idées étaient exprimées à travers le journal dès sa parution, mais elles se sont consolidées avec le temps pour devenir une véritable pensée que formulait Hoàng Dao en 1936, deux ans après que les principaux rédacteurs apparurent sous la nouvelle dénomination de Tu Luc Van Doàn (Groupe littéraire autonome). Cette pensée, Hoàng Dao en faisait part ainsi en s'adressant à la jeunesse:
Chers amis jeunes,
La vieille vie, la vie décharnée des conservateurs, retenue comme les eaux mortes depuis des millénaires a été éliminée.... Le sort de "la voie du milieu" touche à sa fin, l'entreprise de cette voie a été un échec total... Ainsi il faut une nouvelle vie, un état d'esprit et une une conscience nouvelles. Ce sera votre vie, notre vie à nous. Dans cette nouvelle vie pleine de lumières et d'embûches qui nous attend, à tout instant nous devons penser très fort aux idées capitales, à l'essence de l'esprit moderne 1.
Ces idées sont exprimées sous forme de Voeux 2:
1er voeu : pour le "nouveau" sans aucune hésitation;
2e - " - : croire au progrès;
3e - " - : vivre selon un idéal;
4e - " " : participer aux tâches sociales;
5e - " - : se forger le caractère;
6e - " - : reconnaître le rôle de la femme dans la
société;
7e - " - : se forger un esprit scientifique;
8e - " - : oeuvrer sans se soucier de la récompense;
9e - " - : cultiver son corps;
10e - " - : avoir le sens de l'organisation.
Sur ces dix voeux, la moitié était soit inconnue soit négligée dans la société traditionnelle: les 1er, 6e, 7e, 9e et 10e voeux. A propos du 1er voeu,- on aurait dit que Rimbaud lui avait soufflé l'idée, car celui-ci avait bien dit au siècle dernier qu'"Il faut être absolument moderne"-, l'auteur écartait toute ambiguïté:
La culture ancienne ne se cantonne plus que dans de vieux bouquins adorés, et de moins en moins, par les partisans de "la voie du milieu" qui sont fort connus et encore puissants. Rien ne vaut préserver ce qui est positif de la culture chinoise pour servir de fonds à assimiler le bon côté de la culture française pour compléter celui-là. Mais ce ne sont là que des illusions. (...) Dans la pratique, "la voie du milieu" a été un échec total. Voulant faire le tri, ses partisans sont hésitants, timides et ne savent quoi prendre pour devise devant le choix: "préserver ou abandonner". Par exemple, ils voudraient bien accepter l'individualisme occidental car ils pensent, et avec justesse, que le progrès ne se réalisera que si l'individu peut développer ses potentiels. Mais de l'autre côté ils veulent conserver la structure familiale dont l'essentiel n'est que servitude. (...) Situation comparable à celle de l'âne de Buridan pressé par la soif et la faim et placé devant un seau d'eau et un picotin d'avoine, ou à celle d'un mari couché entre deux femmes et ne sachant vers laquelle se tourner 1.
Plus loin, l'auteur de ces lignes va jusqu'à la provocation en affirmant que "Être moderne c'est s'occidentaliser", tout en nuançant : "Bien entendu, l'occidentalisation ne consiste pas à s'habiller à la dernière mode de Paris, ni à danser fidèlement au pas, ni à avoir un long nez, des yeux bleus, mais à rechercher l'essentiel de la culture occidentale pour l'adapter à notre vie". Le fait que le peuple vietnamien a pu préserver ses traits caractéristiques tout en ayant subi la domination de la culture chinoise pendant des siècles conforte Hoàng DAo dans son analyse, puis il poursuit sa plaidoirie:
Les conservateurs considèrent que l'occidentalisation sur le plan matériel, aussi minime qu'elle soit, est déjà une chose terrible. Les femmes qui portent des pantalons blancs, et ont une raie sur le côté, sont accusées d'avoir détruit la morale; l'individualisme est considéré comme la satisfaction des désirs détestables. Mais nous, les jeunes, nous ne devons pas en tenir compte, nous continuons notre route sans hésitation, sans nous laisser affaiblir. Ainsi, nous nous engageons avec courage et détermination dans la voie nouvelle large et pleine de lumière de la culture occidentale 1.
A propos de la marche du progrès, Hoàng Dao n'a pas hésité à dire qu'il fallait deux révolutions:
Une révolution intérieure: avant d'agir nous devons réfléchir pour que nos actes soient en concordance avec l'idée du progrès. Et une révolution sociale et familiale: ceux qui croient au nouveau doivent se faire les avocats de l'occidentalisation. Debout, ceux qui veulent que notre patrie, notre peuple aient une nouvelle vie digne d'être vécue 2.
Bien entendu, ce qui touche à la politique n'a pas été abordé, étant donné le statut du journal, néanmoins ces lignes reflètent bien la détermination et l'engagement de l'auteur. Par ailleurs, même si la notion d'individu ne constitue pas un "voeu" en soi, on la retrouve en filigrane dans d'autres voeux, notamment sur la question de l'engagement dans les tâches sociales (4e voeu).
Nous ne devons plus penser uniquement à la famille comme avant. (...) Cette époque n'est pas celle de la grande famille, ni celle des génies ( au sens d'esprits). Elle est celle des vivants, celle des individus ou plus noblement celle des collectivités. (...) L'individu est en train de se libérer, de rompre avec les structures oppressives qui le canalisaient, en le trompant, vers le petit chemin boueux. L'individu doit se décider seul, apporter la contribution de ses forces pour qu'on puisse arriver à un monde rendu plus vaste par la science 1.
Khai Hung, dans un article intitulé "Une des armes du père vietnamien", a aussi abordé la notion d'individu dans le rapport du fils au père. N'ayant pu châtier corporellement le fils, le père utilisait une autre arme "aussi tranchante qu'une épée", qui consistait à le renier. Cette attitude, l'auteur la condamnait sans réserve, en soulignant que "si les droits de l'individu s'élargissaient, ceux de la communauté devraient être limités 2". Quand le groupe Tu Luc Van Doàn s'est constitué en 1934, "le respect de la liberté de l'individu" (trong tu do ca nhân) a été érigé en devise, - la septième des dix devises du groupe 3.
On se trouve ici en plein débat sur la modernité. Mais avant de le poursuivre, il convient d'essayer de saisir les moments-clefs de l'ébauche de la notion de "modernité" dans la société vietnamienne.
On reconnaît à cet égard qu'il est difficile de localiser dans le temps les débats sur la modernité car à notre connaissance le concept même de la modernité était tellement flou chez les Vietnamiens, et ce jusqu'aux années 1930, que nous nous demandons, dans un premier temps, s'ils l'avaient bien présent à l'esprit. Sans remonter trop loin dans l'histoire, il nous semble que l'idée a été évoquée sous le règne mouvementé de Tu Duc (1848-1883), cependant la question était plutôt de savoir s'il fallait ouvrir le pays vers l'extérieur ou non. La Cour a répondu par la fermeture. Une vingtaine d'années après la mort de Tu Duc, la question revient à l'ordre du jour, et cette fois elle préoccupe les lettrés de l'avant-scène. L'éphémère tentative du Dông Kinh Nghia Thuc en 1907 marque à cet effet le début d'une véritable remise en question de la société traditionnelle à l'épreuve de la colonisation. Si les termes du débat nous échappent, la prise de position de cette institution révèle irréfutablement l'adoption de l'idée du progrès social et culturel formulée à travers l'expression Duy Tân (le renouveau) qui incarne en même temps le mouvement d'opposition au régime colonial. (Nous avons déjà évoqué le Dông Kinh Nghia Thuc en étudiant un manuel scolaire dans un chapitre sur l'enseignement.) En dépit de cette réaction en faveur des idées modernes (adoption du quôc ngu comme écriture nationale, abandon des cheveux longs, reconsidération du rôle de la femme, encouragement de l'esprit d'entreprise, etc.) le concept même de la modernité n'a pas été, semble t-il, explicitement formulé par le Dông Kinh Nghia Thuc. D'un autre côté, les termes Duy Tân désignent selon toute vraisemblance ce qu'on appelle aujourd'hui la "modernité". Dans l'éditorial du Phu nu thoi dàm (La chronique des femmes) sur la condition de la femme japonaise, numéro du 21 janvier 1930, on peut lire les lignes suivantes:
Au Japon, un pays d'Asie qui s'est pourtant lancé dans la modernité (thuc hành su Duy Tân) depuis cinquante ans, la libération de la femme rencontre encore des difficultés...
Quoi qu'il en soit, il a fallu attendre encore deux décennies avant que la "modernité" ne devînt un concept plus ou moins cerné par la jeune génération formée à l'école moderne de l'Occident. Encore fallait-il que le terme équivalent de "modernité" existe dans le vocabulaire vietnamien. D'après le "Dictionnaire sino-vietnamien" de Dào Duy Anh édité en 1931, le terme hiên dai désigne la "période contemporaine", et l'expression hiên dai van minh sert à traduire la "civilisation moderne" 1. Et pourtant c'est ce même terme hiên dai qui sert plus tard à signifier la "modernité", mais son utilisation ne date que d'après l'indépendance en 1954. Jusqu'à cette date on employait plutôt le terme moi pour parler de tout ce qui était moderne, ou son équivalent en sino-vietnamien tân. On s'aperçoit donc qu'après l'indépendance il s'est opéré un glissement de sens du terme hiên dai (modernité). Devant ce problème lexicographique, comment peut-on en conclure? Est-ce-que la notion de "modernité" a précédé l'utilisation du terme qui la désigne ou n'apparaît-elle qu'avec la naissance du terme correspondant? Avant de répondre à cette question attardons-nous sur des exemples de néologismes. A cet égard, on constate que la plupart du temps deux cas de figure se présentent:
* un néologisme est créé pour répondre à un besoin immédiat d'ordre quelconque, c'est le cas de "informatique", "ordinateur" qui sont venus enrichir le vocabulaire français dans les années 1950;
* le terme inventé est pris en compte par les lexicographes après que son usage soit déjà populaire: nous avons par exemple "disco", "funky", etc.
Dans le cas du Vietnam, les choses se compliquent, et ce pour deux principales raisons. En premier lieu, les années 1930 marquent le début de la maturité du quôc ngu qui continue à s'enrichir avec de nouveaux termes pour traduire les concepts modernes venus de l'Occident (qu'ils soient philosophiques, scientifiques, techniques, artistiques, ou autres). En second lieu, le vietnamien n'est pas une langue très précise à bien des égards bien que le langage de base et les expressions populaires qui reflètent des métaphores axées sur le concret soient très riches à d'autres égards. Par conséquent tout ce qui relève de l'abstrait et de la précision pose problème, du moins avant que la notion définie ne devienne populaire. C'est la raison pour laquelle il est difficile de se baser sur l'existence des mots pour accréditer tel ou tel concept. Le terme khai niêm (concept) même n'était pas employé dans la période qui nous intéresse. On employait plutôt son "jumeau", quan niêm qui veut dire "conception". En réalité l'emploi de quan niêm était abusif car il a pris justement la place de khai niêm. A partir de ce moment là, on peut considérer, sans trop de risque, que le concept de la modernité a bien été saisi par la génération d'intellectuels des années 1930, entendons par là les journalistes et les écrivains modernes, sans que le terme hiên dai (modernité) soit utilisé explicitement. A ce propos, dans une série de deux articles qui prônent "l'européanisation de la paysannerie" (Au hoa dân quê), le journal Phong hoa sous la plume de Nhi Linh, alias Hoàng Dao, donne comme sous-titre Quan niêm moi (La nouvelle "conception") 1. Il est question de convaincre les paysans d'abandonner leurs coutumes et pratiques arriérées au profit de l'individu:
La construction d'écoles, de maternités, le creusement de puits dans certains villages constituent le début de l'européanisation de la campagne.
Mais nous voulons que l'européanisation soit plus profonde. (...) Pour lutter contre les arriérés décadents (hu bai) de la paysannerie, il ne suffit pas de quelques réformes superficielles. Pour détruire les arbres nocifs dans un jardin il faut les déraciner puis les remplacer par d'autres plus utiles. (...) Jusqu'à présent les paysans ne reconnaissent pas les bienfaits des réformes parce qu'ils ont en tête une vieille conception de la famille, du village, de la société, de l'honneur.
Ces conceptions, je ne me place pas sur le plan moral pour les approuver ou les critiquer, mais je me place sur le plan social pour affirmer qu'elles sont inadaptées.
Notre époque n'est plus celle de la famille, du village mais celle de l'individu, ou d'une façon plus élevée, c'est celle des associations (doàn thê) 1.
Nous devons savoir que rien n'est parfait dans la vie. La nouvelle vie a ses défauts que nous devons admettre si nous voulons le "nouveau". (...) Suivons ce qui est "nouveau", la loi de la nature finit par éliminer ce qui est mauvais 2.
Si on se réfère au discours philosophique de Jürgen Habermas qui pense qu'en élargissant son champ la modernité se confond avec les "temps modernes" caractérisés par la subjectivité, laquelle comporte avant tout quatre connotations: l'individualisme, le droit à la critique, l'autonomie de l'action et la philosophie idéaliste 1, les deux articles cités sont alors porteurs de modernité parce qu'ils mettent l'accent sur l'individu. Par ailleurs, ces deux articles où la notion de l'individu est soulignée ne sont nullement des cas isolés. Les rédacteurs des deux journaux Phong hoa et Ngày nay et particulièrement les membres du groupe Tu Luc Van Doàn (Groupe littéraire autonome) ne manquent pas les occasions de mettre en valeur cette notion d'individu qui est la septième devise du groupe: trong tu do ca nhân (respect de la liberté de l'individu) 2. Dans son "quatrième voeu" (Diêu tâm niêm thu tu), Hoàng Dao insiste encore sur cette notion:
Cette époque n'est plus celle de la grande famille, celle des génies et des esprits. Elle appartient aux vivants, aux individus (...)
L'individu est en train de se libérer, l'individu est en train de rompre avec des structures contraignantes qui trompent les gens en les amenant vers des chemins étroits et boueux 3.
Le fait que le Tu Luc Van Doàn se désigne comme un "groupe littéraire autonome" reflète bien l'idée d'autonomie, une autre composante de la "subjectivité" définie par Jürgen Habermas. Quant à "l'esprit critique" et à "la philosophie idéaliste", même s'ils ne sont pas formulés explicitement, la critique constitue un des points forts de ce groupe et le fait de vouloir transformer de fond en comble la paysannerie relève justement de l'utopie. Même si le concept de "modernité" n'est pas explicitement défini, il n'en demeure pas moins présent à l'esprit de ce groupe littéraire qui a dominé la vie intellectuelle des années 1930.
L'éditorial du premier numéro de Dàn bà moi (La femme moderne) est aussi consacré à définir le "nouveau" (moi):
... En élargissant le progrès c'est moderne. (...) Cependant, le "nouveau" n'est pas forcément une bonne chose, une perfection; ainsi la femme moderne ne doit pas suivre aveuglement ce qui est nouveau. (...) Le "nouveau" doit être basé sur la raison, être le reflet du progrès des sphères d'activité humaine, sinon il ne serait que superficiel et grotesque, résultat d'une soif injustifiée, d'une curiosité. (...) Dàn bà moi n'a pas l'intention d'opposer les femmes aux hommes car la femme moderne conçoit que la nature a créé les deux sexes non pas pour les diviser mais pour les unir dans l'harmonie 1.
Ces lignes rédigées par la rédactrice en chef, Mme Thuy An sont d'un ton nettement plus modéré que celui des rédacteurs des deux journaux Phong hoa et Ngày nay qui sont radicalement convaincus qu'il faut être moderne. Que pensent leurs lecteurs du "nouveau" ? Afin de cerner les tendances de ces derniers, le numéro 2 du Ngày nay daté du 10 février 1935 a procédé à un véritable sondage d'opinion en leur posant trois questions pour savoir:
1. s'ils sont pour le "nouveau" sans hésitation;
2. s'ils cherchent un compromis entre le "nouveau" et l'ancien;
3. ou s'ils restent complètement traditionalistes.
Si Ngày nay entreprend cette démarche c'est qu'il est à peu près sûr de l'opinion de ses lecteurs. Les résultats sont publiés deux mois plus tard dans les deux numéros 10 et 11. En tout, 2292 réponses sont parvenues au journal. (Beaucoup de lecteurs n'ont pas répondu parce qu'ils ne voulaient pas découper le journal de peur de l'abîmer 1.) 55O provenaient des lecteurs de Ngày nay, et 1742 de ceux de Phong hoa, respectivement 7% de l'ensemble des lecteurs du premier et 11% du second 2. Résultat:
* 6 ont approuvé les valeurs traditionnelles (5 hommes et 1 femme), dont 4 lecteurs de Ngày nay et 2 de Phong hoa, ce qui représente un pourcentage insignifiant de 0,25%. Ils étaient tous originaires du Nord (2 de province et 4 de Hà nôi), ce qui leur vaut le commentaire ironique de Ngày nay: noi gân nuoc Tâu co khac (la proximité avec la Chine fait ses preuves);
* 936 personnes ont prôné la voie médiane (compromis entre le "nouveau" et l'ancien), soit 41% ;
* 1350 autres ont ratifié le "nouveau", soit 59%.
Répartition par région et par sexe
de ceux qui ont prôné la voie médiane 3.
|
Tonkin Hanoi Province |
Annam |
Cochinchine |
Laos Cambodge |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Homme |
Femme |
Homme |
Femme |
Homme |
Femme |
Homme |
Femme |
|
|
372 |
47 |
246 |
22 |
113 |
22 |
66 |
18 |
26 |
Répartition par région
et par sexe des "modernes". 1
|
Tonkin Hanoi Provinces |
Annam |
Cochinchine |
Laos Cambodge |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Homme |
Femme |
Homme |
Femme |
Homme |
Femme |
Homme |
Femme |
|
|
468 |
29 |
358 |
28 |
206 |
22 |
170 |
27 |
42 |
On constate tout d'abord que les femmes étaient beaucoup moins nombreuses à participer à ce sondage que les hommes. Si d'une manière générale, au Tonkin les lecteurs ont plus opté pour la "modernité" que pour le compromis entre le "nouveau" et l'ancien, les Hanoïennes ont eu en revanche une préférence pour le compromis. Bien que la tendance "moderne" l'emporte sur les autres le journal Ngày nay reste prudent en écrivant qu'il ne faut pas négliger ceux qui représentent la voie du compromis, car le combat de ces deux tendances est encore très acharné (cuôc chiên dâu rât gay go) 2. On peut se demander si ces sondages représentent la photographie exacte de la société vietnamienne de cette époque. Dans un premier temps, on peut supposer sans trop prendre de risques d'erreurs d'interprétation, que cette photographie sociale est avant tout celle des milieux urbains, car la presse ne parvient à la campagne que par des circuits informels, passée de main en main. Par ailleurs, ces résultats reflètent uniquement les différentes tendances sociales devant le "nouveau", car les 7% des lecteurs du Ngày nay et les 11% de ceux du Phong hoa ne représentent peut-être pas l'échantillon exact de l'ensemble des lecteurs et encore moins de l'ensemble de la population urbaine. C'est pour ces raisons que les résultats du sondage ne peuvent être pris que comme indicateurs de tendance. Cependant à l'exception de ce sondage on ne dispose d'aucun autre indicateur quantifiable comparable.
Pour le Tu luc van doàn, dont les idées sont représentées par les écrits de Hoàng Dao, le "nouveau" ou le "moderne" ne pouvaient pas ne pas englober la condition et les droits de la femme. A en croire le journal Ngày nay, à cette date, la marche de la femme vers le progrès a déjà été considérable. Le passé n'a pu résister à l'épreuve du temps. Les vieilles idées se sont effritées le jour où l'on s'aperçut que les femmes aux dents blanches, ou avec une raie sur le côté, n'étaient pas de mauvaises femmes. Cependant un souci hantait Hoàng Dao: il avait peur que la femme ne devienne qu'une jolie fleur, un objet précieux qu'on admire et qu'on dorlote. "La libération de la femme pouvait-elle s'arrêter là?" Le journaliste reprend alors une anecdote racontant le refus d'une femme à qui un jeune homme avait cédé la place dans un train en Occident, et il en conclut que "l'égalité des droits doit aller de pair avec le partage des responsabilités", et ce, dans tous les domaines, sans exception aucune 1.
Le débat sur la question de la femme ne constituait pas une idée neuve en 1936 car dès le début de la décennie Phu nu thoi dàm l'avait porté sur le plan national. L'épouse de Nguyên Van Da dirigeait ce journal avec la collaboration du rédacteur en chef Ngô Thuc Dich, licencié du dernier concours triennal au Tonkin en 1915 et écarté du fonctionnariat pour avoir mené des activités politiques au sein du VNQDD, après avoir fait de la prison. Parmi les membres de la rédaction, figurait aussi Vu Liên, un "Retour de France", qui plus précisément avait été expulsé avec les dix autres pour délit politique. Toutes les questions concernant la femme avaient été abordées dans les colonnes de Phu nu thoi dàm: de la virginité à la polygamie en passant par le mariage libre et les droits de la femme. Bref, la libération de la femme trouvait déjà son écho dans les milieux littéraires.
Au travers de ces idées, on constate que la famille, la femme et l'individu constituent les thèmes centraux, le fer de lance de l'intervention de ces journalistes. S'ils se sont acharnés sur ces questions, c'est parce qu'il y avait un malaise profond dans la société et plus particulièrement chez les jeunes, qui se sont retrouvés désemparés devant une situation déboussolante. Les vieux préceptes ont disparu mais ils n'ont pas encore assimilé le nouveau: "l'enseignement à l'école les amène dans une direction tandis que l'éducation familiale les oriente vers une autre". Mais pour ce milieu journalistique, c'est cette souffrance même qui constituerait la base d'un nouvel ordre. D'après cette nouvelle école de pensée, il s'agissait d'inverser les valeurs: "la force vainc la souplesse et non le contraire" 1.
Cette affirmation va à l'encontre de celles d'un autre milieu, le milieu des journalistes groupés autour de la revue Nam phong (Le vent du Sud), caractérisé justement par sa "souplesse". Le premier numéro de cette revue paraît en juillet 1917, au lendemain de la fondation de la République chinoise (1911), en pleine Guerre mondiale, et à la veille de la Révolution soviétique. La naissance d'une revue en langue vietnamienne à caractère culturel, dans ce contexte, répond aux préoccupations de l'Administration coloniale qui essaie de sauvegarder l'influence française en Asie, et en Indochine en particulier. Il suffit de lire ce que le ministre des Colonies, Henri Simon, écrit au gouverneur général Albert Sarraut pour vérifier si le Nam phong n'incarne pas l'idée de la collaboration franco-vietnamienne:
Vous avez mis le Département au courant des initiatives prises par le gouvernement général de l'Indochine pour combattre, tant à l'intérieur de la colonies que dans les pays voisins, l'influence trop longtemps exercée par nos ennemis sur l'opinion publique en Extrême-Orient, et plus particulièrement, dans les milieux lettrés indigènes.
Ces initiatives m'ont paru des plus heureuses et je ne doute pas que la publication de nos revues telles que le Nam phong, par exemple, dont j'ai vivement apprécié (...) le programme adroit et l'intelligente composition 1.
MM. Pham Quynh et Nguyên Ba Trac, explique le fondateur, Louis Marty, le choix de mettre au premier plan ces deux principaux rédacteurs, ont pris cette revue sous leur nom, afin qu'elle conserve aux yeux du public un caractère exclusivement indigène 2. D'autre part, l'administration prend en charge des subventions à raison de 400 piastres par mois 3.
Durant ses dix-sept ans d'existence, le Nam phong (NP) a subi une évolution quant à sa forme qui se traduit en trois phases successives:
* 1917-1922 : la revue est rédigée à la fois en quôc ngu et en caractères chinois; le nombre de pages des deux parties s'équilibre à peu de chose près;
* 1922-1923 : la partie en caractères chinois diminue en volume au profit de l'introduction d'un supplément en langue française;
* 1923-1934 : la partie en caractères chinois s'efface au fur et à mesure que le supplément en français devient plus étoffé.
Quant au contenu, les articles parus dans le NP peuvent être classés en huit rubriques:
* Éditoriaux, dissertations sur l'actualité;
* Études littéraires;
* Études philosophiques;
* Études scientifiques;
* Jardin des lettres;
* Variétés littéraires;
* Commentaires d'actualité;
* Romans, contes, nouvelles 1.
Malgré des articles de vulgarisation technique, le NP garde son caractère littéraire, et comme les rédacteurs sont des lettrés de formation initiale classique, complétée par une formation moderne, le langage de cette revue fait fortement référence au passé, avec des allusions historiques et littéraires aux études classiques. Pham Qùynh, le personnage clef de la revue, n'a qu'une marge de manoeuvre très étroite compte tenu de sa position en faveur de la colonisation. Il essaie tant bien que mal à faire du quôc ngu une écriture nationale, cependant sur le fond, il reste attaché à la tradition confucéenne alors qu'il poursuit des études classiques en tant qu'autodidacte après avoir reçu une formation moderne. Descendant d'une famille originaire de Hai duong, Pham Qùynh est né à Hà nôi en 1892. Sorti du Collège des interprètes à l'âge de 16 ans, il travaille comme attaché à l'Ecole Française d'Extrême-Orient (EFEO) de 1908 à 1917, date à laquelle il devient le rédacteur en chef de la revue NP. Son ascension sur l'échelle sociale est désormais assurée: il est nommé par l'empereur Bao Dai en 1932 comme ministre chargé de la Direction du Cabinet impérial civil, puis ministre de l'Education nationale l'année d'après pour finir en 1942 comme ministre de l'Intérieur auprès de la Cour de Huê 1. Mais sa chute est au moins aussi vertigineuse, car il est exécuté par la milice vietminh le 23 août 1945 à Quang tri 2.
Un autre rédacteur non moins important de la revue est le lettré Nguyên Ba Trac 3. Né en 1881 dans la province de Quang Nam, il a commencé par les études classiques et en est sorti avec le titre de Cu nhân. C'est sans doute le climat de révolte du début du siècle dans lequel il s'était trouvé qui a fait de lui un opposant au régime colonial, avant qu'il s'y rallie en 1917 aux côtés de Pham Qùynh comme "co-fondateur" de la revue NP. Dans la période 1917-1922 il se chargea plus particulièrement de la partie en caractères chinois, avant d'écrire plus abondamment en quôc ngu par la suite.
Le plus âgé du comité de rédaction est Nguyên Ba Hoc (1858-1921). Comme les autres rédacteurs, Nguyên Huu Tiên (1875-1941, avec le titre de Tu tài), et Nguyên Trong Thuât (1883-1940), il a commencé par suivre l'enseignement traditionnel, par passer les concours triennaux, avant de s'adapter au nouveau contexte. Si Nguyên Trong Thuât a reçu en 1925 pour son roman "d'aventure" à caractère légendaire, Qua dua do (La pastèque), le prix de littérature attribué par l'Association pour la Formation Intellectuelle et Morale des Annamites (l'AFIMA ou Hôi khai tri Tiên duc en vietnamien), association dont Pham Qùynh est le secrétaire général, le contenu de cet écrit est sans commune mesure avec un autre roman sorti la même année, et qui est considéré comme un événement littéraire des années 1920; il s'agit de Tô Tâm de Hoàng Ngoc Phach (voir la partie "roman" au chapitre suivant). Néanmoins chacun de ces deux romans a marqué la vie intellectuelle de cette époque, mais chacun dans un milieu culturel différent, le milieu collaborateur d'un côté, et de l'autre les jeunes de formation moderne qui commençaient à remettre en cause les valeurs traditionnelles que le NP défendait. A cet égard et paradoxalement, la collaboration avec le régime colonial se traduit aussi par la préservation des valeurs anciennes ou plus simplement par le conservatisme. Sur les mille articles du NP recensés par Mme Pham Thi Ngoan, une quarantaine seulement sont consacrés à la question de la femme 1. Il n'est pas très juste de qualifier ces articles de "féministes" comme Mme Ngoan l'a fait, car dans leur discours, les auteurs ne font qu'effleurer ce sujet sans l'égratigner, en restant très évasifs sur les questions essentielles que posent les autres journaux vraiment féministes comme Phu nu thoi dàm. Aussi, on peut y lire les jugements suivants: le fait que l'Empereur Bao Dai renonce à son harem impérial pour épouser "une jeune fille du Sud, éduquée en France, de religion catholique, sans ascendance lettrée ni mandarinale" n'a pas aboli "cette coutume périmée qu'était la polygamie". L'article est de Nguyên Tiên Lang (un jeune rédacteur de la revue à cette époque), cité par Mme Ngoan 1. A cet égard il suffit de lire l'article intitulé Nu quyên (Droits de la femme), paru dans NP n° 159 février 1931, pour voir la teneur du propos de son auteur sous le pseudonyme de Hac Dinh:
Autrefois les juristes considéraient la femme comme un être faible, l'opinion convenait aussi que sans l'homme la femme ne pouvait être autonome, comme si elle était dotée d'une capacité intellectuelle (thân tri) moins importante et d'une attitude (tu cach) incompatible avec les activités sociales, alors qu'aujourd'hui, sur sa lancée, elle semble accaparer même la place de l'homme, elle veut ardemment se venger de l'homme qui l'a déconsidérée jusqu'alors.
Après avoir posé cette définition tendancieuse du féminisme, l'auteur poursuit son article en donnant un aperçu sur la naissance du mouvement féministe en Europe, sans faire la moindre allusion à la condition de la femme vietnamienne, sans approfondir ni poser de véritables questions, sans propositions concrètes. On a ainsi une idée de la teneur du "féminisme" de la revue NP.
Partisan de la collaboration et du rapprochement culturel des deux peuples, français et vietnamien, Pham Quynh n'incarne pas pour autant une figure de tyrannie, ni une image de corruption comme bon nombre d'autres mandarins provinciaux et notables de village. Son attitude serait la résultante de la résignation et de la passivité devant les problèmes à caractère national. S'il se montre flatteur à l'égard du régime colonial à travers les expressions "Indochine, fille de la France, sa fille spirituelle, nourrie du lait de la culture et du suc de sa civilisation 1", en acceptant le fait colonial comme une fatalité, en disant que "L'intervention de la France, son établissement dans notre pays sont des faits que nous acceptons comme tous les faits qui arrivent en vertu des lois inéluctables de l'histoire 2", Pham Quynh ne perd pas pour autant le sens critique. Critique du système d'enseignement traditionnel d'abord, qu'il juge inadapté, le mot est faible pour lui:
Ce lien (celui des caractères chinois au peuple vietnamien) fut tellement solide qu'il constituait pour le peuple annamite un véritable joug. (...)
C'était un enseignement purement scholastique, comme le fut celui des peuples d'Occident du Moyen Age. (...) C'était subtil, c'était compliqué, c'était fastidieux. Aucune ouverture sur la vie et la réalité; du formalisme, du verbalisme, de la rhétorique, de la littérature. (...)
En réalité, c'est une utilisation abusive, une exploitation au profit de l'autocratie des principes du confucianisme, c'est un puissant instrument de domination entre les mains des rois, et c'est au point de vue intellectuel, le plus formidable asservissement de l'intelligence qu'on ait jamais connu dans l'histoire de l'humanité. (...) Combien d'intelligences furent gaspillées par ce système absurde d'éducation où la lettre primait l'esprit, où le rite tuait la vie, où toute création de l'intelligence, toute initiative de pensée se réduisait à des formules, à des clichés, à des poncifs 1!
Dans un autre article, Pham Quynh pense que si les Japonais s'en sont mieux sortis que les Vietnamiens, c'est parce qu'ils n'étaient pas tombés dans le piège des concours comme ces derniers 2. Mais critique aussi du régime colonial, Pham Quynh se montre il est vrai aussi virulent:
En fait d'assistance, nous avons l'unique hôpital du chef-lieu avec un médecin français ou un médecin indigène, bâtiment administratif où le moindre infirmier est une sorte de fonctionnaire plein de morgue traitant les pauvres malades comme de la vile racaille. (...)
Quant aux écoles, il y en a bien quelques-unes dans chaque circonscription, mais elles sont notoirement insuffisantes et souvent dirigées par de jeunes moniteurs pleins de prétentions (...). Mais pour le moment, il faut bien avouer que les résultats ne sont guère brillants. Le seul effet de l'éducation française a été de dénationaliser les jeunes Annamites, de les désannamitiser en quelque sorte (...). Après cinquante ans d'occupation française, l'Indochine tout entière ne compte pas plus de dix docteurs, ingénieurs, professeurs indigènes, dont la plupart d'ailleurs ont perdu toute personnalité annamite comme ils ont renoncé à leur nationalité (...) 1.
Pham Quynh remarque aussi un "paradoxe" quant aux idées modernes, celles qui incarnent la grandeur de la France, en renvoyant dos à dos Français et Vietnamiens:
C'est la Chine qui devait nous initier au "nouveau savoir". C'est la Chine qui devait nous faire connaître Montesquieu et Rousseau, Diderot et Voltaire. C'est incroyable, c'est pourtant vrai. C'est le cas de répéter le proverbe annamite : "Quand le Bouddha est dans votre maison, il perd de sa puissance divine, il n'est plus Bouddha". Quand le Bouddha français, - j'entends la culture et la civilisation française, - fut entré dans la maison annamite, il perdait un peu de sa puissance divine aux yeux des maîtres du logis, peut-être parce qu'il est venu armé et casqué comme un Dieu guerrier ou qu'il fut servi par des Prêtres qui n'étaient pas préparés à promulguer sa Doctrine bienfaisante et généreuse 2.
Neutralisé sur le plan politique, Pham Quynh s'efforce de jouer la carte littéraire en misant tout sur le quôc ngu. Dans le numéro de juillet 1927, dixième anniversaire de la revue NP, la rédaction réaffirme ses orientations en ces termes:
Dans un pays où le niveau intellectuel du peuple n'est pas encore élevé, les droits à l'expression ne sont pas encore totalement acquis, comme le nôtre, la politique comme devise ne vaut pas la culture comme doctrine. (...)
Pour que le Vietnam ait une culture respectable, il faut avant tout un outil pratique dans la conciliation et dans la diffusion des idées. Cet outil ne peut être le français, ni le chinois; mais doit être notre quôc ngu. (...)
L'entraînement à une littérature nationale et la diffusion des connaissances sont les deux buts principaux de la revue NP pendant ces dix dernières années 1.
Quoi qu'il en soit, les bonnes intentions de Pham Quynh et son idée de donner à la langue nationale une identité ne furent réalisées que par la génération d'intellectuels de formation moderne déterminée à en finir avec la tradition, en créant un nouveau style d'écriture plus accessible aux non érudits.
D'autres milieux comme les écrivains ou les poètes contribuaient aussi, mais à leur façon, à combattre les anciennes valeurs afin de faire apparaître l'idée de la femme moderne, de libérer l'individu des contraintes familiales et sociales, et il devait en sortir une nouvelle conception de la famille.
LES ECRIVAINS
En dépit d'une tradition littéraire, on constate que le roman au sens moderne n'existait pas, car la littérature en prose n'a vu le jour qu'au XXe siècle, non plus que la littérature basée sur l'observation. Cependant on constate quelques exceptions, qui confirment la règle, avec l'existence de quelques oeuvres en prose à caractère historique. Contrairement à la littérature orale et populaire, sous diverses formes, qui aborde, sans tabou, tous les thèmes imaginables de la vie, la littérature académique, à de rares exceptions près, ne se cantonne que dans la composition des poèmes suivant les règles strictes des Tang. La forme de littérature la plus libérée de ces contraintes était l'apanage des lettrés qui, pour une raison ou une autre, composaient des poèmes dans leurs moments de distraction auprès des chanteuses (cô dâu) 1. Les rares "romans" classiques écrits en vers, dont le "Kiêu" demeure l'exemple le plus représentatif, s'inspiraient d'histoires d'origine chinoise. Cependant, on ne peut accuser le confucianisme d'être le seul responsable de cet état de fait, il faut chercher à comprendre aussi ce que les Vietnamiens ont fait de cette doctrine, d'une part, et d'autre part, s'il existe une relation de cause à effet entre l'univers mental des Vietnamiens, les conditions matérielles, le contexte socio-politique, et l'absence de ce domaine dans la vie intellectuelle de la société vietnamienne précoloniale, car le confucianisme en Chine n'a pas empêché la littérature de s'épanouir, et même les écrits à caractère érotique 2 y trouvaient leur place.
L'éveil de l'intérêt pour la littérature sous sa forme moderne était la conséquence directe de l'enseignement moderne qui avait permis à la jeune génération de découvrir la littérature occidentale, en l'occurrence celle de la France. D'autres facteurs sont à chercher du côté de la réalité sociale. Le contexte de cette époque constitue, sans doute, le catalyseur de la jeune génération d'intellectuels paralysés devant un horizon bouché, à la recherche d'un nouveau mode d'expression et d'une certaine liberté.
De même que pour les journalistes, il est difficile de séparer les littérateurs de ces derniers, car tout écrivain de cette époque a plus ou moins commencé sa vie littéraire en tant que journaliste. Dans ses mémoires, l'écrivain Nguyên Công Hoan évoque cette confusion: "Ainsi à cette époque les gens confondaient les journalistes et les écrivains, et vice versa." 1 Certains étaient des rédacteurs en chef, d'autres des reporters, des responsables de rubrique, etc. Pour devenir écrivain il fallait obligatoirement passer par le journalisme. Par ailleurs, les maisons d'édition se comptaient sur le bout des doigts; et l'éditeur, ne prenant pas de risque, n'acceptait de publier un roman qu'à deux conditions:
- que ce roman ait déjà été publié dans la presse sous forme de feuilleton;
- que l'écho ait été favorable chez les lecteurs.
Pour comprendre l'émergence de cette génération d'écrivains, on ne peut faire l'impasse sur la situation sociale qui ne cessait de s'aggraver. Leur état d'esprit fut le théâtre des affrontements de deux courants culturels, refléta une réalité douloureuse et enfin, traduisit une prise de conscience d'un passé révolu. La littérature sous sa forme moderne, en rupture totale avec la tradition littéraire, répondait à un besoin, venait combler un vide intellectuel laissé par la génération des lettrés de formation classique qui tendait à disparaître. Dans la même période, si les journalistes étaient des "penseurs" du changement, les romanciers, eux, constituaient les hommes de terrain qui alimentaient les débats par leurs apports de situations concrètes. Ils avaient peu de chose à voir avec des écrivains (ou journalistes) déjà connu dans la décennie précédente comme Hoàng Tich Chu, Nguyên Dô Muc, Nguyên Trong Thuât, Phan Kê Binh, etc., qui avaient collaboré avec les revues Nam phong et Dông duong Tap chi. D'une part, les écrivains des années 1920 étaient de formation classique et ils utilisaient le quôc ngu à défaut de s'exprimer en caractères chinois, et d'autre part, leurs écrits ne reflétaient pas la réalité de la société et n'occupaient pas encore une véritable place dans la littérature, car la production des romans de cette décennie se comptait sur le bout des doigts. Cette génération n'avait pas encore connu la grande crise dont les effets ont bouleversé la Colonie dans la période 1930-1931.
La prolétarisation dont parle David Marr, et surtout celle de l'après-crise, donne des frissons. Dans une lettre de l'administrateur-Maire de Hanoi adressée au Résident supérieur du Tonkin du 26 octobre 1934 on peut lire les lignes suivantes: "La ville de Hanoi est devenue le refuge des épaves de la province 1".
Ces derniers (les mendiants), écrit le commissaire central de la Police, qui peuvent être considérés comme "indésirables" dans leurs villages d'origine se rendent à Hanoi soit dans l'espoir de se procurer par tous les moyens des subsides, ou soit encore pour échapper aux sanctions qui peuvent leur être infligées par les tribunaux provinciaux 2. Dans la période 1934-1936, chaque mois deux à trois cents mendiants dans la ville de Hanoi sont envoyés au dépôt de mendicité qui se trouve au village de Thai hà (au sud de Hanoi). La tranche d'âge la plus touchée était celle des 17-35 ans, parmi lesquels les 20-29 ans étaient les plus nombreux 1. Effectivement la misère à la campagne a forcé les plus pauvres à quitter leur village. Toutes les provinces limitrophes de Hanoi étaient touchées: Ninh binh, Thai binh, Hung yên, Hà dông, Bac ninh, Nam dinh particulièrement. L'une des causes de cette prolétarisation résidait dans la pratique de l'usure. Les paysans pauvres ont fini par vendre leurs terres aux propriétaires terriens, les seuls, paradoxalement qui pouvaient bénéficier des prêts consentis auprès du Crédit agricole mutuel créé justement dans le but d'aider la fraction la plus pauvre de la paysannerie 2. Puis pour subsister, ils devaient accepter de faire des emprunts en nature ou sous forme d'argent, à des taux exorbitants allant de 5 à 20 voire 30 pour cent par mois. Les prêteurs avaient trente-six manières de camoufler cette pratique honteuse pour échapper à la justice, si justice il y avait. A ces pratiques frauduleuses s'ajoutaient également les abus de pouvoir, l'oppression morale et le mépris que les notables avaient pour la couche misérable de la paysannerie. Pour ne citer qu'un exemple parmi des milliers d'exactions possibles dans la campagne tonkinoise, le journal Dàn bà moi a révélé le cas d'un Ly Truong du village Lac dao dans la province de Nam dinh, qui a forcé une femme de son village à manger de l'excrément pour avoir proféré une parole jugée peu respectueuse à son égard 3.
Dans les villes, la situation n'était guère brillante. Les plus chanceux des paysans ayant quitté leur village devenaient domestiques, pour les femmes ou les enfants, dans les familles plus riches, ou tireurs de pousse-pousse pour les hommes, ou encore coolies, pour les deux sexes, dans différentes entreprises ou sociétés. Le chemin de la prostitution attendait d'autres femmes dans les bas quartiers ou dans des "maisons de chanteuses". Pour toute l'Indochine, en 1930 la main-d'oeuvre dans tous les secteurs confondus se chiffrait à 221.032 ouvriers salariés (81.168 dans les entreprises agricoles, 86.624 dans les secteurs commerciaux et industriels, 53.240 dans les entreprises minières), soit 1% de la population totale 1. Le chômage touchait donc toutes les couches sociales, les intellectuels compris. A propos de jeunes diplômés et des "Retours de France", le député de la Cochinchine, Ernest Outrey écrit en 1934 :
(...) Hélas, pour un trop grand nombre c'est la déception qui commence. L'avenir est complètement bouché. Rien n'est offert à leur activité. (...)
En Cochinchine, à l'heure où j'écris ces lignes, il y a un fort contingent de diplômés annamites qui ne trouvent pas à utiliser leurs connaissances, ou alors avec des traitements dérisoires 2.
C'est aussi pendant cette période qu'on voyait apparaître à Hanoi et dans ses environs des "Dancings", de petits hôtels meublés facilitant la prostitution clandestine, et que les filles se jetaient dans les lacs pour se suicider à la suite d'amours contrariées, de déceptions amoureuses ou de conflits familiaux.
Ce tableau social, certes raccourci, nous permet néanmoins de situer la génération des écrivains des années 1930 dans leur contexte.
Par ailleurs, le métier d'écrivain était parfois assimilé au chômage 1. D'une part, c'était une nouvelle profession et d'autre part, les jeunes sortis de l'enseignement du second degré n'avaient pas de débouchés professionnelles. Devenir écrivain signifiait pour la plupart des romanciers non une évasion mais avant tout un moyen de donner un sens à sa propre vie, qui procure par la même occasion un moyen se subsistance. C'est la rencontre d'une réalité sociale et du parcours individuel de chacun. Peu d'entre eux sont parvenus aux études supérieures. Leur origine sociale leur interdit cet itinéraire réservé aux jeunes des familles aisées ou mandarinales en bons termes avec le régime colonial. A part quelques "Retours de France" comme Nhât Linh, Vu Liên Hoàng Tich Chu, ils avaient le niveau d'études secondaire, d'autres encore s'inscrivaient qui aux Beaux-Arts, qui à l'Ecole normale d'instituteurs, sans avoir toujours pu finir leurs cursus. La situation économique difficile les a obligés à chercher à gagner leur vie et à subvenir aux besoins de la famille. La recherche de la célébrité n'intervenait que dans l'étape suivante, quand ils commençaient à être connus ou reconnus.
Issu d'une famille de lettrés, Nguyên Công Hoan a fait ses études au Collège du protectorat, le fameux Truong buoi où il côtoyait le futur critique littéraire Vu Ngoc Phan, et le futur avocat constitutionnaliste du Sud, Nguyên Phan Long. Elève peu studieux et turbulent, il s'est choisi volontairement sa date de naissance, le 1er avril (jour du poisson d'avril) 1905 (deux ans de moins que sa vraie année de naissance), lors d'une déclaration aux autorités pour obtenir l'acte de naissance demandé par l'école dans la constitution du dossier pour l'examen 1. Ce qui montre que la culture française n'était pas étrangère pour lui. S'il n'était pas brillant à l'école il lisait tout ce qu'il trouvait à sa portée: des revues comme Nam phong, Dông duong tap chi, Huu thanh; des journaux tels que Trung bac tân van, Hà thành ngo bao, et même Viêt Nam Hôn et Le Paria, etc. Il aimait à lire aussi la littérature française: Les Misérables le passionnait, mais le roman d'Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires (version vietnamienne), demeurait son livre de chevet qui l'aida dans la structuration de ses histoires par la suite. Il était voisin, dans sa jeunesse, du poète Tan Dà, plus âgé que lui, et celui-ci lui a fait rencontrer le milieu littéraire de Hà nôi de la fin des années 1920. En 1926, à l'âge de 23 ans, Hoan devint instituteur, et deux ans plus tard Nguyên Thai Hoc, qui avait été aussi son ancien camarade dans le primaire, lui proposa d'adhérer au VNQDD, décision qu'il a prise sans hésitation 2. Mais en 1937 sous l'effet du Front populaire, il demanda l'adhésion à la section coloniale de la SFIO en Indochine. A cause de ces engagements, les autorités coloniales l'ont sans cesse muté dans les provinces pour l'éloigner des milieux politiques. Ainsi il a passé vingt ans de sa vie comme enseignant tout en écrivant. Ses séjours loin de Hà nôi lui permettaient d'entrer en contact avec la réalité paysanne, d'être témoin des exactions des notables du village et des pratiques humiliantes que subissait le petit peuple. Ceci constituait par la suite le cadre de ses écrits satiriques qui peignaient la vie misérable des couches défavorisées en dénonçant le mandarinat en milieu rural. Ses romans tels que Cai thu lon (La tête de cochon), qui évoque ce symbole de la lutte pour le pouvoir entre les notables, Ngua nguoi và nguoi ngua (Cheval-homme et homme-cheval) 1, Ong chu bà chu (Le patron et la patronne) en sont les preuves. Nguyên Công Hoan ne faisait pas exception à la règle: s'il avait commencé à écrire des nouvelles dès sa tendre jeunesse, son travail effectif date de l'époque où il collaborait pour le journal An nam tap chi du poète Tan Dà qu'il avait connu. La littérature devenait alors pour lui le chemin de la libération (con duong giai thoat) 2. Par ce chemin qui le libérait des tourments personnels, et qui se présentait comme une alternative à l'impasse politique, il entrait en contact avec d'autres écrivains et journalistes dont ceux du groupe Tu luc van doàn. Ses écrits paraissaient pour la plupart dans An nam tap chi puis dans Tiêu thuyêt thu bây (Les romans du Samedi), paru à partir de 1934 et dirigé par Vu Dinh Long qui possédait la maison d'édition Tân dân (Le nouveau peuple), quand le journal du poète Tan Dà fit faillite. Vers la fin de cette décennie Vu Dinh Long laissait la gestion de Tiêu thuyêt thu bây à un autre journaliste, Vu bang, qui menait parallèlement des affaires; par ailleurs, Nguyên Công Hoan était surveillé par la Sûreté qui venait perquisitionner de temps en temps chez lui, tout ceci le séparait petit à petit de cette revue qui vendait selon les semaines de quatre mille à six mille exemplaires.
En termes de distractions et de plaisirs du milieu littéraire, il n'y avait pas de règle. Néanmoins, ceux qui étaient nourris d'idées de progrès et de changements, les idéalistes, ne cherchaient pas à passer leur temps dans les lieux de plaisir, de plus, leur situation financière médiocre et leur responsabilité à l'égard de leur famille les détournaient du chemin des tentations. D'autres, moins préoccupés par des idéaux, cherchaient l'inspiration dans les vices et les plaisirs. Dans ses mémoires Hô Huu Tuong, militant trotskyste des années 1930 reconverti plus tard en patriote, disait en termes ironiques que les vices étaient tout ce qu'il fallait pour être journaliste de cette époque 1. Ceux qui fumaient de l'opium avaient en général leur propre "garçonnière", une chambre servant de fumerie dans un autre quartier que leur lieu d'habitation, pour recevoir les intimes. Mais l'apanage des plaisirs, charnels ou non, revenait plutôt à la petite bourgeoisie marchande, aux médecins et ingénieurs, à certains "Retours de France" désoeuvrés, qui se livraient à des débauches. Ces lieux-là n'intéressaient pas Nguyên Công Hoan qui, par pudeur, s'abstenait même dans ses mémoires de donner des détails 2.
Dans Cô giao Minh (L'institutrice Minh), il dénonce le mariage forcé d'une institutrice avec un homme qu'elle n'aime pas pour satisfaire sa mère. Nguyên Công Hoan voulait opposer son roman à celui de Nhât Linh, Doan tuyêt (La rupture), qui soutient l'idée que l'homme nouveau doit rompre avec la famille ancienne, tandis que lui, il défend l'idée de convaincre la vieille génération pour la gagner au nouveau. Peu de temps après la parution de son roman en 1936, une "jolie jeune fille d'une vingtaine d'années" vint lui rendre visite pour lui exprimer son malheur qu'elle partageait avec l'héroïne du roman. Les circonstances ne leur ont pas permis d'aller plus loin, cependant il devint amoureux de son admiratrice, qui finit, quelques années après, par mourir des coups donnés par son mari 1. S'il a parlé de cette histoire d'amour et d'une autre anecdote, Nguyên Công Hoan n'a pas parlé du tout de sa femme dans ses mémoires, contrairement à Vu Ngoc Phan qui considère la sienne comme une compagne pour la vie, dont il parle abondamment dans ses mémoires 2. Ainsi on peut se demander si dans la vie, Nguyên Công Hoan acceptait l'idée de la femme moderne. Quoi qu'il en fût, de son vivant ses contemporains n'ont pas oublié le trio qu'il formait avec Vu Trong Phung et Tam Lang (les deux reporters étant appréciés pour leurs écrits réalistes sur la société), dans les débats et conférences sur la littérature dans lesquels ils étaient des porte-parole de la nouvelle génération.
Si Nguyên Công Hoan se dirigeait vers la littérature descriptive de la société, Vu Ngoc Phan préférait les critiques littéraires. Ses oeuvres consacrées aux écrivains de la fin du XIXe siècle au début de la Seconde Guerre mondiale 3, publiées en cinq volumes à partir de 1942, témoignent de son ardeur. Originaire d'une grande famille de lettrés, il a fait ses premières études dans une école franco-indigène, puis plus tard il suivit avec assiduité l'enseignement au Collège du protectorat d'où il sortit vers 1926 avec le Brevet. Tout en travaillant il continua ses études jusqu'au Baccalauréat qui lui permettrait d'entrer en contact avec le milieu journalistique. Marié à 24 ans, le jour de Noël 1926 date qu'il avait choisie lui-même, avec la première fille dont il était tombé amoureux, Vu Ngoc Phan devait assurer financièrement les besoins du jeune couple. Il a refusé les propositions de certaines familles riches qui voulaient marier leur fille avec promesse de l'envoyer en France, pour choisir Hang Phuong, sa compagne pour la vie, dont il était fier. Sur le plan personnel, il était sans reproche: assidu dans le travail et respectueux à l'égard de la famille. Il préférait la littérature française et les écrits sur la révolution française aux divertissements et plaisirs auxquels se livraient certains journalistes et écrivains de son époque. Confronté aux difficultés matérielles, il devait corriger des devoirs pour une école privée, pour gagner sa vie dans un premier temps. Comme la plupart des jeunes de sa génération ayant la même formation, il a ensuite enseigné dans des établissements privés. Le métier d'écrivain qu'il a choisi répondait à ses attentes: la possibilité de travailler à son rythme sans avoir à se soumettre à une hiérarchie pesante. Mais il écrit aussi dans ses mémoires, que "ce qu'il est important pour un écrivain de faire sous un régime colonial et féodal (souligné par nous) c'est de préserver et développer sa culture dont la langue, la littérature et les arts font partie. Chacun travaille dans son domaine et selon ses capacités tout en restant pur, là est la voie vers la réussite et vers une contribution pour la patrie, même si cela ne représente qu'une petite part 1". Sa rencontre avec Trân Trong Kim et Hoàng Tich Chu en 1929 l'a introduit au milieu journalistique. Il commença par traduire des extraits de la prose française pour le journal Librement socialiste géré par Babut. A la suite de quoi il collabora avec Vu Dinh Dy, qui avait dirigé La jeune Indochine dans le Sud, pour son nouveau journal L'effort indochinois, et avec bien d'autres journaux et revues encore. Enfin, il dirigea la revue Hà nôi tân van (La nouvelle littérature de Hanoi) à partir de 1939, une revue à caractère purement littéraire.
A partir de 1933-1934 le milieu des journalistes et des écrivains accueillit la venue du jeune reporter Vu Trong Phung qui se distinguait par son style vivant et percutant. Né dans une famille modeste, il a commencé à travailler comme vendeur au magasin Godart puis comme secrétaire-dactylo à l'Imprimerie d'Extrême-Orient, après avoir abandonné ses études à l'Ecole normale d'instituteurs. On dit qu'il a été licencié de cette imprimerie pour avoir tapé ses écrits à la place de son travail 1. Amoureux d'une jeune fille, il lui écrivit chaque semaine une longue lettre d'amour avant de se marier avec elle à l'âge de 26 ans, un an avant de mourir par la tuberculose en 1939. Les gens de cette époque le prenaient pour un jeune homme livré aux vices et aux plaisirs, sans doute une projection mentale faite à partir de ses écrits ayant pour cadre les bas quartiers de Hanoi et les milieux défavorisés, et dont les personnages principaux étaient les débauchés, les désoeuvrés. A en croire Vu Ngoc Phan, il était très correct sur tous les plans, et sa vie n'avait rien de débauché 2. Au début des années 1930, il portait le turban et s'habillait encore à l'ancienne avec une tunique noire. Formant un trio dans le comité de rédaction avec deux autres journalistes, Ta Dinh Binh et Nguyên Triêu Luât, il écrivait dans le Nhât tân (Le jour nouveau) de Dô Van que pour sa part, les idées modernes exprimées dans son journal n'empêchent pas d'avoir deux femmes à la fois tout en menant une vie à part pour être plus libre 1. C'est au siège de ce journal que Nguyên Công Hoan a fait la connaissance du jeune reporter Vu Trong Phung qui écrivait également pour d'autres journaux. A part le groupe Tu Luc Van Doàn qui possédait deux journaux et la maison d'édition Doi nay (La vie actuelle), les autres journalistes ou écrivains, par nécessité économique, travaillaient pour plusieurs journaux à la fois sauf en cas de désaccord politique. Là où on les payait le mieux ils envoyaient leurs écrits, de plus ils n'aimaient pas être liés à un seul journal. S'il était connu plutôt comme reporter, Vu Trong Phung écrivait aussi des nouvelles et des romans et même des pièces de théâtre. Dans Ky nghê lây Tây (Techniques de mariage avec des Français), il décrivait une catégorie de femmes vietnamiennes à la fois désoeuvrées et poussées par les difficultés économiques qui se lançaient à fréquenter des Français puis se sont mariées avec eux pour avoir une vie meilleure. Dans le même ordre d'idées le roman Làm di (Se prostituer) retraçait la vie des laissées pour compte dans une société pleine d'embûches, ayant subi les répercussions de la crise. Ses révoltes contre une société d'injustice dans laquelle les paysans étaient les premières victimes de la classe mandarinale et des notables, on les trouve dans son roman Vo dê (Les digues s'effondrent). On peut dire que ses personnages, que ce fût dans les reportages ou dans les romans, étaient des personnages réels de la vie. Leurs attitudes et les situations dans lesquelles ils se trouvaient étaient des tableaux vivants de cette époque. Il a laissé au total, en une dizaine d'années de travail, six reportages, huit romans, vingt nouvelles et six pièces de théâtre.
A travers les trois portraits, les trois destins que nous venons d'évoquer et qui reflétaient les milieux culturels du Hanoi des années 1930, la littérature apparaît tantôt comme un refuge, tantôt comme une révolte, ou encore comme un gagne-pain, pour ceux qui, ayant senti les problèmes posés à une société en pleine mutation, une société confrontée à une impasse politique, cherchaient dans la limite du possible à faire changer les mentalités et les vieilles traditions oppressives à l'égard de l'individu. Néanmoins, la littérature sous sa forme moderne, répondait aussi à une aspiration, à un renouvellement du mode d'expression pour combler le vide laissé par la vieille génération de lettrés qui ne trouvaient plus leur place, et n'avaient plus aucun rôle majeur dans les structures sociales. Ces milieux d'intellectuels modernes ont ouvert la voie sur une nouvelle perspective, et établi un pont entre l'Occident et le Vietnam en détruisant les barrages culturels qui séparaient ces deux mondes. En tout état de cause, le groupe Tu Luc Van Doàn constituait le pôle le plus solide par la quantité de sa production et par sa détermination à changer la société en profondeur. Les romans de Nhât Linh et de Khai hung allaient au coeur des problèmes en restituant à l'individu les droits qui lui revenaient, en le libérant des devoirs ancestraux faisant de chaque individu une composante passive de la collectivité. Contrairement au jugement des littérateurs officiels de Hanoi qui font l'amalgame en qualifiant cette génération d'écrivains de romantiques ils étaient avant tout des romanciers réalistes à tendance sociale. (En fait, le régime les confondent avec les poètes de la même génération qui, eux, étaient des romantiques.) Reste à savoir ce que les héritiers de cette génération ont fait par la suite de ces fondations.
LES POETES
Bien que les poètes n'aient pas constitué une espèce rare dans la société vietnamienne précoloniale, jamais jusqu'alors on n'avait vu une floraison de poètes aussi significative que celle des années 1930. Toutes les raisons qui ont donné naissance aux journalistes et romanciers s'appliquent aux poètes à une exception près. Tandis que ces derniers n'existaient pas avant la colonisation, les poètes, au contraire, avaient bien leur place dans la société. C'est dans ce sens qu'ils n'étaient pas des hommes nouveaux. Ce qui était nouveau chez eux c'était leur nouvelle forme d'expression en rupture avec celle des générations précédentes qui s'étaient pliées aux règles strictes de la poésie ancienne calquée sur celle des Tang en Chine. Mais cette nouvelle forme d'expression a rapidement fini par transformer le fond de la pensée, pour des raisons liées au contexte évoqué plus haut, concernant les journalistes et les écrivains.
Le représentant de la dernière génération des poètes de formation classique se trouve en la personne de Tan Dà, de son vrai nom Nguyên Khac Hiêu qui, en quelque sorte, marque la transition d'une génération à l'autre. Issus d'une grande famille de lettrés depuis les Tây Son, ses ancêtres ont refusé de servir la dynastie des Nguyên, et les membres de cette grande famille perdirent petit à petit leur réputation et leurs privilèges pour devenir de simples paysans, comme le père du poète, qui, cependant, a fini par être mandarin de district après avoir été reçu au concours triennal. De formation classique, Tan Dà passa le concours en 1912 à Nam Dinh dans l'espoir d'en être lauréat, mais surtout pour se marier dignement avec la femme dont il était amoureux. Son élimination du concours décida sa bien aimée à se marier avec un autre, événement qui le rendit dépressif pendant de longues années. Ainsi, il tourna le dos au concours et commença à écrire dans le Dông duong tap chi de Nguyên Van Vinh à partir de 1915. Poète dans l'âme, il a parcouru le pays du nord au sud avec comme simples bagages "une calebasse d'alcool et des poches (pleines) de poèmes" (bâu ruou tui tho), ses signes particuliers, avant de créer le journal An nam tap chi en 1926 à Hanoi. Il confia la rubrique "Viêt nam nhi thâp ky xa hôi ba dào ky" (Ecrits sur la société misérable vietnamienne du XXe siècle) à Nguyên Công Hoan. La réputation du poète a séduit Diêp Van Ky, le gérant du journal Thân chung à Saigon, qui, voulant se donner le rôle de mécène, lui a offert deux mille piastres 1 pour faire ce qu'il voulait, somme que le poète n'aurait jamais imaginé posséder. Il avait une petite chambre à Hanoi servant à la fois de bureau de travail et de lieu d'habitation, et où il hébergea Nguyên Công Hoan à son arrivée dans la capitale. Sentimental, Tan Dà n'arrivait pas à publier son journal dans les délais et s'endettait pour le sortir coûte que coûte. Mais le vent avait tourné et l'opinion de ceux qui s'intéressaient à la littérature et à la poésie accordait désormais une certaine sympathie à la nouvelle vague. Luu Trong Lu, Thê Lu, Nguyên Binh, Huy Cân, Xuân Diêu, Tu Mo, et bien d'autres encore faisaient partie de cette nouvelle vague. Comme leurs camarades écrivains, ces poètes n'étaient pas des universitaires, les plus avancés sur le plan des études dépassaient à peine le niveau secondaire. Leur groupe se trouvait autour de quelques journaux ou revues "à la mode" de l'époque, tels que Phong hoa, Ngày nay, Phu nu thoi dàm, Nhât tân, Tiêu thuyêt thu bây, etc.
Le mouvement de la poésie moderne a pris naissance en 1932. Le 10 octobre de cette année, Phan Khôi lança, dans les colonnes du Phu Nu Tân Van, journal respecté de l'époque, une idée, qui allait devenir une véritable bombe littéraire par la suite: en conclusion d'un poème, il ajouta qu'"il s'agit d'exprimer ses vraies idées avec des mots rimés mais libérés des règles anciennes, ce que j'appelle provisoirement la poésie moderne". Cette idée a suscité des réactions de la part de jeunes poètes, parmi lesquels figure Luu Trong Lu. Mais un mois avant cette déclaration de Phan Khôi, le journal Phong hoa avait commencé à critiquer la poésie classique en disant que "la poésie devait être moderne, moderne de la forme aux idées 1". L'idée de Phan Khôi a donc trouvé un écho favorable dans le Nord, et à partir de 1933 le journal Phong hoa publiait des poèmes modernes de Luu Trong Lu, de Thê Lu, etc. Sur les cinquantaines de poèmes du recueil Tiêng thu (Les sons d'automne) de Luu Trong Lu, paru en 1939, un bon nombre étaient dédicacés à ses amis, dont un à Phan Khôi, un autre au duo inséparable Xuân Diêu et Huy Cân. Luu Trong Lu était partisan de cette nouvelle forme d'expression, et armé de ses qualités d'orateur il parcourait les grandes villes pour faire des conférences sur ce sujet. Les lettrés de formation classique ont bien riposté: certains rétorquaient que les jeunes préféraient la poésie moderne parce qu'ils ne savaient pas composer des poèmes classiques qui étaient trop difficiles pour eux, en comparant les jeunes poètes aux aveugles qui parlaient des rêves, à des ignorants qui faisaient de la poésie 1. Certains autres voulaient bien céder le terrain scientifique à la jeune génération, mais pour ce qui concernait la littérature ils revendiquaient l'exclusivité 2. Bien que Tan Dà fît partie de la vieille génération, il s'en distinguait par son attitude réservée à l'égard de la poésie moderne et par ses relations amicales avec les jeunes, cependant il se rangeait du côté des classiques étant donné sa formation 3. Parallèlement à ce débat, les milieux littéraires discutaient aussi sur le rôle de l'art en général, et ils se posaient la question "L'art pour l'art ou l'art pour la vie?" Cette question a été soulevée à la suite de la publication de la nouvelle Kep Tu Bên (Le comédien Tu Bên) de Nguyên Công Hoan. Contraint de jouer une pièce comique pour subvenir à ses besoins matériels, Tu Bên se retrouve devant un public qu'il divertit et qui le réclame pendant que son père, malade depuis plusieurs semaines, agonise sans qu'on le prévienne. Cette question divisait la jeune génération montante en deux camps opposés, d'un côté se rangeaient les matérialistes dont le porte-parole le plus influent écrivait dans les colonnes de Doi moi (La vie moderne) sous le pseudonyme de Hai Triêu, et de l'autre on retrouvait les défenseurs de la poésie moderne en la personne de Luu Trong Lu, Hoai Thanh, etc. Ce dernier débat n'a pas connu de fin, quant à la poésie moderne, elle a fini par triompher vers 1936 dans la vie littéraire.
Si Phan Khôi et Luu Trong Lu se faisaient les avocats de la poésie moderne et s'efforçaient de la faire connaître auprès du public, Thê Lu était le véritable bâtisseur silencieux de cette nouvelle école littéraire. Membre du groupe Tu Luc Van Doàn, il assurait la rubrique "Poésie moderne" dans les journaux du groupe en donnant des conseils et des idées aux lecteurs et aux jeunes qui voulaient s'initier à la poésie moderne. C'est encore Thê Lu qui a fait connaître le jeune Xuân Diêu au grand public. Xuân Diêu, membre également du groupe Tu Luc Van Doàn par la suite, était sans doute le poète le plus marqué par l'occidentalisation dans sa façon d'écrire. Cependant ses poèmes reflétaient une dimension non abordée par les autres jeunes poètes de sa génération, à savoir la solitude de la vie. L'amitié qui le liait à Huy Cân suscitait aussi des commentaires, on les comparait tantôt à Rimbaud et Verlaine, tantôt à Montaigne et La Boétie. Partageant un appartement à la même adresse que Luu Trong Lu, le duo Xuân Diêu-Huy Cân était inséparable depuis qu'ils s'étaient connus sur les bancs de l'école, jusqu'au jour où Xuân Diêu quitta le Nord pour le Sud après avoir été engagé comme agent technique au Service des impôts. Avant son départ ses amis vinrent lui dire au revoir autour d'un repas; ils étaient huit dont le poète satirique Tu Mo. Comme tous étaient poètes, chacun a composé un vers en son honneur: le deuxième vers décrit Xuân Diêu comme quelqu'un qui a un visage à deux facettes, l'une de poète et l'autre de mandarin 1; Tu mo, quant à lui, lui rappelle de ne pas oublier les sons du petit tambour chez les chanteuses 1.
Passionné aussi par le théâtre, Thê Lu participait au montage des pièces avec des troupes d'amateurs lors des journées des étudiants. A cette époque les rôles féminins étaient tenus par les hommes, car ce mode d'expression n'était qu'à son début, sinon il aurait fallu faire appel à de vraies professionnelles du théâtre classique ou du théâtre rénové (cai luong) qui a pris naissance dans le Sud.
Contrairement à se qui se passait dans le milieu des écrivains qui ne rassemblait que des hommes, les femmes arrivaient à siéger à la tribune de la poésie moderne. Certaines faisaient des conférences pour défendre cette nouvelle idée, comme la poétesse Manh Manh, pseudonyme de Nguyên Thi Kiêm, dont les poèmes paraissaient dans Phu Nu Tân Van à Saigon. Bien que le nombre de poétesses fût sans commune mesure avec celui de leurs condisciples masculins, des figures comme Anh Tho ou T.T.KH. faisaient partie intégrante de cette génération. La poétesse Anh Tho a obtenu en 1939 le prix d'encouragement décerné par le groupe Tu Luc Van Doàn, tandis que T.T.KH. demeure jusqu'à nos jours une figure énigmatique de la vie littéraire. On ne la connaissait qu'à travers deux poèmes en réaction à une nouvelle parue dans Tiêu thuyêt thu bây en septembre 1937. T.T.KH. décrivait son amour pour un jeune homme qu'elle devait quitter pour se marier avec un autre sans l'aimer et sans que son amoureux le sache. Comme elle n'a pas laissé son adresse à cette revue et que personne ne la connaissait, ce fut une occasion pour les poètes de l'époque de fantasmer. Beaucoup d'entre eux l'ont identifiée comme étant leur propre admiratrice ou à leur bien-aimée.
Effectivement, le thème favori des poètes de la nouvelle vague était essentiellement l'amour, ce qui n'était pas le cas des romanciers qui traitaient plutôt des questions sociales. Parler de l'amour signifie accorder la place qui leur revient aux sentiments, les laisser s'exprimer librement sans aucune retenue ni tabou. Dans le contexte du Vietnam, ceci constitue une rupture avec la tradition littéraire académique qui, à de rares exceptions près, n'accordait pas une vraie place à l'amour. Le débat sur la modernité s'introduit ainsi par le biais de l'amour, servant de prétexte à la révolte contre la famille traditionnelle qui est le lieu de prédilection de l'observation des principes confucéens. Cette "attaque" d'une vigueur sans précédent survient dans une conjoncture où les lettrés de formation classique, dépositaires du savoir ancestral et porteurs de la morale, se retrouvent relégués au second plan. Bien que les poètes ne s'adressent pas à la famille, ou n'en parlent pas du tout, contrairement à ce que font les journalistes ou les romanciers pour exprimer leur désaccord, leurs écrits se suffisent à eux-mêmes pour dire ce qu'ils pensent sans provoquer de vagues. Effectivement, désormais dans la poésie le terme "ta",- qui englobe celui qui parle et ceux à qui on s'adresse, utilisé dans la poésie classique-, doit céder la place au terme "tôi" qui veut dire sans détour "moi", "je". L'individu prend conscience de son existence et reconquiert sa place pour s'affirmer pleinement sans se soucier du "qu'en dira-t-on". Il vient, à cet égard, à se détacher de son environnement familial et social, qui faisait de lui un être anonyme ou à multiples facettes selon les circonstances, pour effacer ce qui était la confusion des rôles à ses dépens. A ce propos, Hoai Thanh et Hoai Chân écrivent:
Le premier jour, on ignore exactement quand, où le terme "tôi" apparut dans la poésie vietnamienne, c'était étrange. Comme s'il était perdu dans un univers. Parce qu'il portait avec lui une notion inconnue dans ce pays: la notion d'individu. Dans la société vietnamienne d'autrefois l'individu n'existait pas. Il n'y avait que la communauté: la nation, la famille. Quant à l'individu, sa nature était immergée dans la famille, dans la nation comme une goutte d'eau dans l'océan. (...) A chaque fois qu'ils (ceux qui sortaient de l'anonymat) regardaient leur âme ou qu'ils se trouvaient devant les autres, soit ils ne se nommaient pas, soit ils se cachaient derrière le mot "ta" qui désigne plusieurs personnes. Ils devaient faire appel à la communauté pour fuir la solitude. (...)
Nos poètes d'aujourd'hui ont perdu l'audace d'autrefois. Le terme "ta" leur semble trop vaste. Leur âme ne dépasse pas les limites du terme "tôi". (...)
Notre vie s'inscrit dans ces limites. La profondeur compense l'étendue. Mais plus c'est profond plus ça fait froid 1.
Ces quelques phrases formulent bien l'état d'esprit de cette génération qui cherche à se libérer de la communauté mais qui découvre par la même occasion la dimension "solitude" au bout de leur recherche, qui donne froid au dos.
Silencieuse mais efficace, la poésie moderne a su faire basculer la situation en intronisant l'individu sur la scène littéraire, et reconquérir la place de l'amour dans les différentes formes d'expression. De même que leurs condisciples journalistes ou romanciers, les poètes étaient traversés par les idées venant de l'Occident. Le romantisme, à travers Verlaine et Rimbaud surtout, et aussi Baudelaire, était considéré par certains comme le fil d'Ariane qui leur permettrait de sortir d'une situation sociale mouvementée. S'agit-il d'une résignation? Sont-ils acculés à écrire sur l'amour faute de liberté? Visiblement ce choix, conséquence directe de la floraison de jeunes poètes modernes, a été déterminé par la rencontre d'une réalité sociale et le parcours individuel de chacun d'entre eux, le même processus qui a donné naissance à la nouvelle génération d'écrivains et romanciers. Par ailleurs on constate que les poètes constituent le milieu le moins engagé politiquement, par rapport aux journalistes et aux romanciers. Comment expliquer ces faits? Question de tempérament ou question de contexte?
Quoi qu'il en soit, chacun des milieux intellectuels des années 1930 a agi et réagi à sa manière. Cependant on dirait qu'il y avait une sorte de répartition tacite des rôles selon les compétences, mais que l'ensemble forme une cohérence et obéit à la même idée, celle du progrès et de la liberté. A cet égard, si les journalistes avaient pour rôle de penser la société moderne, les romanciers apportaient les éléments concrets, et les poètes contribuaient par la description l'individu dans cette société par le biais de l'amour. En ce sens, la modernité reposait sur les journalistes, les écrivains et les poètes. Quels ont été les effets de ces tentatives? Les idées modernes ont-elles pu franchir la frontière qui séparait la ville de la campagne? Quel était le prix à payer pour accéder à la modernité? Nous examinerons ces questions dans les chapitres suivants consacrés à la société et à la vie quotidienne.
D E U X I E M E P A R T I E
LES CINQ MODERNISATIONS
D E
L A S O C I E T E
CHAPITRE 4
L A V I E C U L T U R E L L E
En quelques décennies de colonisation, à travers les agents modernisateurs d'une part et sous l'effet des milieux porteurs de modernité d'autre part, la société vietnamienne a quelque peu changé, du moins ce qu'on constate dans les centres urbains. La campagne qui était pourtant un objet de réflexion pour les intellectuels qui voulaient apporter une touche moderne à la vie rurale, semblait rester à l'écart de ces entreprises et de ces bouleversements. Bouleversements non seulement sur les plans matériel et culturel, mais bouleversements également sur le plan des moeurs dont la presse et la littérature parlaient abondamment. Afin de chercher à comprendre comment ces transformations se sont opérées dans la société, nous nous intéresserons dans un premier temps à quelques domaines tels que la langue, la littérature, le théâtre, le cinéma et les dessins humoristiques qui étaient le reflet de la société, au début, mais qui sont devenus rapidement à leur tour des agents actifs de la modernisation culturelle.
LA LANGUE
Le navire de la révolution est en train
de louvoyer entre les écueils pour avancer.
Extrait de la décision du comité
central du PCV du 9 mars 1946.
Chaque écriture qui est un prolongement de la langue pour matérialiser les idées, possède son propre système et sa propre logique. S'exprimer à travers l'écriture revient à respecter les règles imposées par celle-ci. Si "la langue est un instrument qui permet la communication au moyen de signes vocaux (secondairement écrits) spécifiques aux membres d'une même communauté historique" 1, elle reflète encore l'univers mental de ceux qui l'emploient. Le vocabulaire dont est constitué une langue a, à cet égard, un rôle important. L'introduction ou l'intégration d'un nouveau vocabulaire dans une langue donnée traduit ainsi une évolution dans la façon de penser, car un mot en soi peut aussi véhiculer des notions ou des concepts inexistants dans la langue réceptrice.
Le vietnamien, à cet égard, constitue un exemple significatif. On constate par ailleurs que quand deux peuples (dont l'un possède une écriture et l'autre non) ou deux cultures se rencontrent, c'est celui ou celle qui possède une écriture qui parvient à dominer l'autre, d'une part, et d'autre part, c'est le peuple dominé qui emprunte le plus facilement l'écriture ou le vocabulaire au peuple dominant. L'écriture n'est certes pas un facteur qui facilite la domination mais elle intervient a posteriori comme un fait accompli. Les Vietnamiens ont emprunté aux Chinois leur écriture et le système philosophico-cosmogonique qui va avec. L'effort des lettrés qui voulaient doter le pays d'une écriture spécifique afin de se soustraire à la tutelle culturelle chinoise n'a pas pu aboutir à un véritable système de notation de la langue parlée. Le chu nôm 2 est ainsi resté une entreprise inachevée à l'arrivée des Occidentaux. Tandis que cette écriture, prisonnière des sons sino-vietnamiens, ne pouvait transcrire, au mieux, que la moitié des 150 sons de la langue vietnamienne 1, le quôc ngu utilisant l'alphabet latin, a l'avantage de transcrire sans difficulté tous les sons possibles. Vu sous cet angle, le quôc ngu accélère donc l'occidentalisation par l'emprunt du vocabulaire français en particulier, et plus généralement des concepts modernes liés à la culture française. Le Japon qui n'était soumis à aucune domination politique comparable à celle des pays de l'Asie du Sud-Est, a vu cependant son langage évoluer au contact de la culture occidentale. Le langage vient à son tour modifier les représentations. Dans Histoire de la famille, et plus précisément dans la partie consacrée au Japon, P. Beillevaire écrit:
Les modifications intervenues depuis 1945 dans le vocabulaire témoignent de représentations nouvelles de la famille et de l'évolution des rapports en son sein. Tout d'abord le terme ié, la "maison", qui pour une majorité de Japonais ne correspond plus à aucune réalité concrète,(..) le langage officiel ou celui des sociologues lui ont substitué l'idée de "foyer" ou de "ménage" (setai, shotai, katei). Le "chef" ou "maître de maison" est lui-même devenu en conséquence un "chef de foyer", setai nushi, avec la connotation neutre que revêt chez nous cette désignation administrative. (...) Il est maintenant fréquent d'entendre les jeunes enfants user des termes occidentaux "papa" et "mama" pour appeler leurs parents au lieu des traditionnels otôsan, okâsan: la charge d'autorité et l'obligation de déférence qui s'attachent aux vocables japonais expliqueraient, compte tenu aussi du simple attrait pour les usages venus d'Outre-Pacifique, que ces termes ne soient plus de mise dans le contexte familial actuel 1.
En ce qui concerne la société vietnamienne, les changements de cette nature liés à l'adoption d'un nouveau langage pour s'adapter à un nouvel environnement social ne se sont opérés qu'après l'indépendance. Par exemple, la façon dont les élèves s'adressaient traditionnellement à leurs enseignants en se nommant con (enfant) et en les appelant thây (maître), s'efface au profit de celle qui consiste à se nommer em (petit frère ou petite soeur) à la place de con, surtout quand l'écart entre l'âge de l'enseignant et celui de l'élève n'est pas très grand. Le statut du "maître" si respecté dans l'ancienne conception se voit diminué par la même occasion. La traditionnelle visite annuelle avec des cadeaux à l'approche du têt que l'élève avait le devoir de faire à son maître tombe ainsi en désuétude. Mais avant d'en arriver là, la langue vietnamienne a déjà subi des changements. Approximativement on peut situer ces changements dans trois phases successives:
* la première va du début de la colonisation jusqu'à 1927 (cette date est choisie arbitrairement en prenant l'année de la disparition de Phan Chu Trinh que nous considérons comme la fin des lettrés de formation classique);
* la deuxième va jusqu'à l'indépendance;
* et la troisième, de la Révolution d'Août à nos jours.
La première phase peut être qualifiée de phase d'emprunt durant laquelle la langue vietnamienne , au contact de la vie coloniale, s'enrichit d'un vocabulaire nouveau. Les tout premiers acquis de cette période remontent à la fin du siècle dernier. Il s'agit des noms propres d'origine européenne transcrits à partir des transcriptions chinoises avant de prendre une consonance sino-vietnamienne. Cette double déformation phonétique d'un mot européen donne un résultat qui, parfois, n'a que peu à voir avec son origine. Nous avons, par exemple:
Paris transcription chinoise Ba lê
La Fontaine t.c. La Phung Tiên
Montesquieu t.c. Manh Duc Tu Cuu
Rousseau t.c. Lu Thoa
Napoléon t.c. Na Pha Luân
New York t.c. Nuu Uoc
Washington t.c. Hoa Thinh Dôn.
On remarque que la consonne "r" dans la langue européenne a été déformée en "l", car le son émis par le "r" n'a pas d'équivalent en chinois, d'où cette substitution. Par ailleurs, parallèlement à ces emprunts, les lettrés ont inventé des termes nouveaux pour traduire les titres ou les fonctions dans l'Administration française. On a ainsi:
Toàn quyên : gouverneur général
(littéralement: tout pouvoir)
Thông su : résident supérieur
Công su : résident (provincial)
Mâu quôc : mère-patrie
Nhà nuoc bao hô : le protectorat
(littéralement:l'Etat protecteur)
Quan thây dai phap : haut fonctionnaire (littéralement:
mandarin maître Grande France)
Thu ky : secrétaire
Thu quy : trésorier (littéralement:
tête caisse),
etc., etc.
Lê Van Nuu qui s'intéressait à ce sujet se posait encore des questions dans les années 1930:
Quel sera l'avenir de la langue annamite? Sera-t-elle complètement dominée par le français comme elle le fut jusqu'ici par les caractères chinois? Pourra-t-il y avoir une véritable littérature nationale annamite? Quelles seront les conditions de son existence et de son développement 1 ?
Cet auteur a fait remarquer et a déploré que la classe intellectuelle, ayant reçu une instruction française de cette époque, introduisait facilement du vocabulaire français dans ses discours. Même de nos jours, cette pratique n'a pas complètement disparu dans la diaspora vietnamienne. Cet usage se remarque, en France, également dans d'autres communautés d'origine africaine. Cependant il convient de distinguer les deux cas de figure, car il ne s'agit pas uniquement de la paresse d'esprit que condamnait Lê Van Nuu. Il est fréquent, par ailleurs, qu'un Vietnamien, baigné dans un environnement culturel français, ne trouve pas des mots dans sa langue maternelle pour exprimer certains concepts, ou pour désigner certaines choses, pour une simple raison de retard linguistique: le vietnamien se développait moins vite que le français, surtout pendant la colonisation et dans les domaines techniques ou scientifiques. Même à l'heure actuelle on se demande si ce retard a été rattrapé.
D'un autre côté le peuple contribuait à sa façon à enrichir la langue nationale. La population urbaine en contact avec la vie moderne, avec le conforts moderne, ceux qui travaillaient dans les bureaux, dans les magasins de commerce, dans les usines, ont petit à petit vietnamisé des mots français 1. Dans cette série de mots français vietnamisés on trouve du vocabulaire pour désigner les objets de la vie courante, les articles de consommation, etc. La vietnamisation des mots français consiste simplement à les reproduire en vietnamien. La déformation phonétique devient alors un jeu d'esprit. L'inventaire complet de cet emprunt reste à faire, cependant nous essayons de classer les principaux emprunts par centre d'intérêt.
ALIMENTATION
Légumes Boissons
cresson : cai soong bière : bia
salade : sà lach champagne : xâm banh
chou-fleur : sup lo vin : vang
chou-rave : xu hào cognac : côt nhat
carotte : cà rôt café : cà phê
cacao : ca cao
Autres produits/plats
fromage : pho mat
beurre : bo
crème : kem
(oeuf) à la coque : (trung) la cooc
omelette : (trung) ôp lêt
oeufs au plat : (trung) ôp la
biscuit : (banh) bich qui
cuiller : cui dia
fourchette : phong sêt
HABILLEMENT PRODUITS DE CONSOMMATION
chemise : (ao) so mi savon : sà phong
cravate : cà vat pile : bin
short : (quân) sooc torche : dèn bin
veste : (ao) vet alcool : côn
pull- over : bu lo vo essence : sang
pardessus : ba do xuy valise : va li
châle : (khan) san caisse : ket
laine : len poupée : bup bê
maillot : may ô cigare : xi gà
drap : ga bâton : ba toong
friser : phi dê cartable : cap tap
mouchoir : mùi soa caoutchouc: cao su
AUTRES PRODUITS/LOCOMOTION/DIVERS
ciment : si mang auto : ô tô
béton : bê tông tank : (xe) tang
ressort : lo so gare : (nhà) ga
phare : (dèn) pha banque : (nhà) bang
rails : (duong) rây hôtel : ô ten
enveloppe(pneu) : lôp douane : (nhà) doan
guidon : ghi dông lycée : lit xê
chambre à air : sam pompe : bom
potasse : bô tat acide : at xit
FONCTIONS/ ACTIVITES/DIVERS
docteur : dôc to planton : lang tông
chef : sêp vagabond : ma cà bông
contrat : công ta dame (européenne): (bà) dâm
danser : nhây dâm (littéralement: sauter dame, ce qui
veut dire "sauter" à la manière des dames
françaises), etc.
Dans ces séries de mots vietnamisés, on constate d'abord que quand le mot français est long on retient seulement la partie tonique, par exemple, "sang" (essence), "lôp" (enveloppe). Par ailleurs, des déformation phonétiques, dues à l'inexistence de certains sons français dans la langue vietnamienne, sont inévitables. Ainsi le son "p" qui est une consonne sourde n'existe pas en vietnamien, elle est systématiquement remplacée par la consonne équivalente mais sonore qui est "b". Ce qui a donné:
* "ba" dans ba do suy pour dire "pardessus";
* "banh" dans xâm banh pour dire "champagne";
* bup bê pour dire "poupée"....
Il en est de même pour le son "ch" qui a pour équivalent sonore "j". Ce dernier n'existant pas non plus en vietnamien, le "ch" est remplacé par le "s" (qui possède deux graphies "s" et "x", du moins pour l'accent du Nord). Ce qui a donné:
"xâm" dans xâm banh pour dire "champagne";
"xu" dans xu hào pour dire "chou rave";
"soa" dans mùi soa pour dire "mouchoir;
"san" dans khan san pour dire "châle", etc.
Mais il se présente aussi des cas beaucoup plus compliqués comme le "dr", on le reproduit alors approximativement et ce qui donne "ga" pour dire "drap". Or "ga" veut dire déjà la "gare", on a ainsi deux homonymes issus de deux mots français différents. Cependant il est très difficile de confondre deux homonymes en vietnamien car chaque mot prend sa pleine signification lorsqu'il est placé dans son contexte, ce qui permet d'éviter toute confusion possible.
Mais l'enrichissement de la langue vietnamienne ne s'arrête pas à l'emprunt direct du vocabulaire français. On trouve, par ailleurs, des efforts dans la formation des termes nouveaux pour traduire des concepts ou des choses liées à la culture matérielle occidentale. Par exemple, la "poste" est traduit par nhà dây thep, littéralement:
nhà veut dire maison, bâtiment
dây - " - fil
thep - " - acier.
Ces trois termes réunis permettent de visualiser "le bâtiment reliés aux lignes télégraphiques". Dans le même ordre d'idée,
* les lignes télégraphiques sont traduites par "duong dây thep" (la voie des fils d'acier);
* la TSF : dây thep gio (les fils d'acier au
vent);
* le poste de TSF : dây noi (le fil parlant);
* l'avion : tâu bay (le bateau/bâtiment volant);
* le bâteau : tâu thuy (le bâtiment [qui marche] sur
l'eau);
* le train : xe lua (la voiture à feu) ou tâu hoa
(bâtiment à feu), "hoa" est un mot sino-
vietnamien.
* la voiture : xe hoi (la voiture à vapeur);
* la motocyclette : xe may (la voiture à moteur), ou
xe binh bich (il s'agit ici d'une
onomatopée);
* la bicyclette : xe dap (la voiture à pédales);
* le bureau (meuble) : bàn giây (la table à papier);
* le bureau (local) : buông giây (la chambre à papier);
* dénoncer : bo giây (qui veut dire écrire des
lettres anonymes pour dénoncer).
Contrairement aux transcriptions sino-vietnamiennes et aux traductions des lettrés, le vocabulaire moderne de la vie courante, inventé sans doute par d'autres milieux que celui des lettrés, garde la consonance et, surtout, la syntaxe vietnamiennes. Le "petit peuple" avait recours plutôt aux "objets" concrets qu'à des notions abstraites pour désigner les nouveaux éléments de la vie, de l'environnement. Par ce procédé, la syntaxe sino-vietnamienne qui place le déterminant devant le déterminé s'efface devant celle de la langue vietnamienne qui est le contraire. Par exemple, le "bureau" (local) en langage littéraire se dit "Van phong", dans lequel "Van" (les lettres) est le déterminant et "phong" (une pièce), le déterminé. Alors que dans le langage courant le "bureau" se dit "buông giây" dans lequel "buông" (chambre) qui est le déterminé se place devant le déterminant "giây" (papier). Dans cet exemple, même si "buông" et "phong" sont équivalents à une nuance près, le deuxième terme est un mot sino-vietnamien tandis que le premier est un mot vietnamien. D'autre part le terme "giây" (le papier) est bien plus concret que le terme "Van" (les lettres), et cela montre dans une certaine mesure l'importance du "papier" comme support d'informations dans l'Administration coloniale qui est une réalité. De ce point de vue, bien qu'il soit plus littéraire et plus savant, le terme "Van phong" ne correspond pas à la réalité, car le "bureau" n'est pas le lieu où on étudie "les lettres". Ce qui montre que deux milieux différents ne traduisent pas le même mot d'origine étrangère par les mêmes termes, chacun a recours à ses propres ressources: les lettrés à leur culture académique quelque peu abstraite et le peuple à la sienne axée sur le concret.
A un autre niveau, les mots nouveaux véhiculent avec eux des concepts et des idées modernes venant de l'Occident. Cette famille du vocabulaire moderne est sans doute le fruit des milieux intellectuels politisés, de l'intelligentsia de formation moderne qui ont emprunté des concepts liés à la vie politique et sociale de l'Occident, puis les ont traduits en vietnamien. On a ainsi toute une série de vocables, inexistants auparavant et chargés d'idées nouvelles qui venaient alimenter le débat sur deux versants à la fois. Débat politique, ayant pour buts la critique et la condamnation du régime colonial, et débat social, tendant à remettre en cause la société traditionnelle sclérosée. Cependant, au travers de la presse et de la littérature, on constate que le deuxième versant du débat ne s'est réalisé que dans les années 1930, alors que le premier avait déjà été vivace dans la décennie précédente. Nous avons donc:
Champ politique
* chu nghia thuc dân : le colonialisme (littéralement:
régime manger peuple)
* chinh tri : la politique
* da dao : à bas
* dê quôc : l'impérialisme
* cach mang : la révolution
* tu do : la liberté
* giai phong : la libération
* dân chu : la démocratie
* nhân quyên : les droits de l'homme
* hiên phap : la constitution
* dang : le parti
* chu nghia công san : le communisme
* dâu tranh giai câp : la lutte des classes
* giai câp vô san : le prolétariat
* giai câp Công nhân : la classe ouvrière
* quân chung : les masses
* dinh công : la grève
* biêu tinh : la manifestation
* công doàn (nghiêp doàn) : le syndicat
* giai câp tu san :la bourgeoisie, les capitalistes
* chu nghia tu ban : le capitalisme
Champ social et culturel
* binh dang : l'égalité
* binh quyên : l'égalité des droits
* nu quyên : les droits de la femme
* phu nu chu nghia : le féminisme
* ca nhân chu nghia : l'individualisme
* chu nghia dôc thân : le célibat
* chu nghia lang man : le romantisme
* yêu : aimer
* tiêu thuyêt : le roman
* truyên ngan : la nouvelle
* phong su : reportage.
Ce sont des mots-clefs qui, par la suite, en ont engendré d'autres. La première remarque qu'on peut faire est qu'au plus tard à l'aube des années 1920, les termes chinh tri (politique),- formé de chinh ( ) qui veut dire "juste", "vrai", et de tri ( ), "gouverner"-, ou cach mang (révolution) sont apparus dans le langage vietnamien, ils se substituaient à quôc su (affaires de la nation), terme sino-vietnamien employé jusqu'alors. A son début, le terme cach mang ou sa variante cach mênh, qui existait bien avant la colonisation mais dont l'usage était resté très restreint, désignait le changement de roi par un autre plus conforme au droit divin: cach ( ) terme sino-vietnamien qui veut dire "changer", "renouveler", "stopper", et "mênh" ( ), la prédestination, la "volonté du Ciel" 1. Par la suite, jusqu'aux alentours de 1930, cach mênh évoquait plutôt l'idée d'opposition au régime colonial, de renversement de ce régime. Son champ ne dépassait pas celui du politique. Il fallut attendre les années 1930 pour voir ce terme s'élargir au champ social et enrichi par la dimension internationale.
Dans les domaines culturel et littéraire, l'emploi du terme yêu (aimer) prenait petit à petit la place de celui de thuong (aimer) utilisé pour parler d'autres sentiments que l'amour romanesque: l'amour pour les parents, pour les frères et soeurs... Selon toute vraisemblance, le mot yêu, au sens moderne pour exprimer l'amour romanesque, a été utilisé pour la première fois par l'écrivain Hoàng ngoc Phach, l'auteur de Tô tâm, le roman-phare du romantisme vietnamien écrit en 1922 et publié en 1925. Son usage devint courant par la suite dans la presse, dans la littérature et dans la poésie.
La deuxième étape de l'enrichissement de la langue vietnamienne peut-être situé, supposons-nous, dans la période 1927-1945, qu'on peut qualifier d'étape de consolidation, grâce à l'essor du quôc ngu. Dans cette phase, la presse a joué le rôle primordial dans la promotion de la nouvelle écriture. A partir du numéro 113 (31 août 1934), Khai Hung tient régulièrement la rubrique Tu vung hoat kê (Le vocabulaire pratique) dans le journal Phong hoa pour expliquer les sens des termes susceptibles d'échapper à la compréhension de certains lecteurs. Pour chaque mot, il explique le sens propre, le sens figuré et l'origine étymologique ou historique.
Dans les années 1930, les journaux et revues ont fleuri à un rythme qu'on n'avait jamais connu jusqu'alors. En 1930 il y avait 132 titres légaux ayant obtenu l'autorisation de paraître, 137 en 1931, 192 en 1932, 219 en 1933, 227 en 1934, 267 en 1935, et 230 en 1936 1. Bien que la presse d'information occupe la place prépondérante, la presse spécialisée a vu le jour elle aussi: tous les domaines de la vie y ont été représentés, théâtre, cinéma, sciences et techniques, religion, agriculture, sport, etc. Précisons cependant que tous les périodiques n'ont pas survécu longtemps. Chaque année entre 30 et 40 titres disparaissaient de la circulation. La censure, le manque de professionnalisme, l'opportunisme de certains qui, devant la crise économique, profitaient de l'autorisation pour faire du commerce de papier au noir, étaient les principales causes de ces disparitions.
La littérature est venue ensuite renforcer la place du quôc ngu pour le rendre incontournable, car à l'approche des années 1930 il ne venait plus à personne l'idée de le remettre en question. Le quôc ngu s'imposait donc comme l'écriture nationale pour renvoyer les caractères chinois aux oubliettes. Force est de constater que la "nouvelle langue" possédait sa propre dynamique et ne cessait de se développer. Ainsi on assiste à la naissance de néologismes, de consonance sino-vietnamienne ou non, et de certaines expressions qui sont devenues à la mode à cette époque. Par exemple:
* môt : la mode
* tân thoi : les temps modernes
* gai tân thoi : la femme moderne
* buôi giao thoi : la période de transition.
* phong trào : le mouvement
Bien que le terme vietnamien exact connu de nos jours pour traduire "moderne" soit hiên dai, son usage n'est venu que bien après. Dans le dictionnaire franco-vietnamien (Phap-Viêt tu diên) de Dào Duy Anh, "moderne" a été traduit par "tân", terme sino-vietnamien qui veut dire "nouveau", moi en vietnamien. Cependant le mot hiên dai figurait bien dans son dictionnaire sino-vietnamien (Han-Viêt tu diên) qui avait été publié en 1932, pour la première édition, précédant l'autre dictionnaire de quelques années. Ainsi les termes tân ou moi étaient d'un usage très courant pour ne pas dire "à la mode". Ils s'associaient avec d'autres mots pour donner naissance aux nouvelles expressions désignant ce qui était "nouveau" ou "moderne". A cet égard, rien que les titres des périodiques parus dans la période 1927-1939 sont révélateurs: environ une centaine de journaux et revues dont le titre comporte le terme moi ou tân. Par exemple, Dân moi (Le nouveau peuple), Tân dân (Le nouveau peuple), Tân Viêt Nam (Le nouveau Vietnam), Phu nu tân Van (La nouvelle littérature de la femme), Dàn bà moi (La femme moderne), Tân tiên (Le progrès moderne), Tân xa hôi (La société moderne), Ngày moi (Le jour nouveau), Doi moi (La nouvelle vie)....
Cette floraison s'accompagne aussi d'une nouvelle façon d'écrire qui consiste à intégrer les signes de ponctuation, ce qui commençait à se faire dans les décennies précédentes, à la place des termes anciens ayant cette même fonction, comme phàm pour marquer le début d'une phrase, vây pour marquer la fin. Il en était de même avec les majuscules pour commencer une phrase, etc. Par la même occasion les allusions ou références à la culture académique traditionnelle cédaient petit à petit le pas aux idées modernes telles que "l'hygiène", "les sciences", "les techniques", "la liberté", "la démocratie", "le droit", "le progrès" ...
Sur le plan du style, les écrits de cette période marquent un effort dans la structuration d'une langue nationale. La francisation était à peine perceptible, bien que plus visible dans la poésie, et surtout celle de Xuân Diêu. Par contre, dans la période d'après, de 1945 à nos jours, qu'on peut qualifier d'étape d'assimilation, la francisation dans la structuration des phrases devient omniprésente. Ceci s'explique par les effets à long terme de la connaissance de la langue française d'une part, et sans doute par un retournement de situation avec l'indépendance, qui déculpabilise les Vietnamiens francophones d'imiter les Français, d'autre part. Cependant cette assimilation devient si ancrée qu'on considère aujourd'hui comme "vietnamien" ce qui a été emprunté aux Français. Il en allait de même avec les cheveux longs: à l'arrivée des Français les Vietnamiens considéraient que le port des cheveux longs représentait un caractère spécifiquement national alors que cette tradition avait été introduite au Vietnam par les Chinois.
A titres d'exemples, regardons ce qu'on écrit dans les milieux intellectuels vietnamiens d'aujourd'hui. Dans la présentation des morceaux choisis de l'écrivain Nguyên Công Hoan, Phan Cu Dê écrit en 1981:
" Vu Trong Phung trong môt nam 1936 viêt luôn ba cuôn tiêu thuyêt lon... 1"
On peut traduire ces lignes ainsi, à certains signes de ponctuation près:
"Vu Trong Phung, en une seule année, 1936, a écrit trois grands romans..."
Dans une phrase vietnamienne le verbe suit immédiatement le sujet, alors que dans la phrase ci-dessus, le verbe "viêt" (écrit) est bien séparé de son sujet "Vu Trong Phung" par le complément de temps "trong môt nam" (en une année) suivi d'une apposition "1936". Un peu plus loin on découvre encore ceci:
Nêu nhu
Ngô Tât Tô tâp trung viêt vê nông dân, Vu Trong Phung da kich vào giai câp tu san thi dong gop chu yêu cua Nguyên Công Hoan là da xây dung thàng công môt phông tranh châm biêm và da kich cac kiêu quan lai 2.
On peut traduire ces lignes, presque mot à mot, ainsi:
"Si Ngô Tât Tô concentre ses écrits sur les paysans, (si) Vu Trong Phung condamne la classe bourgeoise, la contribution essentielle de Nguyên Công Hoan est le mérite d'avoir tracé un tableau humoristique qui condamne le mandarinat."
Cette phraséologie, inconnue dans la littérature vietnamienne des années 1930, sans remonter plus loin à celle des lettrés de formation classique, devient très usuelle dans les écrits actuels.
Lê Dinh Ky, quant à lui, a présenté les oeuvres du poète Thê Lu en ces termes:
Tu sau Cach mang Thang Tam, tho moi da di vào di san Van hoc dân tôc, tuy không thuôc dong yeu nuoc và cach mang, nhung cung mang tinh dân tôc, và nhât là nhung dôi moi quan trong vê nghê thuât, no da danh dâu môt chang duong phat triên trong lich su Van hoc nuoc nhà 1.
Ce qui donne cette version:
"Après la Révolution d'Août, la poésie moderne est entrée dans le patrimoine littéraire national, même si elle ne fait pas partie de la lignée patriotique et révolutionnaire elle présente (cependant) le caractère national, et surtout par ses aspects nouveaux importants en ce qui concerne les arts, elle a marqué une étape du développement de l'histoire littéraire du pays."
Ordinairement la phrase vietnamienne est relativement courte. En écrivant à la française, l'auteur a rendu sa phrase trop lourde, et par endroits, elle devient confuse. Notons tout de même les expressions francisées comme di vào di san (entrer dans le patrimoine), danh dâu môt chang duong (marquer une étape).
Le 2 septembre 1945, jour de la déclaration de l'indépendance, Hànoi a été abondamment décorée de banderoles rouges pour saluer et fêter le jour historique. Sur certaines banderoles on pouvait lire les slogans suivants:
* Nuoc Viêt Nam cua nguoi Viêt Nam: Le Vietnam aux Vietnamiens;
* Da dao chu nghia thuc dân phap : A bas le colonialisme
français;
* Dôc lâp hay là chêt : L'indépendance ou la mort;
* Ung hô chinh phu lâm thoi : Soutien au gouvernement
provisoire;
* Ung hô chu tich Hô Chi Minh : Soutien au président Hô Chi
Minh, 1 etc. etc.
On s'aperçoit que ces slogans reprenaient mot à mot les slogans de lutte en langue française. L'année d'après, dans la décision du comité central du parti en date du 9 mars, on trouve cette image:
" Con thuyên cach mang dang luôn nhung mom da ghênh dê luot toi 2".
La traduction donne:
"Le navire de la révolution est en train de louvoyer entre les écueils pour avancer". Les Vietnamiens ne connaissaient pas cette image et surtout pas ce genre de syntagme. N'est-elle pas occidentale, cette imagerie? A côté de ces emprunts d'images ou de phraséologie française on trouve encore d'autres expressions traduites du français qui sont devenues "vietnamiennes". Par exemple:
* trên co so : sur la base de;
* bô may nhà nuoc : l'appareil d'Etat;
* duoi anh sang : à la lumière de;
* duoi goc dô : sous l'angle de;
* duoi su lanh dao : sous la direction de;
* môt cach nhin : une façon de voir;
* di sâu vê : approfondir;
* dong vai tro : jouer le rôle de;
* mat manh : le point fort;
* mat yêu : le point faible;
* ban suc lao dông : vendre sa forcs de travail;
* phong trào quân chung : mouvement de masse.
Après ce bref aperçu sur l'influence du français sur le vietnamien, on s'aperçoit qu'après une période d'emprunt massif de vocabulaire français et d'invention de nouveaux termes pour désigner les éléments de la culture matérielle moderne, les effets de cette influence se poursuivent même après la fin de la "cohabitation" franco-vietnamienne. La période d'assimilation (de 1945 à nos jours) témoigne paradoxalement de l'étape de francisation de la langue vietnamienne la plus significative et la plus profonde. Les éléments empruntés à la langue française sont tellement intériorisés par les Vietnamiens qu'ils ne les distinguent plus de leur propre langue. Par ailleurs, l'emprunt d'une expression peut traduire aussi une évolution ou un changement dans la façon de voir les choses. Par exemple, l'expression troi dep est sans doute la traduction de "il fait beau", expression qui sous-entend qu'il y a du soleil. Pour les Vietnamiens qui vivent sous les Tropiques, le soleil n'a rien de réjouissant mais au contraire il les fait fuir. Pour dire qu'"il fait soleil", les gens diraient plutôt troi nang ou troi nong, quand il fait chaud (à cause du soleil). Le passage de l'emploi de troi nang ou de troi nong à celui de troi dep traduit un changement dans la perception de l'environnement, en introduisant une dimension abstraite voire un jugement personnel. Effectivement, les expressions vietnamiennes liées aux phénomènes météorologiques dressent uniquement un constat, ce qui est perceptible par les sens, évoquent le concret, par exemple:
* troi mua : il pleut (littéralement: ciel pleuvoir);
* troi gio : il vente (littéralement: ciel venter);
* troi tôi : il fait noir (littéralement: ciel obscur),
etc.
Ces éléments linguistiques reflètent la culture matérielle vietnamienne dans laquelle le concret joue le rôle prédominant. Les innombrables termes différents pour désigner les différentes façons de "porter" en sont une preuve parmi bien d'autres:
* dôi : porter un chapeau;
* deo : porter une bague, des lunettes, une décoration...
* mac : porter des habits,
* di (giây) : porter des chaussures;
* xach : porter à la main;
* bê : porter dans les bras;
* cong : porter (un être humain) sur le dos;
* ganh : porter sur l'épaule à l'aide d'une canne de
bambou qui supporte à chaque extrémité un
"panier";
* khiêng : porter (un objet lourd) à plusieurs,
etc.
La richesse de la langue vietnamienne réside dans ce côté concret et pratique, mais il lui manque dans le nouveau contexte les dimensions non développées de la vie comme les sciences et les techniques (que nous avons évoquées dans un chapitre précédent), le droit, et tout ce qui est lié à la culture matérielle moderne. Dans ce sens, la rencontre avec la culture occidentale a permis à la langue vietnamienne de rattraper le retard linguistique afin d'être en phase avec un monde moderne en pleine mutation; mutation qui s'accélère à un rythme de plus en plus rapide. A cet égard, la langue peut servir aussi d'instrument de mesure du développement, plus le développement s'accélère plus il y a de néologismes pour répondre aux besoins de l'usage et inversement. Par ailleurs la langue est à la littérature ce que la matière est à l'art. Même si les romanciers des années 1930 n'étaient pas des maîtres qui manipulaient la langue à merveille, ils ont néanmoins contribué à consolider la place de la langue, transcrite par le quôc ngu, dans la vie culturelle du pays.
Si après l'indépendance, le Nord Vietnam a voulu mettre l'accent sur le caractère national dans le domaine de la langue, notamment par la création de néologismes pour traduire des concepts ou des idées modernes, en rompant avec les termes sino-vietnamiens, cette entreprise n'a pas abouti à sa fin. D'une part on confondait, et là on revient sur le problème déjà posé pour le langage scientifique, un mot avec sa définition, et d'autre part, l'uniformisation restait à faire pour évacuer les confusions, car en l'absence de règles officielles chacun écrivait à sa façon sans se soucier du caractère homogène de l'écriture. Par exemple on a le néologisme:
* may bay lên thang : hélicoptère (littéralement: avion
décoller droit, pour dire avion à
décollage vertical).
Cette traduction présente deux inconvénients:
- le terme thang qui veut dire "droit" est employé improprement pour exprimer l'idée de la verticale;
- ce mot may bay lên thang se présente plutôt comme la définition d'un mot que comme un mot en soi.
Dans le langage familier on dit facilement tâu bay chuôn chuôn, littéralement, "avion-libellule", du fait de la forme de l'appareil qui ressemble à l'insecte. Son équivalent en sino-vietnamien qui est truc thang n'apporte pas plus de précision puisque truc veut dire "droit" et thang, "vers le haut". Il en était ainsi avec d'innombrables termes nouveaux. Tant que la langue vietnamienne ne se dote pas de règles homogène,s on avance dans la confusion et dans l'à peu près.
LA LITTERATURE
Préserver la famille! Mais de grâce, ne confondez pas la famille avec l'esclavagisme.
Nhât Linh (Doan tuyêt)
L'essor de la littérature vietnamienne de l'Entre-Deux-Guerres s'explique par plusieurs raisons. Sur le plan littéraire, elle marque la rupture avec les écrits classiques, composés essentiellement en vers. Par ailleurs, elle s'inspire des romans français traduits en vietnamien par des pionniers dans ce domaine comme Nguyên Van Vinh qui dirigeait, entre autres, la revue Dông duong tap chi. Il a traduit à lui seul plusieurs romans et pièces de théâtre français en se servant de la prose comme mode d'expression, dont:
* Les fables de La Fontaine (1913);
* Les contes de Perrault;
* Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas;
* La peau du chagin d'Honoré de Balzac (1917);
* Manon Lescaut de l'Abbé Prévost (1918);
* Les Misérables de Victor Hugo (1927);
* Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, L'Avare, et Tartufe de Molière (1915), etc.
Sur le plan socio-culturel, les jeunes écrivains de formation moderne viennent occuper le vide laissé par leurs aînés condamnés à disparaître avec les caractères chinois. La simplicité du quôc ngu et son usage généralisé à travers la presse contribuent à la naissance et au développement de la nouvelle école de littérature. A cet égard on se souvient encore de ce que Nguyên Van Vinh a prédit:
Le sort du Vietnam sera déterminé par le quôc ngu.
La conjoncture politique canalise enfin certains milieux intellectuels vers la littérature qui, beaucoup moins subversive dans la forme que la politique, présente moins de risques de répression.
LA PROSE
Dans l'espace de deux décennies, le roman vietnamien a eu le temps d'évoluer. Selon les auteurs, la classification est différente 1, néanmoins deux courants dominants, nettement identifiables, caractérisent cette évolution: le romantisme et le réalisme social. Si le premier courant a dominé la vie littéraire vietnamienne dans les années 1920, avec à son apogée, la sortie du roman Tô tâm de Hoàng Ngoc Phach en 1925, il a dû céder par la suite la place au deuxième courant, celui du réalisme social, dans la décennie suivante marquée par une prise de conscience sociale et l'émergence d'une remise en cause profonde de la société traditionnelle. En dépit des jugements de certains milieux intellectuels de Hanoi, le romantisme répondait, dans le contexte des années 1920, à l'aspiration d'une certaine frange de la jeunesse en proie aux soubresauts d'une société en pleine évolution. Hoàng Ngoc Phach, un ancien élève de l'Ecole supérieure de pédagogie de Hanoi, a terminé son roman en 1922. Après un sondage auprès de ses camarades, il l'a fait publier sous forme de feuilleton dans le Bulletin de l'Association amicale de l'Ecole normale. Le public jeune l'a accueilli sans réserve, ce qui a amené l'auteur à le faire éditer sous sa forme finale. Les trois mille volumes de la première édition ont été rapidement absorbés en l'espace de deux semaines; ceux qui ne l'ont pas acheté à temps ont même avancé de l'argent pour la deuxième édition de deux mille exemplaires qui est parue peu de temps après. Ce fut un événement littéraire qui suscita chez les jeunes de formation moderne l'admiration , et de la part de l'ancienne génération, critique et condamnation 2. L'auteur, sous son pseudonyme de Song An, a reçu d'innombrables lettres de lecteurs de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Les Viêt Kiêu résidant au Siam, en Chine et en France ont salué cet événement en recommandant à l'auteur de leur envoyer l'oeuvre tant attendue 1.
Le roman, écrit en style narratif, retrace la douloureuse histoire d'amour d'un jeune homme, étudiant en Lettres à l'université, avec une jeune fille de vingt ans, gagnée aux idées modernes, d'une bonne famille traditionnelle dont le père était mandarin de district de son vivant. Par un concours de circonstances, les deux jeunes font connaissance. Tô tâm, c'est le nom de l'héroïne (pseudonyme qui lui est donné par le personnage masculin), ayant terminé ses études secondaires, a l'âme sensible et s'intéresse à la littérature française. Elle vit avec sa mère et son petit frère, connaît déjà Dam Thuy, le héros de l'histoire, par ses écrits parus dans la presse. Les visites répétées que Dam Thuy rend à Tô Tâm, leurs discussions sur la littérature moderne et les lettres échangées transforment peu à peu leur amitié en amour sans "souillure charnelle". Quand Dam Thuy réalise que l'amour a envahi leur âme, il décide, à contre-coeur, de lui révéler qu'il était déjà fiancé. Tô Tâm apprend cette nouvelle avec beaucoup de chagrin mais sans un mot de reproche; elle l'encourage, au contraire, à obéir à sa famille. Quant à elle, elle décide de rester toute sa vie fidèle à cet amour. Mais un événement survient: sa mère tombe gravement malade et lui demande avant de mourir de se marier avec l'homme qui vient de lui demander sa main. Partagée entre l'amour et la piété filiale, Tô Tâm reporte à chaque fois sa décision; mais quand l'agonie de sa mère approche, elle donne son consentement pour lui faire plaisir. Le mariage a lieu mais la jeune mariée tombe aussitôt malade et meurt quelques semaines après.
Cet écrit laisse apparaître clairement le conflit des générations, conflit entre la tradition séculaire et les idées modernes. Mais ce conflit révèle par la même occasion que l'amour ne rime pas avec la famille, les deux uniques thèmes du récit bien que l'amour occupe la place centrale et que la famille soit renvoyée au second plan. La dimension sociale en est complètement absente. Si les deux personnages principaux se trouvent confrontés aux tiraillements exercés d'un côté par l'amour et de l'autre par la famille, cette confrontation ne donne lieu à une aucune remise en question ni à aucune accusation à l'égard de la famille. Tous les deux subissent le même sort: obéir à contrecoeur à la famille. Dam Thuy ne renonce pas à ses fiançailles arrangées par sa famille et Tô Tâm non plus, alors que l'un comme l'autre n'en veulent pas au fond d'eux: ou plutôt c'est par respect pour la famille (la tradition) qu'ils poursuivent le chemin tracé. Si la famille sort triomphatrice de cette bataille, sa responsabilité devant la mort de l'héroïne est engagée, à moins que ce ne soit celle du romantisme, qui apparaît sans ambiguïté dans le roman. L'auteur a bien mentionné cette attitude dans le passage qui reproduit l'ultime argument: "Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas 1". Dans les rapports de Tô Tâm à Dam Thuy, même si l'amour les unit l'un à l'autre, Tô Tâm se montre plutôt respectueuse et adoratrice à l'égard de son bien-aimé que complice. A la fin de chaque lettre qu'elle lui écrit, elle n'oublie pas d'ajouter des formules de politesse qui dénotent une certaine inégalité dans les relations: kinh tang (offert respectueusement), kinh lay (prie respectueusement), Tô Tâm bai (la très respectueuse Tô Tâm), etc. Ces quelques aspects montrent les limites de l'école littéraire de cette époque, qui vont être balayées par la génération suivante plus ambitieuse et plus audacieuse aussi. Néanmoins pour la société vietnamienne de cette époque, ce roman a franchi un pas énorme dans la revendication pour faire reconnaître les sentiments, il sème déjà les germes d'un défi contre la famille.
Neuf ans plus tard, en 1934, Nhât Linh fit paraître son roman Doan tuyêt (Rupture) 1 en reprenant les mêmes thèmes (l'amour et la famille), mais cette fois, sans détour, la famille a été mise à l'index: Loan, l'héroïne, s'insurge contre sa mère comme contre sa belle-mère pour affirmer ses droits en tant qu'individu. Dès les premières lignes du roman, ce personnage fait une remarque, à propos du suicide d'une jeune fille maltraitée à la fois par sa belle-famille et par son mari:
Si sa belle-mère était méchante elle n'avait qu'à retourner chez ses parents. Pourquoi se donner le malheur de se suicider? (...)
Pourquoi, quand les hommes quittent leurs femmes pour se marier avec d'autres, trouve-t-on cela normal 2 ?
Loan refuse que le fait de se marier avec quelqu'un revienne à "se marier avec toute sa famille", et elle se dit qu'"il faut créer les conditions nouvelles qui soient conformes aux idées modernes" 3. Écoutons le dialogue entre sa mère et Loan au sujet de son mariage:
Loan:
- Laisse-moi décider si je dois me marier ou non...
La mère:
- Tu dois savoir que tu es déjà grande, et tu dois réfléchir.
- Maman, c'est justement parce que je suis grande et que je réfléchis que je te dis que je ne peux pas être la belle-fille de cette famille...
- Tu plaisantes?
- Nullement! Je considère que c'est quelque chose de très important dans ma vie, et ça ne concerne que ma vie. (...) Pourquoi m'as-tu promise à cette famille depuis des années? ... Cela me concerne et vous (le vous ici englobe le père et la mère) me considérez comme si je n'existais pas dans cette maison. (...)
- Maintenant tu insultes ta mère!... On a dépensé pour que tu puisses aller à l'école, pour que tu sois "civilisée", et en fin de compte tu viennes contredire tes parents... Tu es une ratée, va!
- C'est grâce à vous que j'ai pu aller à l'école, vous ne pouvez pas me traiter comme une illettrée. Je ne suis pas prétentieuse, c'est une chose naturelle. Ce n'est pas de ma faute. Raisonner avec les parents, à mon sens, ne veut pas dire manquer à la piété filiale 1.
En dépit de ces affrontements avec sa famille, Loan consent à contrecoeur à se marier avec Thân, le fils d'une famille traditionnelle à qui les parents de Loan ont promis le mariage. Cependant, Loan n'abandonne pas ses idées pour autant. Le jour de son mariage, elle pense encore que la morale est une hypocrisie, qu'il n'y a pas de liens véritables qui puissent unir les membres de la structure familiale, et qu'ainsi s'explique qu'on invente de faux liens pour les retenir 1. Le soir des noces, voyant son mari préparer le lit en y étalant un tissu blanc 2, elle voit en ce geste une illustration de la barbarie, car pour elle, il n'y a que la virginité de l'âme qui soit précieuse.
Dans ce roman, Nhât Linh décrit avec minutie le sort subi par la bru dans la société traditionnelle vietnamienne, pour qui le rôle de la bru consiste plutôt à servir les beaux-parents lesquels l'éduquent comme on éduque une domestique. Celle qui a souffert dans sa vie de bru réserve le même sort, une fois devenue à son tour belle-mère, à sa belle-fille, et ainsi de suite. Dans ce cercle vicieux, le rôle de la femme (par opposition au mari) n'est qu'accessoire: elle est considérée comme une machine à enfants, même par le mari. Dans ce genre de situation, quoi qu'elle fasse, la bru ne peut s'attendre qu'à des accusations ou à des reproches en retour. Dans le cas de Loan, elle se lève tous les jours à cinq heures du matin même si elle n'a rien à faire. Ainsi elle s'occupe comme elle peut. Si elle fait du bruit en travaillant, sa belle-mère dit qu'elle fait semblant de se lever tôt, si elle travaille silencieusement, à son réveil, celle-ci lui reproche de se coller aux fesses du mari quand il fait déjà jour 3. Ce sort est d'autant plus humiliant que Loan découvre, peu de temps après, qu'elle n'a été qu'un objet d'échange entre les deux familles: n'ayant pu rembourser une dette importante, la mère de Loan a promis le mariage pour s'en acquitter. Dans ce climat d'injustice suffocant, tout détail peut devenir sujet d'accusation ou de mépris. Certains membres de la belle-famille n'appellent pas Loan par son nom ou par des termes conventionnels, mais l'appellent la fille aux dents blanches, comme le fait la tante du côté de son mari 1; il en est de même au sujet de sa raie sur le côté. Sa solitude de femme gagnée aux idées modernes ne cesse de la tourmenter et l'isole de sa belle-famille tournée vers le passé. Après un accouchement difficile qui a nécessité une intervention chirurgicale, la première question que son mari lui pose en la voyant est pour s'informer si c'est un garçon. L'enfant n'est plus son enfant mais celui de sa belle-famille. Loan ne peut même pas nommer son enfant comme elle le voulait car ce droit revient à la belle-mère. Quand le nourrisson tombe malade, c'est encore sa belle-famille qui s'en charge en le confiant aux mains des médiums qui lui préparent des potions à base de cendre d'encens, et qui n'hésitent pas à le frapper pour chasser les mauvais esprits. Loan arrive finalement à arracher son enfant à sa belle-famille pour l'amener à l'hôpital, mais il est trop tard. La mort de l'enfant isole encore Loan de la famille, car elle en est tenue pour responsable par tout de le monde. La belle-mère n'hésite pas à pousser son fils à la maltraiter. Un soir, au cours d'une dispute entre Loan et son mari, dispute envenimée par la belle-mère qui veut à tout prix voir Loan souffrir, et qui encourage son fils à la rouer de coups, l'histoire tourne au drame, et le mari se trouve poignardé à la suite de circonstances malencontreuses. Loan est accusée de meurtre et l'affaire portée au tribunal.
Au jour du jugement, l'avocat de la défense présente une autre version des faits, après avoir dénoncé les accusations non fondées de l'autre partie:
La nommée Loan est une femme instruite et moderne. N'ayant pu avoir d'enfant, elle a consenti que son mari prît une deuxième femme pour avoir une descendance.(...)
C'est la belle-mère qui a tué l'enfant sans le savoir, et elle accuse encore Loan de l'avoir fait. Le coupable c'est la belle-mère, c'est la morale désuète. Au-delà des individus, personne n'est responsable de tout ce qui s'est produit, le vrai responsable c'est le conflit acharné qui se déroule actuellement entre la tradition et le nouveau.(...) La société vietnamienne n'est plus celle de la fin du siècle dernier. On ne peut maintenir intacte la famille comme du passé. (...) Préserver la famille, mais il ne faut pas la confondre avec l'esclavagisme. (...)
La belle-mère, par habitude et par inconscience, a usé de ses droits comme le font des centaines de milliers de belles-mères dans cette société vietnamienne.
Ceux qui ont assimilé la nouvelle culture, ceux qui sont imprégnés d'idées humanitaires, de l'idée du droit à la liberté individuelle, ceux-là cherchent évidemment à échapper à cette servitude. Cette volonté est légitime. (...) Combien de personnes qui n'ont pas pu supporter cette structure rigide et insensée ont-elles sacrifié leur vie pour s'en libérer? (...)
La faute de la nommée Loan, c'est d'être allée à l'école pour s'éduquer afin de devenir une femme moderne, et d'avoir eu à cohabiter avec des hommes anciens. C'est sa seule faute. Mais elle l'a déjà payée avec tant de souffrances.
Si vous l'acquittez vous ferez acte de justice pour dire que la structure familiale inhumaine est appelée à disparaître afin de laisser la place à une nouvelle famille en accord avec le présent, en harmonie avec les conceptions de ceux formés aux idées modernes. Si vous l'acquittez vous rendez justice à une innocente, à la malheureuse qui a gaspillé sa jeunesse, qui s'est sacrifiée pour cette société rigide 1.
Enfin Loan se lève pour ajouter ce qu'elle a au fond de son coeur en se tournant vers les femmes présentes à la tribune:
Je tiens à dire à vous, les femmes modernes, que si vous voulez connaître le bonheur avec votre mari et avec vos enfants, la première chose à faire c'est d'avoir une vie indépendante, une vie autonome et d'éviter de cohabiter avec les beaux-parents, avec la grande famille, et surtout, il faut sortir de l'emprise des beaux-parents 2.
Et enfin elle s'adresse à sa belle-mère:
(...) Vous et moi nous sommes deux personnes qui ne peuvent pas se comprendre ni s'aimer. Et pourtant, nous devions cohabiter, comment éviter des conflits dans ce cas-là! Ce n'est la faute de personne.
Après avoir consulté les magistrats, le juge rend le verdict par un non lieu.
Dans ce roman, l'auteur a concentré ses idées sur l'oppression de la famille traditionnelle, et plus précisément les rapports de la belle-mère à la bru. Loan, le personnage féminin, tient la place centrale dans l'histoire. Elle réfléchit, raisonne et affronte la famille bien plus que les autres personnages masculins. La passivité ou la soumission qui caractérisent la femme vietnamienne traditionnelle ont laissé la place à la combativité et à la lucidité. Cet aspect, à lui seul, représente déjà une nouveauté dans la société pour ne pas dire une rupture. Le thème de l'amour n'est qu'un prétexte pour dénoncer l'attitude odieuse de la belle-mère, la passivité du mari et la complicité de tous les membres de la famille. D'ailleurs, ce thème de l'amour est renvoyé au deuxième plan et n'interfère pas avec le thème central qui est la famille. Bien que Loan aime Dung, elle a renoncé à son amour, à contrecoeur il est vrai, pour satisfaire sa mère. De même, Dung voulait transformer leurs relations amoureuses en une relation amicale tout en décidant de partir loin. Dans sa nouvelle vie de femme, Loan a commencé par se conformer aux règles habituelles dans les rapports aussi bien avec la belle-mère qu'avec son mari ou avec les autres membres de la famille qui, pour leur part, impassibles, ne la considéraient ni plus ni moins que comme une personne qu'ils avaient achetée. L'auteur laisse entendre qu'avec la meilleure volonté du monde, la personne gagnée aux idées modernes, affranchie de la servitude, ne peut cohabiter avec les anciens aux idées arriérées voire inhumaines.
Ou inversement, on peut dire aussi que si l'auteur fait voler la famille ancienne en éclats c'est pour revendiquer la place de l'amour, celle de l'individu. Dans cette logique, l'individu ou l'amour ne peuvent exister qu'après la disparition de la famille comme structure oppressive. Jamais dans la littérature académique ou officielle on n'a vu une attaque aussi virulente envers une conception aussi sacrée que la famille. La remise en cause de la nouvelle génération à l'égard des anciens se situe à ce niveau. La rupture est profonde car elle déracine les fondements mêmes de la société, ceux de la classe dominante ayant pour bases les enseignements de Confucius.
Cependant aux yeux de Nhât Linh, le mandarinat n'est pas l'unique responsable des situations déchirantes, bien que dans la plupart des cas, la famille mandarinale constitue le cadre de ses romans, car il ne veut pas se montrer complaisant avec les couches dominées sous le seul prétexte qu'elles sont opprimées. Cette idée apparaît dans Dôi ban (Les deux amis) 1, qui retrace l'amitié entre Loan et Dung dans leur jeunesse, un autre roman de Nhât Linh:
Il (Dung) s'aperçoit que le mandarin provincial et les paysans ont des rapports étroits dans cette entente (rapport de soumission). Il veut détruire ces rapports car, à ses yeux, ils sont basés sur l'injustice: les dominés acceptent ces relations (de domination) car ils se reconnaissent comme les faibles pour se résigner à la situation d'infériorité, et considèrent cela comme chose normale qui existe depuis la nuit des temps 2.
On retrouve ici l'idée du consentement, développée par Maurice Godelier à propos de la nature du pouvoir 3, et que nous avons évoquée dans la première partie.
L'attitude de Dung est intellectuellement difficile à tenir car elle le sépare à la fois des couches dominantes et des couches dominées. En effet, bien qu'issu d'une famille aisée, il en a honte:
Devenir riche d'une façon honnête c'est déjà désagréable, sans parler de la richesse non justifiée 1.
Pour cette raison Dung se retrouve étranger dans sa propre famille avec qui il a souvent des conflits. Enfin, il se décide à partir loin de la famille; pour lui il n'y a pas d'autre choix si on veut agir et vivre selon ses idées. Quitter la famille signifie pour lui la quitter pour toujours sans garder le moindre contact, afin de s'en libérer complètement 2. Quitter la famille c'est aussi tourner le dos au mariage arrangé qui l'attend.
Dans la même année 1934, Khai Hung, un autre membre du groupe Tu Luc Van doàn, publie le roman Nua chung xuân (Le printemps inachevé), qui garde les mêmes thèmes centraux: la famille et l'amour. Ici comme dans Doan tuyêt, le personnage le plus lucide et le plus combatif est l'héroïne du roman, Mai. L'auteur retrace l'itinéraire et la vie mouvementée de ce personnage. Seule avec son jeune frère, elle affronte les difficultés et les ruses de la belle-mère qui ne veut pas reconnaître le mariage libre de son fils, Lôc, avec Mai. La belle-mère cherche par tous les moyens à détruire cette union en semant le doute chez Lôc à propos de la fidélité de sa femme. Lôc tombe dans le piège de sa mère qui va le marier à une autre fille "digne" de sa situation sociale, et ils se débarrassent de Mai en lui demandant de quitter le foyer conjugal avec l'enfant qui ne tardera pas à venir au monde. Le deuxième mariage de Lôc accuse un échec; sa mère ayant appris que Mai a mis au monde un garçon veut récupérer l'enfant. Mai ne s'oppose pas à cette demande par vengeance ou par méchanceté, mais parce qu'elle ne veut pas que son fils soit élévé dans l'esprit de la famille traditionnelle que représente la belle-mère. Quand Lôc s'aperçoit qu'il s'était trompé au sujet de Mai, il lui demande pardon en l'invitant à revenir. Proposition que Mai refuse catégoriquement sans chercher à blesser son ex-mari. Elle se contente de rester seule avec son fils pour l'éduquer.
Ce roman comme tant d'autres écrits du groupe Tu luc Van doàn montre l'incompatibilité de l'amour avec la famille traditionnelle, de deux conceptions, l'une aspirée vers la vie moderne qui accorde à l'individu la liberté dans le mariage, et l'autre tournée vers le passé qui ligote l'individu dans des règles morales séculaires. Cette morale, l'auteur la récuse à travers les paroles de Huy, le jeune frère de Mai qui découvre que sa soeur a été victime:
Quelle morale? Ainsi, on accorde plus d'importance à la piété filiale qu'à l'amour? C'est inhumain! c'est dégueulasse! 1
Par ailleurs, même si le thème de la libération de la femme n'apparaît pas clairement dans le roman, il est transversal à toutes les discussions car il constitue une composante de la liberté individuelle absente dans la conception ancienne. La reconnaissance de l'individu en tant que tel passe aussi par l'affrontement avec la structure de la famille traditionnelle dans laquelle la place de chacun ou de chacune est définie par rapport à celle des autres membres non seulement de la famille mais également de la société. "Quand les gens, se demande Huy, arriveront-ils à comprendre ce que c'est que la liberté, l'honneur de l'individu? 1" Encore une fois, si le cadre de vie de ce roman est tantôt la campagne, tantôt la ville, la famille comme structure oppressive est toujours celle des couches dominantes tenantes des idées confucéennes. La famille des humbles échappe à ces accusations, et pour cause: elle ne se permet pas le luxe de suivre la morale des autres car les problèmes les plus urgents pour elle demeurent les difficultés de survie, la morale passe après les exigences matérielles.
Une autre tendance littéraire du courant réaliste trouve son expression, entre autres, dans les écrits de Nguyên Công Hoan qui décrit l'injustice et l'oppression exercées par les notables en milieu rural, la vie des humbles confrontés à toutes sortes d'humiliations. Dans la nouvelle Thang an cuop (Le cambrioleur), écrit en 1937, l'auteur met en lumière les rapports, pour le moins curieux, entre un mandarin et un cambrioleur. Ce dernier se lamente:
Je sais que dans la vie il faut s'appuyer les uns sur les autres, ainsi nous devons partager ce qu'on gagne avec les autres: payer les impôts, verser des commissions aux commerçants, etc. Nous, cambrioleurs hors la loi, nous savons qu'il faut maintenir de bons rapports autant que possible avec ceux qui représentent la loi. (...)
Mais depuis que ce mandarin de district a pris ses fonctions, il est terrible. Je sais d'avance que plus je travaille plus je me fatigue pour rien. Je n'exagère en rien. Ce n'est pas parce qu'il ne nous laisse pas agir comme ses prédécesseurs afin de maintenir la sécurité du peuple, ç'aurait été bénéfique pour tout le monde, mais parce qu'il m'oblige à le remercier au-dessus de mes moyens. Ce que je refuse. Même si je ne suis qu'un malhonnête qui dépouille les autres, cependant j'ai dû réfléchir puis peiner physiquement pour y arriver. Sur les dix types que je dépouille neuf le méritent, car eux-mêmes ont dépouillé les autres. Cependant je suis dépouillé à mon tour par le dixième qui, lui, n'est dépouillé par personne. Comment peut-on ne pas s'énerver dans ce cas? Quelle justice dans tout ça 1 ?
Ayant compris ces intentions, le mandarin de district lui tend un piège en faisant semblant de relâcher la surveillance. Le cambrioleur profite de cette occasion et récidive avec sa bande. Le lendemain, le mandarin en question, accompagné de gardes, fait une descente chez le récidiviste. Ni les menaces, ni les coups de bâton ne suffisent pour faire reconnaître les faits par le malfaiteur. Le mandarin a alors recours à la torture: sa spécialité consiste à faire coucher sa victime à plat ventre, puis il dit à ses gardes aux uns de bien le tenir immobile, aux autres de lever ses bras de telle sorte que l'angle formé par les membres supérieurs avec le sol devienne de plus en plus grand, jusqu'à ce que la victime accepte de parler. Ce supplice neutralise la volonté du cambrioleur qui finit par reconnaître avoir participé aux actes de brigandage. Fier de lui, le mandarin demande au cambrioleur après avoir renvoyé ses gardes, de lui remettre la somme qu'il a cachée en échange de sa remise en liberté.
Que cette histoire soit vraisemblable ou non, la chanson populaire dit encore "Les brigands volent la nuit et les mandarins, le jour" (Cuop dêm là giac cuop ngày là quan). Par ailleurs, dans ses mémoires, Nguyên Công Hoan laisse entendre que ses écrits s'inspiraient, la plupart du temps, d'histoires réelles. Souvent quelques pages lui suffisent pour exprimer ce qu'il veut. Ainsi la nouvelle reste le mode d'expression le plus employé par cet auteur. Voici l'histoire, pour le moins surréaliste, de deux inconnus qui se rencontrent la veille au soir du nouvel an, Ngua nguoi nguoi ngua. (Le titre de cette nouvelle forme un jeu de mots: ngua nguoi, -littéralement, cheval homme-, désigne le tireur de pousse-pousse qui prend la place de l'animal; dans nguoi ngua, -en mot à mot, homme cheval, mais "homme" garde le sens d'"être humain" et "cheval" fait allusion à une femme aux moeurs légères.)
C'est une journée néfaste pour le tireur de pousse-pousse, depuis le matin il n'a gagné que quelques sous. Il est huit heures du soir, l'heure où tout le monde rentre pour préparer le nouvel an qui va venir dans quelques heures. Le tireur persiste à trouver encore quelques clients afin d'avoir de quoi le fêter avec sa femme et son enfant. Une femme passe et lui demande de la promener pendant une heure. Après d'interminables marchandages il est contraint d'accepter le prix fixé par la cliente. Au bout d'une heure, elle lui dit de continuer encore une heure à travers les rues de Hanoi. Quand ils passent devant une boutique, elle lui demande de lui avancer quelques pièces pour acheter des cigarettes et ajoute qu'elle lui donnera un billet après la course, car elle n'a pas la monnaie. Le tireur consent, mais commence à s'inquiéter car ça va faire trois heures qu'il travaille et il ne sait toujours pas où la cliente veut aller. Ils tournent en rond. N'osant pas lui poser la question qu'il a en tête, car s'il se trompe il risque de se retrouver sans rien et avec des insultes en prime, le tireur calcule mentalement ce qu'il va gagner. Minuit sonne. Les pétards éclatent de partout pour accueillir la nouvelle année. Le tireur dit à la cliente qu'il arrête de travailler et lui demande de le payer. Elle essaie de la persuader de continuer encore une heure. Devant le refus catégorique du tireur, elle finit par lui avouer qu'elle cherchait également des clients, mais comme elle n'en a pas eu elle se retrouve sans argent pour le payer. Le tireur hausse le ton, mais elle reste inébranlable tout en lui proposant de prendre ce qu'il veut des objets qu'elle porte. Il refuse et ne réclame que de l'argent. Elle finit par lui proposer un marché: son corps contre la somme due. Le tireur ne cède pas, et lui dit qu'il n'a pas envie de s'aventurer à attraper des maladies. Devant cette insistance elle lui demande de la ramener chez elle. Sur le chemin, elle fait halte dans une maison de passe pour dit-elle aller emprunter de l'argent à quelqu'un. Le tireur recommence à espérer et l'attend. Mort de fatigue, il se repose dans son pousse-pousse. Au bout d'un moment, les bruits des pétards le réveillent et il réalise que sa cliente n'est pas encore revenue. Il va alors la chercher, mais le gardien lui dit qu'elle est déjà partie.
- "Partie? Mais par où ?", lui demande-t-il.
- "Par la porte de derrière!" Et le gardien l'envoie promener, car il est indésirable à cette heure sacrée de la nouvelle année 1.
Dans cette nouvelle, l'auteur évoque avec l'humour sarcastique qui le caractérise, la prolétarisation dans les villes de la période d'Avant-Guerre. Beaucoup moins virulent à l'égard de la famille traditionnelle que ne le sont les écrivains du groupe Tu Luc Van doàn, Nguyên Công Hoan n'est pas complaisant pour autant envers le mandarinat, qui représente un de ses thèmes favoris. La condition de la femme dans cet appareil oppressif lui fournit des pistes de réflexion qui se traduisent dans ses nouvelles. Cependant Nguyên Công Hoan garde un humour détaché, contrairement à Nhât Linh qui s'insurge avec véhémence contre cette tyrannie dans ses écrits. A ce propos, la nouvelle intitulée Vo (La femme), écrite en 1933, dénote la toute-puissance d'un père envers sa propre fille à marier.
Ba côc, un jeune paysan pauvre, fréquente la fille d'un petit notable du village voisin. Le père de la fille, qui a peur que leur relation ne débouche sur des actes "immoraux", contraint le paysan à épouser sa fille. Mais le pauvre paysan n'a pas d'argent, il lui est impossible d'apporter la dot exigée. Les marchandages s'engagent et le paysan arrive à faire baisser la dot: quinze piastres au lieu de vingt. Cependant à l'approche du mariage, il n'en a trouvé que dix, et le notable consent à accepter cette somme, en revanche il exige de son futur beau-fils qu'il signe une reconnaissance de dette de cinq piastres, avant de lui donner sa fille.
Cette situation est un sujet d'ironie pour Nguyên Công Hoan qui écrit:
Oui, dans un contexte économique difficile, c'est déjà très arrangeant de la part du notable. Si c'était quelqu'un d'autre, il lui (au paysan) serait impossible de se marier ce jour-là. Essayons de voir ce qui se passe à Hà nôi, dans un magasin. Si on ne complète pas la somme versée comme acompte on ne pourra jamais emporter les marchandises. La femme n'est-elle pas également une marchandise? C'est déjà une chance de pouvoir se marier avec une reconnaissance de dette 1.
Un an après le mariage, le pauvre paysan n'arrive toujours pas à rembourser la dette, et il espère que le beau-père va renoncer à la lui réclamer. Erreur. Le notable finit par le harceler et par le menacer de reprendre sa fille. Le paysan n'y croit toujours pas et essaie de s'arranger avec lui. Inexorable et voyant que ses menaces n'aboutissent pas au résultat attendu, le beau-père passe à l'acte en contraignant sa fille à ne plus retourner chez son mari. Le paysan finit par comprendre que son beau-père ne plaisante pas, il le supplie de lui rendre sa femme. Rien à faire. Le notable a déjà donné sa fille à un autre notable pour qu'elle devienne sa septième femme, et aussi pour s'acquitter d'une dette de vingt piastres envers lui.
Sans porter de jugement ni d'accusation dans ces nouvelles, Nguyên Công Hoan a choisi le rôle de témoin plutôt que celui de révolté, les situations décrites se suffisent à elles-mêmes pour dire combien les pratiques sociales des notables en milieu rural sont scandaleuses. Que ce soit à la campagne ou en ville, les moeurs mandarinales restent les mêmes.
Dans le même ordre d'idées, une autre nouvelle de Nguyên Công Hoan dont le titre, pour le moins ironique, est Xuât gia tong phu, -la règle morale confucéenne qui dicte à la femme de servir le mari quand elle aura franchi le seuil de la famille paternelle -, montre à quel point le mari peut se servir de sa femme comme d'un objet d'échange. L'histoire se passe, encore une fois, la veille au soir du nouvel an. Un certain mandarin pousse sa femme à accomplir ce qu'il a arrangé avec, sans doute, son supérieur hiérarchique, pour le remercier. (La coutume vietnamienne veut qu'on remercie son supérieur en lui offrant des cadeaux à l'approche du Têt.) Devant le refus de sa femme il essaye tous les moyens pour la convaincre: flatterie, persuasion, menace. La femme reste ferme sur ses positions, et il finit par s'énerver. Ne sachant plus que faire pour qu'elle change d'avis, il se met à la rouer de coups. Enfin la femme est contrainte d'accepter de faire ce qu'il lui a demandé, mais elle ajoute :
- Il y a mille façons de le remercier, pourquoi tu m'humilies de la sorte?
- Ferme-la. Arrête de grogner. Tu es ignorante comme une carpe. On peut acheter n'importe quoi, mais pas ça.
Et avant qu'elle parte voir son supérieur, le mari menace encore:
- Si jamais j'apprends qu'il n'est pas satisfait, tu verras!
Le mandarin, enfin, content de lui, est certain que son supérieur le félicitera comme quelqu'un de reconnaissant et de gentil 1.
Cette évocation sociale dans laquelle la femme n'est considérée que comme un objet (d'échange) par le mari, ne constitue sans doute pas un cas isolé. Dans une société où la toute-puissance maritale n'a pas de limite, on peut s'attendre à tout. Dans ses mémoires, Vu Ngoc Phan a aussi évoqué ce genre de situation qui s'est présenté entre le Résident supérieur Châtel et les femmes de ses collaborateurs, les mandarins de province ou de district. Mais Châtel avait déjà eu les mêmes expériences avec certaines femmes de la Cour de Huê, avec bien entendu la complicité des mandarins, à l'époque où il était le représentant de l'administration coloniale en Annam 1.
Si la femme traditionnelle en milieu mandarinal est soumise à son mari et victime de ses abus, elle ne cherche pas pour autant à s'en libérer, car devenir l'épouse d'un mandarin est un rêve inabordable pour la plupart des femmes. Par conséquent celle qui y arrive, avec les arrangements de la famille, et encore faut-il que la famille soit à la hauteur, se résigne à supporter les humiliations pourvu qu'elle garde le titre de "femme du mandarin". Cette idée est développée par Khai Hung dans son roman Gia dinh (La famille) 2. Moins virulent et radical que les écrits de Nhât Linh sur le même sujet, le roman de Khai Hung démonte un processus d'élévation sociale dans lequel la femme joue le rôle clef. C'est elle qui sert à la fois de moteur à cette ambition et de courroie de transmission de l'ancienne conception qui accorde au mandarinat la place la plus prestigieuse. An, le personnage masculin, ayant terminé ses études secondaires, reste indécis quant à son avenir. Il voulait vivre à la campagne pour exploiter les terres cultivables, mais au bout de quelques années Nga, sa femme, qui ne supporte pas la situation, à ses yeux peu glorieuse, le pousse à continuer ses études afin de devenir mandarin. Cette ambition ancestrale lui a été transmise par sa famille et particulièrement par sa mère qui sème la discorde et la jalousie entre ses enfants, les uns mandarins et les autres non. An finit par suivre les conseils de sa femme et s'inscrit à l'université d'où il sort trois ans après en tête de la promotion. Désigné comme mandarin d'un petit district, il remplit sa fonction tant bien que mal. Sa femme qui, pétrie d'ambition et insatisfaite par ce petit poste, veut se faire reconnaître aux yeux des autres et surtout aux yeux de sa propre famille, s'arrange avec les autorités, moyennant finances, pour que son mari obtienne un poste plus important dans un district plus grand. Car d'après elle, ce nouveau poste leur apportera prestige et richesse. N'ayant pas l'habitude des cadeaux et de la corruption, An cherche plutôt à remplir sa mission. Il découvre enfin que l'impartialité ne recueille que mépris de la part de tout le monde, du mandarin provincial au pauvre paysan. Car mandarinat doit rimer avec corruption.
Khai Hung n'apporte pas de solution à cette situation reconnue déplorable. Cependant il laisse entendre que le bonheur conjugal peut se construire dans une vie retirée à la campagne et en se passant de l'étape mandarinale, à l'image de celui d'un autre couple du roman, la soeur de Nga et son mari. A cet égard l'attitude de Khai Hung se trouve à mi-chemin entre celle de Nhât Linh le révolté et celle de Nguyên Công Hoan, plus discrète, car ce dernier préfère le rôle de témoin à celui d'accusateur. Si Nguyên Công Hoan se sert de l'humour et de l'ironie qui sont ses points forts, Khai Hung semble ignorer ces armes redoutables.
Néanmoins le roman Gia dinh de Khai Hung introduit le renversement des valeurs autour de la femme moderne gagnée aux idées modernes. Elle ne se contente plus d'être la femme passive, mais au contraire elle est présente dans tous les actes de la vie de son mari à l'exception du travail. Quand le mari a des conceptions modernes ou s'il est moderne, le couple a des chances de réussir, par contre s'il est indécis ou se comporte comme un classique, sa femme finit par chercher d'autres aventures avec ceux dont elle espère qu'ils peuvent partager ses idées. Cette ironie de l'histoire passe, entre autres facteurs, par l'occidentalisation. Khai Hung évoque ce retournement de situation chez un couple où le mari est un mandarin docile et où la jeune femme préfère les garçons modernes, surtout quand ils sont couronnés par une situation sociale enviable 1. (Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain chapitre.)
L'adultère ou les effets de la modernité sur la société vietnamienne n'étonnent pas le jeune Vu Trong Phung qui, dans son roman Vo dê (Les digues s'effondrent), fait allusion au fait que la modernité ne règle pas tout, mais qu'au contraire, elle a ses propres limites et ses propres contradictions; les problèmes qui se posent aux sociétés occidentales le prouvent 2. Ce roman retrace pour l'essentiel la vie d'un village à l'approche des crues, autour des principaux personnages comme Phu (le héros), le mandarin du district et sa famille, les notables, et les paysans.
Phu est un jeune de formation moderne mais qui n'ayant pas trouvé de travail en ville revient dans son village pour vivre avec sa mère et sa soeur aînée, devenue veuve avec un enfant à charge. Le peu de connaissances qu'il a acquises à l'école, Phu s'efforce de les transmettre à son entourage. Il s'informe sur ce qui se passe dans le pays à travers des journaux trouvés ça et là. Bien que modeste dans sa condition sociale, il jouit du mérite de son père disparu qui était un lettré respectable. Son frère aîné, Minh, a été arrêté puis transféré au bagne de Poulo-condor à la suite des soulèvements de 1930. Après une période relativement calme, le village est menacé par les pluies diluviennes qui ramènent des crues. Les digues mal construites qui le protègent sont soumises aux fortes pressions de l'eau qui monte de jour en jour. Le mandarin du district, en charge de la sécurité, mobilise les villageois de la région, selon le quota fixé par la Résidence provinciale, pour les travaux d'endiguement afin d'éviter la catastrophe. Faute de moyens pour payer un corvéen, Minh se porte volontaire pour les travaux collectifs en échange d'une petite somme promise par les autorités.
On assiste ici à un tableau social dans lequel le paysan devient une "bête humaine" soumise aux exactions des notables tout puissants à ses yeux:
Trois cents personnes! Ils ont creusé la terre, l'ont transportée, ont planté les piquets, fabriqué des sacs, des cloisons. Parmi eux, il y a environ soixante femmes et enfants qui sont venus à la place qui de leur mari, qui de leurs parents. (...) Les coréens demandent à s'arrêter pour manger mais on leur répond qu'il faut continuer jusqu'à la tombée de la nuit. (...) Ainsi du contremaître aux gardes, on injurie, on fouette, sans relâche, pour ramener l'ordre, ceux qui n'obéissent pas.(...) Ils (les responsables des travaux) ont une drôle de conception: aux paysans idiots qui manifestent leur mécontentement ils répondent par des coups. (...)
Ces paysans supportent tous les fléaux sans parler des calamités naturelles: le reste de la fermentation de l'alcool illicite 1, les vols et cambriolages, la corruption, etc. Ils sont canalisés vers le malheur sans borne, la cause de leurs déchirements qui parfois peuvent déboucher sur des meurtres, pour gagner quelques sous en échange d'un quelconque travail 1.
Cependant Phu se pose la question de savoir comment les paysans arrivent à supporter ces conditions de vie depuis des siècles. Ils sont peut-être heureux, heureux de ne pas connaître leur malheur 2. Ils connaissent la misère quotidienne. Durant la corvée ils campent sur place dans des abris provisoires, montent la garde la nuit et ne se nourrissent que de boules de riz apportées par la famille.
Au terme de cinq jours de travaux, les paysans s'inquiètent de la rémunération promise car ils n'ont rien touché. Ils se rassemblent par petits groupes pour se plaindre sans oser parler aux autorités. Devant ces hésitations Phu s'avance au premier rang et interpelle les responsables pour réclamer la somme due à tout le monde. Une trentaine de corvéens le rejoignent, puis peu à peu les autres se rapprochent pour faire bloc devant les représentants des autorités. Les discussions s'engagent sans apporter le moindre résultat. Le chef de canton intervient comme médiateur et se propose d'aller voir le mandarin du district, mais en attendant il demande aux corvéens de continuer le travail. Les paysans commencent à se décourager, seule une centaine d'entre eux campent sur leurs positions; ils finissent par se disperser sous les menaces des gardes. Ainsi la situation revient au point de départ. Phu en veut maintenant plus aux paysans qu'aux autres. Au lieu de se montrer déterminés, les paysans s'enflamment comme un feu de paille. Il se demande comment s'en sortir avec ceux qui déjà misérables et opprimés, n'ont même pas eu l'instruction nécessaire pour prendre conscience de leur condition. Cependant il finit par les convaincre en semant l'idée que peut-être les notables ont intercepté les salaires des corvéens. Cette fois, ils se retrouvent tous ensemble avec leurs outils de travail (pelles, bêches, bâtons) pour manifester (biêu tinh). Le mandarin du district finit par arriver, escorté de ses six gardes armés, qui tirent en l'air pour dissuader les manifestants. Pris de panique, les paysans se dispersent, laissant même des blessés dans la cohue avant que le calme revienne. Phu est arrêté puis mis au cachot pour avoir incité les autres à manifester. Soumis à l'interrogatoire et aux tortures des agents de sécurité qui l'accusent d'être affilié aux sociétés secrètes, Phu garde le silence. Le fait que son frère a participé aux soulèvements puis a été envoyé au bagne leur semble une preuve infaillible. Le mandarin du district convoque alors la presse pour rendre compte des événements survenus autour des travaux d'endiguement. C'est lui-même qui dicte au journaliste ce qu'il faut écrire. A propos du cas de Phu, il dit au journaliste d'ajouter:
H.V. Phu est d'originaire d'une famille réputée pour être têtue et dangereuse. Son père et son frère ont été envoyés au bagne pour s'être opposés au gouvernement. Il se glisse maintenant parmi les paysans, s'engage comme corvéen et profite de cette situation pour semer le désordre. Est-il membre du VNQDD ou le bras de Moscou 1?
Kim dung, la fille jeune et insouciante du mandarin du district, qui jouit d'une réputation de fille moderne (gai tân thoi), commence à se poser des questions devant l'injustice et le mépris avec lesquels son père traite les gouvernés. Un soir, profitant du sommeil du gardien chargé de surveiller Phu dans son cachot, et inspirée par les situations romanesques de ses lectures, elle le libère sans avoir le moindre penchant pour lui. Ainsi Phu rejoint dans la nuit son village.
Entre temps les digues se sont effondrées et les crues envahissent le village, emportant avec elles les maisons, les vivres et tout ce qui se trouve sur leur passage. Le mandarin se sent menacé par ce double échec: le prisonnier s'est évadé et les digues se sont rompues. En attendant de trouver une solution, il se rabat sur le garde qui n'a pas rempli sa mission de surveiller le prisonnier. Voyant les coups insensés qu'il fait porter à la victime innocente, Kim Dung intervient discrètement pour avouer son geste à son père qui finit par relâcher le garde. Avec ses deux collaborateurs, le mandarin essaie de résoudre ces épineux problèmes qui risquent de lui faire perdre sa place. Enfin, il convoque de nouveau la presse pour donner sa version (officielle) sur la disparition du prisonnier sans reconnaître l'évasion, sinon il fournirait une preuve d'incompétence aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques. Comme la dernière fois, il dicte au journaliste ce qu'il faut écrire car il a trouvé une idée de génie: s'apercevant que le prisonnier est innocent il l'a relâché. Ainsi Phu échappe à la justice. Cette ruse n'est pas suffisante pour que le mandarin garde sa place: on le mute à Hanoi comme collaborateur subalterne dans un service public.
L'arrivée du Front populaire au pouvoir déchaîne les espoirs, espoir d'avoir une vie meilleure, de voir enfin régner la justice, espoir aussi de revoir les anciens prisonniers. Minh, le frère de Phu, est libéré avec les deux cents autres, et regagne son village après avoir passé quelques jours chez un ami de jeunesse; celui-ci le dissuade d'aller au bureau du journal Lao dông 1 où il a rendez-vous avec les autres prisonniers libérés. De retour dans sa famille, Minh essaie de se débrouiller autant que faire se peut pour la faire sortir de la misère causée par la sécheresse qui a succédé aux inondations. Il envoie Phu à Hanoi et le confie à son ami qui lui trouve des cours particuliers à donner aux enfants. A la campagne d'un côté la disette sévit, de l'autre les autorités réclament les impôts. Minh rassemble les paysans des environs pour aller demander à l'administration une dispense d'impôts pour cause d'inondations et de sécheresse. Cette manifestation pacifique débouche sur les portes de la résidence provinciale. Le Résident finit par sortir de l'ombre et il leur accorde un délai de deux semaines. Il ne peut pas faire mieux, d'ailleurs chacun doit remplir ses devoirs de citoyen. Les manifestants persistent et demandent une audience. Le fonctionnaire de l'Etat répond qu'il ne peut pas recevoir tout le monde, qu'ils doivent former une délégation avec qui il s'entretiendra de la situation. Minh est désigné comme membre de cette délégation avec quelques autres représentants des villages. Le peuple est ainsi tombé dans le piège de l'administration. Connaissant le passé de Minh, la Résidence le maintient en garde à vue, pour avoir fomenté les révoltes, et renvoie les autres membres de la délégation. Grâce à la générosité du nouveau pouvoir, le Front populaire, Minh n'est condamné qu'à cinq mois de prison. Entre temps, à Hanoi, Phu a revu Kim Dung dont les parents sont locataires d'un appartement appartenant à son protecteur. Profitant de l'absence des autres et de celle des parents de Kim Dung, Phu rend visite à sa bienfaitrice pour la remercier de son acte gratuit et surtout pour lui faire comprendre discrètement qu'il s'intéresse à elle, qui l'a bien cherché aussi. Quelques temps après Phu se rend au bureau du journal Lao dông pour s'informer sur la situation de son frère. Les journalistes produisent une forte impression sur lui:
Nous pensons que le fait qu'il y a des prisonniers sous le Front populaire ne constitue pas un échec collectif mais un échec individuel. Si ça continue il y aura des réactions en France contre les fractions réactionnaires d'ici. (...) L'histoire de l'humanité est un théâtre de lutte perpétuelle. Rien que pour en arriver là l'humanité a versé beaucoup de sang. Beaucoup d'autres se sont sacrifiés, quant à nous la lutte reste insignifiante. Est-ce bien le temps de nous plaindre 1 ?
En sortant du bureau du journal, Phu passe devant le siège de l'association Khai tri tiên duc 2 qui organise une soirée culturelle au profit des villages sinistrés pour cause d'inondations. Il aperçoit ainsi Kim dung en compagnie de ses camarades habillées comme elle à la dernière mode, en short. Ce spectacle le déçoit ou plus précisément Kim dung qu'il admirait le déçoit par ses attitudes modernes, car il pense que ce genre de manifestation à caractère humanitaire ne sert que de prétexte "aux jeunes pour s'amuser, au couples pour se tromper mutuellement par le biais des danses modernes". Ceux qui y viennent, c'est plutôt pour chercher l'amour que pour faire acte d'humanité 1. Par ailleurs les journalistes l'ont impressionné: à ses yeux, ils ont tout pour s'amuser comme les autres mais à la place de cela ils préfèrent s'acharner pour des causes nobles. Cette réflexion pousse Phu à renoncer à son amour et il décide de retourner à son village pour vivre une vie ordinaire comme paysan.
Si le groupe Tu Luc Van doàn choisit la famille traditionnelle comme cible de ses attaques, Nguyên Công Hoan ou Vu Trong Phung, entre autres, préfèrent démanteler l'appareil mandarinal en milieu rural en décrivant avec précision la condition des paysans opprimés. Ce réveil de la jeune génération se mesure à son engagement contre l'oppression des paysans par les notables, qui constitue le deuxième angle d'attaque du combat contre la société traditionnelle sclérosée et inadaptée au contexte moderne. A cet égard, la génération des écrivains critiques des années 1930 a franchi un pas vers le progrès social par rapport à leurs prédécesseurs de la décennie précédente. Ils ne se résignent plus dans le romantisme mais se révoltent par leurs écrits contre les pratiques sociales ancestrales auxquelles se conforment les paysans. Ces derniers n'échappent pas aux critiques, car ils sont également responsables, aux yeux de ces écrivains, de ce cercle vicieux. Cette situation qui n'offre pas d'autre alternative que de se soumettre, -à un régime oppressif colonial qui se prolonge dans l'appareil mandarinal-, ou de se révolter, constitue le thème central de Buoc duong cùng (La dernière chance), un autre roman de Nguyên Công Hoan. Paru en 1938, ce roman a été retiré de la circulation et interdit dans toute l'Indochine qui vivait pourtant dans l'espoir suscité par le Front populaire. Buoc duong cùng évoque la condition des paysans dépouillés, et opprimés par toutes sortes de notables et propriétaires terriens sans scrupules, qui s'appuient sur le régime colonial pour justifier leurs actes. Cette situation explosive ne peut déboucher que sur une conflit opposant les paysans aux autorités coloniales représentées par le mandarinat 1.
Pha, le personnage principal du roman, incarne le paysan victime. Nghi Lai, membre de la Chambre des représentants du peuple, représente le pouvoir de l'argent et les notables, l'autorité coloniale. Nguyên Công Hoan met en lumière comment le pouvoir et l'argent qui ne poursuivent pas le même but s'entendent sur le dos des paysans pour les dépouiller. L'auteur démonte les mécanismes de la corruption qui constitue le principal moteur du pouvoir et de l'argent. Chaque page du roman révèle les ruses et les méthodes les plus sordides qui ligotent la couche sociale la plus démunie n'ayant aucun recours face à un appareil oppressif sans vergogne. La violence physique et le mépris total de la part des notables sont des plats dont les paysans pauvres se nourrissent au quotidien. Nghi Lai, le seul richard du village, force Pha, entre autres, à s'endetter, il pousse les paysans à porter plainte les uns contre les autres, une source de profit pour les notables qui "s'occupent" des affaires judiciaires, car du simple garde au mandarin provincial, en passant par tous les échelons de l'administration, chacun exige des "remerciements", payés en argent, avant de laisser les paysans franchir la porte mandarinale, faute de quoi, ce sera le cachot. L'endettement à des taux exorbitants (5% par jour) conduit inévitablement à la liquidation des terres, porte ouverte à l'esclavagisme. Rien de plus facile que d'accuser un paysan sans défense, tout est permis: l'accuser de vol, de crime d'affiliation aux sociétés secrètes, de tous les délits imaginables. Dans un langage simple et concis, Nguyên Công Hoan emporte le lecteur au coeur d'un véritable cauchemar dont l'horizon est complètement bouché. Cependant, la fin du roman laisse entrevoir une lueur d'espoir, "la dernière chance" (buoc duong cùng) pour les paysans de s'en sortir: la solidarité, contre les deux versants de l'oppression, le pouvoir et l'argent. Ici comme ailleurs, l'auteur se situe comme témoin de la situation en la restituant pour les lecteurs, il se passe des accusations et des dénonciations directes, le tableau social suffit aux lecteurs pour prendre conscience de la gravité des choses, du pourrissement de l'appareil mandarinal. Il convient de souligner ce que Nguyên Công Hoan voit comme le moyen d'en finir avec cette machination, c'est le niveau d'instruction. Enrayer l'ignorance, ne serait-ce qu'en enseignant la lecture et l'écriture, constitue le premier pas vers la conquête des droits élémentaires de chacun, car l'ignorance est la principale source d'injustice et d'oppression. Cette idée est sans cesse répétée par Du, un personnage du roman qui a reçu une instruction élémentaire. C'est Du qui parvient à la fin à canaliser l'humiliation et la haine des paysans en solidarité contre les notables.
Par ailleurs nous admirons, dans le roman, la connaissance qu'a Nguyên Công Hoan de la culture villageoise à travers les injures. Il en a retranscrit une qui défie, par sa longueur (presqu'une page entière), et par sa beauté (paradoxalement, ces injures possèdent leur propre musique et leur propre rime qui n'ont rien à envier à la poésie), sans doute, toutes les injures du monde 1. Malheureusement il est impossible de traduire ces injures, car la traduction les restituerait défigurées.
Il convient de signaler dans ce roman, comme dans d'autres des écrivains critiques de cette génération, l'attitude abjecte des couches dirigeantes à l'égard du peuple, qui se traduit par le tutoiement (mày tao) systématique chargé de mépris quand elles lui adressent la parole. D'un autre côté, quand un paysan a affaire à un mandarin, il se comporte d'emblée comme un coupable par son attitude de soumission. En effet, la tradition veut que le mandarin soit les parents du peuple (quan là cha me dân). A cet égard, le langage employé par les uns et par les autres est révélateur du mépris, d'un côté, et de la soumission, de l'autre. Quand on s'adresse au mandarin, on commence par joindre les mains pour le prier (lay, vai) en disant lay quan lon (je prie le grand mandarin). Aux questions du mandarin on répond par des phrases commencées par bâm, terme de "politesse" réservé aux dignitaires. Quel que soit son âge, on se nomme con (enfant) en suppliant le "grand mandarin" (quan lon), même si ce dernier aurait l'âge d'être son enfant, de vous sauver par sa "lumière divine" (dèn gioi soi xet), tout en reconnaissant qu'on n'est que "serviteur" (tôi to), et qu'on lui demande la "charité" (làm phuc). A l'inverse quand un mandarin parle aux gouvernés, il se permet de les appellera mày (tu ou toi, ce tutoiement est teinté de mépris par le ton employé), thang này (cette espèce, pour les hommes), con này (cette espèce, pour les femmes). En outre le mandarin se nomme bô mày (ton père) pour bien marquer son autorité et son mépris. Pour dire à la personne de se retirer, le mandarin lui dit buoc, buoc di, ou cut di (va-t-en). Tout ceci sans parler des brutalités qu'il fait subir à ses "esclaves" (tôi to) qui déplaisent à son humeur, ou qui n'ont rien pour le "remercier".
Tous ces aspects sont bien soulignés par les écrivains de formation moderne qui s'opposent, chacun à sa manière, à ces pratiques sociales méprisantes et méprisables pour les uns et humiliantes pour les autres. Bien que la Révolution d'Août ait bousculé le champ politique, sur le plan social ces pratiques n'ont pas disparu pour autant. Les compagnons d'hier de Hô Chi Minh et les autres personnalités, parfois plus âgées que lui, consentent à l'appeler l'"Oncle", appellation entretenue à la fois par le culte de la personnalité et par la mythification d'un personnage il est vrai hors du commun pour un Vietnamien 1.
Enfin, signalons tout de même que Vu Trong Phung est un des rares écrivains de cette époque qui ait abordé la sexualité. Certains le considéraient comme victime de la pensée de Freud, voire comme un obsédé sexuel. Le reportage tel que Ky nghê lây Tây (Les techniques de mariage avec les Français), ou les romans provocateurs tels que Làm di (Se prostituer), Sô do (La chance) et Giông tô (La tempête), sont chargés de sexualité. Vu Trong Phung avait un autre but que celui d'exciter les lecteurs: il voulait aborder un problème jusqu'alors tabou pour en faire une discipline pédagogique au service des jeunes. Même si cette ambition n'a pas abouti à ses fins, il a le mérite d'avoir osé en parler. A propos de Giông tô, Vu Ngoc Phan écrit:
Giông tô est un roman structuré à partir d'une morale solide, et fondé entièrement sur les bases familiales et sociales. N'y trouvons-nous pas tous les membres de la famille? Sur le plan social, on voit un mandarin impartial, un autre qui dépouille le peuple et s'apprête à assurer la plus haute fonction mandarinale, un jeune intellectuel, quelques filles modernes qui se chamaillent, un fils prodigue (thang con ban gioi không van tu, littéralement: le fils qui vend le ciel sans contrat), des situations de déchéance au village, un révolutionnaire, le bas peuple, un groupe d'ouvriers, sans parler de Thi Mich, de Long et de Nghi Hach, qui sont tout à fait représentatifs de la société 1.
Il nous est impossible de présenter l'oeuvre complète de Vu Trong Phung ou celle de Nguyên Công Hoan et encore moins celles de tous les écrivains de cette génération qui ont produit en une dizaine d'années un nombre considérable de romans, nouvelles, essais, reportages, etc. Ainsi nous sommes obligés de faire un choix reposé néanmoins sur deux critères précis : des écrits révélateurs du courant réaliste social qui a marqué l'histoire littéraire vietnamienne moderne, et ceux qui sont moins connus du grand public. Les cinq volumes intitulé Nhà Van hiên dai (Les écrivains modernes) du critique littéraire Vu Ngoc Phan et Le roman vietnamien contemporain de Bùi Xuân Bào, que nous avons mentionnés, donneront un aperçu plus complet sur les écrivains de cette époque. Sur Ngô Tât Tô, un autre écrivain-reporter de formation classique mais qui s'est adapté au nouveau contexte et dont les écrits sont au moins aussi importants et riches sur les moeurs et coutumes rurales, les récents travaux de Georges Boudarel apportent une contribution inédite pour la compréhension de cet auteur 1 .
Parallèlement aux écrits à caractère social, la poésie moderne, beaucoup moins virulente et moins contestataire, enrichit, à son échelle, l'expression de la libre pensée. A travers elle, les poètes semblent reconquérir un espace longtemps oublié ou refoulé: l'espace de l'individu. L'amour devient un passage obligé afin d'atteindre cette liberté d'expression.
LA POESIE
Le lettré
Chaque année, quand les pêchers fleurissent
On revoit le vieux lettré
Qui étale l'encre et le papier rouge
Sur le trottoir des rues passantes.
(...)
Mais d'année en année,
Les clients se font rares.
Le papier rouge devient triste:
la couleur en est passée
L'encre se cantonne dans l'encrier morose.
(...)
Il est toujours assis là
Sans que les passants le voient.
(...)
Cette année, les pêchers refleurissent
Mais on ne voit plus le vieux lettré.
Vu Dinh Liên
Dans la tradition vietnamienne, les branches de pêcher en fleurs et les "sentences parallèles" (câu dôi) 1 qu'on affiche de part et d'autre de l'autel des ancêtres, sont les symboles du Têt. Ces quelques vers évoquent la nostalgie du temps où les lettrés modestes cherchaient à gagner leur vie, à l'approche du nouvel an, en s'installant sur les trottoirs avec pour seuls outils, l'encrier, le pinceau et du papier rouge sur lequel ils composaient des "sentences parallèles" à la demande des clients.
Ce poème ayant pour titre Ong dô (Le lettré), écrit au plus tard en 1936, marque en quelque sorte la fin de la génération des lettrés classiques qui laissent la place à la nouvelle génération composée entre autres de poètes modernes. Ces derniers sont tous nés au début du siècle et ils ont grandi dans la conjoncture tumultueuse des années 1930. Contrairement à leurs confrères romanciers qui investissaient le champ social, les poètes s'exprimaient dans les limites du champ "individu". Ils se retournaient vers l'espace intérieur d'où venaient les plus profonds cris du coeur qui annoncèrent la libération des sentiments refoulés. En effet, l'amour constituait le thème principal de ces poètes modernes qui s'exprimaient sans détour à la première personne en employant les termes tôi (moi, je) ou anh (frère aîné, -quand un couple se parle, le garçon se nomme anh et appelle la fille em (petite soeur), de même celle-ci se nomme em et l'appelle anh, c'est l'une des formes de tutoiement des amoureux-), ce qui marqua un tournant dans la poésie vietnamienne; car autrefois on utilisait plutôt le terme ta qui représente le moi collectif. Par ailleurs le courant romantique les a plus ou moins marqués: les poètes français les plus admirés étaient Rimbaud, Verlaine et Baudelaire.
Comme nous l'avons signalé, vers 1935-1936 la poésie moderne s'impose sur la scène littéraire par l'intermédiaire des principaux journaux tels que: Phu nu tân van, Phu nu thoi dàm, Phong hoa, Ngày nay, Tiêu thuyêt thu bây, Hà nôi bao, etc. La poésie moderne a été considérée à son début comme le prolongement voire comme une invasion de la prose 1. En effet, malgré la nouveauté dans la forme et dans le contenu, les poèmes des premiers pionniers étaient chargés de "bavardage" 2, sans doute une réaction à la poésie classique qui était très condensée, et dans laquelle il n'y avait pas de de place pour les termes "inutiles".
On retient aussi l'ironie à l'égard de la poésie classique, à propos de la règle de dôi (parallélisme, opposition, ...) que Luu Trong Lu tourne en dérision ainsi:
" Le chien sort (Con cho di ra)
Le chat rentre (con mèo chay vô)."
Ces deux vers, comportant chacun le même nombre de pieds, respecte la règle de dôi:
- con mèo (le chat) "s'oppose" à con cho (le chien),
- chay vô (rentre) "s'oppose" à di ra (sort) 1.
Phan Khôi, quant à lui, demande qu'on ressorte les poèmes classiques qualifiés de "beaux" pour les "désosser" en vue de chercher où est enfouie la beauté 2.
L'une des figures pionnières de la poésie moderne est sans conteste Luu Trong Lu qui a commencé ses études au collège Quôc hoc à Huê, mais il les a abandonnées au bout de trois ans pour se lancer dans la poésie en arrivant à Hanoi, la capitale littéraire, où s'affrontaient les différents courants de pensée. Bien qu'il ait peu écrit par rapport aux autres poètes de la même génération, ses poèmes, qui évoquaient le désarroi, les émotions intenses de la vie de bohème ou les souffrances causées par l'amour, témoignent d'une grande sensibilité 3. Poète de l'amour, entre le diable et la femme il a choisi la femme, cette jolie créature qui sait non seulement embellir ses cils, vernir ses ongles mais aussi élever les vers à soie, tisser la soie et tricoter les pulls pour couvrir corps et âme de l'humanité 4.
La fraîcheur et le froid évoquent les saisons et particulièrement l'automne qui est un des thèmes favoris des poètes. Bien que les saisons au Vietnam, -pays tropical n'en ayant que deux: la saison sèche et la saison des pluies-, ne se distinguent pas aussi nettement les unes des autres que celles des pays tempérés, septembre, octobre et novembre sont considérés comme des mois d'automne. C'est sans doute un abus de langage par identification à l'automne de la Chine puis à celui de l'Europe, et particulièrement celui évoqué dans la littérature française. Quoi qu'il en soit, le paysage vietnamien de l'automne est moins coloré et peut-être moins romantique que celui de la France, par exemple. Néanmoins "l'automne" apporte une fraîcheur qui tranche avec la chaleur estivale suffocante chargée d'humidité. Ainsi cette saison devient un sujet inévitable pour les âmes sensibles. Contemplons le paysage d'automne décrit par Luu Trong Lu dans Tiêng thu (Les sons d'automne), un des poèmes les plus connus du poète:
N'entends-tu pas l'automne
Sous la lune vague en sanglot?
Ne sens-tu pas l'agitation
L'image du combattant
Dans le coeur de sa femme solitaire?
N'entends-tu pas la forêt d'automne,
Dont les feuilles bruissent,
Le chevreuil jaune hébété
Qui marche sur les feuilles desséchées?
Mais l'automne c'est encore la saison de l'amour. Les Vietnamiens se marient à partir de cette époque de l'année, époque où ils sont libérés des travaux agricoles d'une part, et que la tradition considère comme une période faste pour l'union conjugale, d'autre part. Pour l'heure, seul l'amour intéresse les poètes même s'il est chargé de souffrance. Quoi qu'il en soit, Luu Trong Lu ne fuit ni l'un ni l'autre. D'ailleurs un de ces poèmes s'intitule même "Plaisir de souffrance" (Thu dau thuong) 1:
L'amour s'est dissimulé dans la couleur du soleil,
Mon coeur est si triste, mon amour!
L'amour fait vibrer les lèvres
Difficile de trouver le mot pour parler d'un amour
comblé
Le sourire dans le rêve a fané
Les êtres tant aimés se sont effacés,
Le crépuscule est bleui,
Dans l'âme le rêve se brise.
Laissant oreiller et couverture à leur place,
Pour plonger dans le plaisir de souffrance
Maintenant j'allume un bâton d'encens
Sur le bras j'attache un ruban de deuil d'amour.
Le poète revendique donc même le droit de souffrir pour l'amour. Cette souffrance est en même temps une source de plaisir au même titre que les plaisirs charnels auxquels il fait allusion discrètement par les expressions "vibrer les lèvres", "oreiller et couverture". Ceci constitue une nouvelle dimension dans la poésie moderne qui ne se contente plus de parler des sentiments mais aussi du versant "plaisir physique" qui les accompagne. Bien qu'encore timide dans ce poème, cette tendance va s'affirmer avec d'autres poètes qui vont mettre l'amour à nu.
Si la poésie moderne est caractérisée par l'emploi du terme tôi (moi, je), Luu Trong Lu ne l'a employé qu'une fois, non dans les poèmes d'amour mais dans les quelques vers de Nang moi (Les nouveaux rayons du soleil) dédié à ses parents (cela ne veut pas dire qu'il s'adressait à ses parents en se nommant tôi). L'emploi de tôi est significatif à plusieurs égards: il rompt avec la tradition classique, et il marque l'émergence de l'individu, du moins dans la poésie. La communauté, écrivent Hoài Thanh et Hoai Chân, opprime toujours l'individu avec le poids des idées et des mots conventionnels. Faire de la poésie, c'est renverser ces conventions pour chercher ce qui est plus profond mais caché au-delà 1.
Thê Lu, le bâtisseur de la poésie moderne et l'admirateur du Beau (Dep), s'exprime aussi pour montrer ce qu'il trouve beau:
Je suis un promeneur qui s'aventure
A travers les chemins pour s'amuser
(...)
Je ne suis qu'un convive amoureux
Passionné de la beauté multiforme.
(...) 2.
Bien qu'il ait acquis une formation occidentale, la sensibilité vietnamienne, à travers ses poèmes reconnus modernes de la forme aux idées, ne s'efface pas pour autant, mais au contraire, elle constitue la toile de fond de ses écrits. Notons que certains de ces poèmes sont intraduisibles en français, ou si on les traduit on enlèvera par la même occasion toutes les nuances, les images, la sonorité musicale, et donc la beauté même. D'après Vu Ngoc Phan, Thê Lu est sans doute le premier poète vietnamien qui vénère l'amour de la façon la plus exaltante 1:
Je flâne à côté du jardin féerique,
Elle se cache derrière les fleurs en souriant,
Je m'arrête, pourtant encore perdu,
Séduisante, elle cueille une rose...
Elle jette à mon coeur, qui l'accueille
La fleur qui dissimule l'amour,
Ou qui cache les bourgeons d'épines pointues
Tranchant les blessures de mon coeur.
(....) 2.
On peut décerner à Thê Lu le rôle de pionnier dans l'exaltation de l'amour, cependant son exaltation reste discrète et imagée comparée avec celles des autres poètes venus juste après lui comme Xuân Diêu, Vu Hoàng Chuong. Quoi qu'il en fût, quand Thê Lu apparut sur la scène littéraire, les admirateurs et admiratrices de la poésie moderne ne pensaient plus à Luu Trong Lu qui, en dépit de ses qualités d'orateur, préférait vivre à lire ou à écrire 3 .
Toute situation et toute rencontre fût-elle fugitive, servait de prétexte à Thê Lu pour prolonger son imagination. Parfois il se mettait à la place de "sa rencontre" pour exprimer les sentiments comme dans le poème qui décrit une séparation:
Je t'accompagne jusqu'à la pirogue
Pour prolonger encore notre amour;
(...)
Qui savait que tu étais aussi
Un passager qui s'amuse momentanément 1.
Plus que la prose, la poésie moderne a accueilli des figures féminines en son sein. Il est vrai par ailleurs qu'elles n'ont pas laissé d'oeuvres quantitativement et qualitativement comparables à celles de leurs confrères. Rappelons que la femme n'avait pas été complètement absente dans la littérature classique, cependant sa présence restait une exception. L'histoire littéraire vietnamienne retient surtout deux noms: Bà Huyên Thanh Quan, femme d'un mandarin de province, et Hô Xuân Huong, une poétesse qui a laissé des écrits osés sur le plaisir charnel dissimulé sous les jeux de mots. Dans les années 1930, bien que quelques-unes soient parvenues à se faire reconnaître, elles étaient beaucoup moins nombreuses que leurs condisciples masculins. Celle qui a fait le plus parler d'elle est sans conteste la mystérieuse T.T.KH, devenue une véritable légende. Elle n'a écrit en tout et pour tout, à ce que l'on "connaissait" d'elle, que deux fois en 1937, en réaction à une nouvelle, racontant une histoire d'amour, parue dans Tiêu thuyêt thu bây. Un autre élément qui a contribué à l'édification de sa légende se trouve dans ce qu'elle a écrit, car les admirateurs s'identifiaient facilement à son amant:
Il me caresse souvent les cheveux,
Soupire quand il me voit joyeuse;
Et dit: "La fleur est comme un coeur brisé,
J'ai peur que notre amour sera ainsi!"
(...)
Et un beau jour je devrai également aimer
Mon mari, quand je suivrai
Les filles habillées en rouge 1 quittant leur domicile!
"Dis, le vent, pourquoi fait-il si froid? 2"
D'après ce que T.T.KH a écrit, elle s'est mariée pour une raison ignorée sans pour autant renoncer à son amour. On trouve donc ces vers:
S'il savait que je suis déjà mariée,
Mon dieu, est-ce qu'il serait triste?
(...)
Laisse-moi verser mes dernières larmes
Qui tombent en vers, pour pleurer cet amour!
C'était donc son dernier mot qui laissait tant d'admirateurs espérer la connaître en vain.
Une autre poétesse venue un peu après sur la scène littéraire, est connue plus sous le pseudonyme de Anh Tho que sous celui de Hông Anh. De son vrai nom, Vuong Kiêu An, elle vit encore actuellement à Hanoi. Ses premiers poèmes étaient parus dans Hà nôi bao, Tiêu thuyêt thu bây, Ngày nay. En 1939, Anh Tho a obtenu le prix d'encouragement du groupe Tu Luc Van Doàn. Elle a commencé à écrire des poèmes à caractère descriptif avant de parler des sentiments. Son premier recueil Buc tranh quê (Tableau rural), comme son nom l'indique, regroupe des poèmes décrivant le paysage campagnard. En voici l'image d'un quai de passeurs sous la pluie, tombé dans l'oubli:
Sur le quai désert, le froid investit,
Les quelques "buvettes", sans un seul client.
Le passeur fait une halte pour fumer une pipe
Laissant la marchande suffoquée qui tousse.
(...) 1
Cependant les poèmes qui décrivent le mieux la vie rurale, qui traduisent avec fidélité la simplicité de la mentalité paysanne, sont ceux de Nguyên Binh: le poète n'a jamais mis les pieds dans une école. Autodidacte et aidé par son oncle maternel, Bui Trinh Khiêm, qui, pour avoir participé au mouvement Dông Kinh Nghia Thuc au début du siècle, avait été relégué au triste sort de lettré rétrogradé, Nguyên Binh s'est instruit à l'ombre du village. Il a commencé à écrire à l'âge de treize ans. En 1937, son premier recueil Tâm hôn tôi (Mes états d'âme) a obtenu le prix d'encouragement décerné par Tu Luc Van Doàn. Bien qu'il ait fréquenté le milieu littéraire de Hanoi, il gardait quelques signes distinctifs pour affirmer, sans doute, son origine paysanne. Tandis que les autres poètes ou romanciers se promenaient avec leur chemise cartonnée ou des bouquins sous le bras, la mode pour les écrivains de cette époque, il se contentait d'une boîte à biscuits métallique dans laquelle il rangeait soigneusement ses manuscrits et surtout ses lettres d'amour considérées comme un véritable héritage dont il était fier 2. Ses poèmes, plus de mille au total, sont écrits pour une large part sous la forme de la chanson populaire (succession de vers de six et de huit pieds selon la règle de rime qui les caractérise) d'une part, et d'autre part, il employait le langage des paysans sans chercher à le soigner comme tant d'autres le faisaient. Ainsi l'imaginaire paysanne trouvait en lui le porte-parole. Dans son premier recueil on trouve, par exemple, "Le rêve du passeur" (de pirogue):
Les années précédentes (je) poussais ce bateau,
Pour qu'elle traverse et aille chercher du jute
les après-midi.
Et je rêvais toujours, je rêvais encore:
"Qu'elle me confectionne un hamac 1, me teinte du tissu.
Le roi ouvre solennellement le concours,
Je suis reçu major et rentre au village,
Mon hamac s'avance devant le sien...
Les deux hamacs prennent la même pirogue.
(...) 2
Un rêve "simple" de tous les paysans, mais le rôle peut s'inverser, cette fois c'est la passeuse (de pirogue) qui attend son voyageur d'autrefois:
Le printemps ramène les souvenirs
De la fille de l'autre côté de la rivière
Elle se rappelle, il y a trois ans,
Avec qui elle a échangé des promesses sur le rivage.
Mais cet amoureux printanier
Est parti sans revenir aux rivages
Le printemps passe et repasse
A chaque printemps, elle attend...
Cela fait le troisième printemps
Le feu d'amour s'essouffle peu à peu.
(Elle ne va pas quand même) attendre ainsi?
Elle rompt la promesse à son amant.
Quittant la pirogue, les rivages, les eaux claires
La passeuse se marie.
Depuis ce temps on ne la voit plus
Elle laisse la tristesse aux passants 1.
L'amour, toujours l'amour, Nguyên Binh tombe facilement amoureux des filles du village:
Le village de l'Ouest pense à celui de l'Est 2
Il y en a un qui pense très fort à quelqu'un 3
Le vent et la pluie sont les maladies du ciel
Etre amoureux, c'est ma maladie de l'aimer
Chez toi, tu as du bétel qui grimpe
Chez moi, j'ai des aréquiers 4
Le village de l'Ouest pense à celui de l'Est
Les noix d'arec de l'Ouest pensent au bétel de quel
village ? 5
Ce langage simple a permis à bon nombre de ses admiratrices, et aux paysannes en particulier même celles qui ne savaient ni lire ni écrire, de connaître par coeur ses poèmes. Car l'univers décrit par le poète leur rend facile de s'identifier aux personnages et aux situations analogues aux leurs. Certains de ces poèmes ont été mis en musique (moderne) dans la période de la Résistance. La poésie à travers Nguyên Binh révèle le côté paysan qui se cache derrière chacun (chaque Vietnamien) 1. C'est justement ce côté paysan qui a permis à ses poèmes de franchir les frontières de la ville pour atteindre plus facilement la campagne que les autres écrits.
Nous arrivons maintenant à un autre aspect de la nouveauté à travers la poésie, en l'occurrence la façon de rompre avec d'anciens syntagmes au profit de nouveaux. Xuân Diêu avait ce don qui en déboussolait plus d'un. Les syntagmes qu'il a employés étaient tellement inattendus qu'on les considérait presque comme une naïveté maladroite (ngô nghê) ou comme une occidentalisation à outrance. Cependant Vu Ngoc Phan n'hésitait pas à se faire l'avocat de cette innovation en écrivant:
En réalité, c'est quand les sens sont excités et quand le poète est débordé de sentiments que se produit la poésie. Ainsi, dans l'imagination, l'abstrait peut aussi devenir concret. (...)
Cette façon révolutionnaire d'agencer les mots est difficilement saisissable au début, mais avec le temps, on la comprend mieux 2.
A cet égard on trouve par exemple:
Buvons la poésie qui fond dans la musique...
Rien n'est plus triste que les après-midi
Où la lumière s'obscurcit avec la nuit.
Aujourd'hui il fait froid, le soleil se couche tôt...
En vietnamien l'expression "le soleil se couche" se dit plutôt mat troi lan (littéralement: le soleil "disparait sous", comme un nageur disparaît sous l'eau), tandis que mat troi di ngu est la traduction littérale de l'expression française "le soleil se couche" (mat troi, le soleil; di ngu veut dire se coucher ou littéralement: "aller dormir").
Ou encore ces quelques vers qui rappellent un poème du parnassien Edmond Haraucourt 1:
Aimer c'est mourir un peu.
Car on n'est pas sûr d'être aimé en retour.
On donne beaucoup mais on reçoit très peu;
Sans savoir si c'est de l'indifférence ou du rejet.
(...) 2.
Cependant si on s'arrête à la francisation chez Xuân Diêu on oubliera sa sensibilité et sa profondeur qui n'avaient pas leur expression jusqu'alors. Certains de ses poèmes mettent à nu l'état d'esprit d'une certaine jeunesse assoiffée de vivre: mais plus elle vit plus elle trouve que c'est insuffisant. L'amour que les jeunes recherchent n'arrive pas non plus à combler leur âme devant le temps qui passe. Par ailleurs, mieux que quiconque, Xuân Diêu a démasqué la solitude enfouie chez chacun, elle est présente même dans les moments jugés les plus exaltants de la vie. Dans le poème intitulé Loi ky nu (Parole d'une fille de joie), Xuân Diêu décrit l'amour passionné d'une fille de joie pour un amant passager, en effleurant la zone "glaciale" (gia bang), la peur devant le vide:
"Reste encore un moment avec moi;
Pourquoi te presser, la lune est si claire.
(...)
Tu ne restes pas, mon coeur sera solitaire.
Reste avec moi! Voici l'oreiller,
Sur mon bras, tu t'appuies dans ton ivresse.
(...)
Ne me laisse pas seule avec mon âme;
(...)
J'ai très peur. Les glaciers envahissent tout;
La nuit étoilée, glaciale, transperce la peau.
(...) 1
Le sentiment du temps qui passe décide le poète à privilégier l'instantanéité aux dépens de la durée:
Dépêche-toi, presse-toi!
Mon amour, ce jeune amour est déjà vieux. (...)
Dépêche-toi! Le temps n'attend pas.
(...)
L'amour vient, l'amour s'en va, qui sait.
Dans la rencontre il y a des germes de séparation;
(...)
Une instant radieux vaut mieux
Qu'une tristesse qui dure toute une vie.
(...) 2
Ces constantes exprimées par Xuân Diêu, la solitude, la soif de vivre, l'urgence, sont celles qui traduisent le mieux l'état d'esprit de cette génération de poètes à la recherche d'eux-mêmes. Xuân Diêu est sans le doute le premier à être allé si loin dans les profondeurs de l'âme par rapport à ses confrères. Même aux côtés de son amoureuse, il la trouve toujours trop éloignée, ses yeux évoquent pour lui des "précipices", le front, "l'immensité de l'univers":
Même si on croit partager la même vie, le même rêve,
Toi c'est toi, et moi c'est moi.
Comment traverser la Grande Muraille
De deux univers chargés de secrets.
(...)
Mon âme est encore plus obscure que la nuit,
Je ne comprends pas moi-même, qui comprendra?
(...)
Rapprochons nos têtes, serrons nos poitrines!
Fusionnons nos cheveux longs et courts!
Avec nos bras , embrassons nos épaules! (...)
Serrons fort nos lèvres fermées. (...)
Dans l'ivresse, je te dirai:
"Encore plus près! C'est encore trop loin!" 2
Au-delà de la recherche de soi-même devant le temps qui passe, Xuân Diêu franchit la barrière de la pudeur pour évoquer sans détours les gestes amoureux à forte connotation sexuelle. Les expressions utilisées par le poète telles que "serrons nos poitrines", "embrassons nos épaules", "serrons fort nos lèvres fermées", révèlent une nouvelle forme d'expression libérée des tabous. Cependant Xuân Diêu n'était pas le seul qui s'exprimait de la sorte, Vu Hoàng Chuong qui partageait avec lui le même état d'esprit a réussi de même à se libérer des contraintes du passé. Né en 1916 à Nam Dinh, Vu Hoàng Chuong est sans doute le seul poète qui avait une formation universitaire. Après le baccalauréat, il s'est inscrit à l'Ecole de Droit qu'il a vite abandonnée pour travailler comme agent technique aux chemins de fer. Ensuite il a enseigné dans les écoles privées avant de préparer sa licence en mathématiques. Cette formation a quelque peu influencé sa façon d'écrire caractérisée par le soin dans le choix des mots. Dans son recueil Tho say (Poèmes d'ivresse), on retrouve l'état d'esprit d'une certaine jeunesse tourmentée et confrontée à la solitude et à l'inconnue du lendemain:
Ancre levée, ô bateau!Laisse-toi emporter par les vagues,
Qu'elles t'entraînent vers l'est ou vers l'Ouest,
Loin de la terre ferme, au milieu de l'immensité,
La solitude, amère, peut-être se dissipera-t-elle .
Nous sommes un groupe de cinq à sept perdus.
Abandonnés par la patrie, méprisés par les nôtres,
(...)
Nous nous sommes trompés de siècle en venant au monde,
Certains sont outrés dans l'isolement. (...) 1
Comment sortir de cette situation? Pour Vu Hoàng Chuong, comme pour certains autres, l'oubli serait une solution:
Ce chemin en ruine, -je le connais-
Les amours mortes, les rêves brisés.
(...)
Non, mon amour, je n'ai plus le courage,
Non! Les sources d'amour et de larmes ont tari,
Brûle pour moi dans tes yeux de feu,
Le peu d'inquiétude qui reste sur les lèvres.
Répands ta chevelure,
Approche-toi, approche tes lèvres folles,
Tu m'emmènes dans la fumée,
(Tu) raccompagnes (mon) âme ivre vers l'oubli 1.
Mais l'oubli ne suffit pas, Vu Hoàng Chuong expérimente aussi toutes les ivresses, ainsi l'ivresse charnelle:
L'âme est abattue mais les pieds sont encore solides,
Le coeur trébuchant mais les pas restent harmonieux.
(...)
Le reflet fou de la belle sur les quatre murs de glace, Les épaules palpitent, les jambes trépident,
Les mains se serrent, les deux corps reposent,
(...) 2
Il existe bien entendu d'autres poètes de la même génération que nous ne pouvons pas présenter tous. Nous nous contentons de passer en revue les figures les plus représentatives de ce courant littéraire de l'Entre-Deux-Guerres. Dans l'ouvrage Thi nhân Viêt nam (Les poètes vietnamiens), Hoai Thanh et Hoai Chân en ont présenté une quarantaine qui ont laissé leur nom dans la poésie vietnamienne de cette époque. C'est sans doute l'ouvrage qui donne l'aperçu le plus global sur ce sujet.
Quoi qu'il en soit, le thème dominant dans la poésie moderne reste l'amour romantique sous ses différentes facettes dont les sentiments, une composante parmi d'autres. Il n'empêche qu'à travers l'amour romantique, certains poètes ont découvert la profondeur de leur âme, l'insondable solitude qui caractérise l'individu. Cette révélation livre l'individu à lui-même, l'éloigne de la société: la liberté s'acquiert au prix de la solitude. En ce sens la poésie moderne marque une rupture avec la tradition classique à travers l'expression d'une liberté rendue possible par un concours de circonstances, lesquelles sont déterminées par les facteurs historico-culturels (disparition progressive des lettrés, depuis le début du siècle, qui emportent avec eux les valeurs et les pratiques inadaptées au contexte moderne dont l'étude des caractères chinois, consolidation et promotion du quôc ngu à travers la presse et la littérature, recherche d'un nouveau souffle par la jeune génération de formation moderne confrontée à l'impasse socio-politique...).
Si l'angle d'attaque des romanciers contre l'ancienne structure sociale fut principalement la famille et le mandarinat, celui des poètes reposa sur l'individu. Tandis que les premiers cherchèrent à libérer l'individu des structures oppressives, les seconds contribuèrent à définir son espace vital en le prévenant des limites et des "dangers" que cela comporte.
CHAPITRE 5
L E S I N N O V A T I O N S
A R T I S T I Q U E S
A C A R A C T E R E V I S U E L
Au-delà des querelles ou des procès d'intention, la colonisation a façonné tant soit peu la société vietnamienne à l'image des sociétés occidentales. Elle a véhiculé un certain mode de vie, une certaine perception du monde environnant. Ainsi en fut-il pour l'art, qui est à la fois l'outil et le moyen d'atteindre le Beau, et qui n'a pas laissé les Vietnamiens insensibles. Sans présenter un caractère imposé, le théâtre comme mode d'expression a pris racine dans la société, car les Vietnamiens eux-mêmes sont allés à sa rencontre. Le cinéma comme invention technique et artistique a trouvé de même sa place, bien que les Vietnamiens ne fussent pas acteurs mais spectateurs. Dans un autre domaine, la presse s'enrichissait de dessins humoristiques, - inexistants dans les trois premières décennies du siècle -, qui illustraient d'une manière ou d'une autre certains faits ou phénomènes sociaux. Les caricatures devenaient ainsi l'indicateur de tendance d'une société en transformation, avec ses excès et ses déboires.
LE THEATRE
D'où vient que l'on rit si librement au théâtre, et que l'on a honte d'y pleurer?
Est-il moins dans la nature de s'attendrir sur le pitoyable que d'éclater sur le ridicule?
La Bruyère
Si la poésie était connue au Vietnam de longue date, le théâtre sous sa forme occidentale n'y est apparu qu'avec la colonisation. En matière de divertissement public à caractère spectaculaire, il y avait deux formes d'expression: l'une académique, le tuông, inspiré directement de l'opéra classique chinois, qui s'adressait aux couches dirigeantes, et l'autre populaire, le chèo, une sorte de combinaison à la fois de danse, de chant et de dialogue direct avec le public en milieu rural. Avec la colonisation ces deux formes d'expression artistique ont survécu tant bien que mal. Grâce à son aspect populaire et national, le chèo reste encore bien vivante à l'heure actuelle, tandis que le tuông semble une création d'un autre monde. A cet égard, le théâtre représente un enrichissement culturel emprunté directement à l'art français. De même que pour la littérature, le théâtre lors de son introduction et de son développement, a dû sa diffusion et sa popularité à la presse qui publiait régulièrement des pièces dans ses colonnes. La pièce Chen thuôc dôc (La tasse de poison), de Vu Dinh Long, la première qui ait retenu l'attention du public, fut publiée dans un premier temps par la revue Huu Thanh en septembre 19211. Dans la décennie suivante, le journal Dàn bà moi publiait chaque semaine une petite pièce sur deux ou trois pages, Phong hoa et Ngày nay faisaient de même mais beaucoup moins systématiquement. La revue Kich bong, (Théâtre et Cinéma) spécialisée dans le spectacle, dans la période 1935-1937, contribuait à cet égard à populariser le théâtre. D'autres journaux, y compris ceux en langue française tels que L'Avenir du Tonkin, Le Courrier d'Haiphong, France-Indochine, etc., se chargeaient des comptes rendus et des critiques. On remarque que le théâtre, comme tant d'autres modernisations de la vie culturelle, a pris racine et s'est développé dans les centres urbains où se concentraient les activités littéraires et culturelles.
A partir de 1911, date de l'inauguration du Théâtre de Hà nôi (Nhà hat Tây), chaque année, à la "saison théâtrale" (novembre-décembre), une troupe professionnelle métropolitaine donnait ses représentations dans ce cadre somptueux. Celles-ci s'adressaient aux hauts fonctionnaires et à la communauté française, néanmoins certains collaborateurs vietnamiens francophones ont de même été invités. Cette rencontre avec un nouveau mode d'expression allait peu à peu donner l'idée aux dramaturges classiques et aux hommes de lettres d'innover par rapport à l'art local. Parallèlement à cette entreprise d'innovation, certaines pièces du théâtre classique français ont été traduites et particulièrement les comédies. Pourquoi les comédies plutôt que les tragédies? A cette question, le dramaturge Buu Tiên, actuellement à la retraite à Hà nôi, nous répond:
Cela montre qu'en premier lieu les Vietnamiens n'ont pas rejeté d'emblée tout ce qui venait de France, et par ailleurs ce rire traduisait le rire amer d'un peuple qui a perdu sa patrie. La comédie ou le rire permettaient de contenir cette souffrance, mais pas la tragédie 1.
Il s'agit sans doute d'une réflexion rétrospective, car Buu Tiên était à peine né quand eut lieu la première adaptation d'une pièce de Molière en 1920, un an avant la création de la première association théâtrale Uân hoa, présidée par Nguyên Huu Kim, un pionnier de l'art dramatique. Quoi qu'il en soit, on ignore pourquoi Nguyên Van Vinh, le gérant-rédacteur en chef du Dông duong tap chi, préférait les comédies de Molière aux tragédies de Corneille. Cependant à lui seul, Nguyên Van Vinh a traduit Le Bourgeois gentilhomme ("Truong gia hoc làm sang"), Le Malade imaginaire ("Bênh tuong"), L'Avare ("Nguoi biên lân") et Tartufe ("Gia dao duc"), dans la deuxième décennie du siècle. A cet égard, Nguyên Van Vinh fut le premier homme de lettres qui ait introduit le théâtre dans la vie culturelle. Pham Quynh, qui a aussi traduit des pièces de Corneilles n'a pas franchi l'étape de la réalisation, car il se contentait sans doute de l'apport du théâtre sur le plan littéraire.
La première représentation théâtrale vietnamienne eut lieu le 25 avril 1920 à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de Khai tri tiên duc (l'Association pour la Formation Intellectuelle et Morale des Annamites: l'AFIMA en français.) Cette association présidée par Pham Quynh, le directeur de la revue Nam phong, avait pour but le rapprochement de la culture française et de la culture vietnamienne. La pièce présentée était une adaptation du Malade imaginaire, dont les acteurs se regroupaient autour d'amateurs tels que Nguyên Van Vinh, Pham Huy Luc (le rédacteur en chef du journal Trung bac tân van), et plusieurs "Retour de France". Faute d'amatrices vietnamiennes pour tenir les rôles féminins, le groupe avait recours aux comédiennes professionnelles du théâtre classique. En effet, à son début le théâtre avait du mal à trouver des Vietnamiennes pour tenir les rôles féminins, ceci pour une double raison culturelle et professionnelle. Elles ne voulaient pas se mélanger aux hommes de peur d'encourir la réputation de filles aux moeurs légères, et par ailleurs elles étaient timides. D'un autre côté, elles avaient peur de commettre des maladresses étant donné leur qualité de débutantes. Ce qui explique pourquoi les troupes d'amateurs devaient, soit recourir aux comédiennes du théâtre classique, soit faire tenir les rôles féminins par des hommes déguisés en femmes. Il fallut attendre les années 1930 pour que cette question fût résolue avec l'arrivée de la nouvelle vague de gai tân thoi (femmes modernes) qui, pour revendiquer l'égalité des droits et pour mieux s'affirmer sur la scène sociale et culturelle, surmontaient la timidité qui les caractérisait. Les premières actrices-amatrices du théâtre se recrutaient dans le milieu estudiantin. L'actrice Song Kim, la compagne du poète Thê Lu, une des premières comédiennes se rappelle encore que:
Les actrices de ces soirées théâtrales de bienfaisance ont surpris le public: le rôle des femmes n'est plus joué par les hommes ou confié aux bons offices des actrices professionnelles du théâtre traditionnel. Des intellectuelles, des "femmes de bien" -comme on les appelait à l'époque- n'hésitaient pas à coopérer avec les acteurs. Elles allaient même plus loin en acceptant le rôle de vieilles femmes peu attrayantes 1.
A cette date, les troupes d'amateurs n'avaient pas encore de cadre précis pour présenter leurs pièces. Souvent c'est à l'occasion des soirées à caractère humanitaire, pour venir en aide aux sinistrés des inondations, par exemple, qu'elles organisaient des représentations dans les grands centres urbains: Hà nôi, Hai phong, Nam dinh, Bac ninh, etc. De l'autre côté le public ne s'était pas encore familiarisé avec ce mode d'expression. Lassés par les tirades, les spectateurs non initiés réclamaient des chants à la place 1. C'est la raison pour laquelle on intégrait parfois artificiellement des bouffons pour retenir le public jusqu'à la fin du spectacle.
Balbutiant dans les années 1920, le théâtre comme nouveau mode d'expression est parvenu à sa maturité dans la décennie suivante en contribuant à verser au débat national les mêmes pièces porteuses de modernité que celles apparues dans la presse ou dans la littérature: les thèmes de la famille, l'amour, la femme, visaient toutes, à degrés divers, la structure sociale ancienne devenue anachronique.
Sur le thème de la femme, prétexte à une évocation détournée de l'amour, l'évolution est sensible et significative si l'on compare les pièces apparues dans les années 1920 et celles écrites dans la décennie d'après. Parfois, cette évolution se remarque chez le même auteur, par exemple, chez Vi Huyên Dac. L'une des premières tragédies écrites sur ce thème dans la période des balbutiements, qui ait retenu l'attention des amateurs du théâtre vietnamien, est la pièce Toà an luong tâm (Le tribunal de la conscience) de Vu Dinh Long 1, l'un des pionniers de cette forme d'expression. Cette tragédie met en évidence les rapports difficiles d'un couple dans lequel le mari, Phu, est un adepte de l'ancienne école et la femme, Quy, est une femme gagnée aux idées modernes. Les disputes du couple ont aussi une autre raison, évoquée rapidement et qui touche à la question raciale: Quy voulait se marier avec Quay, un étudiant en pharmacie d'origine chinoise, mais sa famille s'y est opposée car il n'était pas vietnamien. Quy a donc été contrainte de se marier avec Phu, un secrétaire subalterne dans l'administration, choisi par la famille, mais elle a gardé des relations amoureuses avec Quay. La pièce débute par la complainte du mari qui s'adresse à Ai, son ami:
PHU : Vous voyez, c'est maintenant que je réalise que le bonheur de toute une vie dépend du mariage. (...)
Si je la (ma femme) raisonne, elle me réplique en invoquant, éducation inachevée aidant, "les droits de la femme", "l'égalité", "la liberté". Quelle déchéance, d'entendre ces mots si précieux dans la bouche d'une d'ignorant!
Quant à la femme, elle aussi, elle se plaint de sa situation:
QUY : Quand je pense aux autres je me sens encore plus humiliée. (...) J'ai le malheur d'avoir épousé un lettré arriéré (anh dô hu) qui ne pense qu'à la piété filiale (hiêu). Le deuil du père arrive à sa fin et il continue à faire chambre à part en me laissant toute seule la nuit. Le temps passe, et j'aurai perdu ma jeunesse !
Cette évocation de la vie conjugale renoue avec la tradition villageoise sous forme de chanson populaire qui exprime ainsi les doléances d'une femme:
"Trois ans de veuvage pour tomber sur un mari dormeur".
(O goa ba nam, lây chông hay ngu. 1)
Voulant mettre fin à cette situation inconfortable pour tout le monde, l'amant, Quay, se renseigne sur les procédures de divorce, mais dans le cas de Quy, elle ne peut invoquer ni l'un ni l'autre des deux motifs de divorce existant dans la loi vietnamienne en vigueur: premier motif possible, le mari a pris une deuxième femme; deuxième motif, la femme est maltraitée par le mari. Avec le consentement de Quy, l'amant se résout à liquider le mari par le poison: Quy pense qu'il vaut mieux être heureuse en transgressant la morale que de s'y plier pour être malheureuse. Le soir du crime, la femme se charge de l'empoisonnement, et l'amant de se débarrasser du corps; mais ils sont surpris par Bôc, le serviteur fidèle du mari. Ne sachant que faire, Quy propose à Bôc de garder sa place en échange d'une augmentation substantielle. Celui-ci profite de la situation en exigeant une somme plus importante, sous la menace d'un témoignage écrit dont il se sert comme moyen de chantage. Avec l'aide d'un journaliste, il met en place un plan pour arrêter le couple adultère et criminel, cependant, au moment où ils passent à l'acte, ils sont surpris par l'amant qui les tue à coups de couteau. Le temps passe, et Quy jouit d'une totale liberté. Mais au bout de quelque temps les remords la rongent, et elle décide de tuer à son tour son amant. Celui-ci a une autre idée: puisqu'ils sont coupables tous les deux, il faut qu'ils meurent ensemble. Il tue la femme à coups de pistolet et retourne l'arme pour mettre fin à ses jours.
Même si l'auteur a introduit l'idée de la femme moderne dans cette pièce, la femme est peinte comme la source du mal. Moraliste, il punit son personnage féminin (et le personnage de l'amant) sans chercher la cause profonde dans la discorde dans un couple où le mari et la femme sont deux êtres diamétralement opposés face à la morale ancestrale. La famille, dans cette pièce, sort indemne, son emprise ne doit surtout pas être mise en cause, c'est du moins ce que l'auteur laisse entendre. Moins tragique que la pièce de Vu Dinh Long, Ban và vo (L'ami et la femme), une pièce de Nguyên Huu Kim, dramaturge de la première génération, reprend le fameux thème du trio "le mari, la femme et l'amant". Ecrite en 1927, la pièce a été présentée la même année à Hà nôi. C'est l'histoire d'un mari trompé par son meilleur ami. Au début, le mari est incrédule, mais un autre ami le met au courant. Lorsqu'il surprend une scène intime, fou de rage, il s'apprête à tuer les deux amants. Mais il renonce à cet acte criminel au profit d'une "générosité" qui consiste à les laisser face à leur conscience. La femme ramasse alors le couteau pour tuer son amant, qui réussit à l'éviter. Au cours de la lutte, le couteau dévie malencontreusement, et blesse mortellement la femme et la tue. La police arrive et embarque l'amant.
Au-delà de la jalousie ou de la frivolité, l'auteur a introduit la notion d'incommunicabilité entre le mari et la femme, qui se plaint d'avoir un mari ignorant, alors que son amant est un artiste qui connaît l'art de vivre et lui apporte les plaisirs.
A travers ces deux pièces, on voit que la femme commence à se révolter contre son sort de femme cantonnée au foyer. Elle revendique la possibilité d'avoir un compagnon de son choix, avec qui elle puisse s'entendre. Cependant ses tentatives de libération sont toutes sanctionnées par la morale et sévèrement punies par la vie. Elle doit payer ses actes d'infidélité au prix de sa propre vie, pour préserver l'ordre ancien. Cette attitude des auteurs n'est pas une surprise car elle représentait encore dans les années 1920 la tendance dominante de la société, tendance qui s'effacerait peu à peu au profit d'une attitude plus critique et plus contestataire, illustrée justement dans certaines pièces de théâtre.
Effectivement, l'idée la femme moderne commençait à investir le champ littéraire. Cette montée de la femme sur la scène sociale pour affirmer sa présence et sa volonté de rompre avec son ancien statut de femme au foyer, était soutenue et rendue possible par la jeune génération d'intellectuels qui ne manquaient pas de s'exprimer à cet égard à travers leurs écrits, pour lesquels le théâtre fut l'une des formes d'expression possibles.
L'idée de la femme moderne a été reprise par Nguyên Van Nam dans la pièce Cô Tân (Mademoiselle Tân, Tân signifiant "moderne") écrite en 1935. Dans cette pièce, Cô Tân, une fille moderne de 19 ans, sincère et franche, agit selon ses propres jugements sans avoir peur du qu'en-dira-t-on. Ne pouvant supporter l'atmosphère familiale devenue suffocante à la suite du deuxième mariage de son père avec une chanteuse, Cô Tân abandonne sa famille. Le père, un mandarin en retraite, sous l'influence de sa nouvelle femme, fait publier un acte de reniement de sa fille dans la presse:
J'informe tout le monde que ma fille Lê Thi Tân, 19 ans, n'a pas obéi à ses parents et a quitté la maison depuis dix jours. Ainsi je ne la reconnais plus comme ma fille et décline toute responsabilité sur ses actes depuis son départ 1.
Avant de quitter sa famille Cô Tân s'adresse une dernière fois à son père:
Je suis ta fille, c'est un fait, mais je suis aussi une femme. Si tu abuses de tes droits de père pour me contraindre à ta volonté, il est de mon droit d'invoquer "les droits de l'homme" (de l'être humain) pour refuser cette famille tombée en décadence, et pour créer une situation plus conforme à la morale.
L'idée de la femme moderne, d'après l'auteur, ne s'arrête pas aux rapports familiaux mais doit s'étendre également aux rapports avec l'entourage, notamment avec les amis de l'autre sexe. En voyant les copains de Hieu (qui est son petit ami) revenir d'une soirée chez les chanteuses, Cô Tân les interpelle:
CO TAN : Retournez donc à Khâm thiên 2. (...) Vous avez des idées bien égoïstes: vous voulez que votre femme arrive vierge au mariage, sinon vous l'humilierez; quant à vous, sur cent garçons je me demande s'il y en a un qui n'ai pas connu des filles publiques avant le mariage. C'est parce que vous recherchez votre plaisir qu'il y a des femmes qui gagnent leur vie en vendant leur corps.
Si l'auteur de cette pièce se fait l'avocat de l'idée de la femme moderne, il n'oublie pas non plus sur le plan général de remettre en question le statut de l'enfant dans la famille traditionnelle, en l'occurrence le hiêu (la piété filiale), voire d'inverser les valeurs. Cette attitude contestataire est mise en relief dans une réplique de Hiêu (dont le nom signifie piété filiale):
HIEU : On ne sait que reprocher à l'enfant d'avoir manqué à la piété filiale (bât hiêu), mais jamais aux parents qui ne remplissent pas leur rôle vis-à-vis de leurs enfants (bât tu). Ainsi les parents abusent de leur droit, ils considèrent leurs enfants comme des objets inertes, libre à eux de les placer où ils veulent: dans une bonne place, l'enfant en profitera, dans la boue, il est contraint de se salir.
Ce réveil de la jeunesse s'accompagne inéluctablement du conflit de générations qui se creuse: les vieux n'arrivent plus à comprendre les jeunes, et inversement, problème que l'auteur a souligné à travers les répliques de Hiêu. Cependant, on se doute bien que tous les auteurs ou dramaturges n'étaient pas unanimes sur la question de la liberté et sur les droits de la femme. Entre la position conservatrice et la celle des progressistes, il en émergeait d'autres moins radicales, comme celle de Vi Huyên Dac, reconnu comme dramaturge accompli. Cet auteur a commencé à écrire des pièces de théâtre dès les années 1920 et a continué jusqu'à la fin des années 1930. Il a produit en tout 19 pièces, dont certaines étaient écrites en langue française, d'autres ont été présentées au Théâtre municipal de Hà nôi telle que Hai tôi tân hôn (Les deux nuits de noces) 1. Cette pièce a été écrite en 1924 et portée pour la première fois à la scène en 1931 au Théâtre municipal de Hà nôi. La pièce écrite débute par une citation:
La virginité vaut mille talles d'or
A cause de qui as-tu été rabaissée ?
Ces deux vers en disent long sur l'attitude de l'auteur devant l'ancienne conception misogyne. Le premier acte s'ouvre sur la nuit nuptiale d'un jeune couple. La mariée, prise de remords car elle a eu une relation amoureuse et sexuelle avec un autre garçon avant le mariage, tente de se pendre. Le mari arrive à temps et la sauve du désespoir et de la honte. Elle lui confesse ainsi son histoire de jeunesse, et se résout à rester la servante pour que le mari puisse se marier avec une autre. Pour le mari, la surprise du début devient vite une déception en écoutant le récit de sa femme, et il essaie d'oublier le passé. Peu de temps après, Binh, le mari, part travailler dans une autre province. Pendant son absence sa femme reste auprès de la belle-mère pour la soigner et finit par gagner sa confiance. Au dernier acte, la femme rejoint le mari et ils passent une deuxième nuit de noces. Mais au dernier moment avant l'acte nuptial, la femme apprend à son époux que son premier amant était Phu, un ami du mari. Cette révélation n'arrive pourtant pas à gâcher leur deuxième nuit de noces. Le rideau tombe!
Cette pièce montre les limites des idées modernes exprimées par l'auteur à travers les personnages. Même si le mari finit par pardonner à sa femme d'avoir eu dans sa jeunesse une aventure qui lui déplaît, elle doit payer cette "erreur" par la honte et par une tentative de suicide au moment même de la nuit des noces. En outre, elle paye aussi par des années de soumission à l'égard de la belle-mère pour racheter son délit moral. Ainsi le "happy end" de la pièce de Vi Huyên Dac se mesure aux tortures morales que subit la femme. Une autre limite de cette pièce tient à la façon dont l'auteur pose la question du rôle de la femme. En effet, la question de la femme n'a pas été posée d'une façon globale mais d'une manière réductrice: un seul aspect a été abordé, la virginité. Cependant, cette restriction du débat a été revue et corrigée par l'auteur quelques années plus tard quand il publia une autre pièce qui abordait cette fois la question de la femme dans sa globalité. Cô dôc Minh (La directrice Minh), pièce parue en 1930, reprenait le même thème en situant le rôle de la femme au sein de la famille et de la société. Si à cet égard, Vi Huyên Dac posait les bonnes questions il n'apportait pas pour autant une réponse définitive; il semble qu'il ait été retenu par le poids du passé. Il voyait bien l'évolution des moeurs sans pour autant l'approuver entièrement. Comme l'autre pièce, Cô dôc Minh débute par une citation:
Sans accomplir les tâches d'une femme modèle
On ne pourrait devenir une mère digne.
La fiche technique de la pièce se présente ainsi:
* Minh : professeur 1, 26-27 ans
* Qùy : un directeur d'école, 30 ans, un collègue de
Minh;
* René Lan : lycéen, 21 ans;
* Viên : agent technique au Service des Travaux publics, 30 ans, le frère de Minh;
* Hanh : institutrice, 22 ans, une amie de Minh;
* Bao Ngoc : lycéenne, 16-17 ans;
* Kim Oanh : la fille de Viên (la nièce de Minh), 8-9 ans;
* Phu Hoài : le père de Viên et de Minh, 50 ans;
* La domestique.
A part le père, on s'aperçoit que les autres personnages représentent la jeune génération de formation moderne, en particulier les femmes, qui occupent une bonne part de la distribution. Elles incarnent les idées modernes, et les hommes, les idées conservatrices. La pièce met en évidence l'état d'esprit des femmes qui, confrontées à l'ancienne conception familiale, cherchent leur propre issue. Dès le premier acte, les discussions entre Minh et Hanh annoncent la position prise par la femme moderne. Ayant appris que sa belle-soeur voulait reprendre Kim Oanh (qui lui avait été confiée) pour des raisons culturelles (Une fille n'a pas besoin de faire beaucoup d'études), Minh échange ses idées avec son amie:
MINH: (...) J'aimerais l'envoyer (Kim Oanh) en France faire des études pour d'abord montrer nos idées à nous, les femmes, puis pour prouver aux hommes que les femmes ne sont pas des machines à produire des enfants.
HANH : On n'est pas des objets d'art, vendus au plus offrant, directeur, médecin, richard pour devenir un de leurs biens. (...)
MINH : Si on réfléchit bien, tous ceux ou celles qui sont un peu cultivé(e)s, qui respectent l'homme, doivent "froncer les sourcils", "serrer les dents", à cause du mari, à cause de la famille. (...) La morale convenait à l'époque de Confucius, mais au vingtième siècle, c'est l'époque de l'individu, celle des sciences. (...)HANH : Se conformer à la morale pour tout, ce serait se laisser asphyxier.
Ces répliques dénotent le tourment de la femme, et dans la suite de la pièce, les personnages féminins vont encore plus loin en disséquant les problèmes un à un. A propos de la virginité ou de la polygamie, Minh et Hanh les remettent en question:
MINH : Pourquoi la femme doit-elle garder sa virginité tandis que l'homme, sans état d'âme, s'amuse à tout casser (avant le mariage)? Pourquoi la femme veuve qui se remarie est-elle traitée d'immorale, alors qu'il est admis comme chose normale que l'homme veuf le fasse? Pourquoi la femme doit-elle rester fidèle à un seul mari tandis que l'homme peut avoir plusieurs femmes? D'où vient cette injustice?
Minh évoque également le droit de disposer de son corps et décide d'avoir un enfant sans se marier, en s'adressant à Hanh:
MINH : Je te demande: "Est-ce que ce corps nous appartient? S'il nous appartient, on est donc libre de faire ce qu'on veut, cela regarde-t-il quelqu'un ?"
Devant la détermination de Minh, son frère Viên essaie de la ramener dans le "droit chemin" de la morale traditionnelle:
VIEN : Tu te moques ainsi de la morale, des principes (confucéens)? Tu veux avoir un enfant sans te marier, tu sais comment on va te traiter?
MINH : Frère, si je ne veux pas me marier, c'est parce que je veux me libérer de la famille qui, à notre époque, n'est qu'une prison qui a sacrifié déjà combien de femmes? La famille est un piège, une structure oppressive, c'est l'esclavagisme.(...)
Oui je considère que ce corps est un trésor car il m'appartient, et à moi toute seule. Ainsi personne ne peut le vendre aux enchères, ni se l'approprier. (...)
VIEN : Aucun raisonnement ne peut valoir les moeurs et les coutumes d'un pays. (...) C'est parce que tu lis trop, tu ne sais plus distinguer le bon raisonnement du faux.
Enfin, Viên essaie en vain de convaincre sa soeur de se marier pour camoufler sa grossesse, car elle s'y refuse: ce serait laisser les autres croire qu'elle est une fille de mauvaises moeurs. Cette attitude anticonformiste isole Minh de son entourage, elle se résout ainsi à partir de son village pour aller à Saigon. En apprenant cette nouvelle, sa mère la rejoint pour l'accompagner. En tant que femme, la mère la comprend et partage plus ou moins sa souffrance. Cependant à la fin de la pièce, la mère se rallie à la position du frère qui préconise le mariage de Minh.
Pour cette pièce, l'auteur ne fait pas tomber le rideau sur un "happy end" comme pour la précédente, cependant on ignore la décision prise par Minh: est-elle résolue à partir ou consent-elle à se marier pour se conformer à la morale de la famille? On peut se douter que l'auteur approuve totalement la libération de la femme de l'emprise de la famille, car son attitude morale semble annoncée par la citation du lever de rideau: "Sans accomplir les tâches d'une femme modèle, on ne peut pas devenir une mère digne".
Quoi qu'il en soit, le fossé qui sépare la jeune génération de l'ancienne ne cesse de s'agrandir. Il arrive aussi que l'enfant éduqué à l'occidentale renie complètement son origine "indigène" pour se comporter comme un "civilisé" avec ses parents en leur parlant en français. Cette acculturation des Vietnamiens constitue le thème central de la pièce Ong Tây An nam (Le Franco-annamite) de Nam Xuong 1 , qui est une parodie d'un phénomène social. L'auteur a peu écrit, cependant il a laissé deux pièces qui ont retenu l'attention du public de cette époque: Chàng ngôc (L'idiot), et cette caricature des jeunes Vietnamiens qui poussaient leurs comportements d'Européens jusqu'au renoncement à leurs origines. Lân, le personnage principal, revient de France après avoir obtenu le titre de licencié. Il ne parle plus vietnamien (en réalité on découvre peu à peu qu'il n'a rien oublié), et a recours à un serviteur pour les traductions. En voyant son père, il l'embrasse à la française, et ignore Confucius que vénère encore celui-ci. Lân s'exprime donc à son retour en français:
LAN : Il est mon père, je ne le nie pas, mais d'un autre côté, je suis européen et je tiens à l'être, dis-le lui. (...)
Qu'il se taise, voyons! C'est à moi de parler d'abord.
Je ne peux supporter qu'on me considère comme un sale indigène, ni tolérer la compagnie des indigènes, ni appeler papa un homme qui sent l'indigène à vingt lieues à la ronde. (...) Qu'il cesse d'être annamite!
La mère de Lân est venue le chercher à la gare. Il l'a fait arrêter lui-même: il la prenait pour une voleuse. Quand il réalise que c'est sa mère, il lui dit:
Chère madame ma mère et commère... Pourquoi m'a-t-il (le père) fait connaître ce misérable pays annamite?
Devant cette attitude grotesque, les parents tentent une dernière fois leur chance dans l'espoir de le récupérer. Ils l'invitent à un repas en présence de Kim Ninh, une jeune fille de leur connaissance. Lân réagit violemment en disant qu'il ne peut supporter "ces cochonneries (les plats vietnamiens) qui pullulent de microbes, que tout ce qui a une odeur indigène le dégoûte". Mais finalement, il tombe sous le charme de Kim Ninh et lui parle en vietnamien tout en lui expliquant qu'il est devenu profondément européen. Il finit par demander pardon à ses parents afin de pouvoir se marier avec elle, mais Kim Ninh refuse, car elle n'admet pas des "Retours de France" qui se comportent de la sorte. Devant ce refus, Lân dit à son serviteur de faire ses valises pour le suivre en France. Il pense qu'il a échappé à une coutume insupportable qui consiste à se prosterner devant les beaux-parents le jour du mariage. Ce qui lui donne des idées pour envisager une thèse sur ce sujet, la prosternation, une fois de retour en France.
Au-delà de son côté rocambolesque et caricatural, cette pièce peut être considérée comme une étude de moeurs de la société vietnamienne dans une période de transition. Elle montre par ailleurs l'incompatibilité de deux conceptions, l'une ancienne et l'autre moderne. A travers le personnage de Lân, l'auteur souligne les aspects moraux et matériels de l'ancienne société, devenus insupportables pour les jeunes de formation occidentale: la morale confucéenne, la piété filiale, la prosternation, mais aussi le manque d'hygiène, la façon de s'habiller, de se coiffer. Cette remise en cause de la tradition séculaire est passée dans les faits dans les années 1930, après avoir été un sujet de débat littéraire. Les effets de la modernité se mesurent également, on le verra plus loin, à l'ampleur du mouvement de libération de la femme, et à tout ce qui s'ensuit.
De sa naissance à sa maturité, en l'espace de deux décennies, le théâtre vietnamien a suivi l'évolution générale de la société. Il forme avec la littérature et la poésie l'un des trois piliers sur lesquels repose la modernité culturelle qui allait agir sur le comportement et sur les moeurs des Vietnamiens. Sans appartenir à une culture d'élite, le théâtre touchait sans doute beaucoup moins les autres couches de la société que la littérature ou la poésie, car son public se recrutait parmi les citadins des grands centres urbains ayant acquis une formation moderne. Néanmoins, il peut servir d'indicateur de tendance dans cette période de transformation sociale.
Enfin, signalons que ce mode d'expression, introduit par Nguyên Van Vinh dans la vie littéraire et culturelle vietnamienne, a trouvé les successeurs qui lui ont donné une véritable place. Parmi ces derniers, le poète Thê Lu est sans doute celui qui a le plus contribué à cette entreprise dans les années qui précèdent la Deuxième Guerre. En effet, il a créé en 1935, avec la collaboration d'autres amateurs un groupe qui portait son nom (Nhom kich Thê Lu), et qui présentait essentiellement les pièces de Vi Huyên Dac 1. L'année suivante la troupe Tinh Hoa (Elite) vit le jour, et Thê Lu, soucieux de la formation des acteurs, devait assurer le rôle de metteur en scène. Il conseillait aux comédiens appelés à tenir un rôle d'observer avec minutie le personnage dans la vie réelle afin de pouvoir le transposer sur scène. Cette observation, une étape nécessaire de la formation théâtrale, devait s'appliquer également à l'élocution, à l'emploi du langage des personnages imités; il s'agissait bien de se mettre dans la peau du personnage 2. Avec Thê Lu, le théâtre est parvenu à sa pleine signification pour devenir un art véritable, en cassant la coquille première des "soirées à caractère humanitaire".
LE CINEMA
L'opinion appelle l'attention du public sur le préjudice causé en Indochine à l'industrie française du film par l'organisation actuelle de la censure et la concurrence américaine.
CEDAOM - Agence FOM
De toutes les activités culturelles, le cinéma reste de nos jours le domaine le moins connu de la société vietnamienne de l'Entre-Deux-Guerres. Bien que les historiens vietnamiens aient privilégié le champ politique, le champ culturel a tout de même été un sujet d'enquête, de la littérature à la peinture en passant par le théâtre. Cependant le cinéma demeure un terrain vierge.
On constate par ailleurs que, si les Vietnamiens ont été acteurs dans les autres domaines culturels (littérature, poésie, théâtre), ils se sont retrouvés cantonnés dans le rôle de spectateurs-consommateurs en ce qui concernait le cinéma. Il y a plusieurs raisons à cela. En premier lieu, la formation cinématographique ne pouvait se faire, à cette époque, qu'en Métropole. La plupart des Vietnamiens partis en France pour continuer leurs études étaient particulièrement attirés par le prestige et la richesse que procuraient les études médicales ou d'ingénieur d'une part, et d'autre part ils y étaient encouragés par leurs familles qui voyaient en ces études une promotion sociale vers un bel avenir. Les autres étudiants engagés dans la voie du patriotisme privilégiaient l'apprentissage politique aux dépens des études proprement dites. La deuxième raison est d'ordre matériel: la réalisation d'un film nécessitait de grands moyens techniques et un investissement financier qui dépassaient les capacités des hommes d'affaires vietnamiens dont le nombre se comptait sur les doigts de la main. Ces différentes raisons expliquaient naturellement l'absence de promoteurs, qu'ils fussent artistiques ou financiers. Par conséquent, le cinéma était un domaine entièrement contrôlé, de la réalisation à la diffusion, par les autorités coloniales.
Avant 1921, l'entrée des films et leur projection en Indochine n'étaient soumises à aucun contrôle local. Cependant les films destinés aux Colonies devaient passer par la censure ministérielle, l'importateur et le directeur d'établissement devaient obtenir le visa du ministère garantissant le droit de projection 1. Par la suite, l'arrêté du 23 mai 1921, signé par le gouverneur général Maurice Long, institua "dans un but de salubrité publique", deux commissions de censure, l'une à Hà nôi et l'autre à Saigon, et une commission d'appel formée de trois membres; le gouverneur général se réservant le droit de statuer en dernier ressort 2. Ces précautions devaient donner d'excellents résultats, mais sur le plan pratique elles ont créé des situations qui surprenaient pour le moins l'opinion. On parle d'un film qui avait obtenu l'autorisation d'exploitation dans le Nord, et un succès inattendu pendant tout un mois, et qui s'est vu refusé par la commission dans le Sud 3. Confrontés à ces deux sons de cloche, certains milieux coloniaux se sont indignés et ont déconseillé les autorités de se priver de cet "instrument admirable de propagande" pour la grandeur de la France. Les autres, plus prudents, déploraient que la censure fût venue trop tard. Il eût mieux valu, écrit le Courrier colonial du 16 décembre 1921, prendre ces précautions 15 ans plus tôt. Aujourd'hui le mal est fait 4. Cet article rendait au cinéma responsable de l'influence néfaste exercée sur "les Annamites qui avaient un moindre respect de l'Européen".
En effet, le Service photo-cinématographique qui a été créé "dans un but de propagande afin de mieux connaître les richesses ignorées et les beautés mal connues de la Colonie", fonctionnait à perte, à cause du coût élevé de sa mise en place et de l'insuffisance des recettes. Cette situation ne pouvait perdurer, ainsi ce service devait passer par une procédure de réforme. La commission permanente du Conseil de gouvernement approuva, le 15 avril 1924, qu'à partir du 1er janvier de cette année, un contrat de cinq ans soit passé entre le gouverneur général et la Société Indochine Films et Cinémas.
Aux termes de ce contrat, la société est chargée d'exécuter tous les travaux cinématographiques dont le gouvernement demandera ou acceptera la livraison. (...)
La société s'engage à assurer chaque année l'insertion des films d'actualité ou documentaires sur l'Indochine dans les journaux ou revues cinémato-graphiques (...) Elle s'engage également à projeter dans ses établissements des films exécutés en vertu de la convention et les films de propagande qui lui seront remis par le gouvernement général et à projeter dans les villes et les villages les films de propagande jugés utiles par l'Administration 1.
On ignore le volume et la proportion des films à caractère commercial projetés dans les salles pendant les années 1920, cependant entre 1919 et 1931, environ 400 films, dont le métrage allait d'une vingtaine de mètres à plus de seize cents mètres, ont été réalisés en Indochine 2. L'année 1931 compte à elle seule 136 films, la production la plus importante de cette période. Il s'agit d'une part de films vantant les bienfaits de la colonisation, tels que grands travaux, excursions, voyages officiels, et d'autre part de films à caractère culturel évoquant les fêtes, les métiers artisanaux, les cérémonies religieuses, etc. Cette deuxième catégorie de films est constituée, si on se fie à leur titre, de véritables documentaires portant non seulement sur les activités les plus diverses en Indochine, mais également sur des sujets à caractère ethnologique. A titre d'exemple, on trouve des courts métrages tels que :
* Journée d'un coolie-pousse;
* Les petits métiers tonkinois;
* Travaux d'art annamites. L'incrustation, la laque;
* La soie en Annam;
* La pêche au Tonkin;
* Les inondations au Tonkin;
* Combats de buffles à Dô son;
* Cortège bouddhique;
* La vie rurale;
* Fête au village de Xuân tao, province de Hà dông;
* Une cérémonie rituelle pour l'anniversaire de la mort d'un génie;
* La vie rurale chez les "Méo";
* Une cérémonie funéraire chez les Thai blancs.
Dans la première série de films de propagande on trouve les titres suivants:
* La puissance militaire de la France;
* L'Indochine à l'exposition coloniale de Marseille (1922);
* Les grands chantiers de l'Indochine;
* Arrivée de M. le Gouverneur Général Varenne à Saigon;
* Excursion en Baie d'Along;
* La foire d'Hanoi, 1924.
* Enseignement public en Cochinchine;
* Service de santé en Cochinchine;
* Ecole professionnelle de Hà dông;
( Annexe: liste des films, AOM - Sce Eco C19 c125.)
D'après les renseignements trouvés dans le Fonds Service économique des Archives d'Outre-Mer, la première réalisation cinématographique en Indochine remonte, au plus tard, à 1919 avec la production de 16 films. Cette faible production a été compensée par des films tournés en France à destination des Colonies. On peut trouver par exemple:
* Les fêtes de la victoire à Paris;
* La Côte d'Azur en hydravion;
* M. Maurice Long remet des décorations aux tirailleurs tonkinois à Saint-Cyr.
A quoi s'ajoutent des films sur les réalisations techniques ou sur des activités industrielles en France, et des documentaires sur la vie animale, en tout une trentaine de films.
D'une année à l'autre la production cinématographique coloniale était très variable, elle pouvait être très faible, environ cinq films, comme pour les années 1921, 1922, 1923 et 1930, ou encore satisfaisante avec plusieurs dizaines de films pour les années 1920, 1924, 1925, 1928, 1929, ou bien même monumentale comme pour l'année 1931. A l'exception de ceux tournés en 1931, la longueur moyenne de ces films était de l'ordre de 200 mètres, autrement dit il s'agissait bien de courts métrages d'une dizaine de minutes.
Les autres pays de l'Indochine n'ont pas été oubliés: la plupart des films sur le Laos ont été tournés en 1924 puis en 1929, au total une vingtaine, et sur le Cambodge d'une quarantaine de films ont été réalisés, pour la plupart en 1928.
On remarque par ailleurs que peu de renseignements sur les débuts du cinéma en Indochine jusqu'aux années 1920 nous sont parvenus. On ignore par exemple le nombre d'établissements, la fréquence et les lieux des projections. Quoi qu'il en soit, si le cinéma est parvenu à la campagne, il a dû toucher uniquement les villages limitrophes des centres urbains, compte tenu des moyens limités dont disposait le Service chargé de la diffusion. En 1941, vingt ans après l'introduction du cinéma en Indochine, d'après la lettre, datée du 23 juin, du Chef de la Section Photo, adressée au Directeur des Services économiques, la Section Photo n'avait dans son magasin que deux appareils de projection dont l'un "à faible source lumineuse", et l'autre "en très mauvais état" à la suite des prêts et de mauvaises conditions d'utilisation 1. A en croire Nguyên Vy, dans la période 1924-1925, seuls les grands centres urbains tels que Hà nôi, Huê et Saigon avaient des salles de projection 2. Cependant Les Annales coloniales mentionnent qu'il y avait en 1926, 29 établissements pour toute l'Indochine3. Il va sans dire que ces établissements s'implantaient en priorité dans les villes. Ainsi nous ignorons complètement la pénétration du cinéma dans la société vietnamienne pour cette période. Comme les films sonores ne datent que de 1927, et que les films parlants n'ont vu le jour que quelques années après, tous les films réalisés dans la période 1919-1931 en Indochine étaient des films muets. Ils représentaient au total 104.000 mètres de films, contre 4.000 mètres de films sonores réalisés par la suite, et dont la liste n'a pas été mentionnée dans les documents d'archives 4. En dernier lieu, il nous est impossible de connaître les réactions des spectateurs devant cette invention technique des frères Lumière, les effets des images animées sur les comportements des Vietnamiens. Seule, peut-être, une enquête auprès des octogénaires vivant au Vietnam à l'heure actuelle permettrait d'avoir une idée sur la question.
En matière de production locale, à l'exception de celle du gouvernement général ou assimilée, la presse coloniale s'est fait l'écho de deux films réalisés avec la participation des acteurs vietnamiens: une adaptation du roman en vers Kiêu de Nguyên Du, réalisée en 1924, et une comédie sous le titre de Tou fou veut se marier, portée à l'écran l'année suivante. Ceux qui auront le plaisir de voir ce film (Kiêu), écrit L'Avenir du Tonkin, seront surpris de l'originalité et de la perfection de cette première production qui, par de nombreux côtés, laisse loin derrière elle l'envahissement des films américains 1. Le Petit journal, quant à lui, rapporte deux ans plus tard:
Ce qui fait tout le charme de ce film, ce n'est pas seulement le merveilleux, naïf et très pur, qu'il exprime, c'est aussi le jeu des acteurs -jeu sobre, dénué de toute grandiloquence et simple comme le sujet lui-même. (...)
Certes, bien des détails dans le film sont de nature à déconcerter et à faire sourire des Occidentaux, mais quelle candeur, adoucissant et quelle fraîcheur 2.
D'après les souvenirs de l'écrivain Tô Hoài, connu vers la fin des années 1930 et actuellement membre de l'Association des écrivains (Hôi nhà van), souvenirs basés sur ce que Nguyên Công Hoan lui avait rapporté, les acteurs et actrices de ce film étaient des professionnel(le)s du théâtre classique (tuông) 1. Kiêu était donc un film muet qui a été projeté gratuitement, sans doute, un peu partout dans les environs de Hà nôi. Tô Hoài se souvient d'une séance qui a eu lieu sur la place du Dinh dans un village près de Hà nôi. La soirée avait un parfum de fête de village, car le succès a été total, grâce à la présence de tout le village. On retrouve l'ambiance des débuts du cinéma, où tout le monde parlait, faisait des commentaires pendant la projection.
Quant au deuxième film local, il a été chaleureusement accueilli par La Presse coloniale qui écrit:
On admettait difficilement jusqu'ici, que les artistes annamites puissent montrer, dans l'art compliqué du cinéma, le sens comique nécessaire pour assurer le succès d'une production de ce genre. L'expérience vient de montrer le contraire. Le principal protagoniste de ce film, Luong Huu Thât, vient d'y déployer un talent essentiellement original. Certaines scènes sont de véritables trouvailles de technique cinématographique, et ce film reflète, en entier, un sentiment artistique élevé. Voilà une production exclusivement locale 2 .
Quoi qu'il en soit il faut attendre les années 1930 pour avoir une idée plus précise sur le cinéma et sur les questions qui s'y rattachent. D'une part, cet art est parvenu à sa maturité avec l'insertion de la bande sonore et parlante, et d'autre part, la diffusion était sans doute plus fréquente dans les salles de projection situées dans les centres urbains. En 1933 La Dépêche coloniale a fait mention de l'existence d'une centaine de salles en Indochine 1. Ce chiffre nous semble un peu exagéré car en 1939, il y avait en tout 96 salles pour toute l'Indochine: 28 au Tonkin, 18 en Annam, 33 en Cochinchine, 9 au Cambodge, 6 au Laos et 2 pour le territoire de Kouang Tcheou 2. Cependant toutes les salles n'étaient pas équipées de matériels permettant la projection des films parlants; Hà nôi avait trois salles équipées de procédés techniques modernes à cette date 3.
Après recoupement de renseignements divers, il nous est permis de constater que la première salle de cinéma au Tonkin était le Tonkinois sis au 58 rue des Éventails à Hà nôi, ouverte au plus tard au premier trimestre de l'année 1920. Le 22 septembre de cette année la salle Palace, plus somptueuse et plus moderne, située dans la rue Paul Bert du quartier français (actuel rue Tràng tiên), a été inaugurée par la Société "Ciné-Théâtres d'Indochine" 4. Une dizaine d'années après, la salle Olympia, rue des Citadelles, a été ouverte le 15 décembre 1933 5. Cependant, pour une raison inconnue, on n'a aucune trace dans les Archives relatives au fonctionnement de ces salles, de l'ouverture jusqu'à l'année 1933 pour le Palace, à de rares exceptions près, et jusqu'à l'année 1935 pour le Tonkinois, et 1937 pour l'Olympia. En effet, on sait seulement que, d'une part, d'après le dossier concernant le Palace 6, Les Trois mousquetaires ont été projetés sur les écrans du 28 mars au 4 avril 1933, et d'autre part, le journal Trung Bac Tân Van (La nouvelle littérature du Centre et du Nord) signale dans ses numéros du mois de janvier, la projection d'un film sentimental en dix parties ayant pour titre La femme nue et de la comédie 600.000 F par mois en décembre 1927. On ignore dans l'une et dans l'autre source, la fréquentation des spectateurs de même que la proportion des spectateurs vietnamiens. Dans le même ordre d'idées, d'après une note postale du Commissaire central adressée à M. l'Administrateur-Maire de Hà nôi, des projections ont eu lieu dans la salle du Tonkinois, entre le 19 et 21 février 1935, auxquelles ont assisté quelques dizaines de spectateurs à chaque séance (23, 20 et 40 en soirée et 70 en matinée) 1. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas de projections dans la période 1920-1935. La presse coloniale et celle en langue vietnamienne de cette période faisaient de temps à autre des comptes rendus sur certains films. Il serait possible, après un dépouillement minutieux des journaux et revues indochinois, de rassembler du matériau relatif au cinéma afin de connaître les films passés à l'écran. Par exemple, les journaux ou revues tels que Tân thoi (L'Epoque moderne), Dàn bà moi (La femme moderne), Kich bong (Théâtre-Cinéma) etc. tenaient régulièrement une rubrique "cinéma" dans leurs colonnes. Mais ce travail demanderait un investissement considérable en temps, qui dépasse nos limites.
Quoi qu'il en soit à partir de 1937, les Archives de la Mairie de Hà nôi fournissent la liste complète des films projetés sur les écrans de la capitale, salle par salle, et semaine par semaine. A partir de cette date on est sûr également que chaque province du Nord avait au moins un cinéma dans son chef-lieu, ce qui fait au total une bonne vingtaine de salles. En 1939, il y avait 28 salles au Tonkin dont 7 à Hà nôi, 5 à Hai phong, et 2 à Nam dinh. Les régions les plus éloignées comme Cao bang, Tuyên quang, Lang son avaient aussi leur cinéma. La plupart de ces salles appartenaient à la Société française "Indochine Films et Cinémas", le restant était partagé entre la Société française "Cinéma-Théâtre d'Indochine", et des particuliers, dont les Chinois, qui possédaient deux salles.
Nombre de salles de cinéma à Hà nôi
1. Le Tonkinois devenu le Moderne à partir de 1937;
2. Le Palace, rue Paul Bert (actuel Tràng tiên);
3. L'Olympia, rue de la Citadelle;
4. L'Eden;
5. Le Majestic, Boulevard Dông Khanh;
6. Le Philharmonique, rue de la Philharmonique;
7. Le Trung quôc (La Chine), appartenant aux Chinois;
rue de Éventails.
Cependant seules Hà nôi, Hai phong et Nam dinh avaient des salles équipées de matériels modernes permettant de projeter des films parlants 1. A Hà nôi et à Hai phong, les films étaient changés chaque semaine, tandis qu'à Nam dinh on les changeait deux fois par semaine. Chacune des sociétés exploitantes projetait une bonne quarantaine de films par an. Il s'agit bien entendu cette fois des films commerciaux, mais à chaque séance un court métrage "Actualités" était inséré au début du film. Ces bandes "informatives" avaient pour but de montrer l'influence de la France dans le monde et en Indochine en particulier. Mais parfois, ces "Actualités" provoquaient des effets inattendus qui ont décidé les autorités à les supprimer. Dans une lettre "confidentielle" datée du 11 février 1938, le Résident supérieur du Tonkin, Yves Châtel, informa le Gouverneur général de sa décision:
Mon attention vient d'être attirée sur divers incidents qui se sont produits récemment dans une salle de spectacle cinématographique à l'occasion de la projection de films "d'actualités" à caractère politique.
En raison de ces inconvénients que présente, pour l'éducation des populations du Protectorat, la présentation d'actualités de ce genre, j'ai prié les directeurs d'entreprises cinématographiques du Tonkin de s'abstenir de les projeter dans leurs salles en raison des manifestations qu'ils peuvent provoquer de la part du public 1.
Dans la même année, la commission de censure a refusé le visa de projection d'un autre film, de production soviétique portant le titre de Dawns of Paris, importé par le cinéma Trung quôc, qui raconte certaines épisodes de La Commune de Paris. Ce long métrage a été visionné par la commission dont faisait partie comme membre suppléant le juriste Nguyên Manh Tuong. Le président de la Commission dressa ainsi les observations faites à l'unanimité:
Le film est entièrement parlant russe. (...)
Les images qui se succèdent pendant deux heures de projection montrent successivement les principaux acteurs de la Commune de Paris et du gouvernement de Versailles (en particulier M. Thiers, les généraux Dambrowsky, Cluseret, M. Clémenceau).
Le film fait évidemment l'apologie de la Commune, met en évidence l'esprit d'abnégation et le courage du peuple de Paris par opposition aux hommes de Versailles. (...) Cependant les scènes de guerre civile, les luttes à armes blanches, les constructions de barricades, et la défense de celles-si, font comprendre aux spectateurs qu'il s'agit d'une véritable révolution commandée par les éléments ouvriers et qui s'effectue à l'encontre des éléments bourgeois.
A ce titre la commission estime que la projection de ce film peut être l'occasion pour certains éléments indigènes turbulents, en particulier, pour le parti communiste, de manifester ouvertement sa sympathie pour les défenseurs de Paris. (...)
En conséquence, et vu sous cet angle, la commission estime que la projection de ce film est indésirable en Indochine et que le refus de visa doit être opposé 1.
Cet avis est en suite remonté au Résident supérieur qui informa le Gouverneur général de son interdiction dans une lettre en date du 6 juin 1938 2. Parfois l'interdiction de projection provenait directement du ministère des colonies comme pour le film Tempête sur l'Asie, une production française de "la maison" SEFERT. Il y aurait un certain danger, écrit le directeur des Affaires politiques du ministère dans une lettre du 5 mai de la même année, adressée au gouverneur général de l'Indochine, à ce que ce film où l'on voit des indigènes torturés par les Blancs et se révolter contre eux, fût représenté dans nos pays de protectorat ou dans nos colonies. (...) Je vous prie, en conséquence, d'interdire la projection de ce film sur le territoire que vous administrez 1. Cependant les autorités pouvaient intervenir dans le sens inverse si elles jugeaient que certains films étaient bons "pour le moral des troupes" comme elles l'ont fait à propos de Soeurs d'armes, Sommes-nous défendus, La revue du 14 juillet 1939 et Le voyage du Président Daladier en Corse en En Afrique du Nord, les quatre films de propagande recommandés par le Résident supérieur en 1939. Dans un sens ou dans un autre ces démarches relèvent de la même logique qui est parfaitement cohérente avec l'esprit de la colonisation, l'esprit de ceux qui règnent sans partage. Le public devait donc se contenter des films commerciaux qui ne présentaient pas de danger pour le pouvoir.
Les salles des grandes villes (Hà nôi, Hai phong et Nam dinh) étaient ouvertes tous les soirs, et en matinée les jeudis et dimanches. Le prix des places variait de 5 xu (le xu était le centième de la piastre) pour les places "debout" derrière l'écran, à deux hào (le hào était le dixième de la piastre) suivant les établissements 2; au Palace, la place était plus chère qu'ailleurs car la salle était plus moderne et plus luxueuse. Quelles ont été les fréquentations de ces salles?
En province le public ne dépasse pas soixante personnes par séance, tandis qu'à Hà nôi et à Hai phong, au jour de changement de programme, l'affluence peut atteindre, suivant les établissements, entre 300 et 400 personnes avant de diminuer graduellement au cours de la semaine pour se stabiliser à quelques dizaines de spectateurs le dernier jour 3. Ces salles de cinéma sont fréquentées pour les deux tiers environ par des Français, un tiers par des indigènes appartenant à la classe bourgeoise (secrétaires, employés, commerçants et surtout jeunes scolaires et étudiants) 1. La faveur du public "indigène" va aux films d'action, aux films de guerre, aux documentaires et aux comédies dont celles de Charlot. La plupart des films qui passaient à cette époque ne sont plus connus de nos jours, cependant un examen rapide permet de les classifier d'après leur titre en plusieurs genres: des films à caractère historique, des films de voyage montrant la vie ou les paysages lointains en Europe ou ailleurs, des comédies de moeurs, des films policiers, etc. Dans cet ordre nous avons par exemple:
FILMS A CARACTERE HISTORIQUE. COMEDIES.
* Au service du tsar; * Jeunes filles à marier;
* César; * L'île des veuves;
* L'affaire du Courrier de Lyon; * La vie parisienne;
* Une aventure de Buffalo Bill; * Les femmes collantes;
* Le docteur Cornélius; * J'aime toutes les femmes;
* Guillaume Tell; * Tarzan s'évade;
* La Dame de pique; * Folies bergères;
VOYAGES. * Une nuit de noces;
* La Perse ; * Les amants terribles;
* Jérusalem ville sainte; * Un mauvais garçon;
* Bornéo; * La femme du boulanger;
* Malacca; * Topaze;
* 25.000 km au-dessus de l'Asie; * Plaisirs de Paris;
* Visages de France; * Le coeur de Paris;
* Images de Paris; * Les temps modernes;
* Montmartre; * Charlot cambrioleur;
* Ménilmontant; * Charlot travaille;
* Cap au sud;
FILMS POLICIERS
* Le corbeau;
* Arsène Lupin;
* Double crime sur la ligne Maginot;
* L'agent n° 13.
Au total, plus de 500 films commerciaux sont passés sur les écrans de Hà nôi dans la période 1937-1938, soit une moyenne de 250 films par an. (Voir la liste complète des films en annexe). Les comédies occupent sans conteste la place prépondérante avec les trois quart des films voire davantage. Quoi qu'il en soit, cette période peut être considérée comme l'âge d'or du cinéma au Vietnam depuis son introduction jusqu'à nos jours. Cependant, cette distraction était l'apanage des couches sociales les plus aisées. Le prix des places, qui paraît modique était inabordable pour la majorité des gens qui gagnaient leur vie à la sueur de leur front. Quand on sait que le salaire journalier correspondant à une dizaine d'heures de travail pour un manoeuvre dans les mines était de l'ordre de 3 hào (la femme gagnait moins que l'homme, et l'enfant encore moins que la femme), que celui d'un ouvrier agricole ne dépassait pas 2 hào, et que 1 kilo de viande de porc valait 2 à 3 hào, 1 kilo de riz, 5 à 6 xu 1, le cinéma était alors un luxe pour les masses laborieuses car une place de cinéma correspondait à une journée de travail. Il est fort possible que la moyenne des paysans n'ait jamais mis les pieds dans une salle de cinéma ou même n'ait jamais vu un film. Car avec l'implantation des salles payantes dans les villes, le cinéma ambulant, qui certes n'avait existé qu'à une échelle restreinte, disparaissait du paysage villageois. Encore une fois on constate que les entreprises de modernisation culturelle ou artistique n'arrivaient pas à franchir les frontières de la ville. De plus, le cinéma est une distraction individuelle, contrairement à la presse ou à la littérature qui peuvent se passer de main en main; ce qui vient limiter son influence. Néanmoins on peut se demander si les images qui traduisaient les comportements ou les attitudes occidentaux quant à l'amour, par exemple, n'ont pas produit des effets sur le public. Il est fort probable que les images véhiculées par le cinéma aient précipité le changement dans le domaine des moeurs, contribué à la valorisation du rôle et de la place de la femme en famille et dans la société. "Tout ce qu'ils (les Vietnamiens) retiennent de ces scènes sentimentales, écrit la Chronique coloniale, c'est la place de plus en plus importante que prend la femme dans notre société. (...) La jeunesse pourtant, ne reste pas insensible au spectacle sans cesse renouvelé de notre vie intime. Les plus "avancés" commencent, bien timidement, il est vrai, à nous imiter... Si dans leur for intérieur, les sentiments qu'ils éprouvent restent spécifiquement asiatiques, l'extériorisation de ces sentiments revêt une forme européenne à laquelle notre cinéma n'est pas étranger 1 ". A cet égard les comédies de moeurs ont, selon toute vraisemblance, redonné une place à l'amour mais également incité à la recherche du plaisir. Nguyên Vy se rappelle encore que dans les années 1924-1925 les jeunes qui fumaient aimaient à acheter la marque Mélia non pas pour son goût mais pour le paquet sur lequel figurait un couple d'Européens qui s'embrassaient; et sous cette photo on pouvait lire ceci:
"Bonne année , parfait amour,
A toi seul, à toi pour toujours 1.
La floraison des maisons de "chanteuses" dans cette période n'est sans doute pas sans rapport avec cette libération du tabou refoulé par une société qui ne lui accordait aucune place réelle et légitime. D'un autre côté, le cinéma comme apport de l'Occident a reçu un accueil favorable de la part de la société vietnamienne. Ceux qui n'allaient pas au cinéma, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens et non pas parce qu'ils s'y opposaient. Même si le cinéma était parfois utilisé comme instrument de propagande, les incidents qui se produisaient traduisaient plutôt une réaction contre les autorités coloniales que contre le cinéma en tant que distraction ou art en soi. Enfin, l'apport du cinéma se situe sans doute aussi dans les images filmées des régions lointaines inaccessibles autrement. Cette ouverture serait alors un appel d'air pour une société trop longtemps repliée sur soi-même.
LES DESSINS HUMORISTIQUES ET SATIRIQUES
Les dessins humoristiques et satiriques, cette forme d'expression à mi-chemin entre l'art et la littérature, a vu le jour avec la parution du journal Phong hoa en 1932, dirigé par Nhât Linh, le personnage clef du groupe Tu Luc Van Doàn fondé par la suite. Nhât Linh, qui était aussi un ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts à Hà nôi, sans avoir terminé le cursus, a néanmoins contribué concrètement, par ses dessins sous la signature de Dông Son, à populariser ce mode d'expression inexistant jusqu'alors. Si son passage en France lui a permis d'obtenir une licence de sciences, il lui a aussi permis d'observer la vie culturelle et sociale de la France. Le passage par la France était pour lui une occasion d'assimiler le progrès afin de faire "quelque chose" une fois de retour au pays. A sa place, beaucoup d'autres auraient préféré rentrer dans le mandarinat, devenir collaborateurs du régime colonial pour bénéficier des avantages personnels, profiter de la pauvreté et de l'ignorance du peuple pour s'enrichir sur son dos, pour l'opprimer, pour en abuser. Nhât Linh a choisi un autre chemin, le chemin du journalisme pour défendre une société rendue malade par toutes sortes de fléaux. C'est sans doute lui qui a eu l'idée d'introduire les dessins satiriques dans les pages du journal. On disait qu'il avait emprunté cette nouveauté au Canard enchaîné lors de son séjour en France. Quoi qu'il en soit, un dessin bien fait vaut parfois mieux que des pages d'écriture.
Les dessins de cette époque parus dans Phong hoa, Ngày nay et d'autres journaux qui se sont mis à l'heure de la caricature visaient la société d'injustice, les exactions, des fléaux qui rongeaient physiquement et moralement une bonne part de la population. A cet égard, "les petites gens" étaient victimes davantage de l'appareil mandarinal et des notables de village, que du régime colonial qui servait de paravent aux autorités locales. Certes, le régime colonial n'a pas cherché à neutraliser les conflits inter-vietnamiens ou les abus de pouvoir, mais était-ce son rôle ? En revanche, ces divisions, ces déchirements lui permettaient de mieux "gouverner" le peuple. Le journal Dàn bà moi, certes avec un bon sentiment, a demandé naïvement aux autorités coloniales d'intervenir pour faire cesser les abus de pouvoir commis par les notables de village à l'encontre de leurs "gouvernés" 1. D'après nombre d'observateurs, ce fléau était le plus redoutable de tous les fléaux, car il n'y avait pas de remède d'une part, et d'autre part, du jour au lendemain, pour un oui ou pour un non, un paysan pouvait se retrouver sans terre et devenir esclave pour toujours, ou mendiant à jamais, ou encore c'est petit à petit qu'on le privait de tous ses moyens d'existence. Les paysans sans terre rendus misérables par toutes sortes d'exactions, et les "petites gens" vivant dans les villes, sans recours, sont devenus les dindons vietnamiens de la farce coloniale. A la campagne, plus qu'en ville, la société vietnamienne était l'incarnation d'une tyrannie et une violence sans bornes. Ces situations inhumaines dénoncées à la fois par les journalistes et les écrivains se perpétuaient grâce à l'obscurantisme que les notables et les propriétaires terriens, les deux facettes de la tyrannie qui s'appuyaient les uns sur le pouvoir, les autres sur l'argent, sous couvert de la colonisation, utilisaient comme arme pour faire taire voire éliminer "la voix du silence". Il suffit de lire les reportages de Ngô Tât Tô 2, les écrits de Nguyên Công Hoan, de Vu Trong Phung et certains articles de presse, pour se rendre compte à quel point les paysans pauvres étaient victimes de leurs concitoyens tyrans. A cet égard les dessins satiriques, si modeste que fût leur rôle, contribuaient à démasquer les figures de la tyrannie. Nous verrons donc dans la première série de dessins des caricatures politiques où figurent les trois principaux acteurs d'une société croulant sous son propre poids, le colonialisme, le mandarinat et le petit peuple.
LES CARICATURES POLITIQUES
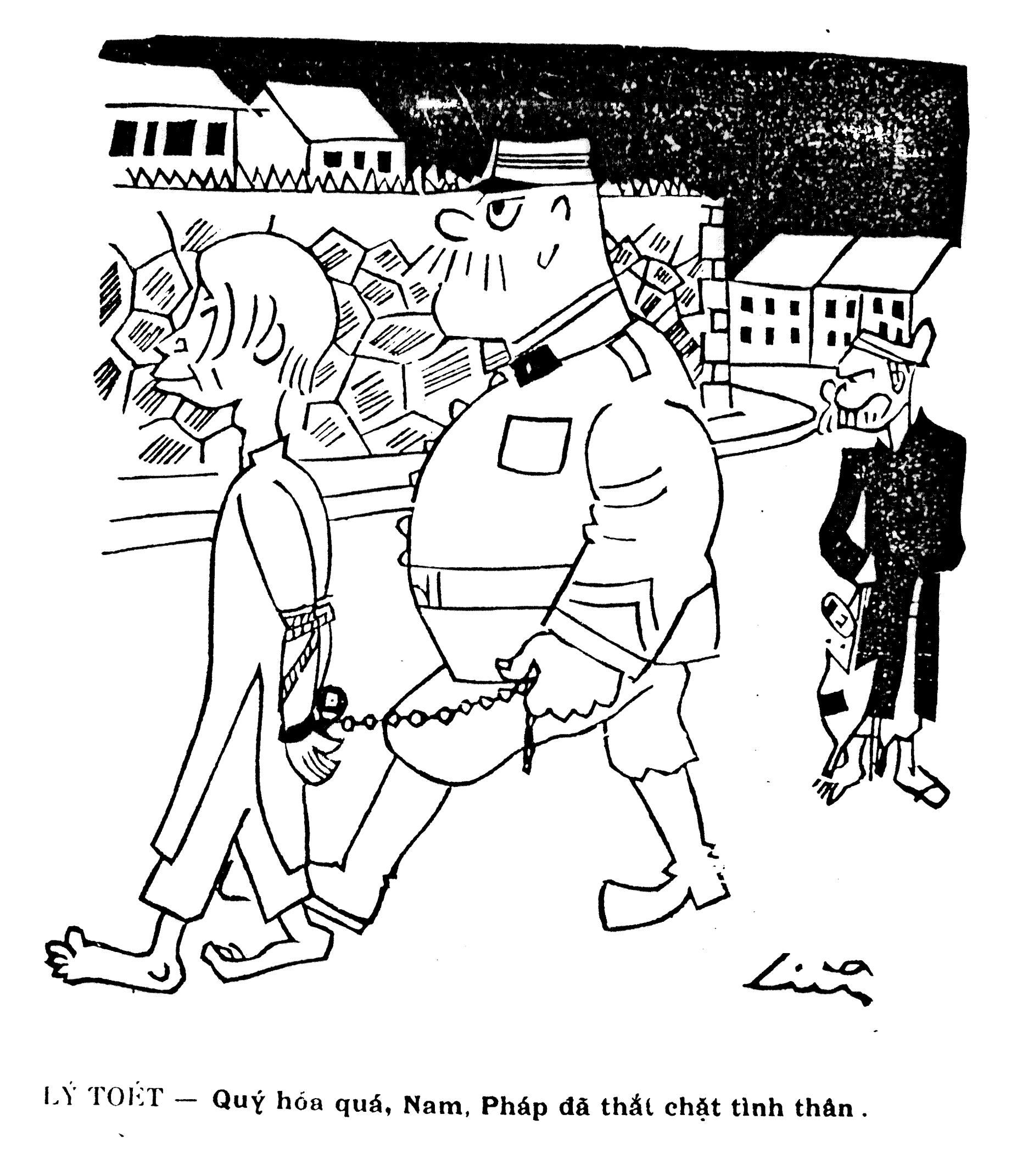
Ngày
nay, n°80, 10/10/1937
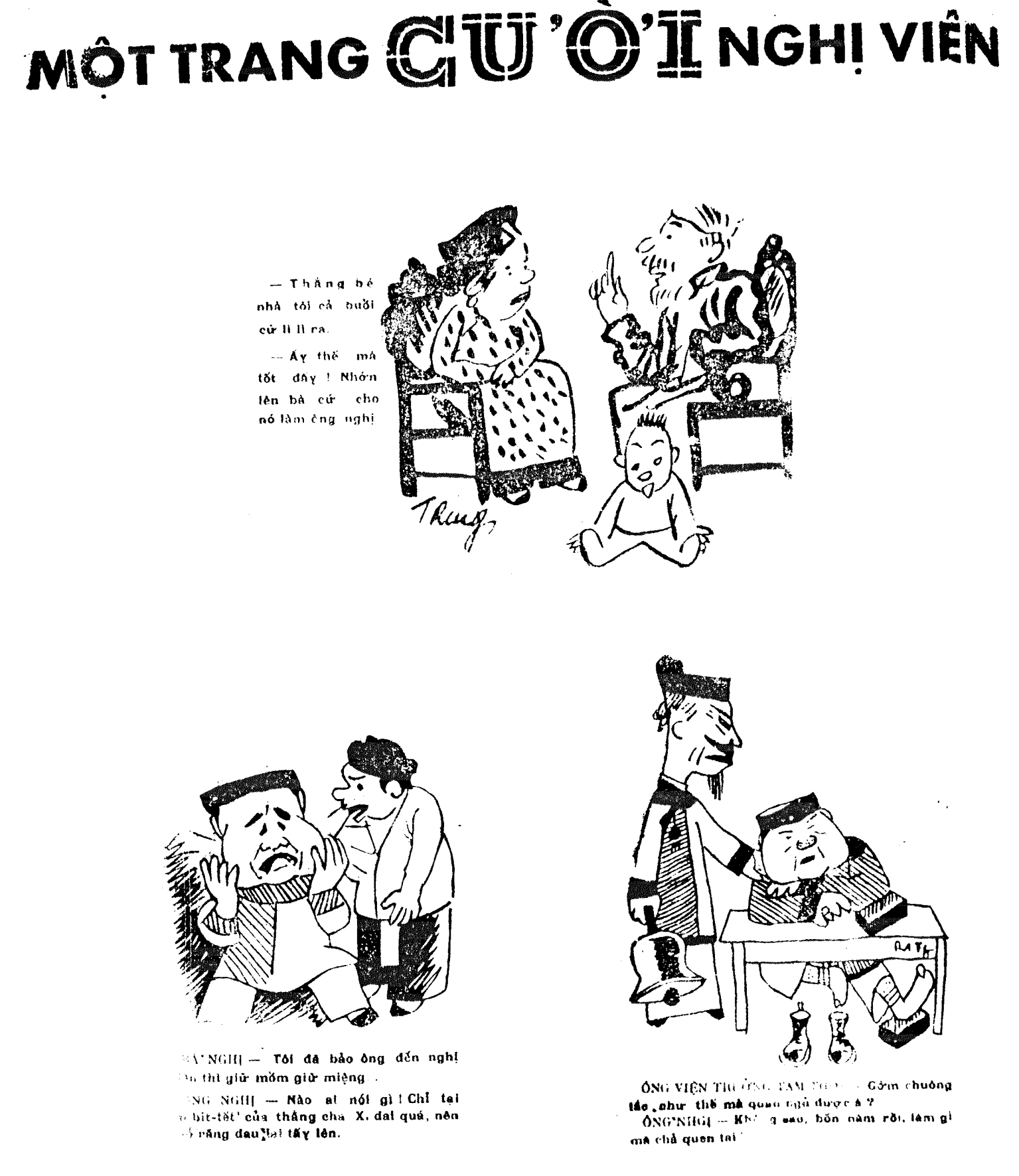
Ngày
nay, n°85, 14/11/1937
Ces dessins ont pour titre: "Une page de RIRE à propos des représentants du peuple", dessins et paroles de RITG. En réalité la page comporte encore cinq autres dessins mais nous avons sélectionné ceux qui nous semblent les plus parlants.
Le dessin du haut présente une conversation entre la mère de l'enfant (assis par terre, et qui a l'air pas très éveillé, pour ne pas dire gâteux), avec un ami et voisin. Ils représentent la vieille génération par leur tenue vestimentaire et leur coiffure, quoique l'homme ait déjà les cheveux courts tandis que la femme garde encore la coiffure traditionnelle. Elle dit:
- Mon petit garçon reste inactif toute la journée.
Alors l'homme lui répond:
- C'est un bon signe! Plus tard tu feras de lui un représentant du peuple.
En fait le terme "représentant du peuple" (nghi viên ou dans le langage courant Ong Nghi, - M. Nghi-), est un abus de langage qui traduit sans doute le penchant des Vietnamiens pour les titres. En réalité ce terme désigne les "représentants" vietnamiens de la Chambre des représentants du peuple, un "machin", aurait dit Le Canard enchaîné reprenant l'expression du général De Gaulle, qui n'a aucun pouvoir réel dans l'appareil administratif colonial car il s'agit d'une assemblée consultative, en aucun cas représentative des colonisés. Cependant, pour beaucoup de Vietnamiens, Ong Nghi est assimilé à un grand mandarin, car il s'attribue un pouvoir sans bornes à l'égard de la population, qui se méfie de lui. L'écrivain Vu Trong Phung est célèbre, entre autres, grâce à un de ses personnages, Nghi hach, du roman Giông tô (La tempête), qui caricature ces "représentants du peuple".
Le dessin en bas à gauche montre Monsieur et Madame "Représentant du peuple". Ong Nghi s'habille à la manière traditionnelle avec son turban sur la tête. Il vient de rentrer d'une réunion. Voyant que ses joues sont enflées, sa femme croit qu'il a trop parlé en réunion, ce qui lui a valu des gifles. Elle dit:
- Je vous ai dit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en réunion (avec les autres collègues)...
Elle a tout faux, car le mari lui répond:
- Mais je n'ai rien dit! C'est à cause du beefsteak de cet animal de X qui est trop caoutchouteux, alors mes abcès dentaires s'aggravent.
Effectivement le rôle des "représentants du peuple" ne consiste pas à parler au nom du peuple, mais plutôt à faire de la figuration.
Sur le dernier dessin (en bas à droite), on voit Ong Nghi dans son bureau de travail. Le président par intérim (de la Chambre consultative) l'appelle en sonnant la cloche, mais il continue à dormir à son aise. Surpris, le président lui demande:
- Comment vous pouviez-dormir avec tous ces sons de cloche?
Ong Nghi lui répond:
Ca ne me dérange pas, ça fait déjà quatre ans que j'entends (ces bruits), j'ai l'habitude.
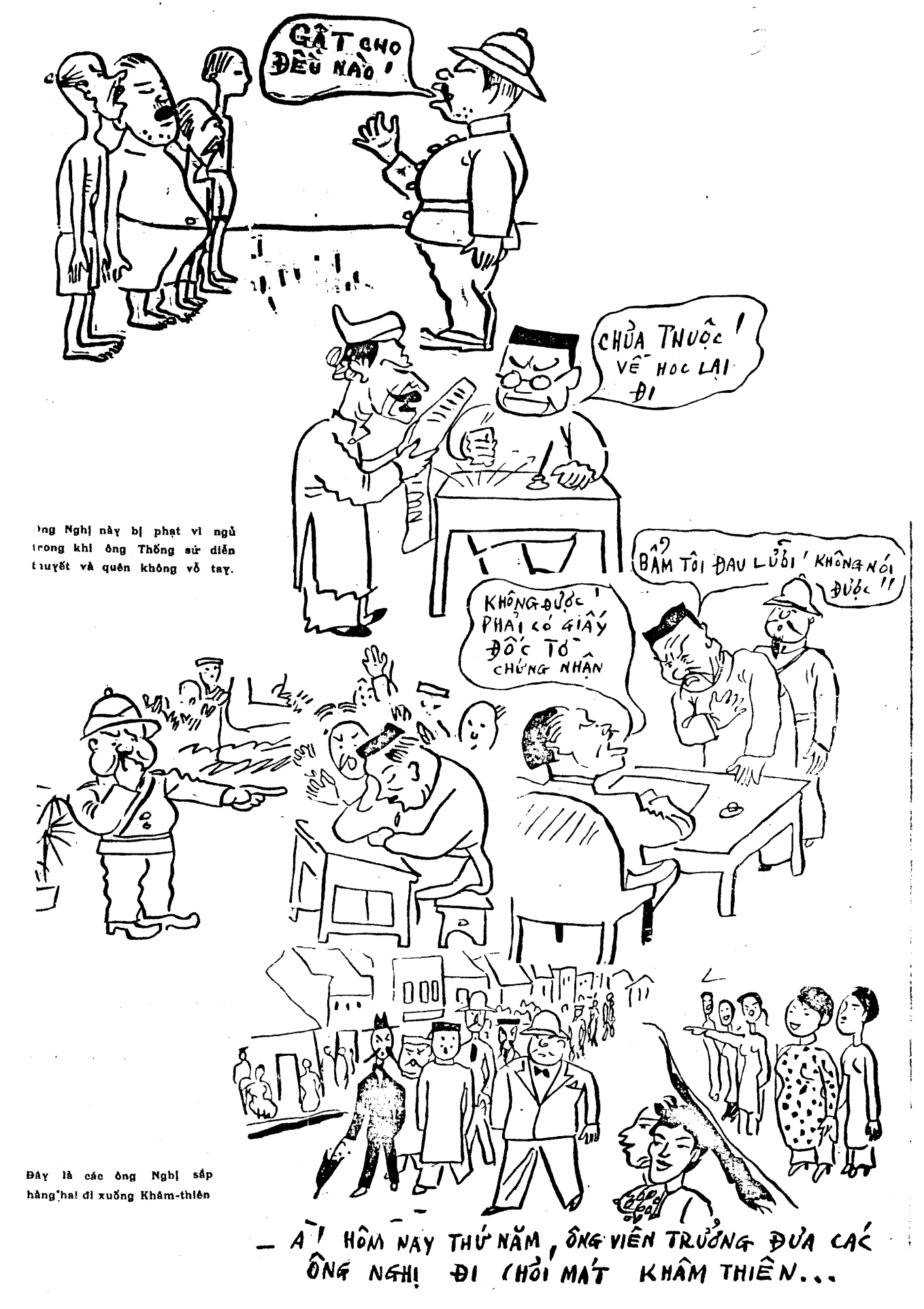
Ngày
nay n°118, 10/07/1938
Sur le deuxième dessin, on voit un élève-Ong Nghi en train de réciter difficilement sa leçon à son examinateur. Il est habillé de la tête aux pieds à la manière traditionnelle, turban, robe longue, et chaussures de fabrication locale. Néanmoins il s'est déjà mis à l'heure de la modernité avec ses cheveux courts. L'examinateur est mécontent et furieux car son élève ne sait pas bien sa leçon, alors il l'envoie la réapprendre en donnant un coup de poing sur la table pour exprimer son autorité.
Le troisième dessin (côté gauche) représente une salle en fin de réunion. L'agent chargé de la sécurité, le sifflet à la bouche, sans doute un Vietnamien si l'on en juge par sa petite taille, mais qui a toutes les apparences d'un Occidental, incarnant l'autorité, surprend un Ong Nghi au premier rang, en train de roupiller. Il y a de quoi, car comment pouvait-il suivre un discours politique ? La légende dit qu'"il sera puni pour avoir dormi pendant le discours du Résident supérieur et ne l'avoir pas applaudi à la fin". On l'amène donc devant les autorités, quatrième dessin, à droite. Ong Nghi dit qu'il "a mal à la langue et qu'il ne peut pas parler". L'homme derrière le bureau, dans son fauteuil, un Vietnamien qui représente les autorités, l'envoie promener d'un air fier et autoritaire:
- Il faut pour cela une attestation médicale!
Le mandarin fautif est obligé d'inventer un prétexte (un mal de langue), allusion à rôle qui consiste à se taire devant les autorités.
Le dernier dessin, en bas de la page, montre une sortie des Ong Nghi accompagnés par le président (de la chambre consultative), personnage habillé à l'occidentale, avec casque colonial, noeud papillon et costume deux-pièces. Ils sont à Khâm thiên, le quartier des "chanteuses" (cô dâu). Celles-ci attendaient des clients. On remarque qu'elles s'habillent à la mode de cette époque avec la longue tunique (ao dài), -popularisée par le dessinateur Cat Tuong, alias Lemur, des journaux Phong hoa et Ngày nay -, et des chaussures à talons. L'une d'elles les interpelle en les montrant du doigt. La légende écrite en caractères gras en bas de la page dit: "Ah, c'est jeudi, le jour où le président promène les Ong Nghi à Khâm thiên pour les distraire." A cette époque, il y avait plusieurs quartiers de "chanteuses" à Hà nôi, mais Khâm thiên était le lieu favori des milieux aisés (mandarins, commerçants, employés, étudiants ...).
Les "maisons de chanteuses" 1 étaient une véritable institution d'exploitation de la femme qui contraignait les jeunes filles à rester avec leur patronne afin de procurer de la distraction et du plaisir aux clients. Dans ce commerce du plaisir, comme dans tous les autres commerces, plus on est riche mieux on est reçu. Ainsi les mandarins ne pouvaient qu'être satisfaits de l'accueil. En recoupant les différentes sources (journaux, littérature), on constate que le fait d'être mandarin à cette époque et la fréquentation des ces lieux étaient comme les deux faces de la même pièce de monnaie.
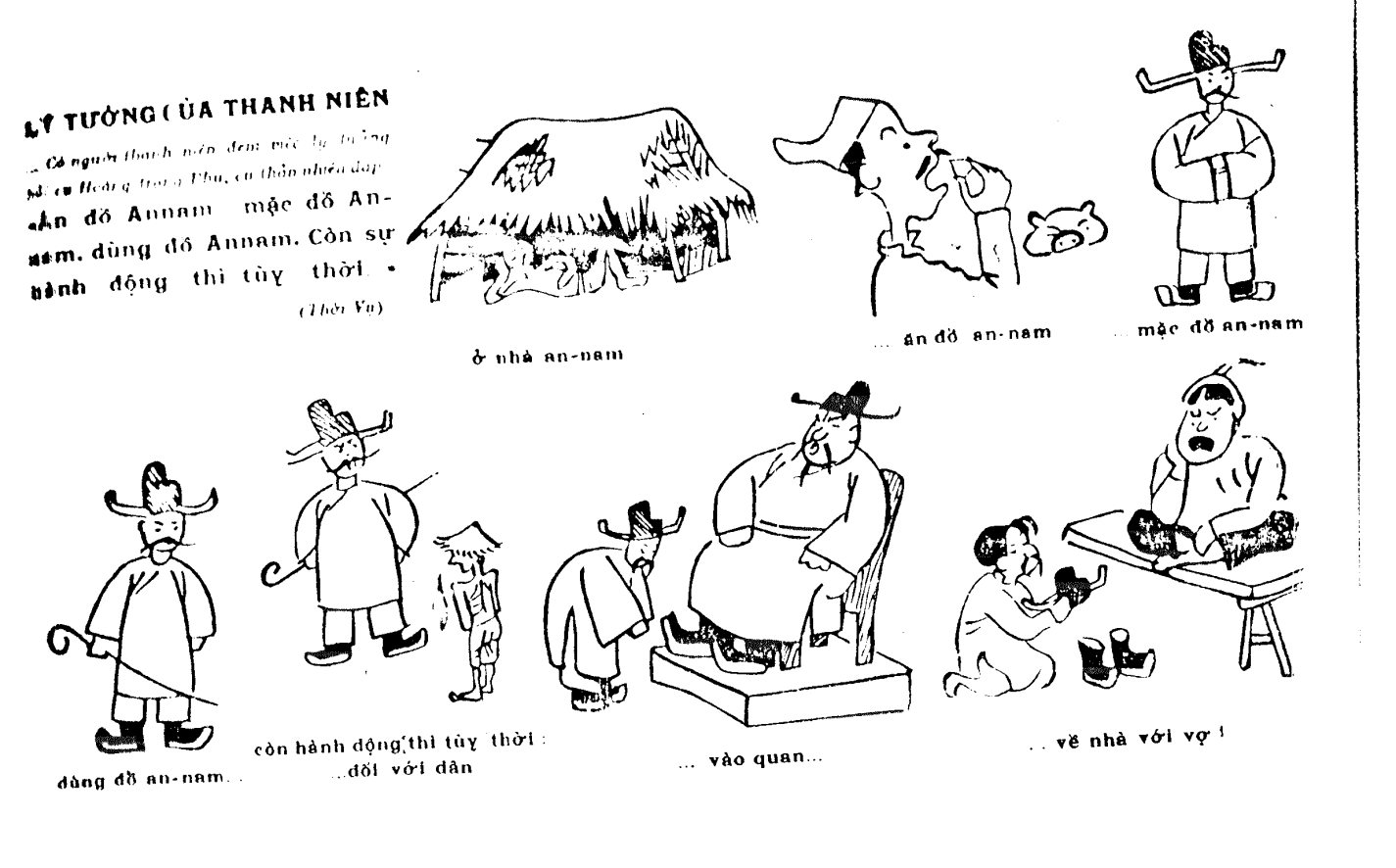
Ngày
nay n°102, 20/03/1938
La vertu principale de l'Annamite n'est pas la propreté. (...) Un annamite pur sang, point frotté à nos moeurs européennes, se croirait déshonoré s'il n'avait pas devant sa porte une petite mare sentant les oeufs pourris, et derrière sa case, quelques dépôts, comment dirais-je ? Mettons: guano.
Que faire? direz-vous; le temps, avec nos moeurs policées, aura raison de cette coutume; on ne peut changer cela du jour au lendemain. Je vous demande pardon. Avec ce système, le choléra tuera une génération d'Européens, et les indigènes ne seront pas corrigés.
Moi, j'ai une idée, une simple idée. Je connais un moyen facile, économique, de guérir radicalement les nhaques de cette mauvaise habitude. Savez-vous ce qu'on fait aux chats qui sont malpropres ? On leur fourre le nez dans leur saleté, et ils ne recommencent plus. Si l'on agissait de même avec les indigènes ? Si chacun était autorisé par un édit public, à fourrer le nez de l'Annamite dans sa m.... archandise ? Qu'en pensez-vous ? 1"
L'oeuvre de la France en Indochine se mesure t-elle à la valeur de cette proposition civilisatrice ?
Le deuxième dessin montre un Vietnamien en train de manger; la tête de cochon symbolise les querelles de pouvoir intestines des notables dans les villages. Ce qui veut dire aussi que manger pour les Vietnamiens est au centre de toutes les activités communautaires. Les troisième et quatrième dessins montrent comment un mandarin vietnamien s'habille: chapeau aux longues "oreilles" (mu canh chuôn), robe longue aux manches très larges, sabots en bois dont la pointe est recourbée, il tient à la main (quatrième dessin) un bâton, symbole de l'autorité. Le cinquième dessin représente le mandarin devant un paysan vêtu de loques avec un chapeau conique déchiré. Face au mandarin, le paysan devient insignifiant, cet aspect est matérialisé par sa petite taille par rapport à celle du mandarin. "Le parent du peuple" 1 se montre dans une attitude autoritaire voire méprisante: première cas de figure. Mais quand il se retrouve devant le grand mandarin, reconnaissable à sa taille bien supérieure, et assis dans son fauteuil surélevé par une estrade, sixième dessin, il devient tout petit et fait des courbettes en signe de soumission: deuxième cas de figure. Le grand mandarin n'a pas l'air content, il est sans doute en train de lui faire la morale. Mais quand le petit mandarin rentre chez lui, il enlève le chapeau prestigieux et se met à genoux devant sa femme pour écouter ses reproches et ses mécontentements: troisième cas de figure. Elle est en position dominante, car assise sur un lit de camp, elle se retrouve plus haut que le mari dont les moustaches retombent vers le bas, signe révélateur, pour les Vietnamiens, qu'il a peur de sa femme (so vo). En effet dans le cinquième dessin le petit mandarin avait les moustaches bien relevées, signe d'autorité. So vo est un véritable tabou dans la société vietnamienne, dont on a honte de parler si on se trouve dans cette situation. D'un autre côté certaines Vietnamiennes sont de véritables tigresses qui tyrannisent tous les membres de la famille et qui font de leur vie un cauchemar. Les femmes de Hà dông ont cette réputation, on les appelle su tu Hà dông (lionnes de Hà dông), c'est justement la province dont Hoàng Trong Phu est le mandarin.
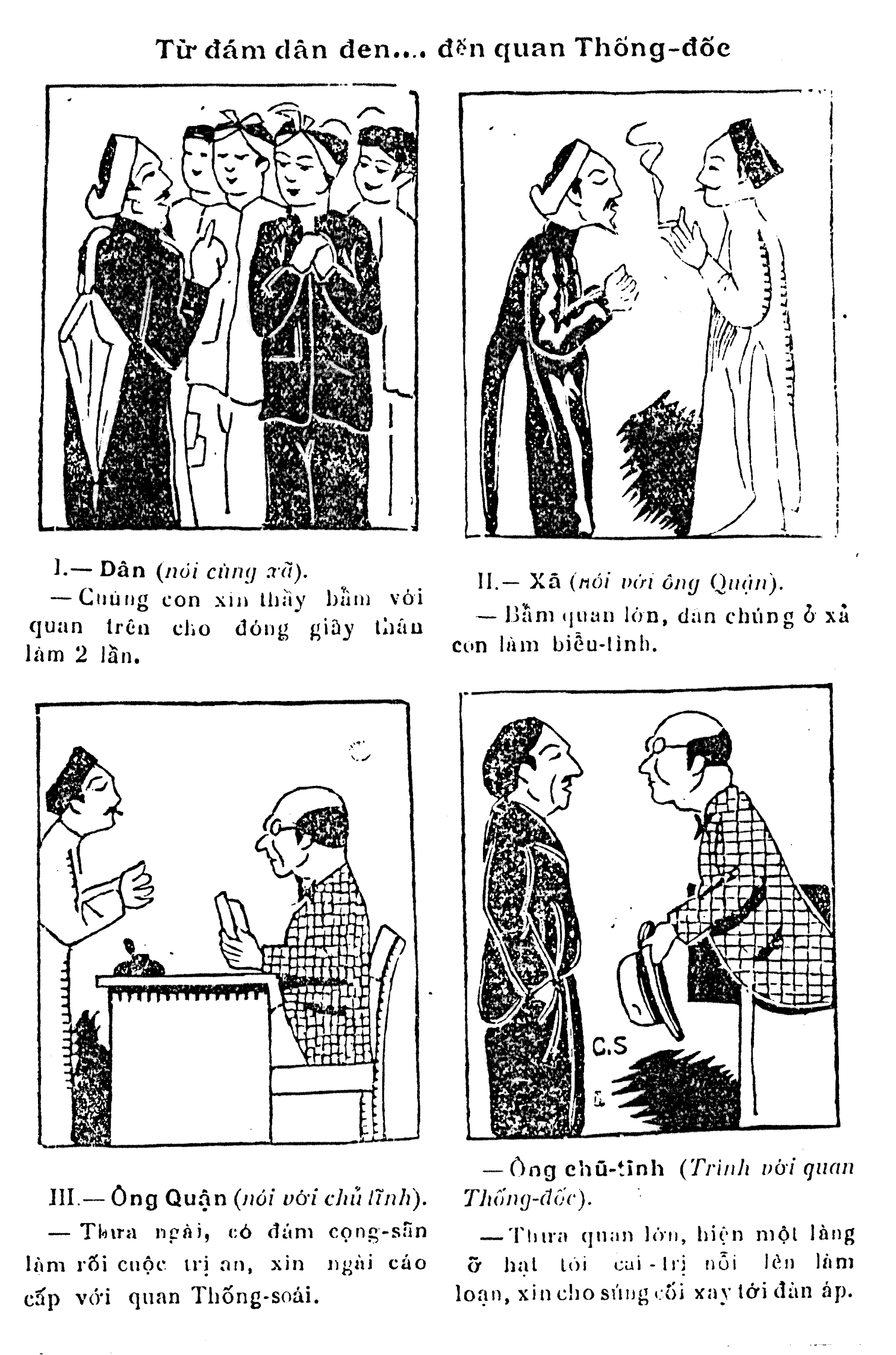
Dàn
bà moi, n°15, 30/03/1935
Le titre de ces dessins: "Du peuple attardé (dân den)... au Gouverneur (de la Cochinchine)." Le premier dessin en haut à gauche représente le peuple qui fait des réclamations au chef du village, reconnaissable à sa tenue traditionnelle et surtout à son parapluie sur l'épaule, signe distinctif des notables. En effet, le parapluie est plutôt un symbole de notabilité qu'un objet utilitaire. Le peuple dit:
- Nous vous supplions de bien vouloir transmettre au mandarin supérieur notre demande pour qu'il nous autorise à payer les impôts personnels en deux fois.
Le chef du village "rapporte" alors ces propos au chef de l'arrondissement qui, cigarette à la main, se trouve à droite du deuxième dessin (en haut à droite):
- Grand mandarin, le peuple de mon village se rassemble en manifestations.
Le chef de l'arrondissement "rapporte" à son tour au maire de la ville, assis dans son fauteuil, en bas à gauche du dessin. Cette fois, le représentant du peuple est un Français, reconnaissable sa tenue vestimentaire occidentale mais surtout à son "long nez" et à sa tête à moitié chauve. Le maire écoute le rapport:
- Votre Excellence, il y a un groupe de communistes qui sèment le désordre. Veuillez transmettre cela au Gouverneur.
De bouche à oreille, et d'un échelon à un autre, cette "affaire" prend de plus en plus d'importance et de gravité. Le maire qui ne remet pas en doute les propos entendus, prend les mesures qui s'imposent en s'adressant au Gouverneur, habillé d'un costume noir, les mains dans les poches, en bas à droite du dessin:
- Monsieur le Gouverneur, il y a actuellement un village de mon ressort qui se révolte, veuillez nous donner des armes pour les mater.
On constate que les exagérations mensongères se sont produites d'abord au niveau local, du chef du village au chef de l'arrondissement. Ces deux représentants du peuple qui sont pourtant vietnamiens n'ont aucun scrupule à tenir des propos si meurtriers. Cette attitude scandaleuse des notables vietnamiens ne peut en aucun cas se justifier, seule leur bassesse d'esprit les pousse à cette conduite qui les fera reconnaître de leurs supérieurs hiérarchiques. Ces pratiques rentrent pourtant dans une logique administrative qui ne laisse aucun recours au petit peuple pour s'exprimer. La moindre réclamation doit passer par l'intermédiaire du "représentant" qui se moque éperdument des "petites gens". Le fléau social se trouve aussi à ce niveau.
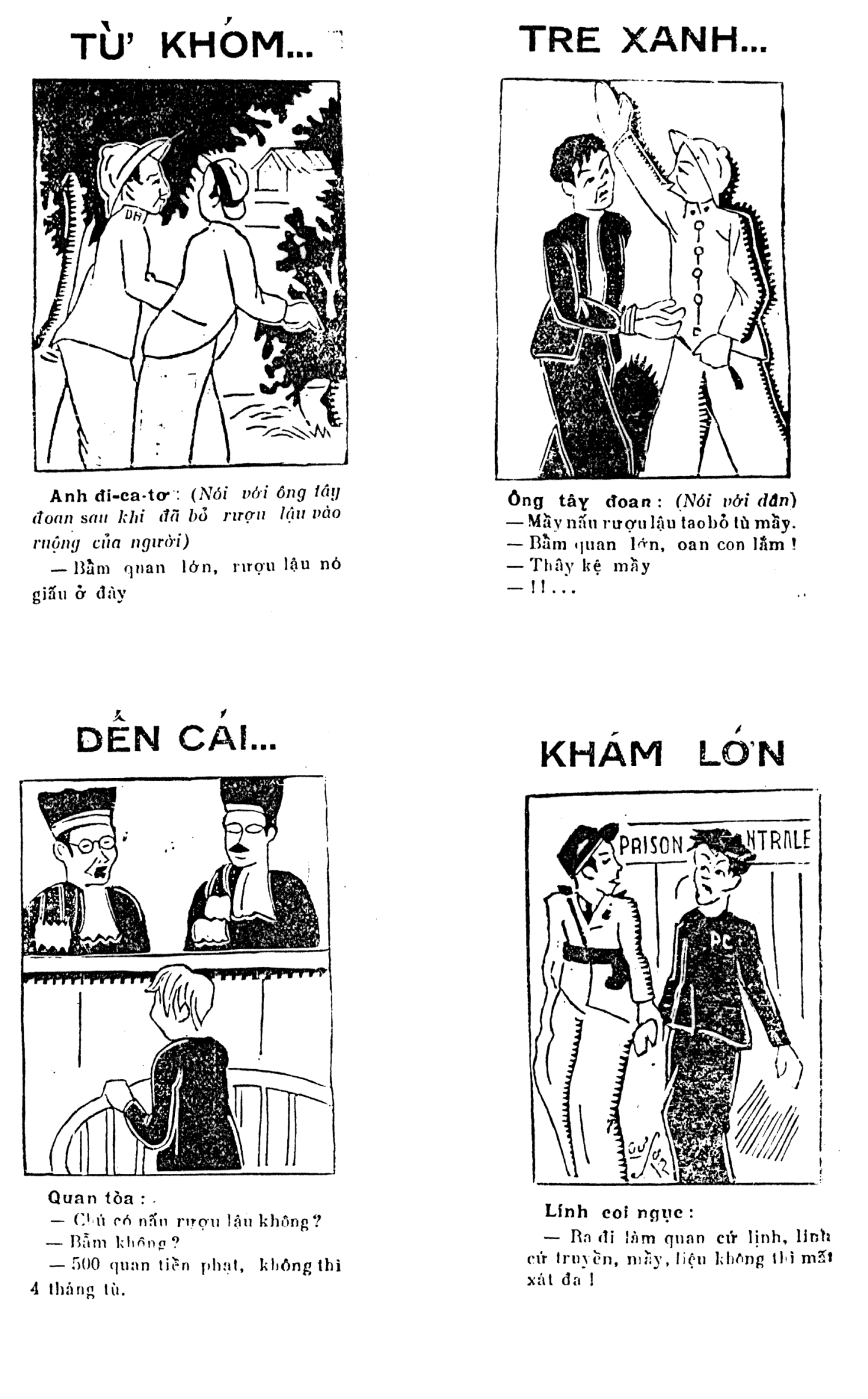
Dàn
bà moi, n°17, 13/04/1935
"Bien que l'Administration s'en défende, l'achat de l'alcool est obligatoire. Tout village qui n'achète pas, mensuellement, une quantité d'alcool proportionnellement de ses habitants se voit imposer cette quantité. Il est vrai que cela se fait, maintenant, avec quelque habileté. Tout village qui diminue ses achats d'alcool est présumé faire de la contrebande et se voit brusquement envahi pour des perquisitions inopinées par le douanier accompagné de miliciens. Pour avoir la paix, il achète de l'alcool.
Cela crée l'insécurité, voire l'épouvante, dans les paisibles paillotes et des drames s'en suivent 1."
L'administration poussait le vice jusqu'à imposer l'achat de l'alcool dans les différentes circonstances sociales: 30 litres quand on tue un buffle à l'occasion de l'anniversaire des ancêtres. Le Ly truong qui n'arrivait pas à "satisfaire au désir de l'autorité supérieure" se voyait renvoyé de sa fonction. Le problème de l'alcool, "un drame quotidien", est une perversion de l'Administration coloniale car "la population de l'Indochine n'a aucune tendance à l'alcoolisme", d'après les termes du même Rapport.
Mais ce qui était redoutable aussi dans ces réglementations, c'est qu'elles donnaient des idées à ceux qui voulaient se venger, détruire les autres, pour une raison ou une autre. Dans la campagne vietnamienne, cette pratique était monnaie courante. Il suffisait de placer de l'alcool dans la rizière de quelqu'un, puis d'aller le dénoncer à la douane, pour que le propriétaire de la rizière se retrouve criminel. Justin Godard écrit encore que "La simulation des fraudes est, nous dit-on, un cas qui se produit rarement. Or je soutiens le contraire et, avec moi, tous les notables et représentants de la population annamite. La preuve en est que presque tous les ans, tant au Nord qu'au Sud de l'Indochine, les membres indigènes de diverses assemblées élues sont unanimes à se plaindre des cas très fréquents de dépôt clandestin du riz fermenté dont sont victimes les propriétaires terriens 1". C'est cette pratique que le dessinateur veut illustrer sous le titre de "De la haie ... de bambou... à la... prison centrale." Le dessin en haut à gauche représente un agent de douane, reconnaissable à sa casquette coloniale et aux initiales DA sur son col, à côté d'un indicateur vietnamien qui lui dit après avoir mis de l'alcool dans la rizière de quelqu'un:
- Monsieur le grand mandarin 2, il a caché l'alcool de contrebande là-bas.
Le paysan vêtu d'une chemise noire à la sudiste (ao bà ba) et d'un pantalon également noir, propriétaire de la rizière où l'indicateur a mis de l'alcool se retrouve les mains liées par l'agent de douane qui lui dit (dessin en haut à droite):
- Je vais t'emprisonner car tu as fabriqué de l'alcool de contrebande.
Le paysan:
- Monsieur le grand mandarin, ce serait injuste pour moi!
Et il se voit répondre:
- Tant pis pour toi!
Notre paysan se retrouve donc au tribunal, dessin en bas à gauche. Le président lui demande:
- Est-ce que vous avez fabriqué de l'alcool de contrebande?
- Non, répond le paysan.
On dirait que les représentants de la loi n'ont pas entendu sa réponse car ils lui répliquent:
- Alors 500 ligatures 3 d'amende, ou 4 mois de prison.
Cette somme, astronomique pour un paysan, comment peut-il la payer quand il gagne difficilement quelques dizaines de piastres par mois? Ainsi il se retrouve, dans le dernier dessin, à la prison centrale, avec en prime, le statut de prisonnier politique, qui lui vaut les initiales "PC" sur sa tunique. Effectivement, le dessinateur fait allusion à une autre pratique qui consistait à accuser arbitrairement quelqu'un, pour un oui pour un non, d'être communiste pour se débarrasser de lui. Le sort du paysan condamné est maintenant dans les mains d'un garde omnipotent qui le menace d'entrée de jeu:
- Les mandarins commandent, les gardes (soldats) appliquent; alors gare à toi, sinon tu vas crever.
En effet, sous ce régime et à tous les échelons, quand un arriviste parvient à la position dominante, il en profite pour exploiter les autres par tous les moyens, seul l'argent permettrait, dans certains cas, d'alléger la peine. La corruption est un plat quotidien pour les "damnés de la terre".
A l'origine de ce drame, comme on l'a vu dans les dessins précédents, les Vietnamiens sont victimes de leurs propres représentants. Le régime colonial n'a pas besoin de faire de grands efforts pour qu'ils s'entretuent. Par contre "chacun sait que le monopole de la fabrication de l'alcool a tué complètement l'élevage du cochon, qui occupait des villages entiers, et que le monopole du sel a fait disparaître les industries saumurières aux quelles se livraient les populations maritimes", écrit le Résident de la province de Ninh binh au Résident supérieur du Tonkin 1. Tout ceci montre que l'oppression était une entreprise bien orchestrée à tous les niveaux, de la législation à la pratique.
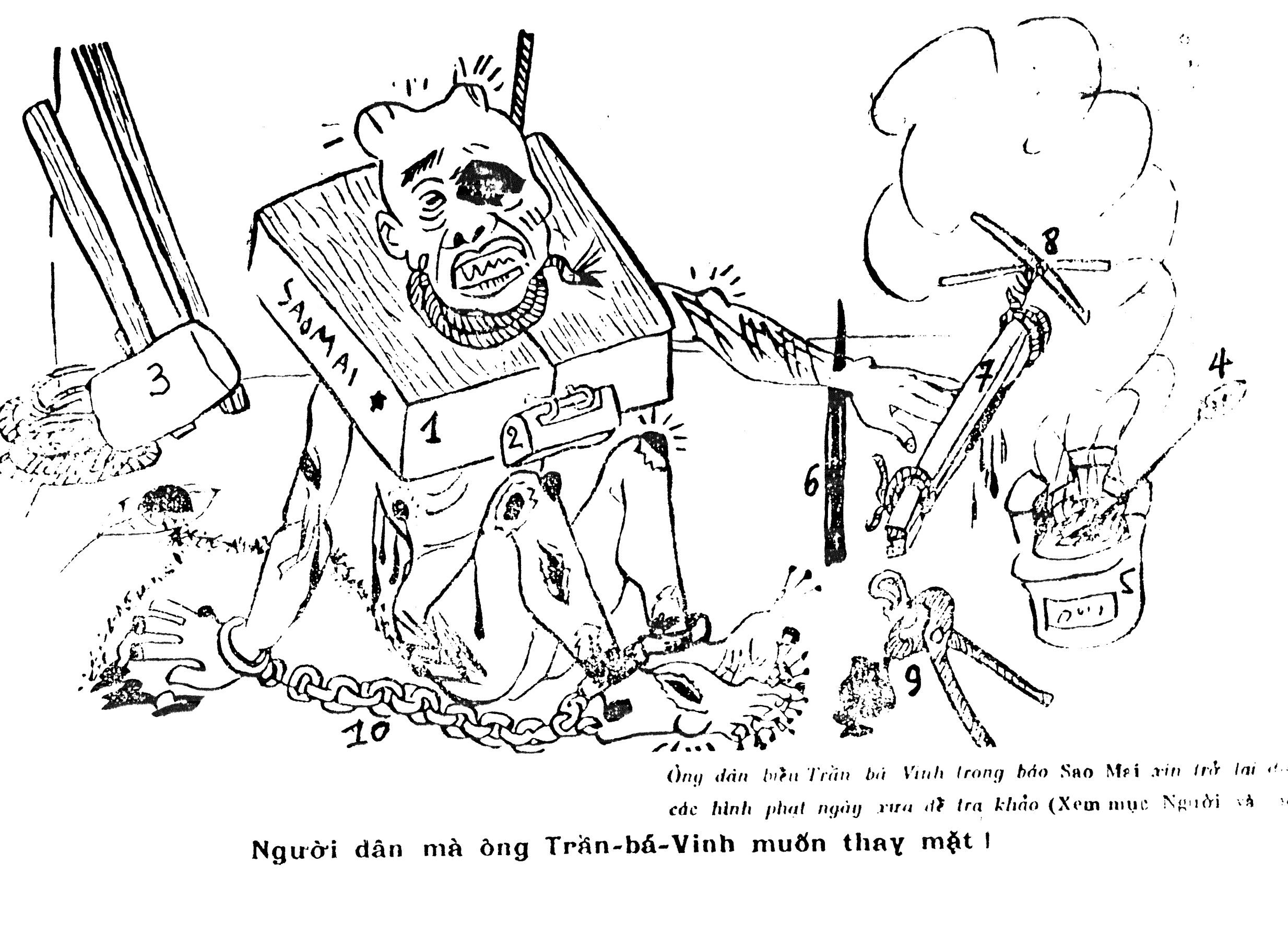
Ngày
nay, n°101, 13/03/1938
LY TOET, L'INADAPTE SOCIAL

Phong
hoa, n°32, 19/01/1933
- Ly : terme utilisé pour désigner les Ly truong (représentants officiels du village), en exercice ou ceux ayant assuré cette fonction;
- Toet : terme peu élogieux pour ne pas dire hideux, surtout quand il s'agit du nom de quelqu'un, signifie "écrasé", "ratatiné". Mais dans ce contexte précis, Toet désigne une tumeur des yeux qui les rend rouges et humides en permanence. Ly Toet signifie donc "le représentant du village aux yeux écrabouillés".
Ly Toet représente avant tout un paysan qui cumule les retards sur tous les plans (social, culturel, matériel...) dans la vie moderne en ville. En effet, Ly Toet est un illettré mais curieux, il observe et cherche à comprendre la vie qui l'entoure, à travers hélas, ses lorgnettes qui le guident vers de fausses interprétations ou vers les faux pas. Il est représenté comme quelqu'un de risible, de ridicule, mais pas méchant, car souvent c'est lui qui devient "victime" de ses propres initiatives ou de ses propres idées en cherchant à imiter les autres, qui s'expose à des situations comiques. Agé d'une soixantaine d'années, avec une figure qui présente des traits de laideur, le front bien avancé, un nez arrondi, quelques poils de moustache qui surmontent ses lèvres bien charnues, Ly Toet s'habille à la traditionnelle avec une longue tunique noire. Il n'a plus le chignon mais porte encore le turban sur la tête, symbole de la vieille génération conservatrice. Le succès de ce personnage a été tel que d'autres dessinateurs que celui qui l'avait créé se sont eux aussi mis à imaginer les situations comiques dans lesquelles Ly Toet était l'acteur principal. Ainsi on le trouve tantôt avec un chignon tantôt sans chignon. Il se promène toujours avec ses objets fétiches: l'éventail qui est un objet très usuel à la campagne (en ville on s'en sert également mais uniquement chez soi), le parapluie, signe de notabilité, dont il ne se sépare presque jamais, enfin ses chaussures, de fabrication locale, suspendues au parapluie; il n'ose pas les porter de peur de les user, ce qui constitue un symbole de l'avarice chez les paysans; ainsi il va nu-pieds dans toutes les circonstances. A propos du parapluie, le docteur Ch. Grall écrit:
" Notre établissement dans ce pays s'est traduit pour lui (le Vietnamien) par une conquête qu'il considère comme un véritable bienfait, celle du parapluie, dont l'usage était réservé antérieurement aux personnes de marque, et qui aujourd'hui s'est universellement répandu; l'indigène le tient ouvert par tout temps et à toute heure 1.
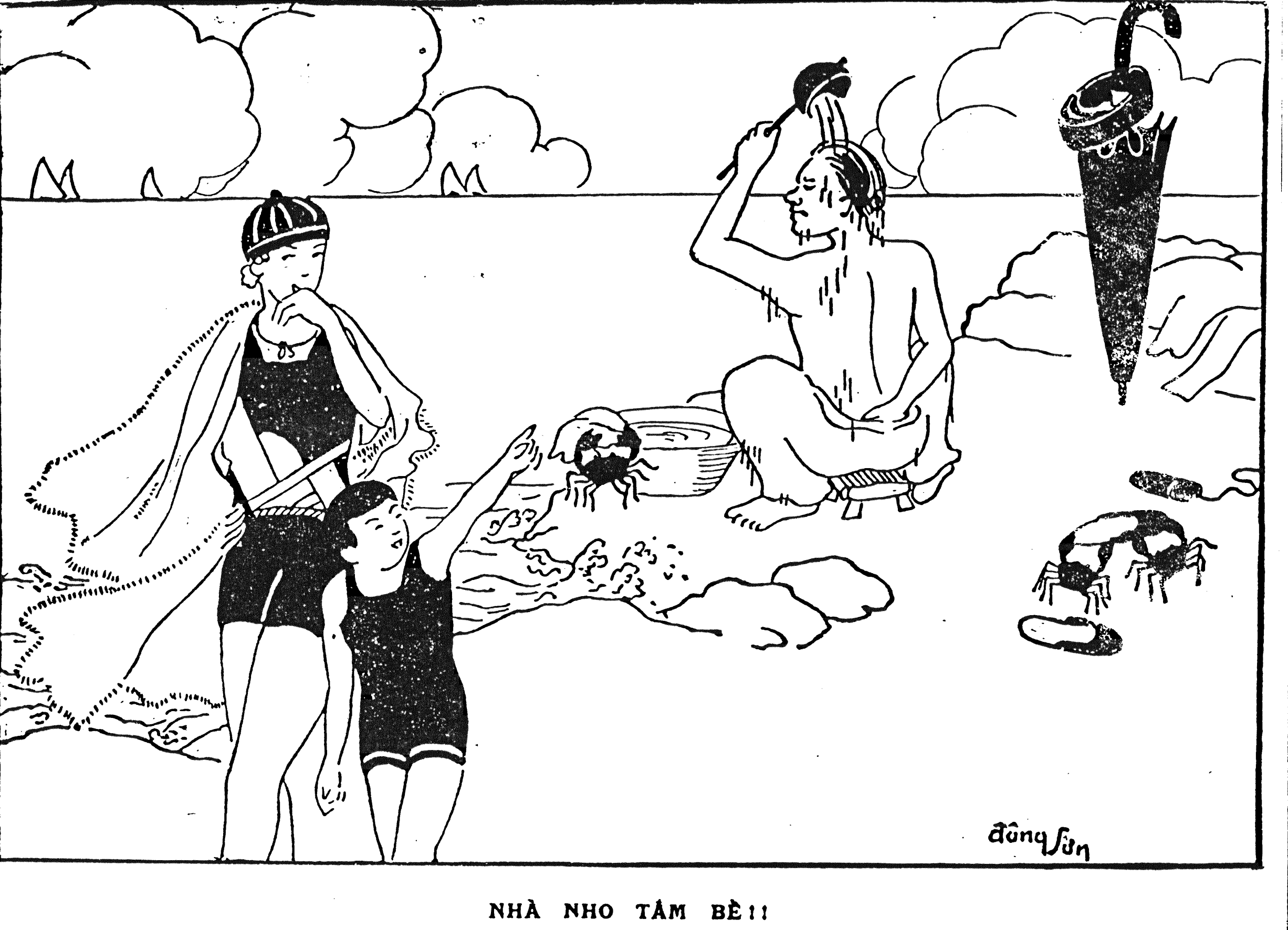
Phong
hoa, n°55, 14/07/1933
Cette caricature est dessinée par Nhât Linh sous la signature de Dông Son et porte la légende :"Un lettré à la plage." Elle montre le contraste entre deux univers, celui du lettré et celui de la jeune femme. A cette époque, aller à la plage pour se baigner était déjà entré dans les moeurs des citadins vietnamiens qui ont repris ce mode de vie aux Occidentaux. Notre lettré de la vieille génération, reconnaissable à son turban accroché au parapluie qui est planté dans le sable, se veut aussi moderne, ainsi il est venu à la plage. On remarque qu'il n'a plus les cheveux longs enroulés en chignon, mais à la différence des autres qui ont assimilé ce plaisir, il arrive avec les accessoires servant traditionnellement à cette séance d'hygiène: le petit tabouret sur lequel il s'assoit et surtout une sorte de grande louche (gao), faite d'une moitié de noix de coco vidée munie d'un manche, servant à puiser de l'eau puis à la verser sur le corps, et aussi une bassine pour contenir de l'eau. Par pudeur, le lettré garde son pantalon, quelque peu desserré tout de même, pour pouvoir frotter à l'intérieur. Près de lui, on reconnaît son porte-monnaie noir avec un bout de fil servant à l'attacher au niveau de la taille, ses chaussures, ainsi que sa petite serviette pendue sur le bord de la bassine, qui attirent les crabes. Le dessinateur veut signifier par là que ses objets personnels ne sont pas très propres puisqu'ils attirent les bêtes. A côté de lui, accompagnée de sa petite soeur, passe une jeune fille tout à fait moderne (s'habillant comme les Européennes à la plage), avec une grande serviette sur l'épaule. Le contraste entre les deux générations représentées, d'un côté, par un lettré qui garde ses habitudes culturelles, et de l'autre, par une jeune fille complètement "dans le vent" comme on disait dans les années 1960, apparaît d'une façon frappante: l'un garde le pantalon, l'autre montre son corps en maillot de bain. Pour une Vietnamienne de cette époque, elle a fait du chemin pour rompre avec les tabous. Si on pousse un peu plus loin les interprétations on dirait qu'elle passe son chemin après avoir vu le lettré se donner en spectacle, ou elle se dirige vers un autre endroit pour ne pas le voir.

Phong
hoa, n°109, 03/08/1934
Toujours sur le
thème de la baignade à la plage, nous revoyons notre
personnage préféré, Ly Toet, qui se
trouve à droite du dessin, signé de NVU dont nous
ignorons l'identité. A l'arrière plan un panneau
indique qu'on est à Dô son, la plage la plus
proche de Hà nôi, à une dizaine de kilomètres
au sud-est du port de Hai phong, et la plus fréquentée
par les Vietnamiens gagnés au mode de vie moderne. Tandis que
les autres, hommes et femmes, prennent leur plaisir dans l'eau, Ly
Toet, perplexe, se demande encore comment il va faire. On
remarque dans ce dessin qu'il n'a plus les cheveux longs mais la
boucle sur la nuque rappelle aux lecteurs les "plis"
façonnés par son chignon qui n'est plus pourtant. Il
s'est déjà déshabillé et s'est séparé
de son parapluie fétiche, il a posé ses chaussures par
terre mais il garde encore son gao sous le bras. Prévoyant
et logique, il l'a apporté pour pouvoir se laver. Tandis que
les autres sont en maillot de bain, Ly Toet, torse nu, garde
son cache-sexe (khô), vêtement très ancien
des Vietnamiens. Un exemple de situation dans lequel Ly Toet
est complètement "out".
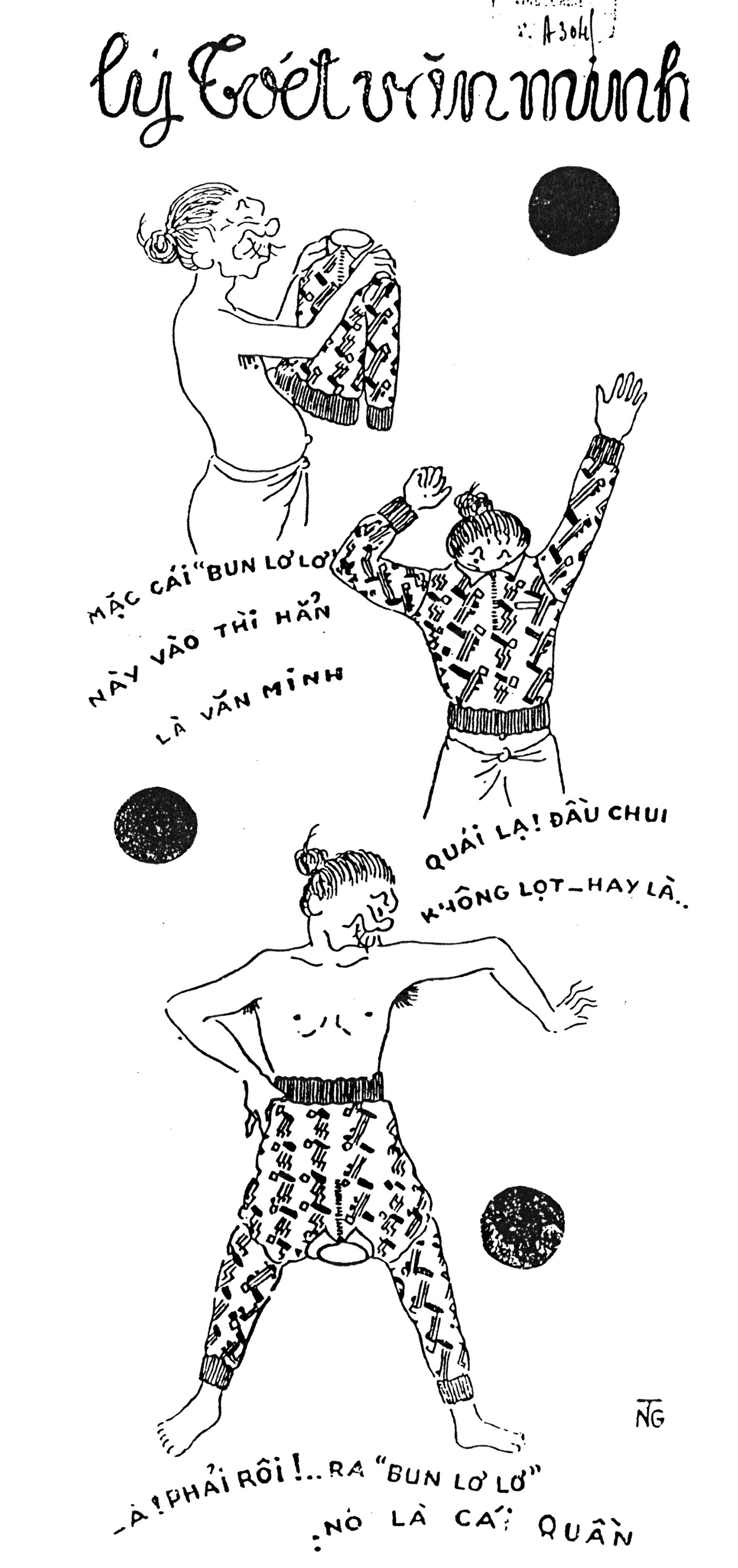
Phong
hoa, n°91, 30/03/1934
Ces
trois dessins de NTG, dont nous ignorons l'identité, portant
le titre de "Ly Toet civilisé",
montrent ce personnage au contact de la vie matérielle
moderne. Sur le physique de Ly Toet d'abord, deux trois petits
détails dans le dessin du haut de la page méritent le
détour. On le voit ici avec le chignon (suivant les
dessinateurs on le présente avec ou sans chignon), son ventre
est proéminent (bung ong), signe qu'il n'est pas en
très bonne santé car bung ong pour les
Vietnamiens est le symtôme des intestins envahis par des
parasites tels que vers ou ténias. Son nombril en forme de
petite boule saillante rappelle que le cordon a été mal
coupé par la matrone à la naissance. Ces deux détails
rappellent la méconnaissance des règles d'hygiène
de la part les paysans. Les dessinateurs insistent sur cet aspect
parce que l'hygiène est considérée aussi comme
un signe de modernité et de progrès. Quand on
s'aperçoit à quel point les paysans qui vivaient à
la campagne pouvaient la négliger ou l'ignorer, on comprend
alors qu'il y avait de quoi en parler. Ly Toet est en train de
contempler son pull-over et il se dit : "Si je mets ce
pull je serai vraiment civilisé" (légende).
Sur le second dessin, il commence à le mettre mais comme il
n'a pas déboutonné le col, le pull reste coincé
sur sa tête, ce qui lui rend perplexe, et il se dit: "Bizarre!
Ma tête ne passe pas, à moins que ..."
(légende). Sur le dernier dessin Ly Toet a "trouvé"
comment un pull se met et il est content :"Ah oui! Un pull
est en fait un pantalon" (légende).
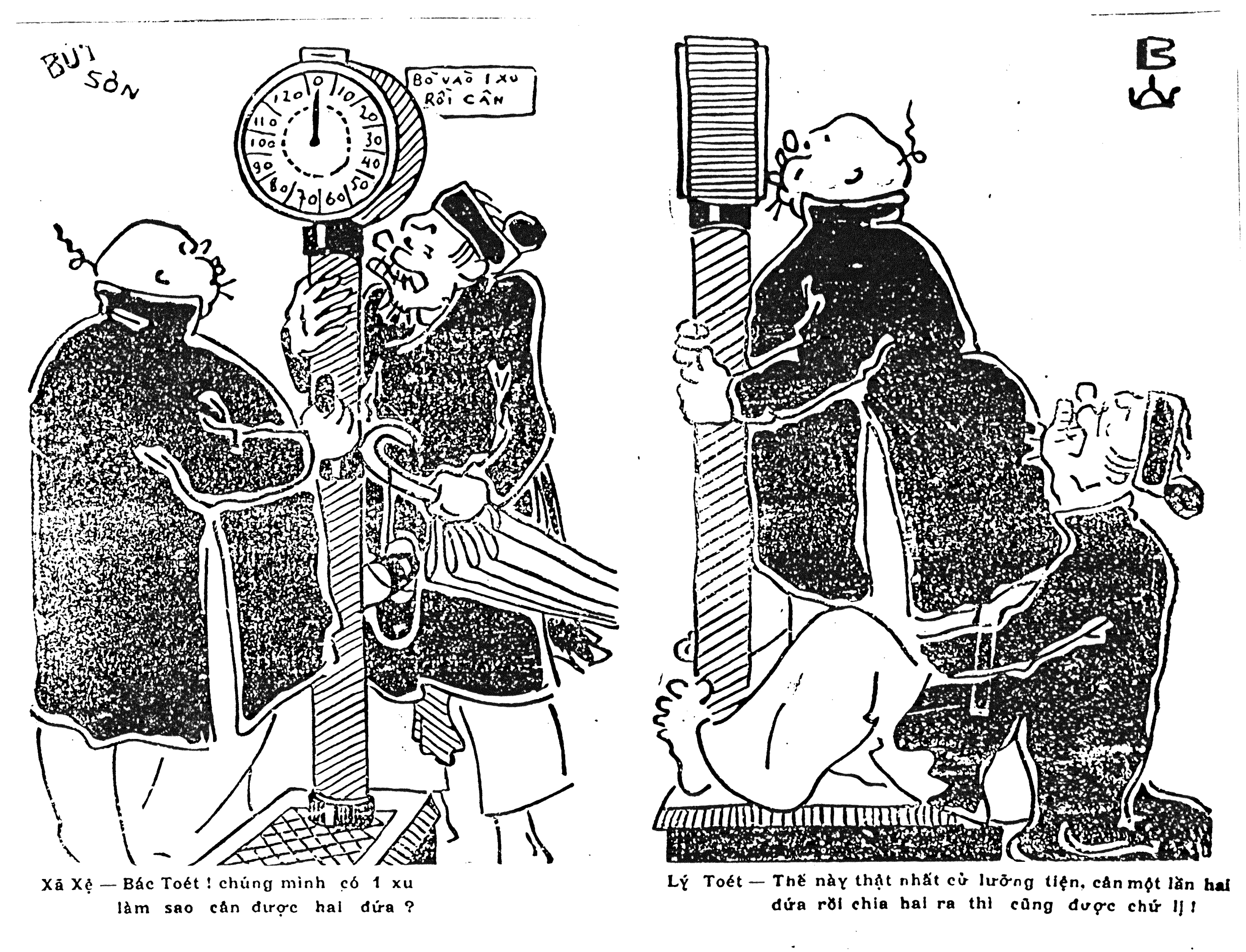
Phong
hoa, n°89, 16/03/1934
Dans cette caricature, le dessinateur Bui son présente une nouvelle situation à la quelle ils sont confrontés. Devant une bascule avec un petit panneau (en haut du dessin de gauche) indiquant qu'il faut mettre un sou pour chaque pesée, Xa Xê ne sachant pas encore comment s'en sortir pour que tous les deux puissent se peser, pose la question à son compagnon en train d'observer l'instrument pour savoir comment ça fonctionne:
- Monsieur Toet! Nous n'avons qu'un sou, comment faire pour nous peser tous les deux?
Ils ont fini par trouver une solution: tous les deux à la fois sur le plateau, et Ly Toet content de l'idée dit alors:
- Ainsi c'est vraiment économique. Les deux en une pesée, puis il suffit de diviser le résultat (du poids) par deux!
Remarquons que la bascule est un instrument de la vie moderne qui n'existait pas auparavant dans la société vietnamienne.
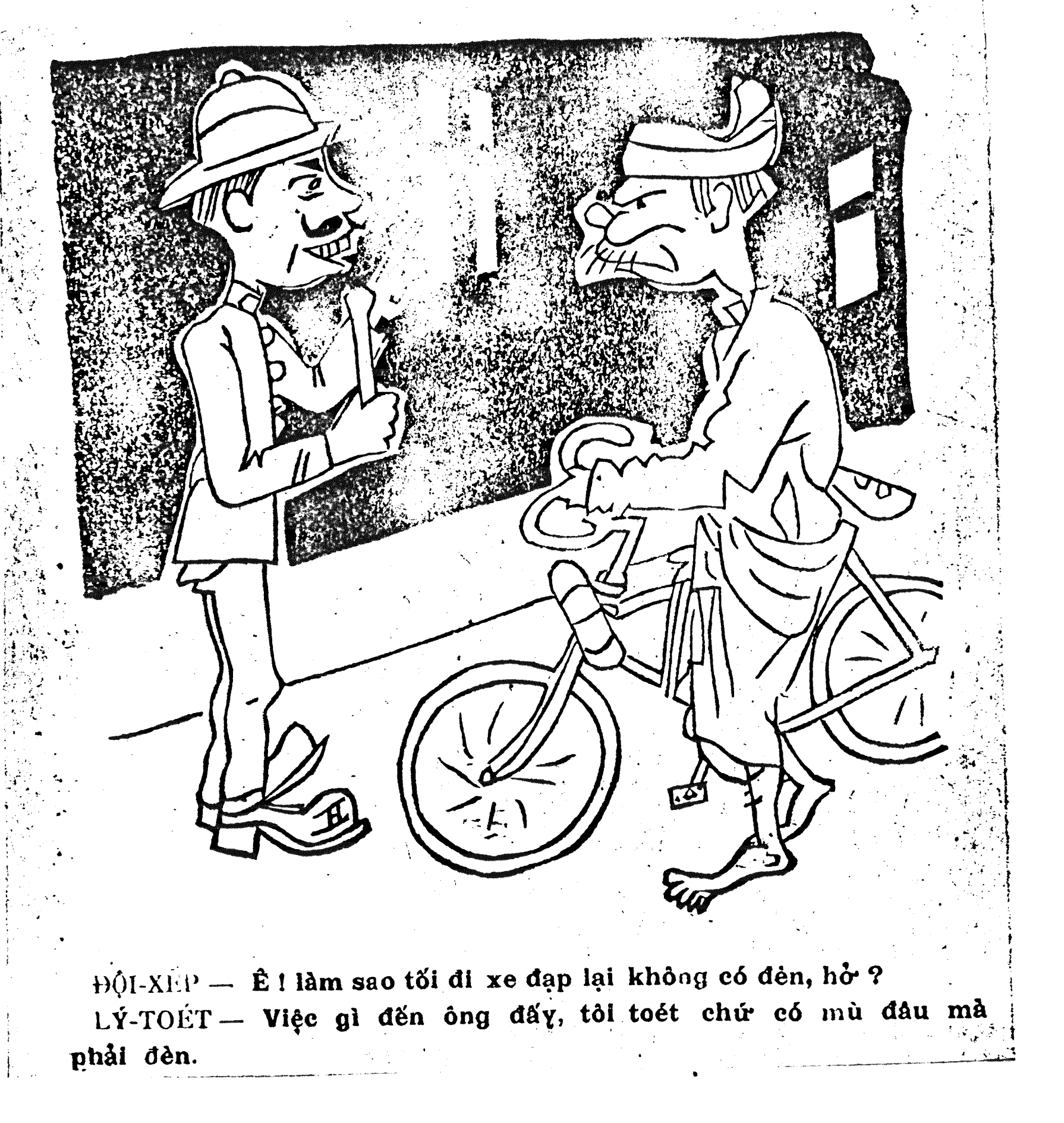
Ngày
nay, n° 81, 17/10/1937
Dans ce dessin, Ly Toet est arrêté par un agent en uniforme. Ce dernier est présenté avec l'apparence d'un Occidental. La matraque à la main il interpelle Ly Toet toujours pieds nus. On remarque que Ly Toet a bien retroussé sa tunique et son pantalon large pour ne pas être gêné sur la bicyclette.
Monsieur l'Agent (légende):
- Eh! Pourquoi (tu) roules la nuit sans lumière?
Devant cette question, pour lui incongrue, Ly Toet, de bonne foi, réplique:
- Mais ça ne vous regarde pas! J'ai mal aux yeux mais je ne suis pas aveugle, alors pas besoin de lumière.
Encore une fois Ly Toet reste dans son monde et ignore les règles élémentaires de la vie moderne. Il faut noter aussi que les agents coupaient souvent les cheveux en quatre pour embêter les cyclistes.
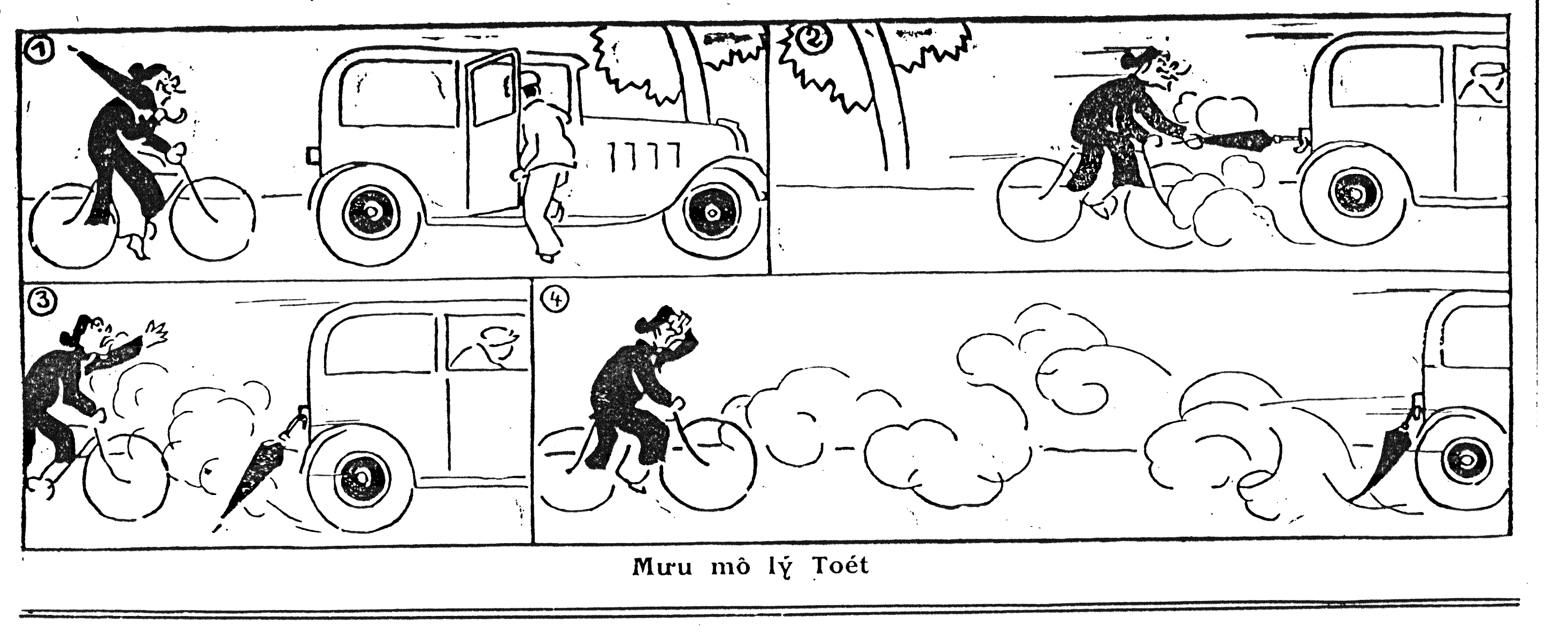
Phong
hoa, n°96, 04/05/1934
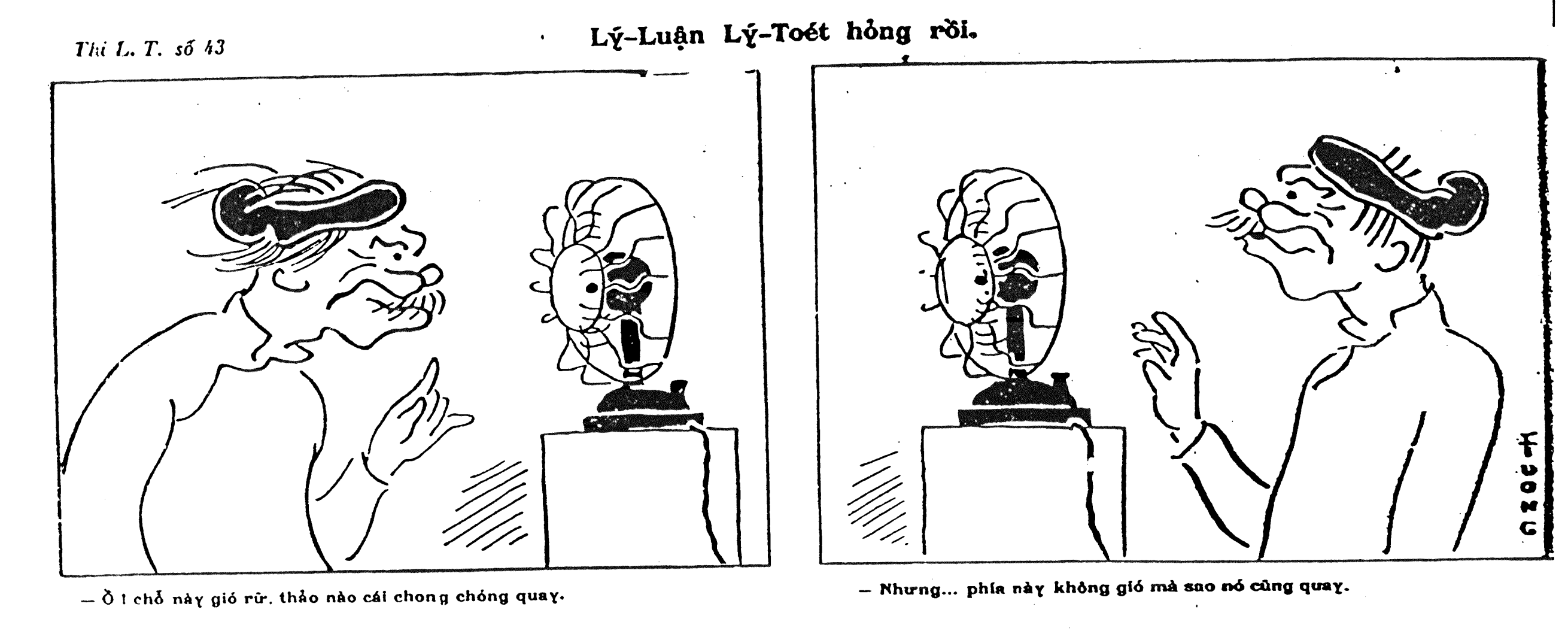
Phong
hoa, n°90, 23/03/1934
- HO! Le vent souffle très fort ici, on comprend pourquoi l'hélice tourne.
Curieux (comme toujours) de connaître le principe de fonctionnement de l'engin, Ly Toet se place cette fois derrière le ventilateur, car d'après son bon sens et selon sa logique, si le vent souffle dans une direction il provient obligatoirement de la direction opposée. Mais le voilà perplexe car ce phénomène échappe à son raisonnement:
- Mais... de ce côté il n'y a pas de vent, pourquoi elle (l'hélice) continue à tourner?
Bien sûr, il s'agit ici de caricatures, par contre la vie matérielle moderne, elle, échappait à beaucoup de gens dépassés par l'évolution. Elle provoquait parfois même des accidents ou des drames. Dans les faits divers rapportés par les journaux, on apprend qu'untel a été électrocuté en tendant le linge sur les fils électriques, un autre décapité par le passage d'un train alors qu'il se reposait, la tête sur les rails. Bref la modernité ignore ses contemporains, elle ne se pose pas la question de savoir s'ils sont en phase avec elle, par contre ceux-ci sont condamnés à la suivre sous peine d'être éliminés, socialement ou même physiquement dans le cas des accidents de parcours.
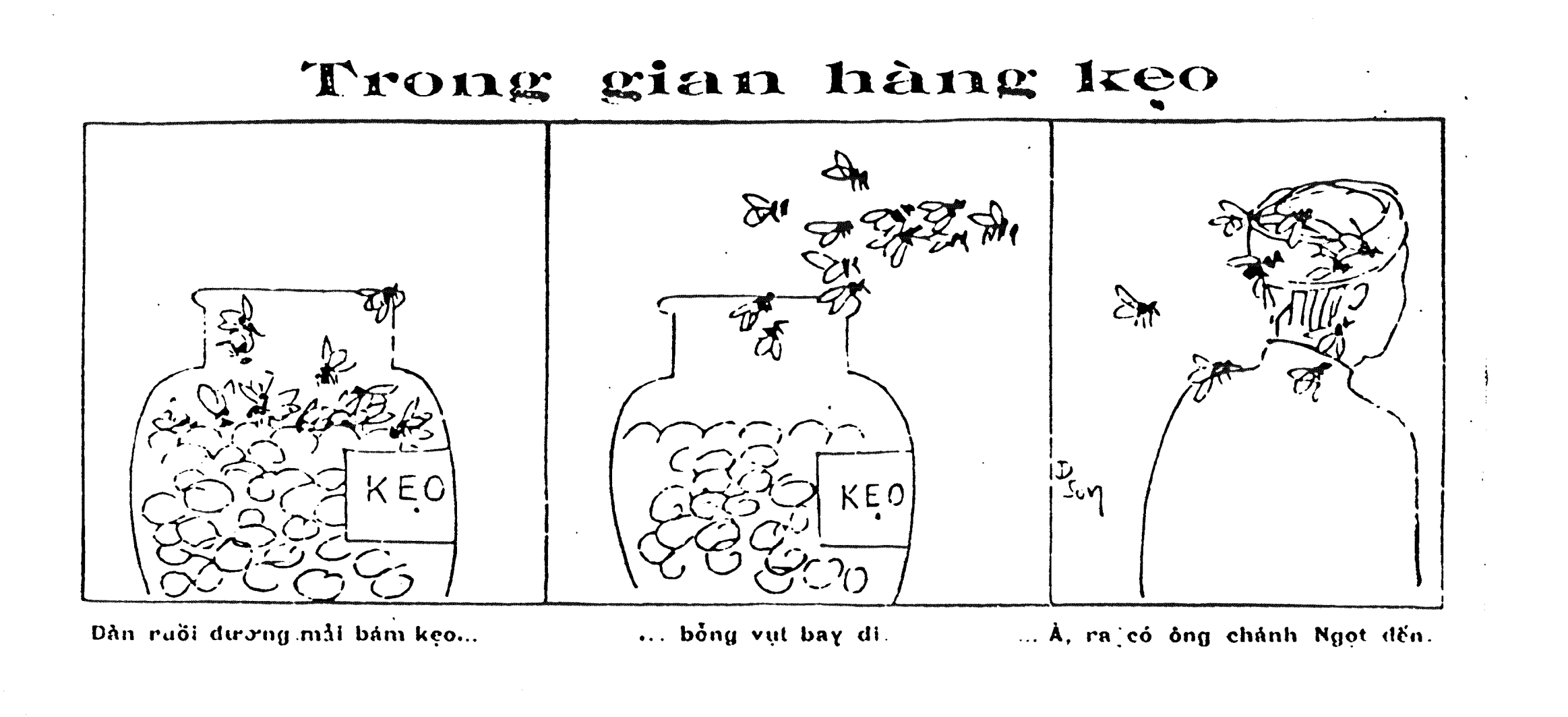
Phong
hoa, n°126, 30/11/1934
On retrouve
dans ce dessin les caricatures, au nom de la modernité qui
ridiculisent le port des cheveux longs et du turban, symboles de la
tradition conservatrice. (Voir plus loin sur l'évolution de la
coiffure sous la colonisation.) Il ne s'agit pas uniquement d'une
question esthétique, ou d'une mode mais également du
bien-être et de l'hygiène car selon toute vraisemblance,
les cheveux longs étaient le repaire des poux. A cet égard
on voit sur des photos prises par les coloniaux, une Vietnamienne en
train de chercher les poux sur la tête de la voisine, une
pratique courante de la vie quotidienne. Ici, Dông Son, alias
Nhât Linh, en quelques traits illustre ce manque d'hygiène
sous le titre de "Dans le magasin de bonbons."
A gauche se trouve un bocal de bonbons qui attirent les abeilles. Au
milieu, elles s'échappent du bocal pour se poser, à
droite, sur la tête d'un homme à cheveux longs portant
le turban. L'illustrateur explique pourquoi les insectes ont préféré
les cheveux aux bonbons :
- C'est parce que Monsieur Chanh Ngot est arrivé (légende du dessin de droite).
Chanh est un terme pour désigner le représentant d'un canton (tông), et ngot veut dire sucré. Encore une fois, les notables sont caricaturés car ils cumulent à la fois le conservatisme et le mépris des règles d'hygiène nécessaires au bien-être.

Phong
hoa, n°40, 31/03/1933
- Quand Nguyên Van Tô avait encore son chignon il pesait...
La bascule indique 60 kilos. A droite, le dessinateur montre notre lettré débarrassé de ses cheveux longs grouillants de poux qui s'échappent sur le sol. Et cette fois la bascule n'indique plus de 50 kilos: ses cheveux et les poux pesaient 10 kilos. Sans doute une exagération, mais le propre de la satire n'est-il pas de pousser l'imagination à l'extrême?
A travers cette série de caricatures, il était question du mode de vie moderne que les Vietnamiens vivant en ville avaient adopté. Son antagonisme, la tradition conservatrice, était le principal objet d'attaque de ceux qui représentaient le progrès. Les situations comiques auxquelles Ly Toet et Ly Toet parfois Xa Xê sont confrontés étaient sans doute exagérées, néanmoins elle reflètent la rencontre de deux cultures, de deux modes de vie qui jusqu'alors n'avaient que peu de chose en commun. Bien sûr, les plus dépassés par les événements étaient les paysans qui découvraient la ville. Si le terme nhà quê qui veut dire "la campagne" (nguoi nhà quê, le paysan, le campagnard) était devenu une injure que les coloniaux "crachaient" à la tête des Vietnamiens "attardés", son sens péjoratif provenait sans doute de situations, semblables à celles des caricatures évoquées, qui ont énervé les coloniaux impatients.
AUTOUR DE LA FEMME
A travers la presse et les écrits divers, la remise en question de la place de la femme dans la famille et dans la société était devenue effective dans les années 1930. Ce défi à la société chargée de préjugés, et à l'ancienne génération aux idées conservatrices a porté des fruits. Les femmes aux idées modernes, surtout celles qui se trouvaient au contact de la vie moderne de la ville, ont refusé d'être reléguées au second plan ou d'être soumises comme leurs aînées des générations précédentes. Du rêve à la réalité, les oubliées de l'histoire ont parcouru non sans embûches les étapes de la conquête de leurs droits, d'un autre côté les opportunistes ont su de tout temps tirer les marrons du feu. Les "maisons de chanteuses" étaient là pour permettre aux filles désorientées d'exprimer leurs sentiments aux bons écouteurs venus chercher une compagnie, en échange de la privation de leur liberté. Les jeunes citadins insouciants et libérés des tabous rôdaient autour de leurs proies afin de satisfaire leur ego refoulé. Mais la modernité se mesurait également au nombre de suicides de femmes, qui pour une raison ou une autre, glissaient dans les ténèbres. C'est autour de ces thèmes que le journal Phong hoa et d'autres se sont livrés à une véritable campagne de critique violente contre la tradition et contre les "effets pervers de la modernité".
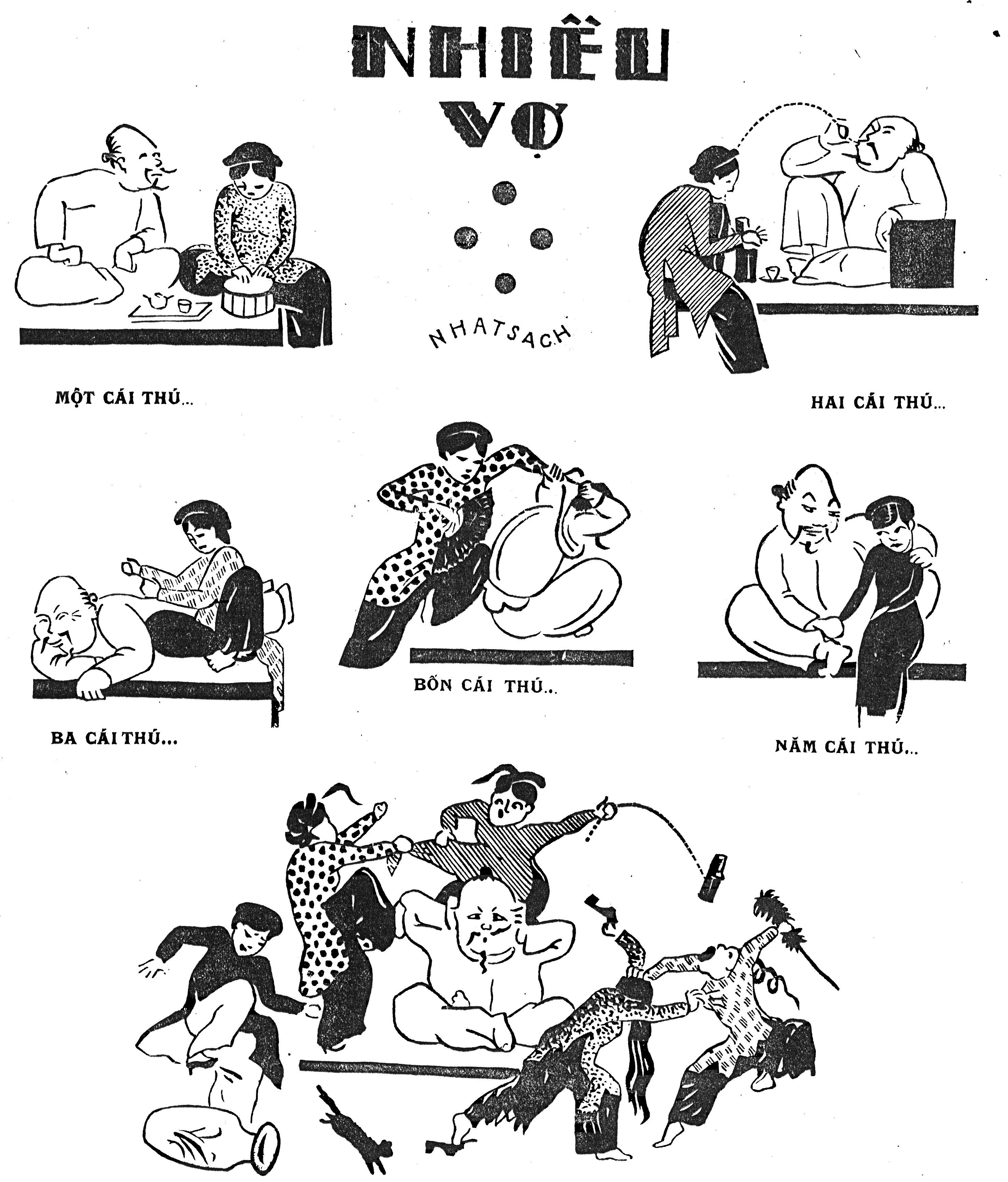
Phong
hoa, n°65, 22/09/1933
Sur cette caricature (qui présente une certaine similitude avec une bande dessinée), le dessinateur Nhât Sach - nom emprunté à la carte ayant le plus de valeur dans le jeu de cartes traditionnel To tôm - , met à plat la polygamie (nhiêu vo) dans la société vietnamienne. Il convient de remarquer que cette pratique qui fait de la femme un objet au service de l'homme était surtout l'apanage des classes privilégiées: la cour, les mandarins, les notables, les propriétaires terriens. Le commun des mortels n'avait pas les moyens matériels de s'offrir ce luxe, car sa vie était déjà assez dure avec une femme et quelques enfants. Si les hommes privilégiés se permettaient d'avoir plusieurs femmes, ses femmes n'avaient cependant pas toutes le même statut. Il y avait d'abord la femme principale (vo ca), souvent la première mariée selon les rites traditionnels, puis les femmes de second rang (vo le). Ces dernières formaient aussi une hiérarchie selon l'ordre de "mariage". Et en dernier lieu arrivent les "servantes" (nàng hâu). Cette hiérarchie se traduit également par la façon dont les unes et les autres devaient se nommer ou s'adresser aux autres. La femme principale et ses enfants appellent les femmes secondaires di (di hai si c'est la deuxième femme, di ba, pour la troisième, et ainsi de suite), et elle se nomme elle-même chi (soeur aînée). Elle appelle les "servantes" may et se nomme elle-même tao (tutoiement méprisant), tandis que réciproquement elles doivent l'appeler bà (grand-mère) et se nommer con (enfant). Cette dernière catégorie de femmes était constituée de paysannes plus ou moins jeunes, et pauvres. Deux cas de figure se présentaient le plus fréquemment soit les parents, ne pouvant plus acquitter les dettes contractées auprès de leur créancier, finissaient par lui sacrifier leur fille; soit une femme, qui se retrouvait seule sans famille et sans recours, à la suite du décès de son mari par exemple, se résignait à accepter cette proposition qui constituait la seule possibilité pour elle de survivre. Le statut de "servante", en principe du mari, consiste dans les faits à servir aussi la femme principale et les enfants du "couple légitime": c'est une domestique pour ne pas dire une esclave. En principe, le mari doit avoir le consentement de sa femme légitime avant de prendre d'autres femmes secondaires ou "servantes", ou souvent, il invoque des raisons liées à la descendance, plus précisément "pour avoir un garçon", afin de perpétuer le culte des ancêtres. Dans la pratique il parvient toujours à persuader sa femme principale du bien-fondé de son intention même s'ils ont déjà des enfants et surtout des garçons, car cela lui permettrait de devenir ainsi chef d'une petite armée de femmes sous ses ordres; cet aspect suffit à beaucoup de femmes principales pour accepter les caprices de leur mari.
Sur ces dessins qui se lisent de gauche à droite et de haut en bas comme une BD, le dessinateur présente, dans le premier, un couple assis sur un lit de camp, où la femme est en train de servir du thé au mari. La légende signale que c'est "Un plaisir" du mari. Sur le deuxième, on voit le même homme, mais avec une autre femme qui est en train de lui allumer une pipe à eau. Cela fait "Deux plaisirs". Sur le dessin suivant le même mari se couche sur le ventre pour que sa troisième femme lui fasse des massages : on arrive à "Trois plaisirs". Sa quatrième femme lui soulève sa tunique pour le rafraîchir à coups d'éventail. Il se trouve sur le dessin suivant avec sa cinquième femme, une petite jeune fille encore timide à ses côtés. Les yeux avides devant sa jeune femme à la chair fraîche expriment son cinquième plaisir. Cependant ces cinq plaisirs réunis "ne valent pas le plaisir du spectacle", le spectacle de la jalousie entre ses cinq femmes. On le voit à la fin se boucher les oreilles pour ne pas entendre les cris, les injures et le bruit des bagarres: la quatrième femme déchire la tunique de la seconde, qui se défend à coups de pipe à eau, tandis que la troisième arrache les cheveux de la première qui essaie de lui rendre les coups. La petite dernière, quant à elle, se venge sur le mobilier...
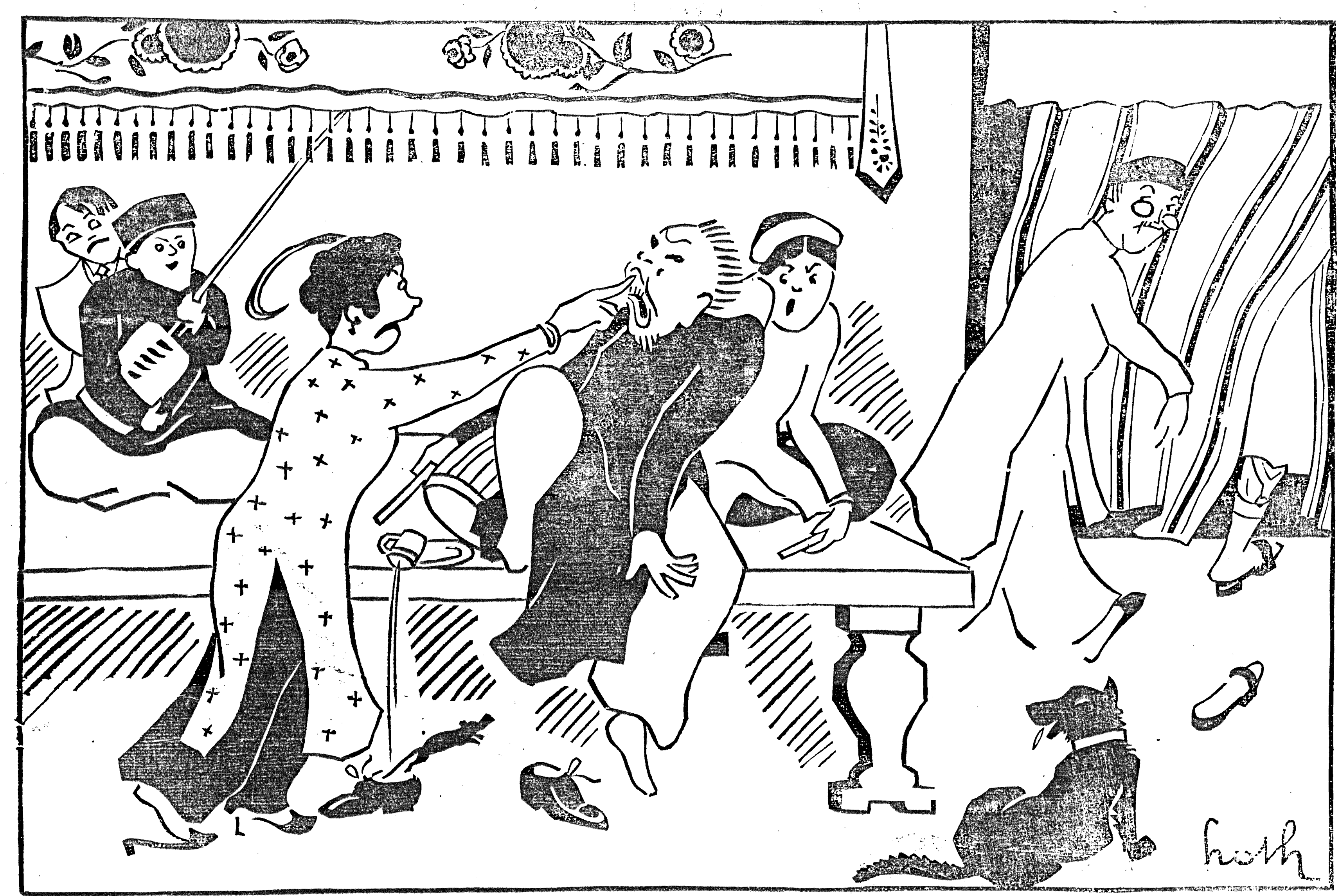
Phong
hoa, n°30, 13/01/1933
Dans la société traditionnelle, le mari avait tout pour lui, surtout quand il jouissait d'une situation sociale enviable. Il pouvait avoir plusieurs femmes mais apparemment cela ne lui suffisait pas, alors il cherchait des moments de distraction à l'abri des regards. L'une des formes de ses distractions, qui consistait à aller écouter les chanteuses, supposait aussi un apprentissage: il devait savoir au moins battre le tambour selon des règles précises (câm châu) 1, s'il voulait être un client actif. C'est autour de ce thème que le dessinateur caricature une scène de ménage dans une "maison de chanteuses".
Un mari d'un certain âge, habillé à la mode traditionnelle mais avec les cheveux courts, et qui tient encore dans sa main droite la baguette du tambour qui se trouve à ses côtés, est surpris par la venue de sa femme. Elle le ridiculise en public. Un autre participant, le vieux aux lunettes et au turban, s'esquive pour échapper au scandale. Sur le lit de camp, à droite du mari sur le dessin se trouve la chanteuse qui garde dans sa main gauche une baguette avec laquelle elle tape sur un autre instrument en bois (phach) - qu'on ne voit pas sur le dessin. Elle est terrorisée par l'intrusion de la femme de son client. A gauche du dessin, le musicien en tunique et en turban noirs tient dans ses bras son instrument, une sorte de guitare (dàn day), et regarde la scène sans s'émouvoir. Derrière lui, se cache un jeune habillé à l'occidentale: lui aussi, a peur d'être impliqué dans ce "remue-ménage".
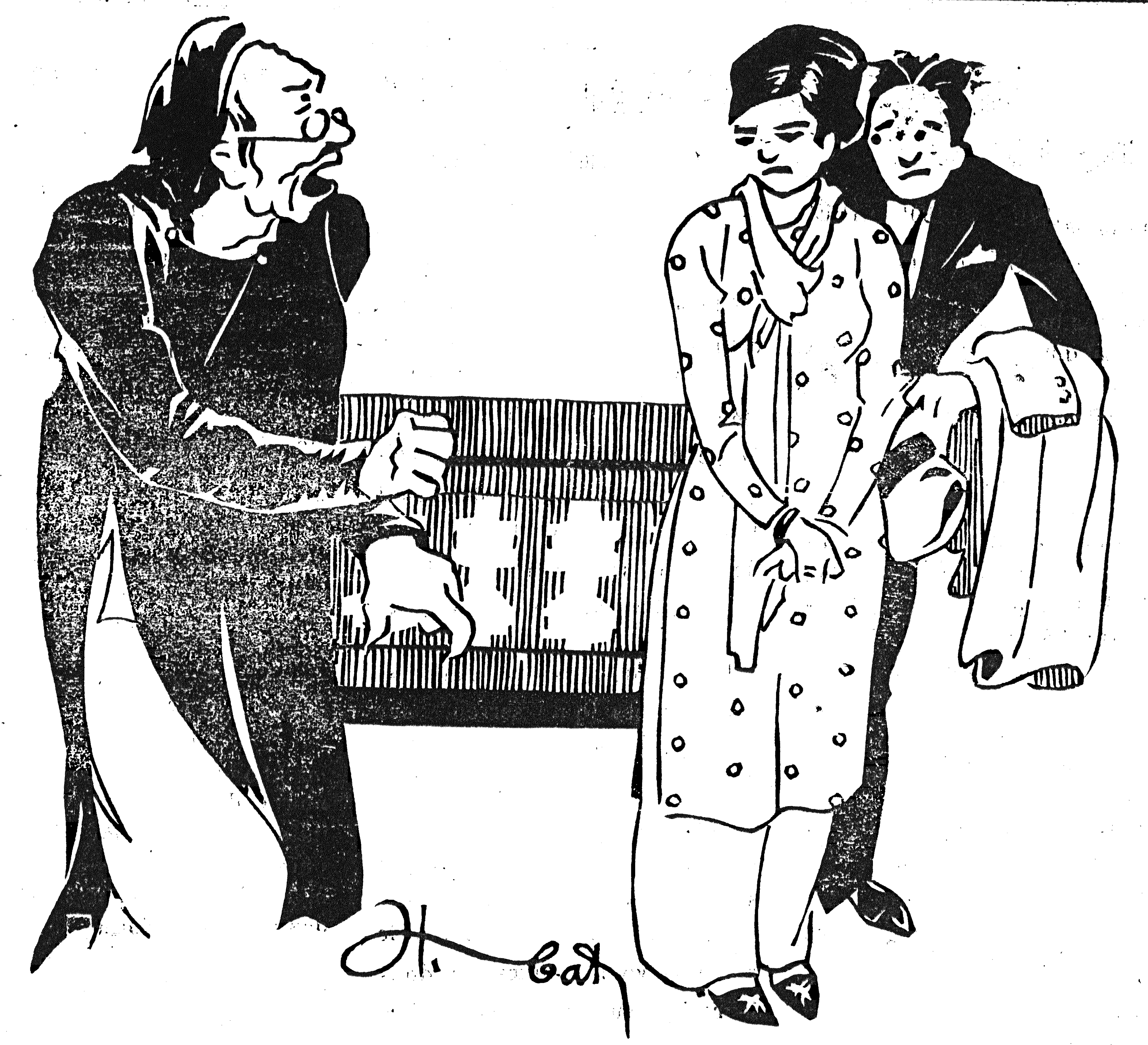
Phong
hoa, n°9, 11/08/1932
Changement de décor et renversement de situation: cette fois-ci ce n'est plus le mari qui est fautif, mais la femme. On la voit ici dans une tenue moderne, avec une tunique à motifs, un châle au cou, une raie sur le côté. Ce sont les signes distinctifs de la femme moderne. Le mari, qui se trouve à gauche du dessin, est habillé à la mode traditionnelle. Il est bien plus vieux que sa femme. Furieux de surprendre sa femme en compagnie d'un jeune homme, il se met dans tous ses états. Ne sachant quoi lui répondre, la femme, dans une attitude de chien battu, n'ose pas l'affronter du regard. Tandis que l'amant, représentant de la jeune génération, avec sa tenue moderne et le chapeau qu'il tient à la main, ne sait plus non plus où se mettre : il se cache derrière sa maîtresse qui lui sert de paravent. On constate que la femme et son amant font partie de la même génération. La légende souligne que "C'est ainsi, la liberté".
Le mot liberté, ici, fait allusion à la liberté de la femme. On ignore la véritable ampleur du phénomène de l'adultère -le trio mari, femme et amant. D'après les échos parus dans la presse et la fréquence de ce genre de situation présentée sous forme de caricature, tout laisse à penser que la femme moderne ne se contente plus d'un seul homme. Le cas le plus fréquent est observé chez le couple où il y a une grande différence d'âge et donc de mentalité. La femme préfère ainsi être en compagnie d'un homme avec qui elle puisse partager les mêmes idées sur la vie, du moins elle l'espère.
Cette ironie de l'histoire parvint aussi à inverser les valeurs, car désormais, dans les années 1930, on commençait, contrairement au passé, à se moquer du mari trompé, et non de la femme "adultère".

Phong
hoa, n°36, 03/03/1933
Cependant, les couples jeunes, donc modernes, n'échappent pas non plus à ce phénomène social attribué, peut-être à tort, implicitement par les gens de cette époque à une imitation des moeurs occidentales. A cet égard, il est difficile de défendre l'idée qu'une société quelconque puisse être à l'abri de ces aventures. Tout est question de degré ou de normes. D'un autre côté, si rigides et sévères que soient les coutumes, les usages, les traditions, ou la loi, les barrières sociales deviennent insignifiantes quand la passion se déchaîne. Par ailleurs on constate que dans certaines sociétés ce tabou ne constitue nullement un délit de moeurs mais une pratique tout à fait normale. Chez les Eskimos, la coutume veut que le visiteur venu de loin ait droit, en signe d'accueil, à une nuit d'amour avec la maîtresse de maison. Chez les indiens Yanomami, "personne n'appartient à personne" et chaque individu est entièrement libre de ses relations 1. Chez les Thaï de la région de Binh liêu (Vietnam), note Auguste Bonifacy qui a entrepris des recherches ethnologiques dans le haut Tonkin dès le début du siècle, chaque année, le 22e jour du 3e mois, les femmes mariées ou non allaient "draguer ouvertement les hommes dans la rue du bourg pour chercher des amants d'un jour avec lesquels elles partaient s'unir dans la nature sans que les époux officiels manifestent de jalousie ou de dépit" 2. Plus près de nous, en France, les clubs d'échangistes organisent des soirées d'ébats sans que cela attire l'attention de quiconque.
Dans le contexte du Vietnam des années 1930, si les moeurs françaises, à travers les images vues au cinéma ou la vie quotidienne coloniale, y étaient pour quelque chose, elles agissaient plutôt comme révélateur que comme cause déterminante. Car au moment où les barrières sociales sont démolies, l'individu se voit rajeuni avec ses propres désirs, ses propres sentiments refoulés qui se réveillent.
Néanmoins sur ce dessin, l'illustrateur a emprunté le symbole européen de l'adultère : les cornes. On voit ici un couple jeune qui échange des propos évocateurs. Le mari innocent demande à sa femme:
- Où est-ce qu'il faut mettre les cornes offertes par le directeur?
Et sa femme lui répond:
- Les cornes offertes par le directeur? Tu n'as qu'à te les mettre sur la tête.
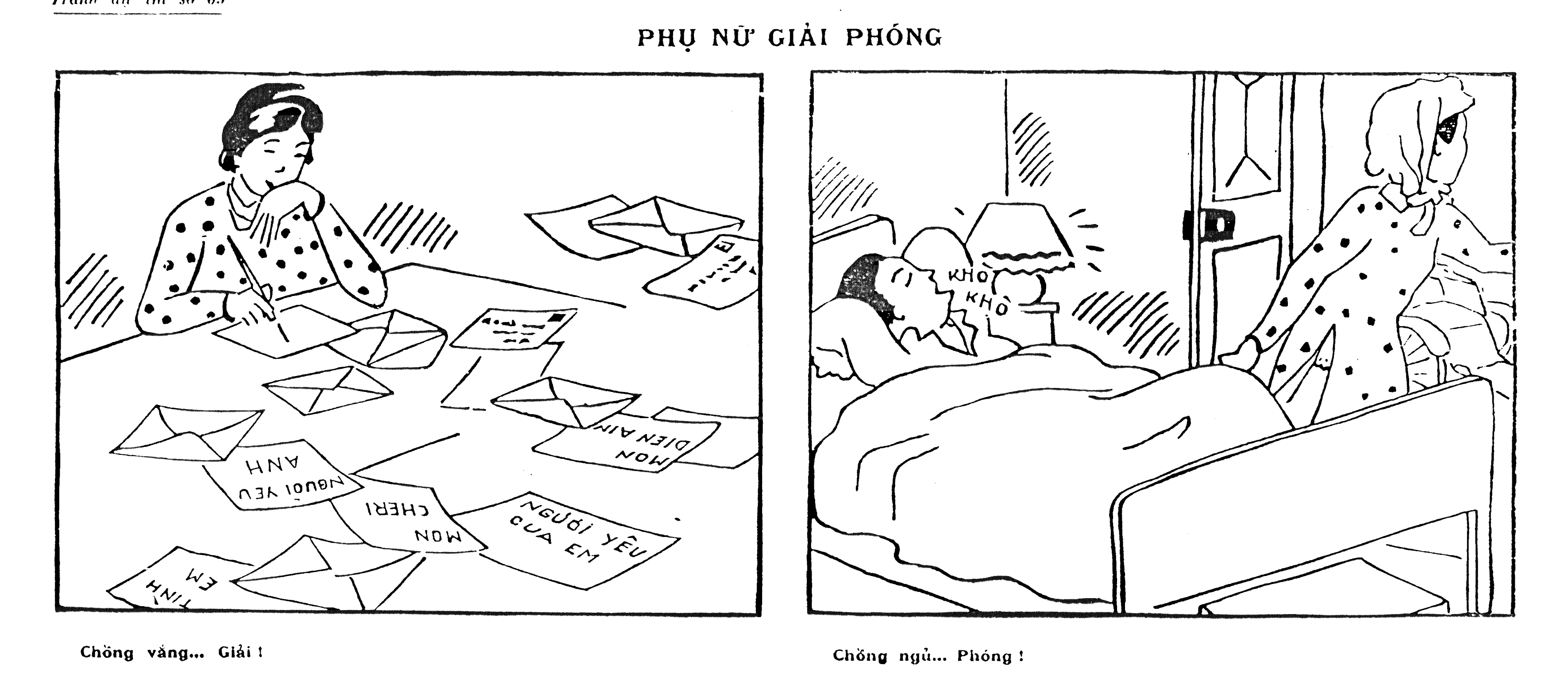
Phong
hoa, n°56, 21/07/1933
Pour en finir avec ce thème, voici une autre situation qui reflète l'idée de "La libération de la femme" (phu nu giai phong) qui est le titre de ces deux dessins. A gauche, une jeune femme moderne, la plume à la main, est en train d'écrire des lettres d'amour à son amant. Sur les papiers qui traînent sur la table, à côté des enveloppes, on peut lire: "Mon amour" (nguoi yêu cua em), ou d'autres formules de ce genre; il y en a même qui sont écrites en français: "Mon chéri", "Mon bien- aimé". Ce détail, comme la raie sur le côté montre qu'il s'agit bien d'une femme moderne, non seulement elle sait lire et écrire, mais elle connaît encore le français. Effectivement, dans l'ancienne société vietnamienne la femme était souvent privée de ce droit, élémentaire pourtant. Pas plus tard que les années 1920, il n'était pas rare que les parents des familles conservatrices déchirent les cahiers de leur fille, empêchée d'aller à l'école, et qui devait apprendre à lire et à écrire en cachette. Ils agissaient de la sorte car, en eux-mêmes, ils avaient peur que si leur fille savait lire et écrire, elle écrirait des lettres d'amour à ses amants: un délit moral impardonnable car les sentiments personnels n'avaient pas droit de cité chez les moralistes et les filles ne pouvaient pas choisir elles-mêmes leur compagnon.
La légende du dessin de gauche indique que la jeune femme profite de l'absence du mari (chông vang) pour écrire des lettres d'amour. A droite, quand le mari dort (chông ngu) elle le quitte d'un pas pressé (phong). Il s'agit ici d'un jeu de mots car giai phong veut dire "libération".
La pénétration du mode vie moderne se traduit aussi par le nouveau comportement des jeunes dans les rapports inter-sexes. Dans l'ancien temps, les couples mariés ou non, ne devaient pas se montrer en public dans des attitudes familières. Jamais on ne les voyait se toucher, se tenir par la main dans une promenade. Quand ils allaient quelque part ensemble, en général le mari précédait la femme de quelques pas pour ne pas attirer les regards ou alimenter des commentaires fâcheux, et surtout la femme devait suivre le mari afin de respecter l'autorité maritale. Il convient de signaler que ces comportements ne s'appliquaient qu'aux couches dirigeantes (mandarinat et ses prolongements au niveau local). Le peuple ordinaire se montrait moins pudique et moins ridicule, toutefois le comportement moderne de la jeune génération (se tenir par la main ou par la taille) n'était pas d'usage non plus.
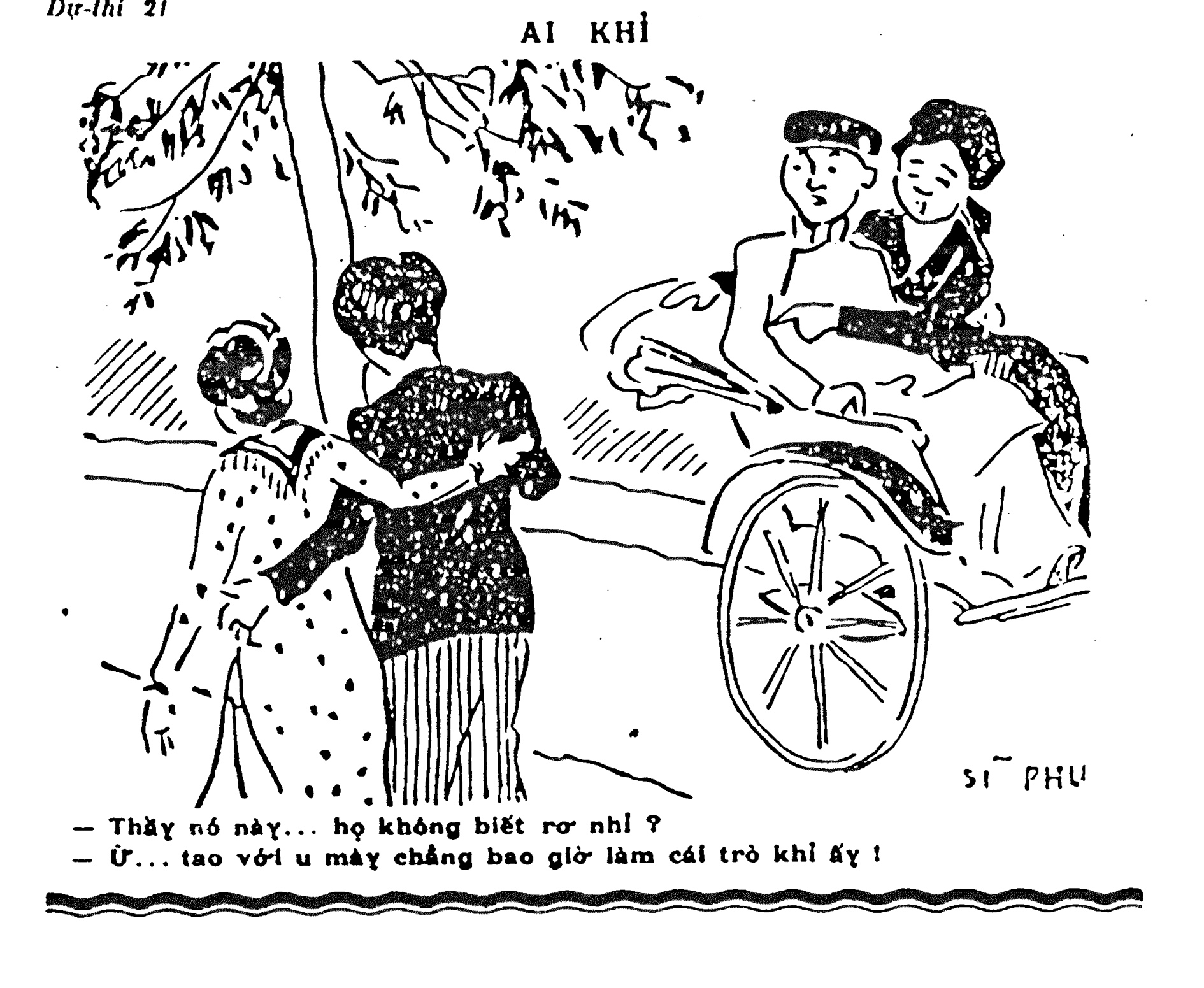
Phong
hoa, n° 75, 01/12/1933
Sur ce dessin l'illustrateur, Si phu, veut montrer le contraste dans le comportement amoureux de deux générations sous le titre : "Lesquels font des singeries?" (Ai khi). Le vieux couple, assis dans un pousse-pousse est étonné par un couple d'amoureux en train de se promener, qu'il croise sur son chemin. En effet, les deux jeunes marchent côte à côte et se tiennent par la taille, un comportement que le vieux couple ne peut pas supporter. La femme fait alors remarquer à son mari:
- Tiens, regarde... Ils n'ont vraiment pas honte ?
Le mari approuve la remarque de sa femme et lui dit:
- C'est vrai ... moi et toi, on n'a jamais fait ces singeries!
A titre d'exemple le journal Phong hoa donne un échantillon de couples-types de cette époque. De gauche à droite, le niveau de notoriété et la condition sociale décroissent d'un couple à l'autre: on part du sommet pour arriver à la base. Le premier couple, français, est habillé élégamment; l'homme tient la femme par le bras: il y a bien contact physique. Il représentent un couple de dignitaires français, Résident, directeur ... La légende indique qu'il s'agit de "Madame (Bà dâm) et Monsieur (me su)", -ces deux termes ont été vietnamisés avec certes des déviations phonétiques. L'illustrateur a placé "Madame" devant "Monsieur" dans la légende pour montrer sans doute que les Français sont plus galants que les Vietnamiens.
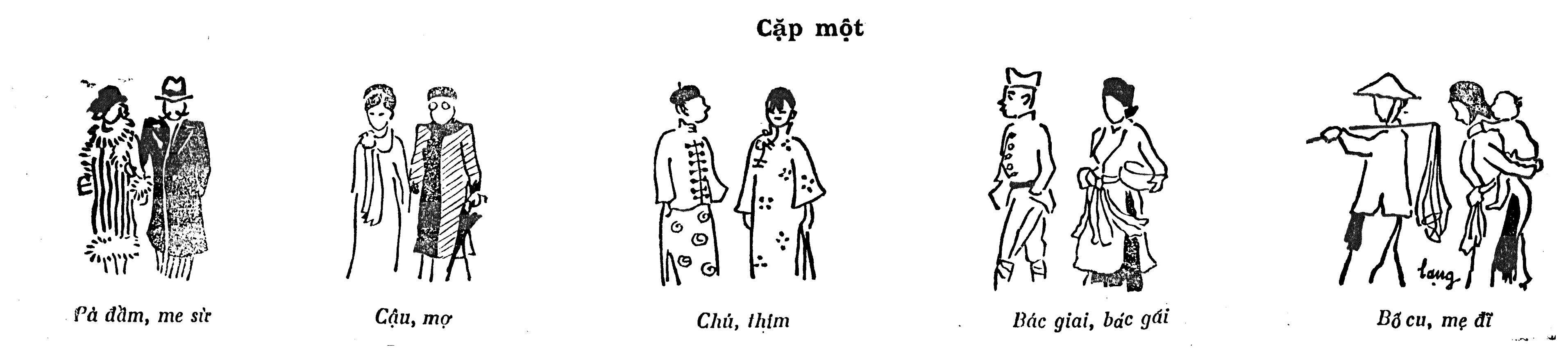
Phong
hoa, n°32, 03/02/1933
Le couple suivant est formé d'un mari d'un certain âge, le représentant de la vieille génération. Il s'habille à la traditionnelle avec turban et tunique, et tient à la main gauche le symbole de notabilité, le parapluie. A côté de lui, sa femme qui a l'air nettement plus jeune porte une tenue moderne avec un châle autour du cou. Ils sont côte à côte, cependant ils ne se tiennent ni par le bras ni autrement car le contact physique en public est banni par la pudeur et surtout par la morale. Enfin, ils représentent ici un mandarin et sa femme. Le port des lunettes symbolise pour l'homme la culture (des lettrés). La légende "câu mo" rappelle qu'ils sont citadins, en effet, en ville les enfants appellent le père câu et la mère, mo. Quand le mari ou la femme s'adresse à sa ou son conjoint(e) il (elle) se substitue aux enfants en appelant l'autre également câu ou mo.
Le troisième couple est chinois. Aussi bien le mari que la femme sont habillés à la chinoise. Sur le plan social, ils se trouvent dans la bonne moyenne. Leur sens du commerce les place dans des conditions sociales acceptables. En effet, la quasi totalité des Chinois vivaient au Vietnam comme ailleurs du commerce; en tant qu'immigrés le régime colonial ne leur permettait pas d'accéder au fonctionnariat, d'ailleurs ils n'étaient pas très demandeurs non plus. La communauté chinoise de Hà nôi se regroupait, entre autres quartiers, dans la rue Hàng buôm (rue des voiles -de bateau-), la rue des restaurants chinois (cao lâu) dans le vieux Hà nôi. La légende "Chu, thim" précise leur origine nationale. En effet, quand les Vietnamiens s'adressent à un Chinois ils l'appellent chu, qui veut dire "oncle", le frère cadet du père et non l'aîné; dans certains contextes chu veut dire aussi le frère cadet du mari ou son propre frère cadet si c'est l'homme qui parle. Thim est l'équivalent de chu pour l'autre sexe.
La quatrième couple, d'après la légende "Bac giai, bac gai", (oncle, tante) il s'agit d'un couple de paysans de condition acceptable. Le mari est un légionnaire ou un militaire de l'armée coloniale. Il devance sa femme de quelques pas, l'inverse serait non conforme aux représentations homme-femme: la femme plus faible doit suivre le mari. Ils ne marchent pas côte à côte non plus, car surtout à la campagne, cela revient à attirer les critiques. La femme est dans une tenue de paysanne, tunique large attachée par une ceinture et pantalon noir.
Enfin, le dernier couple, à droite du dessin, représente le couple de paysans pauvres. On appelle l'homme "Bô cu", et la femme "me di". Ces termes sont certes liés à la culture populaire villageoise, cependant ils ne sont pas très élogieux car en langage familier, cu veut dire le zizi, et di la prostituée sans connotation péjorative cependant, et thang cu pour dire "le petit" (thang, terme familier pour dire un garçon, un homme), con di pour dire "la petite" (de même con est l'équivalent de thang pour le représentant du "sexe faible"). En milieu paysan, plus on est pauvre plus les noms que portent les enfants sont laids. Il arrive de nommer l'enfant de noms très laids quand les parents ont eu du mal à l'avoir, ceci pour détourner l'attention des esprits qui voudraient emporter avec eux, car on pense que plus le nom est joli plus ça attire les esprits (malfaisants).
Au fond, le comportement des jeunes gagnés aux idées modernes traduit aussi un changement dans la façon de voir le monde. La vie matérielle du monde moderne qui les entoure exerce une influence certaine sur eux. Dans la conception ancienne de la société, le fait d'être parvenu au mandarinat présentait une valeur sûre et inégalée. L'argent n'avait qu'un rôle "mineur", et ne constituait pas un signe de distinction sociale reconnu explicitement. L'économie rurale de subsistance et à une échelle très réduite, et l'absence de grand marché à dimension nationale ou internationale faisaient de l'argent un instrument d'échange, certes nécessaire, mais qui ne tenait pas le rôle de "nerf de guerre" qu'il tient dans l'économie de marché.
Avec la colonisation, l'économie s'est développée et s'ouvrait sur les débouchés régionaux puis mondiaux. Ce qui a permis l'émergence d'une petite bourgeoisie marchande, surtout dans le Sud où on faisait des affaires (làm ap phe, terme emprunté au vocabulaire français). L'argent rivalisait ainsi avec le prestige détenu jusqu'alors par les mandarins, et s'affirmait dans la vie quotidienne comme une autre valeur sûre. Les jeunes grandis dans le nouveau contexte socio-économique n'étaient pas indifférents du pouvoir de l'argent. C'est cette idée que le dessinateur a voulu illustrer sous le titre "La jeunesse vietnamienne".
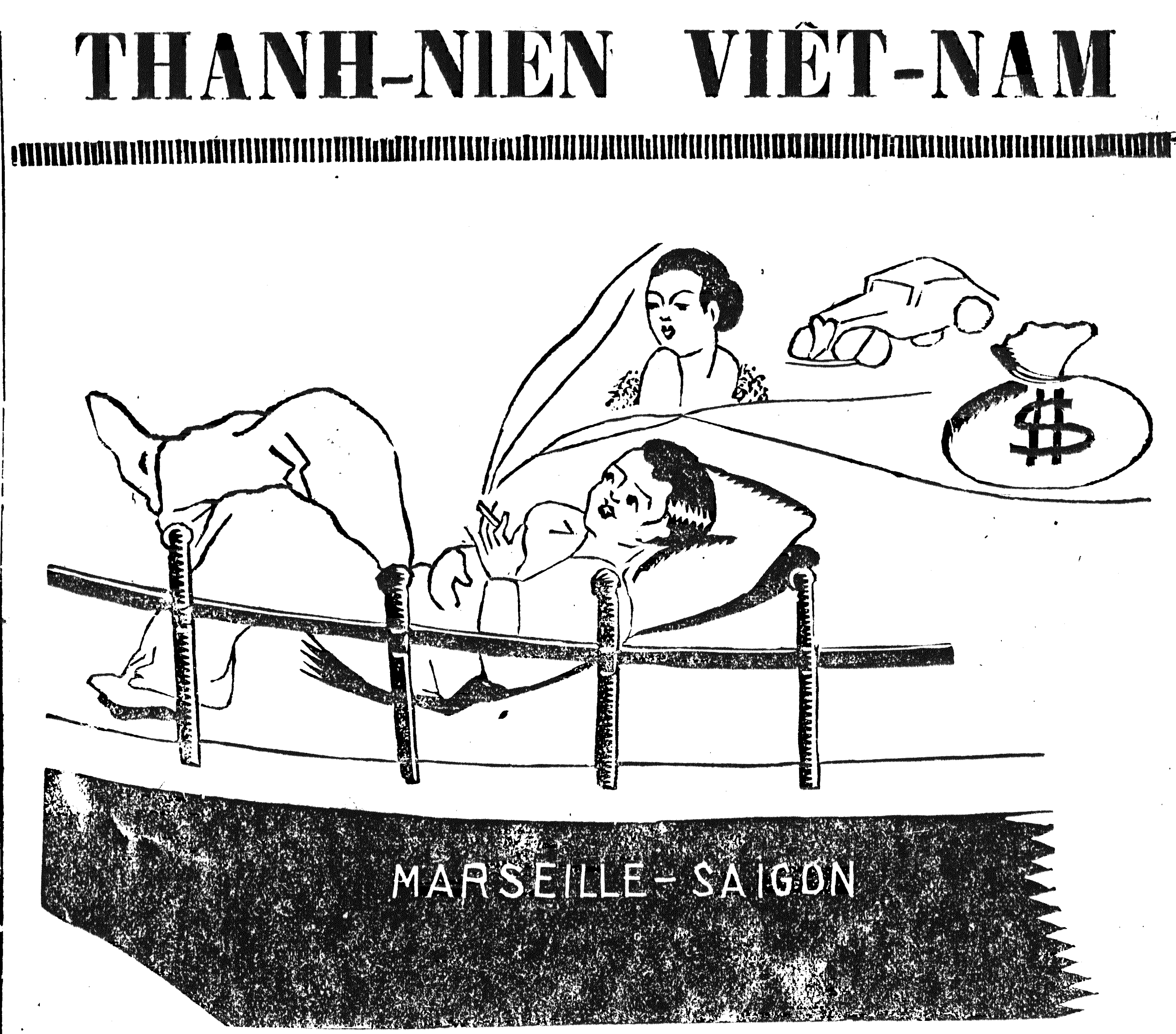
Dàn
bà moi, n°24, 03/06/1935
On voit ici, un jeune homme couché sur le pont d'un bateau qui le ramène au Vietnam après un séjour en France. Il rêve à son retour d'avoir une jolie jeune femme, une belle voiture et beaucoup d'argent.
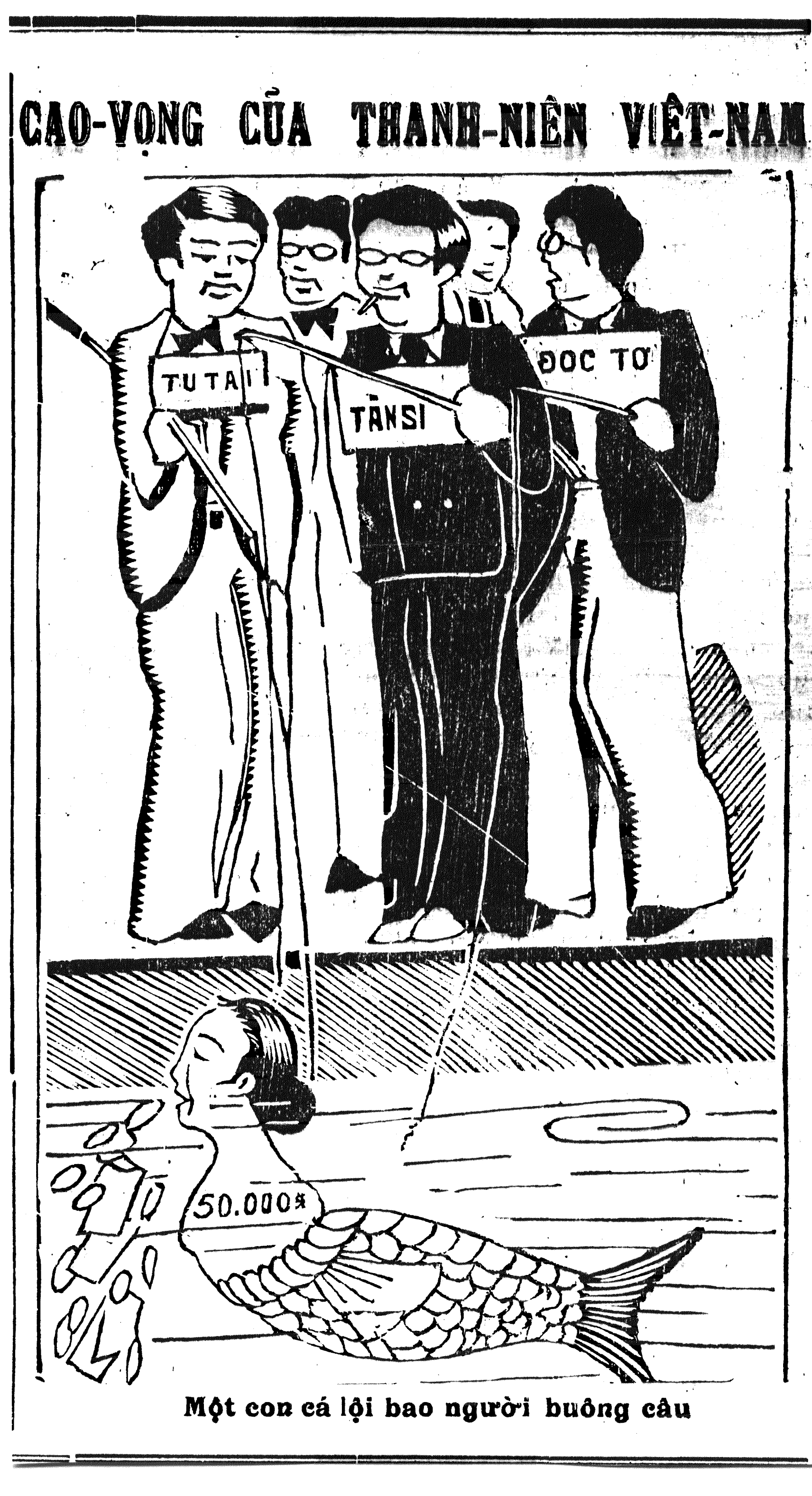
Dàn
bà moi, n°20, 04/05/1935
Ainsi l'argent et la femme fortunée deviennent l'objet de convoitise d'une frange de la jeune génération gagnée au confort matériel. On voit dans ce dessin sous le titre "Les voeux de la jeunesse", les représentants de cette génération ayant suivi des cursus modernes de formation, couche privilégiée qui essaie sans scrupule de profiter de la situation aux moindres frais. Ils s'habillent à l'européenne, costume et noeud papillon. Leur première préoccupation ? Arriver à "pêcher" une fille fortunée que l'on voit évoluer dans l'eau sous la forme d'une sirène, un "poisson" qui vaut 50.000 $. Les trois candidats, à gauche le bachelier (tu tài), au centre le docteur (tân si) et à droite le médecin (dôc to, terme emprunté au mot français "docteur") rivalisent dans cette course au trésor. En dépit de leur apparence moderne, les garçons ne font que reprendre les pratiques traditionnelles: s'appuyer sur leur diplôme pour se valoriser dans la quête de la femme. Mais pour eux l'argent devient le premier critère de choix, à la différence de leurs aînés qui choisissaient la femme en fonction de son ascendance, de sa moralité.
La modernité n'est certes pas une valeur en soi, elle peut aussi bien comporter du progrès que de la médiocrité.
Quoi qu'il en soit, sur le plan social la femme s'affirme de plus en plus par sa présence et préoccupe l'homme dans le bon sens comme dans la mauvais sens du terme. Le confucianisme en déclin laisse la place aux idées réformistes qui permettent à l'individu de repenser son rôle dans la famille et dans la société. Il (re)découvre l'amour autrefois "ignoré", car c'était le devoir qui liait les époux et non les sentiments. Les parents choisissaient leur future bru en fonction de son milieu social, il fallait qu'il fût équivalent au leur sur le plan du prestige et de la notabilité, ce qui était résumé dans l'expression môn dang hô dôi; c'était le premier et sans doute le seul critère de choix pour les couches dirigeantes dans le choix de la future bru. Les couches sociales inférieures prêtaient attention à l'ascendance de celle-ci, à sa moralité et à son habileté dans les travaux manuels. La beauté physique n'était certes pas un avantage pour la fille, au contraire elle pouvait lui valoir des critiques. L'écrivain-reporter Ngô Tât Tô en donne un exemple dans son roman Lêu chong (La tente et le bat-flanc), retraçant les différents parcours du candidat, l'atmosphère dans les concours mandarinaux, et tous les rituels liés à cette tradition. La famille d'un lauréat qui porte le titre de tiên si (docteur, appelé encore familièrement Ong Nghè à son retour au village), et qui est déjà promis à une fille réputée pour sa beauté, défait cette alliance au profit d'une autre fille de même condition sociale mais moins jolie 1. Car l'ancienne génération des lettrés prenait pour parole d'évangile l'expression hông nhan bac mênh (hông nhan: beauté; bac mênh: destin ingrat), qui "prédit" que la beauté est inséparable du malheur. L'héroïne Thuy Kiêu dans le roman classique en vers (Truyên Kiêu) de Nguyên Du en est selon eux la preuve irréfutable. Mais la nouvelle vague neutralise l'ancienne et inverse les valeurs. Hier sacrée, la piété filiale, passe désormais après l'amour.
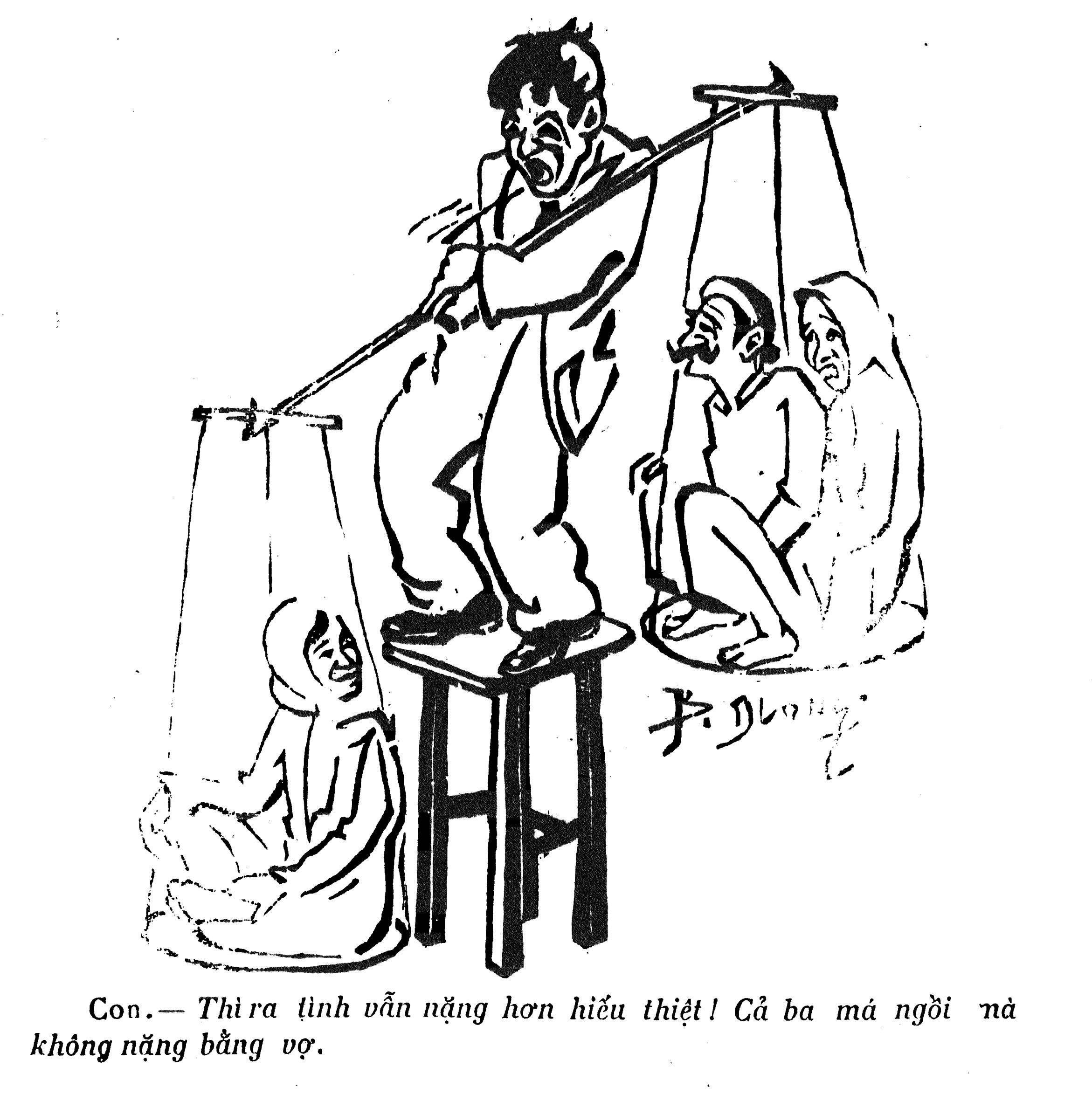
Dàn
bà moi, n°7, 12/01/1935
Ce dessin illustre ce renversement de situation. L'homme, au milieu, dans le rôle du justicier, met sur sa "balance" d'un côté les parents et de l'autre la femme. Il se révèle que celle-ci pèse plus lourd que ceux-là. Il essaie de changer de point d'appui en se penchant en arrière pour trouver l'équilibre, mais rien à faire, les choses sont ainsi. La légende attribue au fils des paroles pour le moins subversives à l'égard de la tradition:
- Ainsi l'amour est bien plus fort que la piété filiale! Et le père et la mère ensemble ne pèsent pas aussi lourd que la femme.
A part la famille, la superstition constitue un autre angle d'attaque du journal Phong Hoa contre la tradition. Les cérémonies cultuelles liées aux divers génies font sans cesse l'objet d'attaques dans les colonnes du journal. L'une des formes de culte les plus pratiquées au Vietnam, et surtout par les femmes, était appelée familièrement lên dông (entrer en transe). Ce culte, dérivé du taoïsme, se pratiquait dans les temples réservés à cet effet (dên), qui n'ont rien à voir avec la pagode, lieu de culte du Bouddha, ou avec la maison communale (dinh). Les génies vénérés pouvaient être aussi bien un héros national qu'un simple individu; mais si ce dernier était vénéré en tant que génie c'est pour des "raisons" très précises: soit il avait été victime d'une mort accidentelle, soit sa mort représentait une injustice ou soit encore il était mort à une heure sacrée (gio thiêng) sans parler le cas des bienfaiteurs ou sauveurs du village. polit0004.pngLes gens font des rapprochements avec les événements de la vie villageoise: perte de récoltes, épidémies, maladies non expliquées et répétitives qui atteignent plusieurs personnes sur une courte période, etc. La vénération de ces âmes errantes a pour but formel d'éloigner les malheurs en s'adressant à elles, qui sont censées détenir la clef. Cette forme de culte n'exclut pas la pratique d'autres religions, mais elle s'adresse tout de même à des couches plus ou moins aisées. Sinon chaque couche sociale fréquente son propre temple, vénère son propre génie. Il semble que les génies non plus ne sont pas indifférents à la richesse. Quoi qu'il en soit, ce culte indéracinable a même immigré en France, et actuellement il renaît au Vietnam après une période d'interdiction et de campagnes contre les superstitions.
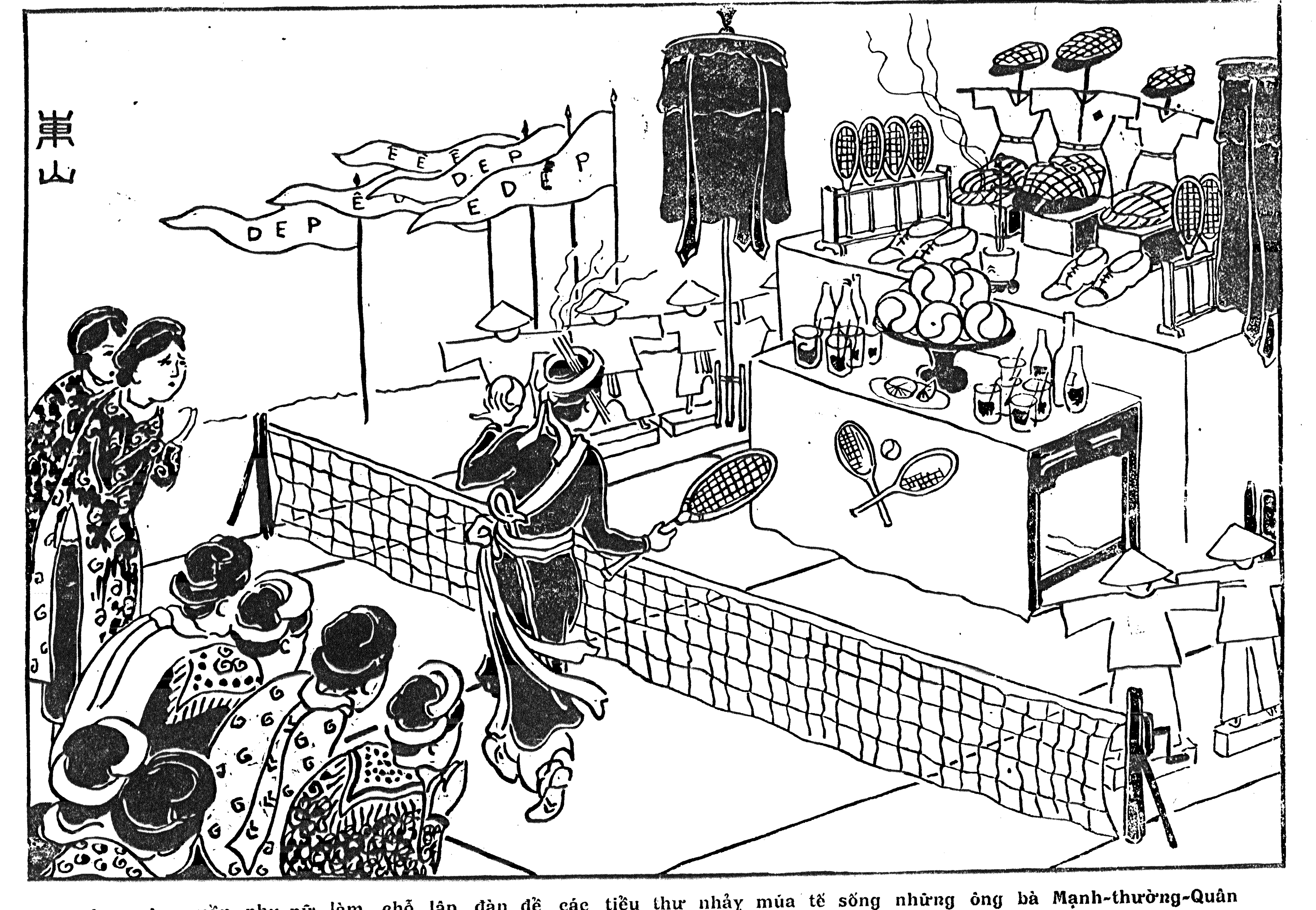
Phong
hoa, n°61, 26/08/1933
Cette dénonciation de la superstition est illustrée ici par Dông son (le nom figure en caractères chinois, en haut à gauche), alias Nhât Linh, sous le titre "Une bonne idée pour que les courts de tennis ne soient pas déserts". Dans les années 1930, le sport, en particulier le tennis, était à la mode chez les jeunes des deux sexes. Madame Hoàng Xuân Han a été citée par Ngày nay dans son numéro du 1er août 1937 comme l'une des pionnières du tennis au Vietnam. Ici le dessinateur a transformé le terrain de tennis en lieu de culte. Au milieu, une femme, la raquette dans une main et la balle dans l'autre, représente celle qui est en transe. Elle est habillée d'une somptueuse tenue de circonstance. A sa taille est accrochée une épée, sur sa tête, quelques bâtons d'encens sont retenus par le turban, ce sont les indispensables objets de culte. Derrière elle, un groupe de femmes, les unes accroupies et les autres debout, les mains jointes, suivent la transe en priant. Leur tenue suggère qu'elles ne sont pas de simples paysannes n'ayant pas de quoi manger. De l'autre côté du filet, sur l'autel, les tenues de sport (polo, short et casquette) et les deux rangées de raquettes à chaque bout de l'autel ont pris la place prestigieuse des génies. Juste devant les "génies", on voit deux paires de chaussures placées de part et d'autre de l'encensoir. Ce détail signifierait dans la vie courante le mépris total, un blasphème à l'égard des cultes, car selon la conception vietnamienne, ce qu'on porte aux pieds représente la bassesse au degré zéro. Plus bas, à la place des offrandes on voit un plateau de balles de tennis en guise de fruits, des bouteilles de sirop et des verres à la place de l'alcool. En bordure du terrain, flottent des fanions portant l'inscription "dep", qui veut dire jolie et fait allusion à la femme, à la place d'autres termes à caractère cultuel.
Si on essaie de comprendre le rapport de ce dessin avec la réalité, autrement dit "quelle était l'extension à cette époque de la pratique du tennis chez les femmes?", la caricature, pour le moins surréaliste, signifie, peut-être qu'en dépit de leurs aspirations modernes, la plupart des femmes se tournaient encore vers leurs pratiques cultuelles habituelles en désertant les courts de tennis.
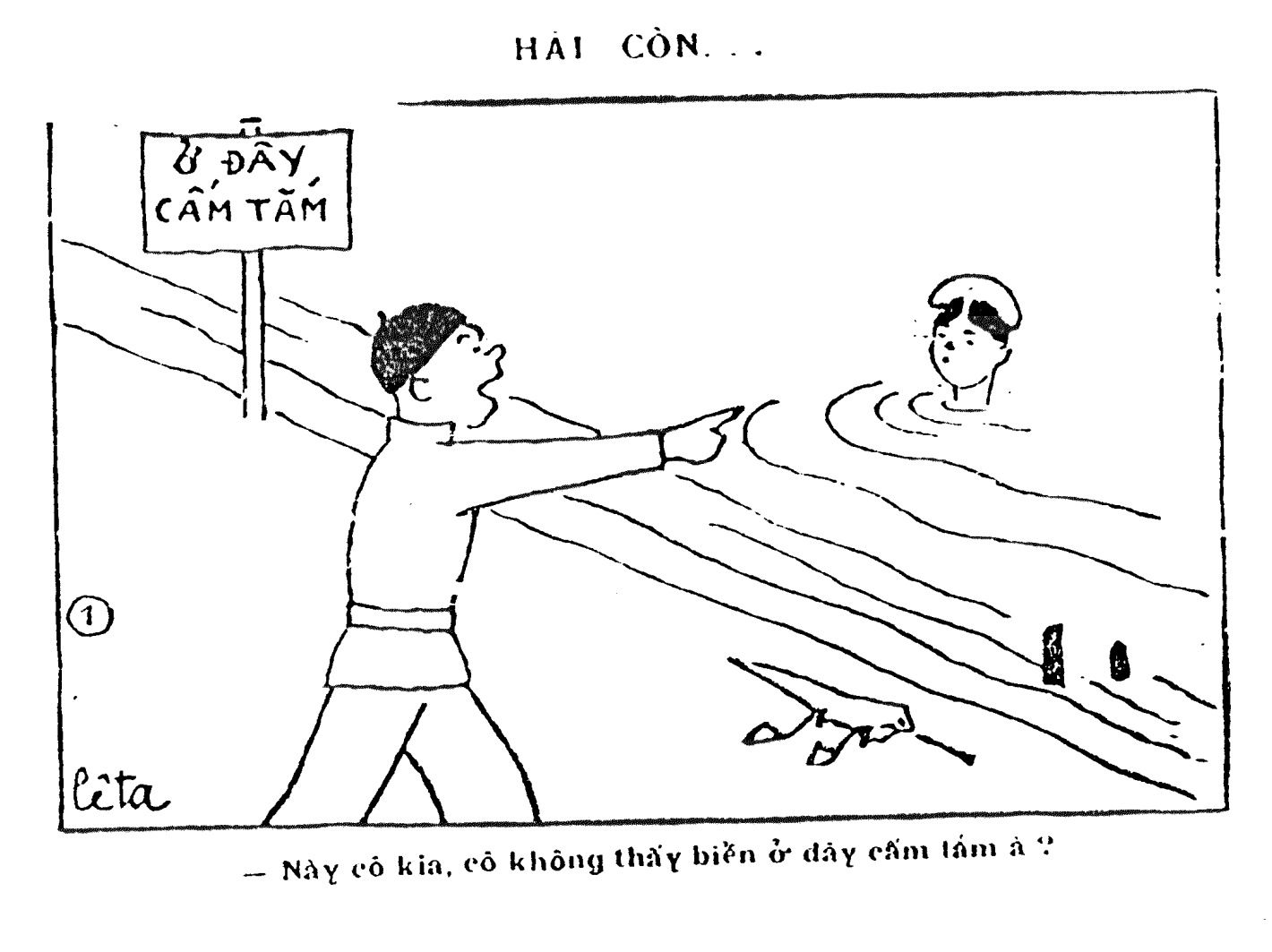
Phong
hoa, n°101, 08/06/1934
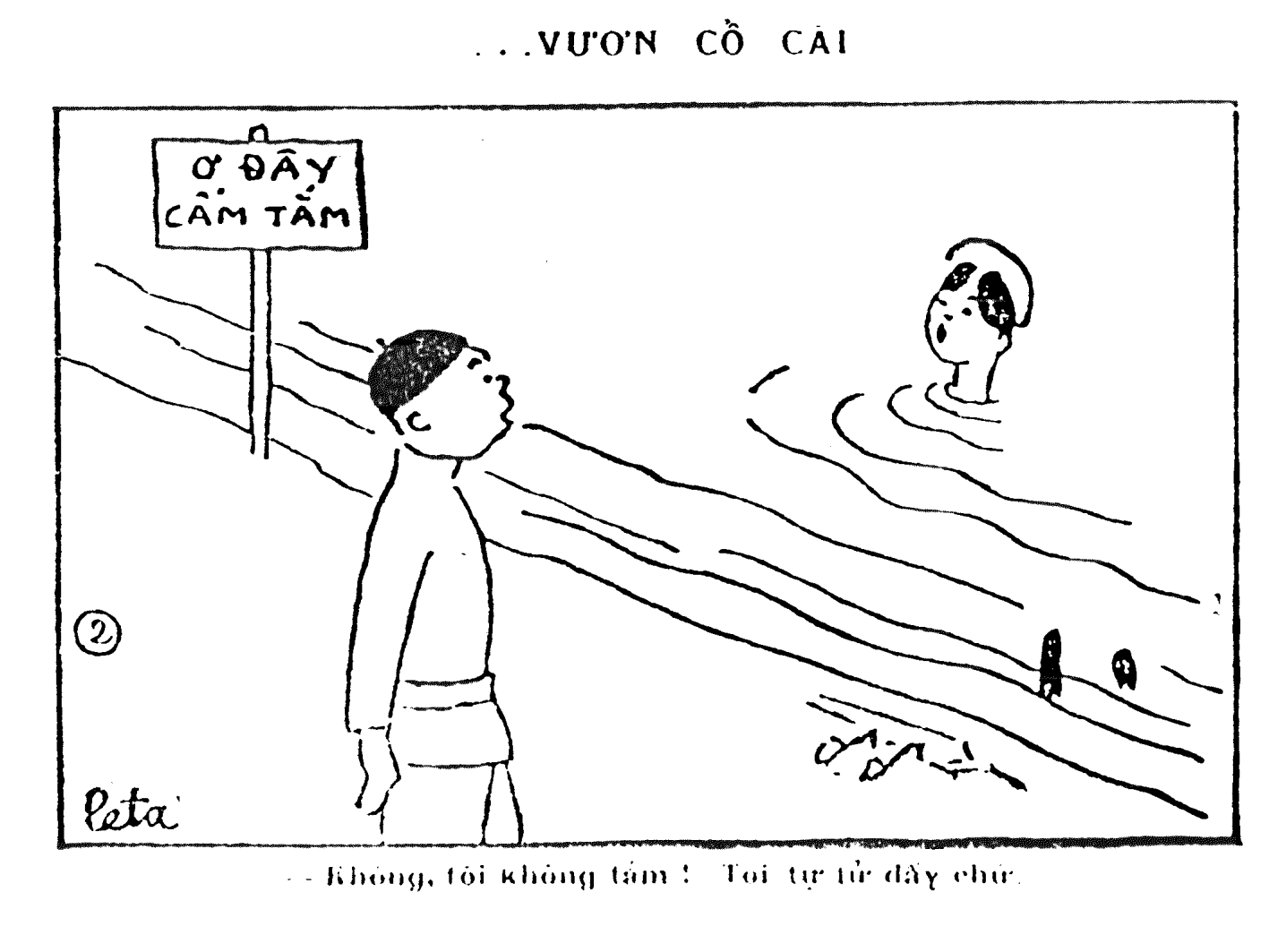
La libération des moeurs se passe comme la libération des prix dans les ex-Pays de l'Est bureaucratiques et totalitaires, dans l'un et l'autre cas, il faut des gens pour payer les pots cassés. Dans le contexte du Vietnam, la libération des moeurs avait son prix, elle se mesurait aussi au nombre des femmes qui se suicidaient, la plupart d'entre elles en se jetant dans les lacs de Hà nôi 1. Si ce drame social a toujours existé dans la société vietnamienne, il a pris un tournant alarmant dans les années 1930 et une signification particulière qui n'avait rien à voir avec celles connues jusqu'alors. Car il s'agissait non seulement du désespoir, mais encore de la dernière issue de l'individu confronté aux vicissitudes de la vie. Les échos dans la presse à ce sujet laissent penser que le drame était quotidien. C'est l'idée qui est illustrée ici avec un humour noir.
Sur le dessin de gauche un passant rappelle avec innocence, à la fille qui se trouve dans l'eau, que la baignade est interdite. Cette interdiction est signalée sur la pancarte "O dây câm tam". Mais la fille lui répond dans le dessin de droite:
- Non, je ne me baigne pas. Je me suicide.
Bien que les dessins humoristiques et satiriques ne puissent pas servir de preuves pour établir des faits ou des phénomènes sociaux, ils illustrent cependant les excès, les transgressions jugées inadmissibles par l'opinion. Ils agissent comme la conscience devant les faits. Ils montrent le côté risible ou ridicule des personnages critiqués, et c'est à ce titre qu'ils peuvent être considérés comme un indicateur de tendance du baromètre social. Certes, suivant les journaux, le ridicule est différent car les dessins représentent le prolongement des idées que chaque journal est censé défendre. Pourquoi donc les caricatures parues dans Phong hoa et Ngày nay plutôt que celles des autres journaux ? De fait, ce choix s'impose. Premièrement pour une question d'unité: la plupart des sujets que nous traitons ont été évoqués par ces journaux qui, par ailleurs, avaient bénéficié d'une durée relativement longue, cinq ans pour le Phong hoa et dix ans pour Ngày nay. S'ils ont pu exister pendant ces longues années, c'est parce qu'ils étaient lus, car ils étaient tenus à une rigueur financière au même titre que n'importe quelle entreprise commerciale. Leur tirage moyen se situait aux environs de 6.000 exemplaires avec des pointes de plus de 10.000, un chiffre significatif pour l'époque, sans parler du fait que le journal pouvait passer de main en main. Ce qui permet d'estimer le nombre de lecteurs à quelques dizaines de milliers. Par ailleurs, si les gens les lisaient, c'est parce qu'ils répondaient à leurs aspirations, qu'il y avait bien une demande, par conséquent ces journaux représentaient bien une tendance de la société qui aspirait aux idées modernes véhiculées dans leurs colonnes. On peut ne pas être d'accord, pour diverses raisons, avec ces journaux, mais il faut reconnaître qu'ils étaient dirigés par un groupe progressiste, le Tu Luc Van Doàn, qui savait où il allait. Les transformations sociales préconisées par ce groupe étaient pour le moins radicales et sans complaisance avec aucune couche sociale, fût-elle victime ou dirigeante. Le seul reproche qu'on puisse leur faire ce serait qu'ils n'arrivaient pas à établir une base sociale en milieu rural, en dépit de leurs préoccupations et de leurs initiatives. En effet ce groupe a fondé l'association Anh sang (La lumière) destinée à apporter du progrès à la campagne en abattant des vieilles coutumes arriérées, sans parvenir à un résultat significatif. Par exemple, Anh sang a bien proposé un modèle d'habitation conçu pour les villageois en prenant en compte l'hygiène et le côté pratique de la vie rurale. Mais ce modèle est resté à l'étape de projet car il est sans rapport avec les moyens matériels des paysans.
Le fait que Phong hoa a été le premier journal à avoir introduit les caricatures dans la presse, et leur abondance, pourrait être invoqué comme critères de choix, mais ce ne sont que des arguments mineurs. Par ailleurs la longévité de ces deux journaux permet aussi de voir s'ils n'ont pas dévié de leurs idées affichées, il s'avère qu'ils leur ont été fidèles d'un bout à l'autre. Ce qui confirme leur ténacité pour faire de la société vietnamienne une société moderne, libérée des entraves et des forces d'inertie qui retiennent "le char" et l'empêchent d'avancer, pour reprendre l'image de Ngô Tât Tô qui compare le pays à un "char à boeufs" tiré d'un côté par les intellectuels et poussé de l'autre par les paysans 1. Toutes ces raisons font des caricatures de ces journaux les plus représentatives d'une société en transformations.
CHAPITRE 6
D E L ' I N T I M I T E
A L A V I E S O C I A L E
LES IDENTITES CORPORELLES
L'Asie du Sud-Est est l'une des régions où la densité ethnique est la plus importante au monde. Rien qu'au Nord Vietnam, les recensements actuels ne dénombrent pas moins de trente-six ethnies différentes dont les populations varient de quelques milliers, comme dans le cas des Lu, des Sila, des Puna, à plusieurs centaines de milliers chez les Tay, les Thai, les Muong, pour ne citer que les plus connus 1. Ces îlots ethniques sont séparés par la mer humaine formée de Vietnamiens qui représentent plus de 80 % de la population totale. Dans un temps reculé ces derniers auraient partagé avec d'autres minorités et particulièrement avec les Muong et les Thai un certain mode de vie, certaines moeurs et coutumes, certaines pratiques cultuelles, et certains aspects esthétiques. La découverte récente des dinh construits sur pilotis, des motifs sur les tambours de bronze qui attestent l'existence de cette architecture commune à la plupart des ethnies de la région, les vestiges des cultes divers aujourd'hui éteints, et la survie de certaines moeurs liées au rapport homme-femme jusqu'à la colonisation, laissent bien des spécialistes du Vietnam perplexes, qui se posent maintenant la question de leurs origines culturelles et historiques. Les disputes entre Vietnamiens et Chinois sur l'appropriation de la civilisation dongsonienne, -l'époque de la dynastie des Hung, 1000 ans av. J.C.-, bien que moins passionnées que celles sur la civilisation hoabinhienne 1, matérialisée par l'existence des tambours de bronze, n'ont fait ni vainqueur ni vaincu. Si les Vietnamiens reconnaissent leurs origines "sauvages" en en fournissant la preuve "irréfutable" avec les motifs de sculpture des deux exemplaires de "tonneaux" de bronze trouvés à Dào thinh (Thap dông Dào thinh) et visibles l'un au Musée d'Histoire, et l'autre au Musée des Beaux-Arts à Hà nôi, les Chinois, quant à eux en tant que civilisés depuis toujours, auraient honte de reconnaître leurs ancêtres figurés sur ces vestiges archéologiques. La dispute prendrait alors fin à l'avantage des Vietnamiens. En effet, sur le "couvercle" de ces deux "tonneaux" (thap), on voit quatre couples, disposés suivant les quatre points cardinaux, en train de copuler: la femme allongée "par terre" et l'homme dessus dont le sexe, bien visible, touche celui de la femme. Un motif digne des "sauvages" devenu oeuvre d'art. Une société "civilisée" n'aurait jamais permis cette représentation pour le moins indiscrète. Les Vietnamiens auraient été aussi "sauvages" que les autres ethnies qui les entouraient avant la visite de la Chine. Mais les temps ont changé. Pourquoi diable les Vietnamiens "appartenant" à la même aire culturelle auraient-ils fait bande à part au cours de leur histoire, pour se couler dans le "moule confucéen"? Pourquoi auraient-ils abandonné leurs us et coutumes, même les plus anciens, leurs pratiques sociales et cultuelles, leur esthétique, pour se lancer dans un processus d'acculturation? Sans doute au nom de la "civilisation" pour devenir les plus forts, eux qui l'étaient déjà numériquement. Selon toute vraisemblance et d'après Georges Boudarel, "entre le XIIIe et le XVe siècle" il s'est produit une mutation sans précédent dans la société vietnamienne 1. Cette "mutation en profondeur" coïncidait avec l'avènement de la nouvelle dynastie des Trân qui ont usurpé le trône des Ly en 1225 sur l'instigation de Trân Thu Dô, le fondateur des Trân. Durant deux siècles de règne (1225-1413), les Trân n'ont apparemment pas changé grand-chose sur le plan vestimentaire, à part l'interdiction à la population, exception faite pour les femmes, de porter la couleur jaune, réservée à la Cour. Par contre sur le plan administratif, ils ont bouleversé les règles du jeu en nommant les représentants dans chaque village 2, introduit les titres des notables et la hiérarchie (ngôi thu) liée à la place occupée dans les festins, institué, d'après Ngô Tât Tô, le dinh 1, lieu de repos prévu pour les sorties royales dans les villages selon certains auteurs. Ces transformations s'accélèrent avec la domination des Minh qui réglementèrent les us et coutumes, la tenue vestimentaire de chaque couche sociale suivant le modèle chinois. La population avait un mois pour appliquer ces décisions venues d'en-haut 2
LA COULEUR DES DENTS
L'origine de cette tradition, comme celle de bien d'autres, reste obscure. D'après le Docteur Vu Ngoc Huynh, il existe deux principales thèses, l'une légendaire et l'autre nationaliste. La première fait remonter cette coutume à l'époque de la séparation (de corps et de biens) du couple légendaire: Lac Long Quân, descendant des dragons, et la fée Au Co, les ancêtres présumés des Vietnamiens qui ont engendré cent garçons sortis de cent oeufs. Cependant, leur union n'était vraiment pas une réussite, car l'incompatibilité de moeurs et d'humeur, et on les comprend, a fini par les décider à rompre leur vie amoureuse. Or, le partage des enfants leur posait problème car la fée Au Co revendiquait la garde de tous les enfants contrairement à son compagnon qui avançait l'idée d'un partage équitable, 50-50. Ainsi, pour dérouter sa compagne d'hier, Lac Long Quân ne trouva "rien de mieux que de les (les 50 enfants qui le suivraient) rendre méconnaissables au moyen de tatouages, et en leur noircissant les dents" 1. La version nationaliste interprétait cette tradition comme un moyen d'échapper à l'assimilation chinoise, un signe de reconnaissance permettant aux Vietnamiens de se distinguer des Chinois pendant la domination. De l'autre côté, "la réponse du berger à la bergère" ne se fit pas attendre: "Le noircissement des dents était plutôt imposé aux vaincus en signe d'esclavage 2". Au-delà de ces querelles intestines, les propos des uns et des autres sont formellement démentis par les annales des Tcheou en Chine (1109 av. J.C.) et les mémoires de l'historien chinois Seu Ma Tsien de l'époque des Han postérieurs (140-87 av. J.C.), qui ont mentionné que, d'une part, "Les hommes du Viet thuong (les Viet) portaient les cheveux courts pour courir la forêt facilement, se tatouaient le corps, ne portaient pas de chaussures pour grimper plus facilement aux arbres, n'avaient pas de chapeau, se noircissaient les dents avec la chique de bétel" (on verra plus loin que la chique de bétel n'a que peu à voir avec les dents noircies), et que d'autre part, cette tradition était "une pratique particulière au Giao Chi" (Vietnam) 3.
Quoi qu'il en soit le noircissement des dents présente bien des avantages quant à l'hygiène et à la protection, sans parler de son aspect esthétique dont les Vietnamiens étaient fiers. En effet, ils considéraient que l'homme (l'être humain) devait avoir les dents noircies pour se distinguer des animaux, au même titre que les vêtements qui couvrent et protègent le corps. Les expressions "rang trang nhu rang Ngô" (les dents blanches comme celles des Ngô, c'est à dire les Chinois), "rang trang nhu rang cho" (les dents blanches comme celles des chiens), sont des critiques voire des injures qui traduisent une certaine conception de la beauté. A ce propos le docteur Huynh rapporte aussi une anecdote qui lui a été racontée par le docteur Hocquard:
Pendant une fête donnée au palais du gouvernement à Saigon, vers 1890, un officier français s'approche d'un haut mandarin qui regardait danser les invités du gouverneur:
- Eh bien, grand mandarin, chuchote-t-il, que dites-vous de nos Françaises?
- Je les trouve jolies, répond l'Annamite, seulement elles ont des dents de chienne 1.
Quoi qu'il en soit, le noircissement des dents est une opération délicate qui se pratique avec beaucoup de minutie. Cette technique transmise de père en fils nécessite quatre phases successives, du moins la première fois qu'on se noircit les dents, qui peuvent s'étendre sur une vingtaine de jours pour arriver à un résultat convenable. La phase préparatoire qui dure trois jours consiste à brosser, à curer, et à se gargariser avec de l'alcool de riz mélangé avec du jus de citron. Ensuite, on teint les dents en rouge avec une drogue spéciale composée de stick-lac (canh kiên), de jus de citron et d'alcool de riz, pendant dix jours durant lesquels il faut se contenter d'une nourriture légère. L'opération suivante, qui s'étend sur trois nuits, est la teinture proprement dite en noir avec une autre produit qui donnera les résultats attendus: sulfate de fer (phèn den), écorce de grenade séchée (vo luu), cannelle (quê chi), clou de girofle (dinh huong), fleur de badiane (hôi). Enfin, arrive la phase de consolidation avec bien entendu d'autres formules chimiques transmises de génération en génération 1.
On constate par ailleurs que cette tradition s'est répandu chez certains peuples de la région qui va du Sud de la Chine jusqu'aux îles Salomon en Indonésie, en passant par les îles de la Sonde en Malaisie 2. Au Japon, elle a été introduite au plus tard en 920 avant d'être interdite en 1870 à l'avènement de Meïji 3. Toutes les femmes mariées, précise à cet égard un autre auteur, se noircissaient les dents jusqu'au jour où la grand-mère de l'empereur actuel (début Meïji) donna l'exemple d'abandonner cette pratique 4. Apparemment cette mutation culturelle n'a pas produit de vagues au "Pays du soleil levant". Louis Frédéric qui étudie la société japonaise du début de l'ère moderne écrit:
Ce qui est particulier au Japon (...), c'est que, chaque fois, les mutations culturelles résultant de changements politiques furent librement acceptées par le peuple tout entier (avec bien entendu des remous particuliers) non pas par l'effet d'une résignation apathique, mais avec la claire conscience que ces mutations, ces changements relativement subis de culture étaient nécessaires pour le plus grand bien du pays et de ses habitants. (...)
En fait, toutes les réformes furent imposées au peuple par une poignée d'hommes politiques manipulés par les intellectuels qui, afin de se donner l'illusion de penser par eux-mêmes, tentaient désespérément (...) d'adapter tant bien que mal les idées philosophiques, religieuses et politiques de l'Occident à la réalité japonaise 1.
Dans le nord du Vietnam seuls les Muong et les Thai observaient cette tradition du noircissement des dents. Un symbole esthétique et culturel de plus qui rapproche les origines culturelles, voire l'origine historique tout court, de ces peuples de celles des Vietnamiens. La domination chinoise suivie de sinisation ne déracina pas cette tradition qui resta encore vivace et intacte jusqu'à la colonisation. Contrairement au cas du Japon, le noircissement des dents au Vietnam n'a pas été banni par le pouvoir politique fût-il colonial. "Une des façons de s'orner les plus prisées chez l'Annamite, écrit encore E. Langlet au début du siècle, c'est d'avoir les dents noires 2". On aurait pensé que cette tradition était indéracinable face à l'épreuve du temps, et au contact avec d'autres cultures. Mais il se révèle qu'au bout d'une soixantaine années de colonisation, elle cessa progressivement d'être observée scrupuleusement, alors qu'elle avait survécu à bien des défis. "Au XVe siècle, écrit J. Silvestre, quand les mandarins chinois gouvernaient (le Vietnam) au nom du Céleste Empereur, ils voulaient abolir cet usage et alors la révolte éclata sur tous les points 3." Plus tard à l'époque des Tây Son au XVIIIe siècle, Nguyên Huê, le futur roi Quang Trung, en a fait le slogan de mobilisation contre les Thanh (dynastie régnante en Chine qui a occupé le Vietnam), dans la formule magique "Danh cho dê rang den" (combattre pour pouvoir garder les dents noires). Avec le recul, on constate que les dirigeants vietnamiens de toute époque ont toujours su mobiliser leurs compatriotes pour la cause nationale contre l'étranger.
Pour une raison inconnue, le glissement de la couleur des dents du noir au blanc n'a pas soulevé de grands débats à caractère national ou du moins les intellectuels de tous bords ont prêté moins d'attention à cette question qu'à celles liées aux cheveux ou aux vêtements, par exemple. En effet, très peu d'écrits sur cette "essence nationale" ont paru dans la presse ou dans la littérature. Ngô Tât Tô, l'observateur très attentif des moeurs et coutumes, qui a bien consacré dans les années 1930 deux articles l'un au vay et l'autre au tatouage, sur le ton de son humour percutant, n'a pourtant rien écrit, à notre connaissance, sur les dents noires. On est tenté de dire que paradoxalement les Vietnamiens (les hommes) étaient plus attachés, au début de la colonisation, à leur chignon, produit pourtant importé de Chine, qu'à la couleur des dents, une tradition ancestrale qui remonterait au temps des Hùng.
A cette époque ancienne, les Vietnamiens se tatouaient le corps (van than) pour mieux se confondre avec la faune aquatique quand ils allaient dans l'eau, et cette tradition, à en croire Ngô Tât Tô, n'a été abandonnée que sous le règne de Trân Anh Tôn (1293-1314) 1. Les hommes et les femmes avaient encore les cheveux mi-longs qui tombaient au niveau des épaules, il leur arrivait d'en faire des chignons pour ne pas être gênés dans les travaux, ou de les couper très court 1. Hommes comme femmes portaient des parures, des pendentifs ou des anneaux car ils avaient tous les oreilles percées 2. D'après les statues de bronze de cette époque, leurs oreilles, sans doute sous le poids des anneaux, ou en conformité avec une autre coutume qui consistait à se distendre les lobes des oreilles, descendaient jusqu'au niveau des épaules. Sur le plan vestimentaire, les femmes portaient des jupes (vay). Il y en avait de deux sortes: l'une "fermée" (vay kin) faite d'une pièce d'étoffe dont les deux bouts étaient cousus, et l'autre "ouverte" (vay mo), plus courte et non cousue. Ces vêtements moulaient bien le corps de la femme qui laissait voir par la même occasion sa silhouette. Par ailleurs il s'agit bien là d'un vêtement de femme très répandu chez les minorités ethniques et même chez les autres peuples dominants de l'Asie du Sud-Est; on le trouve encore chez les Muong, les Thai, les Tay, les Thô, les Lao, etc., à quelques variantes près. Pour le haut, les femmes avaient d'abord le yêm, le couvre-seins, par-dessus lequel elles portaient une sorte de "corset" serrant bien le corps et ouvert devant, l'ensemble tombant au niveau de la taille 3. Les hommes se contentaient d'un couvre-sexe (khô) fait d'une bande de tissu d'environ d'un mètre sur dix centimètres, entourant de part et d'autre les jambes et attaché à la taille. Les Lao s'habillent encore aujourd'hui de cette façon quand ils sont chez eux, c'est leur tenue décontractée à une différence près, c'est que leur pha slong est bien plus large. Si, par ces vêtements les Vietnamiens présentaient beaucoup de similitudes avec les autres peuples, ils se distinguaient d'eux sur un autre plan esthétique, ils avaient bien entendu les dents noircies par une sorte de laque, tradition qui, bien qu'en voie de disparition, survit encore de nos jours.
Si les vietnamiens étaient plus attachés aux cheveux longs qu'à la couleur des dents c'est sans doute parce que les cheveux longs symbolisaient la piété filiale selon la doctrine confucéenne, tandis que les dents noires ne figuraient pas dans les livres canoniques du maître Không (Confucius) 1. Le fait de blanchir les dents remet en cause uniquement l'esthétique et non l'ordre familial et social comme l'abandon des cheveux longs. Mais si l'ordre est contesté c'est le pouvoir en place qui est en cause directement. Placés entre l'esthétique national (le noircissement des dents) et le pouvoir (les cheveux longs), certaines couches "dirigeantes" des lettrés vietnamiens, ont choisi comme par hasard le pouvoir, c'est à dire garder les cheveux longs au détriment des dents noires. C'est logique car les cheveux longs symbolisaient en quelque sorte le pouvoir, lequel permettrait de rétablir l'esthétique alors que celle-ci ne donne pas droit à l'accès au pouvoir. Mais comme le pouvoir des mandarins vietnamiens n'est qu'apparent, sauf à l'égard de leurs "gouvernés" dans la vie quotidienne sous le régime colonial, il finit par s'estomper aussi, et la question des cheveux avec lui.
Il est difficile de situer à quelle époque précise, en quelle année les Vietnamiens ont décidé de blanchir les dents. En tout cas, cette mutation était le résultat direct de la rencontre avec l'Occident. Ce furent les hommes, les premiers, avant les femmes qui "renoncèrent à l'usage traditionnel" 1. "Le contact avec les Européens, écrit encore le docteur Vu Ngoc Huynh, l'adoption de leurs manières de se vêtir, et un peu de paresse aidant, arrivèrent facilement à bout des dernières hésitations". Les femmes ont ensuite emboîté le pas. Les premières qui bravèrent le qu'en-dira-t-on furent les femmes qui fréquentaient les Français. On les appelait les con gai, "désireuses de plaire par tous les moyens à leurs seigneurs et maîtres" 2. S'il n'y avait pas de vrai débat national sur cette question dans la presse, l'opinion publique n'était pas pour autant tendre avec ces pionnières dans le domaine des moeurs. Elles étaient qualifiées de "filles de moeurs légères" ou même de prostituées tout simplement. L'évolution suivait pourtant son cours. La deuxième vague de femmes qui ait renoncé aux dents noires ne furent autre que la nouvelle génération de formation moderne, les institutrices, les étudiantes, etc. L'écrivain Nguyên Công Hoan a rappellé qu'une de ses collègues, institutrice, qui avait blanchi ses dents ne rentrait chez elle qu'à la tombée de la nuit; en arrivant, elle devait éteindre la lumière avant de converser avec sa mère, pour éviter qu'elle ne voie ses dents 3. On en est au début des années 1930. Dans son ouvrage, le docteur Hùynh raconte encore l'anecdote suivante:
Une de nos connaissances, actuellement mandarin provincial, (...) avait déjà les dents teintées quand sa famille s'avisa de l'envoyer, à l'âge de 14 ans, poursuivre ses études en France. Lors de son séjour en Métropole, pour ne pas se singulariser il s'était adressé à un dentiste et lui avait demandé de rendre à sa denture sa coloration naturelle. (...) Un acide dilué fut d'abord essayé sans résultat. Impatient, l'homme de l'art employa la solution forte. (...) Ce fut un véritable désastre: alitement pendant une semaine 1.
En 1938, dans la rubrique môt (mode) du journal Vit duc (Le Canard), une certaine dame nommée Nguyên Thi Thao écrit:
A bas les dents noires, vive les dents blanches!
Mes soeurs, actuellement à Hà nôi, les dents blanches sont devenues une question de mode. C'est ainsi... Seulement j'ai peur de ma mère qui me traiterait de prostituée 2.
Selon toute vraisemblance et d'après nos maigres renseignements sur cette question, le blanchissage des dents pour leur rendre leur couleur naturelle, sous l'influence de la présence d'Européens, a commencé chez les hommes, suivis de très près par les femmes, au plus tard dans les années 1920. Bien que la résistance, liée à la tradition mais sans la charge symbolique, car il s'agissait plutôt d'une question esthétique, fût très forte au début, elle finit par s'estomper au profit de l'évolution en cours devenue de plus en plus marquante dans la décennie suivante. Ce qui caractérise cette période, c'est le rapport de forces en faveur des "dents blanches". On peut donc supposer sans trop de risque d'erreur que ceux et celles qui avaient entre 20 et 30 ans dans les années 1930 ont tourné le dos à la tradition en découvrant que les "dents de chien" présentaient tout de même une certaine beauté. Cependant, ce déferlement ne parvenait à franchir les frontières de la ville qu'à de rares exceptions, pour atteindre la campagne vivant loin des contact avec les Européens.
On constate tout de même que cette mutation, limitée aux milieux urbains, s'est produite surtout sous la pression de la vie matérielle moderne sans qu'il y ait eu l'intervention du pouvoir politique. Les Vietnamiens ont choisi la modernité eux-mêmes sans trop de mal. A cet égard on peut se poser la question de savoir comment en si peu de temps la colonisation est parvenu à les séduire sur ce point alors que la domination chinoise suivie de la sinisation n'était pas arrivée à enrayer cette tradition. La colonisation devait avoir alors son charme secret. D'un autre côté, on est tenté de rapprocher cette question de celle de l'enseignement traditionnel, une véritable institution millénaire qu'on croyait indéboulonnable, et qui a fini elle aussi par disparaître sous la colonisation. Cependant, si l'enseignement traditionnel n'a pas survécu à l'épreuve des temps modernes, c'est surtout parce que la volonté politique a fait ses preuves, ce qui n'était pas le cas pour la couleur des dents. Au fond, peut-être les Vietnamiens ne sont pas si conservateurs qu'ils ne le laissent paraître. Moins doués pour ce qui est de l'invention et de la création, ils se rattrapent par leur capacité d'adaptation. Ce qui présente un inconvénient dans cette démarche, c'est qu'elle finit par les déboussoler, ils ne peuvent plus distinguer ce qui relevait de leur culture de ce qui était emprunté aux autres, car les deux aspects ont tous deux à leurs yeux le même statut. Par ailleurs, placés comme ils l'étaient dans des structures culturelles conformistes qui ne reconnaissaient pas la singularité ni l'originalité, mais qui les condamnaient, les Vietnamiens ne trouvaient pas de contexte favorable à l'expression de leur imagination. Pour ne prendre que l'exemple du concours mandarinal où les règles prescrites interdisaient toute interprétation "fantaisiste", les candidats prévenus qui devaient se conformer à ces préalables, sous peine de sévères punitions, savaient lesquelles des dynasties il fallait louanger, lesquelles blâmer 1. Dans ces conditions, seuls les "je-m'en-foutistes", et ils étaient bien rares, auraient oser prendre un autre chemin, celui de la marginalité.
Cette façon de se situer par rapport aux autres constitue un mécanisme mental déterminant dans les comportements et dans l'évolution des esprits chez les Vietnamiens. C'est elle qui a sans doute pesé de tout son poids dans la métamorphose des dents. Avec la colonisation, les Vietnamiens ont fini par s'apercevoir qu'ils n'étaient plus dans un univers clos réduit à l'existence de quelques pays avoisinants, mais qu'ils occupaient juste un petit territoire d'un grand ensemble nommé le monde. Un glissement des repères géographiques et culturels s'est alors produit pour relativiser leur place réelle dans cet ensemble. La présence d'Européens sur le territoire du pays était certes "insignifiante" sur le plan démographique, cependant elle représentait la forte majorité des humains sur Terre qui avaient les dents blanches. A titre d'exemple, en 1919 la population européenne au Tonkin est estimée à 6.000 contre 6.000.000 de Vietnamiens, soit une moyenne de un pour mille, en 1936 ce rapport dépassait les deux pour mille (2,3 plus exactement). Les Français et autres Européens se concentraient plutôt dans les grands centres urbains et surtout à Hà nôi et Hai phong où les colonies françaises étaient les plus importantes: on atteint alors un chiffre de l'ordre de 3,5%. Dans les années 1930, ce rapport restait inférieur à 5%. A cet égard, les Occidentaux servirent de catalyseurs par rapport à une pratique sociale dominante pour les Vietnamiens, car ils n'étaient pas majoritaires en nombre sur le territoire. Compte tenu de la pression sociale et du poids que le conformisme présentait pour les Vietnamiens, ils ont dans cette logique adopté ce qui leur semblait unanimement admis par les autres bien plus nombreux qu'eux, car la recherche de la singularité et le désir de se distinguer ne représentaient pas à leur yeux une qualité.
A cet égard, l'exemple du Vietnam devient une illustration du propos de Louis Dumont qui, dans la préface de l'ouvrage de Karl Polanyi, écrit:
Le besoin de reconnaissance de l'identité collective se situe précisément au point d'articulation des valeurs universalistes et des cultures particulières: il s'agit en définitive du poids des cultures et de leur interrelation. (...)
Lorsqu'une culture déterminée s'adapte à la culture moderne ou, comme disent les anthropologues, "s'acculture", elle construit normalement des représentations qui la justifient par rapport à la culture dominante. Ces représentations sont si l'on veut une "synthèse" plus ou moins profonde, une sorte d'alliage sui generis des deux sortes de représentations; elles sont deux forces: une force universaliste en relation avec la culture dominante, une force particulariste en relation avec la culture dominée, et pour cette raison ces produits de l'acculturation d'une culture particulière peuvent passer dans la culture dominante ou universelle du moment 1.
Par ailleurs, comme l'individu n'était pas reconnu en tant que tel par les structures sociales traditionnelles, la conformité aux normes dominantes leur semblait alors inéluctable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'irréductibles devant cette mutation culturelle, cependant leur conviction relevait plutôt du conservatisme ou du nationalisme que de la recherche de singularité.
LE VAY OU "L'ESSENCE NATIONALE"
Mais dans d'autres domaines, "la mutation en profondeur" entamée sous les Trân sur le plan administratif, s'était accompagnée d'une période d'acculturation, sans doute la plus importante avant la colonisation, sous les Minh (1414-1427) devenus maîtres du territoire conquis. Désormais les femmes devaient abandonner leur jupe (vay) au profit des pantalons à la mode chinoise; il leur était interdit de montrer leurs pieds 2. Il était interdit aux hommes et aux femmes de se couper les cheveux, ils devaient les garder longs, seuls les bonzes avaient droit de se raser la tête. Si cette sinisation a été imposée au début par les maîtres vainqueurs, les Vietnamiens, entendons par là les classes dirigeantes, l'ont bien reprise, par la suite, à leur compte, car cela allait de pair avec l'implantation et la consolidation du confucianisme. A ce propos, Ngô Tât Tô a écrit avec beaucoup d'humour dans un article pour "alimenter" le débat sur la préservation de "l'essence nationale" (quôc tuy), débat très vivant dans les années 1930, "que le vay pour le Vietnam est une essence nationale très ancienne", et que les Vietnamiens devraient suivre l'exemple des Thô qui gardaient intact ce mode vestimentaire 1. D'après cet auteur, ce vêtement était le même que celui des femmes Thô d'une part, et il a été porté par les Vietnamiennes jusqu'à la répartition du pays entre les deux seigneuries, les Trinh et les Nguyên au XVIIe siècle, d'autre part. Les seigneurs Nguyên ont commencé par obliger les femmes du Sud à porter le pantalon afin de les distinguer de celles du Nord, territoire des Trinh, leurs adversaires. A telle enseigne que sous le règne de Minh Mênh (1820-1840), en 1826 ce monarque a interdit à trois reprises, le port des vay aux femmes; le vay est appelé à cette époque humoristiquement "le pantalon sans fond" (quân không day) 2. Visiblement cette décision royale devait être très sévère car les mandarins ont été mobilisés pour arrêter les femmes désobéissantes, à tel point que cela est entrée dans la chanson populaire du Nord Vietnam:
Au sixième mois, il y a la décision du roi
Qui interdit de porter le vay, cela fait peur.
(...)
Habillée en pantalon, on tient son commerce,
Sans pantalon, on regarde le mandarin à l'entrée du
village,
Dis donc! Je t'y prends...
Visiblement les successeurs de Minh Mênh n'étaient pas aussi sévères que lui, et avec le commencement de la colonisation le vay reprend sa place qui lui revient. Truong Vinh Ky, le rédacteur en chef du premier journal en langue vietnamienne, le Gia dinh bao (le journal de Gia dinh) et lettré distingué de cette période, n'a pas oublié de mentionner cette coutume lors de son voyage au Tonkin en 1876. Ayant le sens de l'observation, à chaque passage dans une province, il décrit, certes d'une façon générale, mais avec quand même beaucoup de détails, l'organisation administrative, la situation géographique, les coutumes régionales et donne même parfois des rappels historiques. Cette tournée touristique à Hà nôi, puis dans les provinces comme Nam dinh, Hai duong, Thanh hoa, Ninh binh, lui a fait remarquer que l'habit des femmes était bien le vay et non le pantalon 1. Près de trente ans après, un autre observateur français, E. Langlet, a fait la même remarque en écrivant que "Dans le Nord de l'Annam et au Tonkin, le costume n'est plus le même pour les deux sexes. Les hommes ont le même costume en Annam, mais les femmes portent encore la jupe noire et courte, au lieu du cai quân (le pantalon) 2". De mémoire de Trân Dinh Huou, professeur de Lettres à l'Université de Hà nôi, dans les années 1930 quand il était encore au collège, les femmes portaient bien le vay en Annam, son pays d'origine comme au Tonkin 3. Le manuel de "Lecture française" de R.E. Michel, édité en 1928, adressé au Cours moyen comporte une leçon sous le titre de Les vêtements annamites dans laquelle on peut lire:
Les hommes (au Tonkin) ont le même costume qu'en Annam, mais les femmes portent encore la jupe noire et courte, au lieu du pantalon. Jadis toutes les femmes portaient cette jupe, mais Minh Mang ordonna qu'elles porteraient désormais le pantalon. Ce décret déplut à beaucoup et resta lettre morte au Tonkin 1.
A cet égard, nous sommes étonnés que dans son ouvrage, Joseph Nguyên Van Phong, prêtre, qui a fourni beaucoup de précisions et de détails quant à la culture matérielle, entre autres, notamment les différentes fonctions de la tenue vestimentaire chez les Vietnamiens, n'a pas fait mention de l'existence du vay qui, visiblement, était encore bien populaire dans la période qu'il a étudiée (1882-1902) 2.
Selon toute vraisemblance, ce vêtement était porté surtout par les paysannes de condition modeste ou moyenne. Les femmes des couches dirigeantes (mandarins, notables, propriétaires terriens) se seraient référées plutôt aux décisions royales du XIXe siècle en portant le pantalon large, symbole de la distinction sociale. Nous faisons ensuite un saut dans le temps. Faute d'écrits et de sources, on ne connaît que peu de choses dans la période 1915-1935 sur la popularité du vay. Y avait-il une rivalité entre ces deux vêtements? Quoi qu'il en fût, tard dans les années 1930, on remarquait qu'à la campagne les femmes portaient encore le vay, d'après les souvenirs de certains spécialistes vietnamiens, en particulier de Nguyên Du Chi, qui se sont penchés sur l'art populaire.
LA COUPE CARREE DESACRALISE LE CHIGNON
A l'arrivée des Français les Vietnamiens (les hommes) avaient donc les cheveux longs enroulés en chignon, et ils portaient un turban sur la tête. Nous avons vu que le port des cheveux longs pour les hommes représentait la piété filiale, un symbole parmi d'autres pour consolider et perpétuer le culte des ancêtres. Nous avons relaté une anecdote déchirante pour une famille dont le fils de 12 ans devait se couper les cheveux pour être admis à l'école publique. Contrairement à la mutation de la couleur des dents qui a laissé peu d'écrits, les cheveux ont suscité nombre d'observateurs d'horizons très divers, qui ont consacré une littérature bien plus abondante à cette question. Sa charge symbolique constituait sans doute le mobile de leurs réactions. Nguyên Vy, dans "ses mémoires" nous a relaté un événement, survenu au début du siècle en Annam, relatif à l'abandon des cheveux longs. Il s'agit de "la guerre des tondeurs" ou "guerre des compatriotes" (giac dông bào) qui a coûté la vie à bon nombre de contestataires en 1908. Ils étaient environ cinq cents répartis en deux groupes, et tous avaient les cheveux courts. Le premier a été chargé d'aller dans les lieux publics et chez les particuliers pour appeler la population à une manifestation contre les impôts jugés insupportables; le deuxième a eu pour tâche de convaincre, dans un premier temps, tous ceux qui rejoignaient cette action d'abandonner le chignon, avant de sortir les ciseaux, par la suite, pour leur coupe les cheveux. Les manifestants, composés de jeunes de formation classique, de patriotes fidèles à la monarchie et hostiles au protectorat français, et de paysans, se sont dirigés vers la résidence du gouverneur de province. Après un bref échange verbal avec eux par l'intermédiaire de son interprète, celui-ci n'a pas hésité à donner l'ordre d'ouvrir le feu. Résultat de cette "subversion": 30 morts. Quelques jours plus tard, tous ceux qui avaient les cheveux courts ont été arrêtés 1. Les descendants de Nguyên Dông Chi (1915-1984), originaire du Nghê tinh, gardent encore dans leur mémoire cet événement car Nguyên Hàng Chi (1885-1908), l'oncle de ce dernier, a participé à cette manifestation contre les impôts en tant que meneur. Ce geste lui a coûté la vie, il faisait partie des exécutés de 1908. Cependant, au moins deux ans plus tôt, le "subversif" Hàng Chi avait déjà les cheveux courts. Lors de l'anniversaire d'un de ses proches, retraité, Hàng Chi est venu la tête rasée. Pour convaincre les autres en se prenant lui-même comme objet d'ironie, il a composé lors du festin une chanson ca trù pour qu'elle fût reprise par les a dào (chanteuses), en ces termes:
Dis donc Hàng Chi,
Il n'est pas facile d'avoir la tête rasée comme toi.
On verra que les Asiatiques sont comme les Européens
Ce sera partout pareil dans le monde.
Les meilleurs gagnent, les moins bons perdent
(...)
Si Confucius était encore vivant il aurait aussi la tête rasée,
Hàng Chi, lui, aura les dents brillants (blanches)
jusqu'à sa mort.
La civilisation forme les talents,
Qui rattrape qui, comment ne pas rattraper?
Le théâtre du destin est comme la pluie et le vent qui
rugissent
la solidarité permettra de vaincre avec détermination,
Allez vous faire couper les cheveux! 1
Nous avons ici une anecdote riche de témoignages sur une nouvelle époque qui commençait. D'après Nguyên Van Xuân, auteur d'un ouvrage sur le mouvement Duy Tân, "la guerre des tondeurs" faisait partie intégrante de ce vaste mouvement 2 qui prônait le "modernisme". Nous avons vu, dans un chapitre précédent sur l'enseignement, que l'éphémère Dông kinh nghia thuc en 1907, très lié au mouvement Duy Tân, appelait la population à se débarrasser des cheveux longs qui représentait l'ignorance même aux yeux des lettrés en rupture de ban avec la tradition. Le fait que les cheveux longs étaient un produit "made in China", et les souvenirs du temps où les Vietnamiens avaient les cheveux "courts" avant la domination chinoise, constituaient deux facteurs qui allaient dans le même sens, et qui ont décidé les lettrés patriotes à rompre avec le passé récent chargé d'amertume. Mais on peut se demander si cette prise de conscience aurait eu lieu si la colonisation n'avait pas servi de détonateur? Car se couper les cheveux signifiait aussi se conformer à la coupe occidentale. Quoi qu'il en fût, l'appel des irréductibles progressistes a porté des fruits, cependant le rôle de l'école comme institution était loin d'être négligeable même s'il n'y avait pas explicitement une volonté politique souhaitant aller dans ce sens.
A la rentrée de l'année scolaire 1911-1912, tous les instituteurs avaient les cheveux courts, tandis qu'il fallut attendre vers 1916 pour voir tous les élèves de l'école publique avec leur "coupe carrée" pour se conformer aux "règlements"; le restant de la population gardait encore les cheveux longs pour les raison évoquées 1. Cet encouragement se trouvait aussi dans les manuels scolaires en langue vietnamienne. Dans une lecture ,sous le titre d'Hygiène les auteurs abordaient la question des cheveux:
Il ne faut pas garder les cheveux longs, par contre il faut se laver les cheveux aussi fréquemment que possible avec du savon. Pour les femmes, les cheveux longs sont élégants; quant aux hommes qui sont occupés, les cheveux longs leur prendront beaucoup de temps pour les laver, pour se coiffer. Actuellement, beaucoup de Vietnamiens ont coupé leurs cheveux comme les Occidentaux 2.
Aussi loufoques que fussent les interprétations des Vietnamiens au sujet des moeurs et du mode vie occidentaux, les contacts indirects avec la population européenne n'étaient pas sans rapport avec l'évolution. Pham Quynh qui représentait le mandarinat réformateur face à la tradition a livré le point de vue des Vietnamiens sur les Français, à l'aube de la colonisation, en ces termes:
D'autre part, tout nous choquait en vous, dans vos habitudes, dans votre genre de vie. (...)
Voyant les militaires français se tenir et marcher au pas gymnastique le nhà quê annamite en concluait que les Français n'avaient pas d'articulations du genou et que leurs jambes étaient toutes d'une pièce. Voyant les Français mouiller de la langue les enveloppes pour les fermer, ils disaient que leur salive contenait de la colle 1.
Quand la femme du Résident provincial se rendit à une fête chez les Vietnamiens, elle attirait remarques et commentaires de la part des Vietnamiennes. Nguyên Vy nous rapporte certaines de leurs conversations qui sont pour le moins extravagantes:
- Vous avez vu? La dame a des seins aussi gros que des pamplemousses!
- Plus gros que les pamplemousses, plus gros que la tête de ce petit Ty.
- Tu sais pourquoi les Européennes ont des seins aussi gros et n'en ont pas honte?
- Oui, c'est vrai. Pourquoi n'ont-elles pas honte? Nous, on s'efforce de les aplatir, pour les rendre plus petits, elles, elles les laissent tels quels; elles ne sont pas très civilisées en fait.
- Elles laissent leurs dents toutes blanches, sans les teinter, ça n'a aucun charme, n'est-ce pas?
- Tu as vu leurs chaussures avec des talons si hauts; et elles marchent sans tomber, c'est formidable!
- Elles ne tombent pas parce que quand elles marchent elles balancent leur derrière, c'est tout 2.
Apparemment, les Vietnamiens (les hommes) n'étaient pas de cet avis. Frottés à la société française, les tirailleurs et ouvriers non spécialisés (ONS) délocalisés pendant la Première Guerre mondiale découvraient le charme des Françaises. Dans leur correspondance ils n'ont pas manqué de souligner cette découverte:
Il y a ici beaucoup de belles dames: certaines sont d'une beauté surnaturelle. Vous m'avez demandé de vous envoyer un objet curieux, mais la chose la plus curieuse d'ici, c'est la femme 1.
Un autre ouvrier de la poudrerie de Toulouse faisait la même remarque:
Quand j'ai vu les belles dames françaises pour la première fois, je les prenais pour des épouses de hauts fonctionnaires, sinon du rang de présidents du tribunal, du moins de celui de procureur 2.
Cette attirance pouvait aller jusqu'à l'union. J'ai une femme à Vincennes, écrit un tirailleur affecté dans cette commune, dont mes deux frères sont contents. Ma femme ne connaît pas l'annamite, c'est pourquoi j'apprends à parler sa langue 3. D'après Mireille Favre qui a étudié cette question, les femmes françaises "furent les véritables introductrices à la démocratie et à la vie moderne pour les Vietnamiens, auxquels elles apprirent une indépendance d'allures, une liberté dans le langage et les attitudes, un joyeux mépris des hiérarchies et des contraintes traditionnelles qui auraient du mal, désormais à s'accommoder du régime politique et social de la colonisation" 4.
Après la Guerre, le retour de la plupart des 90.000 tirailleurs et ONS déplacés posait problème à l'Administration qui les prenait pour de futurs contestataires au régime colonial. Le gros contingent de cette masse humaine était des paysans arrachés de leur milieu culturel avec la complicité des notables 5. Même si leur retour a été échelonné jusqu'aux années 1920, ils ont rapporté avec eux la culture matérielle occidentale. On ignore s'ils sont rentrés avec les dents blanches ou toujours avec les dents noircies, de toute manière ils avaient abandonné depuis leur départ le chignon et le turban pour se conformer dans un premier temps aux règlements de l'armée, puis dans un deuxième temps pour s'adapter à la vie française, sans parler de leur tenue vestimentaire européenne. C'est en ce sens que ces contingents constituaient un milieu porteur de modernité à leur retour et qu'ils auraient ainsi contribué à précipiter l'évolution.
Dans les années 1920, la coupe occidentale commençait à se populariser. Même les paysans se sont décidés d'aller au chef lieu de province pour se faire couper les cheveux, car à la campagne il n'y avait pas de coiffeur 1 . Ainsi est né un nouveau métier. L'extension de la coupe occidentale était telle qu'elle entre dans la chanson populaire:
La civilisation est présente dans le monde entier
Même le bonze se paye la coupe à trois sous 2.
Cela ne veut pas dire pour autant que l'évolution est arrivée à son terme car dans les années 1930 la résistance était encore assez forte. La revue Khoa hoc tap chi (Revue scientifique) dans son numéro du 15 décembre 1931 signale qu'il y avait encore beaucoup de d'hommes qui gardaient leur chignon. (Cette revue paraissait certes dans le Sud, en avance sur le Nord dans le domaine des moeurs, nous sert ici d'indicateur.) Le Phong hoa a suggéré en 1934 à toutes les couches sociales de se débarrasser des cheveux longs dans une série d'articles sur les réformes liées à la vie matérielle 3. Ce discours, inséparable de celui sur l'hygiène, fait partie intégrante des idées modernes préconisées par le biais de l'occidentalisation dont ce journal se fait l'avocat. Mais les irréductibles ont résisté jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre. Parmi eux se trouvait Nguyên Van Tô, un lettré classique et moderne à la charnière de deux générations, qui a été nommé sous-directeur du musée de l'Ecole Française d'Etrême- Orient. Il n'abandonna son chignon qu'en 1939 après avoir subi les moqueries de la presse, notamment le Phong hoa qui lui a consacré un dessin humoristique 1.
Tous ces récits et révélations montrent que l'évolution de la coiffure chez les hommes est passée par trois étapes:
- une résistance douloureuse au "nouveau" qui se situait dans la première décennie du siècle, sauf pour les engagés sur le plan politique comme le Dông kinh nghia thuc, et des partisans du mouvement Duy Tân, pour qui le progrès doit passer par le rejet de la tradition conservatrice;
- une progression du "nouveau" qui gagnait du terrain durant les deux décennies suivantes face à l'immobilisme;
- enfin le triomphe de la coupe occidentale dans les années qui précédèrent la Deuxième Guerre.
Quoi qu'il en soit, la pression venant de l'extérieur a joué le rôle primordial, et l'enseignement dans la première phase a été déterminant pour la future génération de formation moderne. Par la suite, l'influence venait directement des Vietnamiens qui ont assimilé le "nouveau" avant d'en être les porte-parole. Cette mutation a quand même nécessité une quarantaine d'années avant d'arriver à son terme, mais c'est une durée relativement courte par rapport à l'existence de cette tradition qui remonte au XVè siècle. Tout compte fait, on dirait que ces quarante années ont pesé plus que les quatre siècles dans la mentalité et dans les moeurs des Vietnamiens, puisqu'elles ont balayé le passé sans trop de difficultés. Mais on pourrait dire aussi que les Vietnamiens n'ont fait que reprendre le même schéma d'adaptation, s'appuyer de gré ou de force sur ce qui vient de l'extérieur pour effacer le passé.
Une autre évolution qui est bien mineure cette fois, liée à la question des cheveux, ou qui l'accompagne, mérite tout de même d'être citée: il s'agit du turban. Originellement le turban était fait d'une étoffe assez large et assez longue pour pouvoir envelopper les cheveux et la tête. Mais avec l'évolution, un certain Hai chinh à Hà nôi a trouvé l'idée, dans les année 1920, de le simplifier en turban-chapeau (khan xêp), dont l'intérieur en carton en forme de cylindrique d'une hauteur d'environ dix centimètres, est enveloppé de tissu 1. Cette commodité est devenue une mode par la suite car il épargne au porteur de faire et défaire le turban tout le temps; désormais il suffit de le poser sur la tête pour avoir l'air élégant. Cependant l'abandon du chignon n'était pas incompatible avec le port du turban. C'est pourquoi, mis à part la jeune génération (les 20-35 ans), les écoliers du primaire et les autres hommes portaient le turban malgré leur nouvelle coupe occidentale. Encore une fois las manuels scolaires n'ont pas oublié cet aspect. Dans une lecture française adressée aux élèves du primaire (Cours enfantin, préparatoire et élémentaire) on peut lire ceci:
Je porte un chapeau. (...) Mon maître ne porte pas de chapeau. Il porte un turban noir. Mon camarade Khang porte un turban blanc 1.
Le turban faisait désormais partie plutôt de la tenue vestimentaire traditionnelle que de la coiffure. La génération de Pham Quynh (Pham Qùynh, Nguyên Van Tô, Nguyên Dô Muc, Nguyên Van Ngoc...) a porté le turban jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre.
LE COSTUME TROIS-PIECES
Contrairement à la coiffure, la tenue occidentale n'a apparemment pas été imposée ni par l'Ecole ni par une autre institution coloniale quelle qu'elle fût. C'est sans doute la raison pour laquelle la tenue traditionnelle a résisté plus longtemps que le chignon. A cet égard on peut se demander si la colonisation, par l'intermédiaire de l'Ecole comme agent modernisateur, n'a pas sciemment détruit le symbole de la piété filiale, fort sacrée pour les Vietnamiens, pour les éloigner de l'influence culturelle chinoise. Toujours est-il que ce qui était symbolique a paradoxalement disparu plus vite que ce qui ne l'était pas. D'après Georges Balandier, le "sacré" et les "agencements symboliques" font partie des "secteurs dits lents" dans les transformations au même titre que les "rituels", la "religion" et le "politique", contrairement à l'"économie", au "savoir scientifique", qui forment des secteurs "dits plus rapides" 2. Aussi, on s'aperçoit que dans des circonstances particulières de l'histoire les secteurs dits "lents" peuvent devenir "rapides" et inversement.
A titre d'exemple, à la rentrée scolaire 1911-1912, si tous les instituteurs avaient leur "coupe carrée", ils continuaient à porter la longue tunique noire par-dessus le pantalon large traditionnel, et ce fut le cas au-delà de l'année 1920 1. L'année 1927 fut le point de départ de la banalisation du costume européen. Un beau lundi matin, raconte Nguyên Vy, peu après la sonnerie, le directeur et les professeurs furent surpris de voir que la plupart des élèves du secondaire étaient habillés à l'occidentale 2. Certains professeurs français ont regardé ce changement avec curiosité, d'autres l'ont même qualifié de "révolution" 3. Par contre, du côté vietnamien, les enseignants l'ont désapprouvé. Profitant d'un cours d'instruction civique sur le "respect de soi", un de ces derniers n'a pas hésité à taxer les élèves de gens qui manquaient de respect envers eux-mêmes, de gens méprisables; un autre, qui ne s'est pas exprimé a pourtant noté sévèrement les "occidentalisés" 4. A l'origine, ce mouvement partit du collège Quôc hoc de Huê, mais les collégiens de Qui nhon eurent l'idée de se faire tailler un costume dans du tissu de fabrication locale. Cette campagne, qui survint un an après la grève générale des étudiants en 1926, ne cachait-elle pas un but politique? Les futurs dirigeants de la République démocratique du Vietnam, tels que Pham Van Dông (ex-premier ministre), Vo Nguyên Giap (le général vainqueur de Diên Biên Phu), Truong Chinh (ex-secrétaire général du parti), ont été soit expulsés de l'école, soit sanctionnés, pour avoir participé à cette contestation. On serait tenté de dire que derrière l'occidentalisation couvait la révolte, et ce à deux niveaux: révolte contre les colonisateurs et révolte contre la tradition. Le retour au Vietnam de Phan Bôi Châu en 1925, et la mort de Phan Châu Trinh en 1926, prétexte à la grève des étudiants, n'étaient pas sans rapport avec cette campagne d'occidentalisation partie de la base. Nguyên Van Xuân attribue à Phan Châu Trinh le rôle de premier Vietnamien qui ait adopté le costume européen, sans fournir de précision sur la date 1. Il laisse entendre que cela remonte à l'époque du mouvement Duy Tân (1907-1908). D'après les écrits de Phan Châu Trinh à cette époque, cette mode vestimentaire était avant tut une question matérielle:
Jusqu'à présent, les Vietnamiens de conditions moyenne et supérieure avaient l'habitude d'utiliser les produits d'origine chinoise. Depuis que les taxes d'importation ont fait grimper les prix, les marchands chinois ont fraudé en remplaçant les bons produits par de mauvais. Le tissu, payé pourtant à bon prix, se déchire très vite, aussi les lettrés ont-ils choisi de s'habiller à l'européenne dans la vie quotidienne. Cela revient moins cher et ça dure plus longtemps, et c'est pratique pour ceux qui travaillent. C'est l'idée du "club de ceux qui s'habillent à l'européenne" (hôi mac dô Tây).
Si on ne parle pas de l'aspect matériel, quel est le crime de s'habiller à l'européenne? Est-ce que la loi l'interdit? Si l'on était condamné à mort pour ça, ce serait du jamais vu 2.
Il va sans dire que le "nouveau" a soulevé des débats voire des polémiques. Le journal Phong hoa qui prône l'occidentalisation "sans hésitation" lance des attaques en direction des conservateurs représentés, entre autres, par les rédacteurs de la revue Nam phong, en publiant un article intitulé Quôc hôn quôc tuy (Essence nationale), termes polémiques considérés comme arme ultime des conservateurs de cette époque 1. Phong hoa leur reproche d'avoir une attitude attentiste car ils ne veulent pas "lâcher la proie pour l'ombre dans une période de transition", et poursuit ainsi:
Autrefois, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, la plupart des gens considéraient encore que la civilisation occidentale est une civilisation matérialiste plus redoutable que méprisable. (...) Petit à petit les conservateurs tombent de haut en découvrant que les Occidentaux savent faire autre chose que manger, s'embrasser et danser. Sachant très bien que l'Occident ne nous dépasse pas seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan spirituel, les conservateurs et ceux qui prônent "la voie du milieu" s'efforcent cependant de sauvegarder les usages arriérés. (...)
Si nous imitons l'Occident comme le perroquet qui répète les paroles humaines, nous ne ferons que comme dans le passé: reprendre le modèle chinois qui tombe aujourd'hui en ruine. Nous devons chercher l'esprit de la civilisation occidentale, puis créer ce qui nous est utile. Mais pour en arriver là, nous devons abandonner les attachements qui lient nos âmes 2.
A propos de la question vestimentaire, le journal Phong hoa, dans une série d'articles sur les réformes de la vie matérielle, rompt aussi avec la tradition qui accordait aux vêtements une fonction sociale, pour en faire une simple question de commodité et de décence :
Détruire la haie de bambou pour la remplacer par une haie de dâu (arbuste servant à l'élevage des vers à soie) ou par des arbres fruitiers, et de même abandonner l'ancienne tunique paysanne, la longue tunique qui traîne au profit d'une tenue commode, simple, et conforme à l'hygiène. (...)
Les fonctions essentielles des vêtements sont la propreté et la décence: pourvu que l'été ils tiennent frais et que l'hiver ils tiennent chaud 1.
Alors qu'en Europe, l'habit a, entre autres, été depuis longtemps un signe de distinction sexuelle , au Vietnam dans les couches populaires, l'homme et la femme s'habillaient presque de la même façon. Par contre, les habits des autres couches sociales, dont les couches dirigeantes n'avaient rien de commun, ni dans la forme ni dans la couleur. Plus un Annamite est riche, note un observateur français, à la fin du siècle dernier, plus il porte de cai ao (tunique). J'invitai un jour à déjeuner un personnage de Nam dinh. (...) Il arrive vêtu de sept cai ao 2. Cet état d'esprit a bien survécu même chez ceux qui ont adopté la tenue occidentale. A ce propos, Nguyên Vy raconte qu'en 1920, un certain directeur d'école (vietnamien) qui s'habillait tout le temps à l'européenne, se mit un jour à détester un enseignant qui l'imitait avec le costume trois-pièces; aussi cherchait-il par tous les moyens à le virer 1. Cette attitude s'explique par le fait que d'après la tradition mandarinale, les gouvernés, les inférieurs ne pouvaient pas s'habiller comme les gouvernants ou les supérieurs. A cet égard, la tenue occidentale est-elle parvenue à abattre ces barrières sociales, à démocratiser la vie matérielle? Loin s'en faut. Les observateurs font remarquer que dans les années 1930 encore, la tenue occidentale était uniquement portée par la petite bourgeoisie et la jeune génération de formation moderne, la large majorité, dont les paysans, continuant à s'habiller à la mode traditionnelle; et entre ces deux extrêmes, la classe "moyenne" mélangeait les deux genres, soit la tunique noire par-dessus le pantalon à l'européenne, soit la chemise par-dessus le large pantalon traditionnel 2. Si la tenue européenne, - c'est-à-dire le costume trois-pièces car les Vietnamiens de cette époque ne se contentaient pas d'un simple pantalon et d'une chemise - , a gagné du terrain avant de s'imposer sur la scène sociale, elle n'a pas convaincu les irréductibles. Le poète Tan Dà (Nguyên Khac Hiêu) porta la tenue traditionnelle jusqu'à sa mort en 1939; quant à Pham Quynh, à Nguyên Van Tô (caricaturé par Phong hoa à cause de son chignon), à Nguyên Van Ngoc, auteur de nombreux manuels scolaires et d'un recueil impressionnant de proverbes et chansons populaires 3 (le premier dans le genre), ou à Nguyên Triêu Luât, rédacteur de la revue Nam phong, et bien d'autres encore, ils ont gardé la tunique noire par-dessus le pantalon large jusqu'en 1945 1.
LA MODE FEMININE
Les évolutions sur le plan de l'habillement constatées jusqu'à présent ne concernent que les hommes. Que s'est-il passé du côté des femmes? Si chez les hommes la vie moderne les a amenés à s'occidentaliser sur le plan vestimentaire, chez les femmes l'évolution a pris un autre chemin moins direct en apparence mais bien plus radical sur le plan des idées, car elles ne s'habillaient pas à la manière européenne comme les hommes mais à la nouvelle mode issue des réformes des tenues traditionnelles. Sur cette question comme sur bien d'autres, le rôle de la presse a été déterminant. La nouvelle tenue a ainsi donné à la femme vietnamienne une allure "moderne" décrite par un humoriste sous le pseudonyme de Tân khach (Le nouveau convive) en ces termes:
Femme moderne
Qu'elle est moderne, cette femme moderne!
Elle ne manque à aucune mode!
Les cheveux enroulés sans turban, la raie sur le côté,
Au pieds elle porte même des chaussures à talons.
Tunique de couleur, pantalon en soie et châle blanc
Le visage fardé, les lèvres rouges, les joues maquillées,
Son rire laisse voir des dents toutes blanches,
Son regard amoureux est aussi tranchant qu'un couteau 1.
Ce poème donne un aperçu de l'apparence d'une femme moderne qui a commencé à s'habiller à la nouvelle mode au début des années 1930. Le Phong hoa dans son numéro 4 du 7 juillet 1932 a constaté cette évolution:
Depuis peu de temps les femmes et les filles habitant les villes se sont mises à s'habiller à la mode. C'est une réforme sur le plan vestimentaire. Elles ont enterré non seulement la tunique à la mode chinoise et le pantalon en lin de Buoi (un village aux environs de Hà nôi), mais aussi les tuniques de couleur sombre pour les remplacer par un pantalon blanc et une tunique bleue.
C'est le premier pas décisif franchi par la femme dans les réformes de l'habillement, car rappelons que le blanc, selon la tradition, était la couleur du deuil qu'on ne portait pas dans d'autres circonstances de la vie. Par ailleurs, les couleurs retrouvent un certain intérêt: celles qui sont sombres et ternes comme le noir ou l'indigo (nâu) doivent désormais céder la place à celles qui évoquent la gaîté telles que le bleu, le vert, le jaune clair. Les couleurs, écrit Viêt Sinh, alias Thach Lam, sont essentielles pour les vêtements des femmes 2. D'après Madame Trinh Thuc Oanh, un professeur des années 1930, la tunique de couleur et le châle étaient la mode de l'année 1920 3. A cet égard, les journaux Phong hoa et Ngày nay en général, et le dessinateur Lemur, alias (Nguyên) Cat Tuong, en particulier, ont beaucoup contribué à créer et à propager la mode vestimentaire féminine. Nous ignorons tout de ce dessinateur qui reste dans l'ombre, à part son passage à l'école des Beaux-Arts à Hànôi. Collaborateur assidu de ces deux journaux et membre du groupe Tu luc van doàn, Lemur est encore propriétaire d'un magasin de mode féminine, rue Lê Loi à Hà nôi 1, où il concrétise les modèles parus dans les pages de ces périodiques sous la rubrique "Ve dep. Riêng tang cac bà cac cô" (La beauté. Dédicacé aux femmes). Dans un article consacré à la mode féminine l'écrivain Thach Lam (frère de Nhât Linh), sous le pseudonyme de Viêt Sinh, écrit:
L'honneur d'être l'initiateur des réformes vestimentaires féminines revient à Nguyên Cat Tuong (Lemur). Bien que les réformes impulsées par ce dessinateur ne soient pas encore profondes et complètes, qu'il ne donne pas précisément ses raisons, les modèles qu'il a suggérés ont été accueillis par bon nombre de personnes, et ils ont créé un changement dans la tenue vestimentaire féminine d'aujourd'hui 2.
En effet, c'est ce dessinateur qui a créé le modèle de tunique qui porte son nom, ao Lemur (Tunique Lemur). Il s'agit du ao dài qui est devenu la tenue nationale des femmes vietnamiennes jusqu'à nos jours. Cette tunique est la nouvelle version de l'ancienne ao tu thân, la tunique formée de quatre pans de tissu munis de manches serrées mais sans col, et dont les deux pans de devant sont fendus de la taille jusqu'en bas, au niveau des mollets. "Leur cai ao (la tunique des femmes du Nord), écrit E. Langlet à ce propos, n'est pas pareil à celui des femmes du Sud de l'Annam. Au lieu de se boutonner sur le côté, il ne ferme pas; les deux pans sont simplement noués devant ou maintenus croisés par une ceinture, laissant à découvert le cache-seins que les femmes ont alors soin d'avoir bien blanc 1". Si l'ancienne tunique avait son charme dans sa simplicité, la nouvelle prend en compte la dimension corporelle. Ainsi le ao dài est raccourci jusqu'à mi-mollet en épousant la forme du corps, les manches sont élargies juste ce qu'il faut pour faciliter la circulation du sang 2. Au lieu de quatre pans, la nouvelle tunique n'en a que deux, l'un devant, l'autre derrière, l'ensemble est fendu en bas jusqu'à la taille et fermé sur le côté droit. Quant au pantalon qui va avec, le dessinateur suggère de le rendre plus serré de la taille aux genoux pour "mieux montrer la beauté personnelle de chacune" 3. Au-delà de l'apparence vestimentaire, cette mode introduit une nouvelle conception, celle de la beauté du corps féminin. Les femmes n'ont pas attendu longtemps pour prendre conscience de cette dimension, autrefois minimisée voire bannie, pour en faire un objet de culte. La chroniqueuse Cô Duyên dans Ngày nay n'y va pas par quatre chemins pour abattre les vieilles idées conservatrices à propos du corps de la femme. Elle s'en prend même au proverbe "Cai nêt danh chêt cai dep" (les bons caractères prévalent sur la beauté) en le qualifiant de "paroles charitables des moralistes pour consoler celles dont la beauté physique est moins prononcée. (...) La raison accepte ces paroles mais notre instinct ne les considère jamais comme justes" 4. La rubrique Phu nu (Femme)dans Ngày nay fournit régulièrement des recettes pour les soins du corps: comment se farder, mettre du rouge à lèvres, entretenir les seins, etc. Dans un autre article la même chroniqueuse aborde un sujet jusqu'alors tabou: les seins justement. Sa prise de position est pour le moins virulente:
La vieille morale hypocrite (gia dôi) fermait les yeux devant la beauté de la poitrine. Et quand on l'appelle par son nom, les seins, ça fait rougir les esprits vertueux et les femmes de "bonne famille". (...) L'idée sur la beauté féminine a ainsi été complètement déformée par les préjugés risibles (buôn cuoi)! On voulait que la femme ne laissât rien apparaître: celle qui avait la poitrine aplatie était qualifiée de vertueuse, et selon une morale bizarre la poitrine la plus belle faisait l'objet de ce qui était le plus criticable chez la femme. (...)
Maintenant c'est différent. Nous avons osé découvrir - au sens propre et au sens figuré - , nous pouvons ainsi mieux respirer. Si cela gêne les yeux des moralistes à cause de notre beauté naturelle, tant pis pour eux 1.
Et la chroniqueuse de terminer sur les conseils d'entretien de cette "partie importante de la beauté du corps féminin" par des exercices de gymnastique quotidiens comme les Européennes, tout en indiquant qu'en Europe on pouvait embellir les seins par des opérations chirurgicales esthétiques. Cette nouvelle conception de la beauté du corps est directement calquée sur celle de l'Occident dont le dessinateur Lemur, entre autres, se fait l'avocat:
Contrairement aux opinions des moralistes vietnamiens, les Occidentaux s'accordent à dire que la poitrine est primordiale pour la beauté de la femme 1.
Cependant la chroniqueuse Cô Duyên fait remarquer que dix ans au-paravant les femmes chinoises ont "libéré" (giai phong) leurs seins, événement qualifié par les Vietnamiennes de "l'époque de révolution terrible" (môt cuôc cach mang ghê gom) 2.
En effet, autrefois le corps de la femme en général et la poitrine en particulier devaient être dissimulés pour ne pas éveiller le désir de l'autre sexe. Cette attitude "pudique" trouve aussi son expression dans une chanson populaire:
"Les filles qui fréquentent les garçons
(Con gai choi voi con trai)
Auront les seins aussi gros que les noix de coco".
(Rôi sau cai vu bang hai so dua. 3)
Il convient de remarquer qu'il y avait deux morales sur ce sujet: celle des couches dirigeantes confucéennes, qui font du corps de la femme un tabou sans que cela les empêche d'en profiter; et celle des couches populaires qui ne suivent pas pourtant à la lettre les bonnes paroles des "maîtres-penseurs" moralistes. En théorie, cette morale confucéenne est la règle de conduite pour tout le monde mais en pratique, les couches populaires ne font que sauver les apparences. Les femmes cachent évidemment leur poitrine par le port du yêm (le cache-seins), la seule partie du corps en fait qu'elles ne montrent pas, et encore, jusqu'à un certain âge seulement, alors que pour les autres parties du corps, elles sont loin d'être pudiques, à l'exception bien entendu de la partie la plus intime. En effet, quand elles travaillent, elles n'hésitent pas à retrousser le pantalon jusqu'aux hanches pour ne pas le salir, laissant ainsi leurs jambes nues au regard des autres. A partir de 50-60 ans, les femmes se lavent naturellement torse nu sans éprouver aucune contrainte morale. Les observateurs français n'ont pas oublié de remarquer ces habitudes. Mais dès qu'elles (les Vietnamiennes) sont vieilles et flétries, écrit Jean Bonnet en 1905, perdant toute pudeur, elles ne se gênent guère pour exhiber en public leur pauvre poitrine délabrée 1. Et C. Paris, écrit encore dans son Voyage d'exploration que: "Chez la femme vietnamienne, l'essentiel consistait à ce que sa poitrine soit cachée. Que les profanes aperçoivent ses jambes jusqu'à la ceinture, sa pudeur n'en reçoit aucune atteinte si le sein demeure couvert. Pendant les fortes chaleurs de l'été, la femme du peuple dans sa paillote se débarrasse de sa tunique et porte une culotte courte, laissant à nu son dos et ses jambes" 2. Ces habitudes sont encore bien vivantes dans la campagne vietnamienne d'aujourd'hui.
En France même, le corps de la femme fut considéré pendant longtemps comme non regardable. Alain Corbin écrit justement que:
Dans les classes aisées, le code de bonnes manières imposera longtemps à la jeune fille d'éviter de se regarder nue, ne serait-ce que dans les reflets de la baignoire. Des poudres spéciales ont pour but de troubler l'eau du bain afin de prévenir la honte. La stimulation érotique de l'image du corps, exaltée par un tel interdit, hante cette bonne société qui accumule les glaces dans ses bordels, avant d'en garnir, tardivement, la porte de l'armoire nuptiale 1.
Par ailleurs, on peut douter de l'efficacité de la mise en garde faite aux filles, d'avoir à se tenir loin des garçons sous menace de voir leurs seins devenir "aussi gros que les noix de coco". Car si cette "mise en garde" est entrée dans la chanson populaire, on peut supposer que le "pelotage" chez les jeunes n'était pas l'événement du siècle, bien au contraire. Et sans doute les jeunes hommes des couches populaires n'ont-ils pas pris cette mise en garde pour paroles d'Evangile, leur faisant détourner les yeux du corps de la femme. L'expression bop vu (pétrir les seins) dans le langage populaire vietnamien, quelque peu machiste il est vrai, vient témoigner en quelque sorte de l'attirance qu'exerce le corps de la femme sur les hommes. Un écrivain, actuellement à Hà nôi, dont nous tairons le nom, se rappelle encore que dans sa jeunesse, la fête du village Lim 2 fut l'occasion pour lui et ses camarades d'aller se faufiler dans la foule pour "pétrir les seins" (bop vu) des filles. Ce qui montre par là les limites de la morale des couches dirigeantes.
L'évolution poursuit son cours et ne s'arrête pas à l'apparence, car elle atteint le corps lui-même. Le yêm (le cache-seins) fait d'un tissu en losange, arrondi à son bout supérieur du côté du cou, autour duquel il est maintenu par deux cordons, avec deux autres liens des deux bouts latéraux pour venir se nouer au dos, obéit à la morale, car sa fonction consiste non seulement à cacher les seins mais aussi à les aplatir en les empêchant de se développer. Avec l'évolution ce vêtement tombe en désuétude pour laisser la place au soutien-gorge qui épouse la forme des seins, et que les Hanoïennes adoptent dans les années 1930 1. Apparaissent aussi dans la presse des slogans publicitaires vantant les qualités de certains produits esthétiques concernant les seins, par exemple, "Oh femmes! Il est conseillé d'avoir des seins fermes et développés", "Les beaux seins en trois semaines", "Soignez vos seins", etc. 2.
Si on essaie de dater ces évolutions, l'année 1934 est le point de départ de grandes réformes vestimentaires féminines. Le journal Ngày nay se fait l'écho d'un événement survenu en cette année à Hôi-an, dans le centre du Vietnam. Profitant de la foire de Lac thiên, une localité de la région, les femmes se sont mises à s'habiller à la mode, avec des tuniques de couleur et le châle sur les épaules, adoptant la nouvelle coiffure, portant des chaussures à talons et se fardant le visage 3. Cependant, ce mouvement a déjà quelques années au-paravant été amorcé par les femmes du Nord, et particulièrement par celles qui sont "mariées" à des Français, avant d'atteindre la nouvelle génération d'enseignantes et étudiantes dans les années suivantes. A cet égard, on ne peut pas passer sous silence le rôle qu'a joué la presse féministe. Le journal Phu nu thoi dàm (Chroniques des femmes), paru à Hà nôi de décembre 1930 à juin 1934, a disséqué les problèmes un à un dans ses colonnes, les idées émancipatrices sont reprises par l'hebdomadaire Dàn bà moi (La femme moderne), édité dans le Sud de décembre 1934 à décembre 1936 1. Bien que moins ardents sur cette question, Phong hoa et Ngày nay contribuaient de même à faire de la femme vietnamienne une femme moderne. Quoi qu'il en soit, cette campagne de modernisation comme tant d'autres laisse la population paysanne à l'écart de l'évolution. Car ces tenues modernes ne conviennent qu'aux femmes résidant dans les centres urbains. Elles peuvent les porter pour aller au travail, pour se promener ou dans d'autres circonstances de la vie, les occasions ne manquent pas; tandis que les paysannes n'ont ni les moyens matériels ni le même mode de vie; seules les occasions exceptionnelles, telles que le nouvel an ou les fêtes de village, les décident à s'habiller différemment des jours ordinaires. Le dessinateur Lemur a bien proposé dans sa rubrique 2, "Un modèle de tenue paysanne" (Môt kiêu y phuc nhà quê) mais on peut se demander s'il a été suivi.
Quoi qu'il en soit ces réformes divisent l'opinion en deux camps antagonistes: les conservateurs les voient d'un mauvais oeil, traitant les femmes modernes de "femmes de mauvaises moeurs", et les progressistes tournent le dos à la tradition quoi qu'il advienne. A un autre niveau, plus profond, ces réformes traduisent la prise de conscience du rôle de la femme dans la famille et dans la société. Bref l'émancipation des femmes passe aussi par l'adoption d'une nouvelle parure. A cet égard, elles vont sans doute plus loin que les hommes, qui pour leur part s'habillent sans hésitation à la mode occidentale (costume trois-pièces et cravate), mais dont au fond d'eux-mêmes, on peut douter de la conviction à propos de l'idée de la femme moderne, car il s'agit aussi de leur propre femme et de leurs propres filles. Combien d'hommes appliquent leurs idées en faisant la cuisine à la place de leur femme, sans parler de leurs virées nocturnes en compagnie uniquement d'hommes? Pour reprendre les termes de Georges Boudarel, nous nous bornons à poser cette question sans pouvoir apporter de réponse. Les femmes, pour leur part, ont opté pour une réforme de leur tenue traditionnelle, sans chercher à imiter la mode occidentale, et ainsi elles se libèrent, elles, complètement du passé. Par ailleurs, les paysans et les paysannes n'ont pas les moyens matériels pour s'habiller à la mode citadine, ou bien les réformes vestimentaires ne s'imposent pas pour eux et pour elles, par contre, dans la vie quotidienne, leurs tâches sont assurées indifféremment par l'homme ou par la femme sans distinction aucune dans la vie quotidienne. Les paysans n'ont sans doute pas des idées modernes mais dans la pratique, et les conditions matérielles obligent, ils sont côte à côte avec leur femme.
La mode illustrée
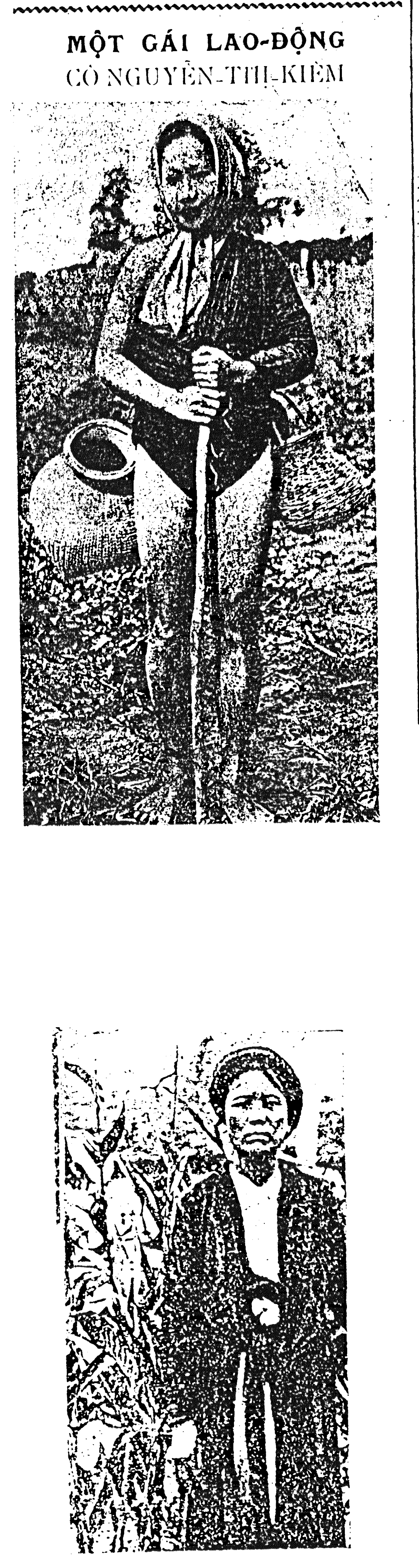
La tenue de travail d'une paysanne. En fait, il s'agit de Nguyên Thi Kiêm, une ancienne rédactrice de Phu nu tân van (La nouvelle littérature des femmes) qui s'est reconvertie en paysanne après la fermeture du journal. Son "pantalon" est bien retroussé jusqu'aux hanches, laissant ses jambes nues.
Photo prise par Ngày nay, 16.04.1935.
La tunique paysanne.
On remarque sur cette photo que la paysanne porte l'ancienne tunique (ao tu thân) dont les deux pans de devant sont simplement noués au niveau de la taille, laissant voir ainsi son yêm (le cache-sein) blanc qu'elle porte dessous.
Il s'agit de la troisième femme de Dê Tham, la conseillère militaire très écoutée du "bandit" Tham comme l'appelaient les colons, las de ce personnage insoumis. Cette dame est la mère de Nguyên Thi Thê, devenue actrice de cinéma en France dans les années 1930, et épouse d'un certain Robert Bourgès.
Cette photo a été prise en 1913 lors de l'arrestation de Dê Tham. Sa femme, quant à elle, s'est donné la mort sur la route de la déportation en Guyane.
Ngày nay, 30.01.1935.

Melle Nguyên Thi Hâu.
La première fille qui ait porté la nouvelle tunique
(ao dài), modèle dessiné par Lemur.
Photo Ngày nay, 30.01.1935.
Un nouveau modèle du yêm
suggéré par Lemur.
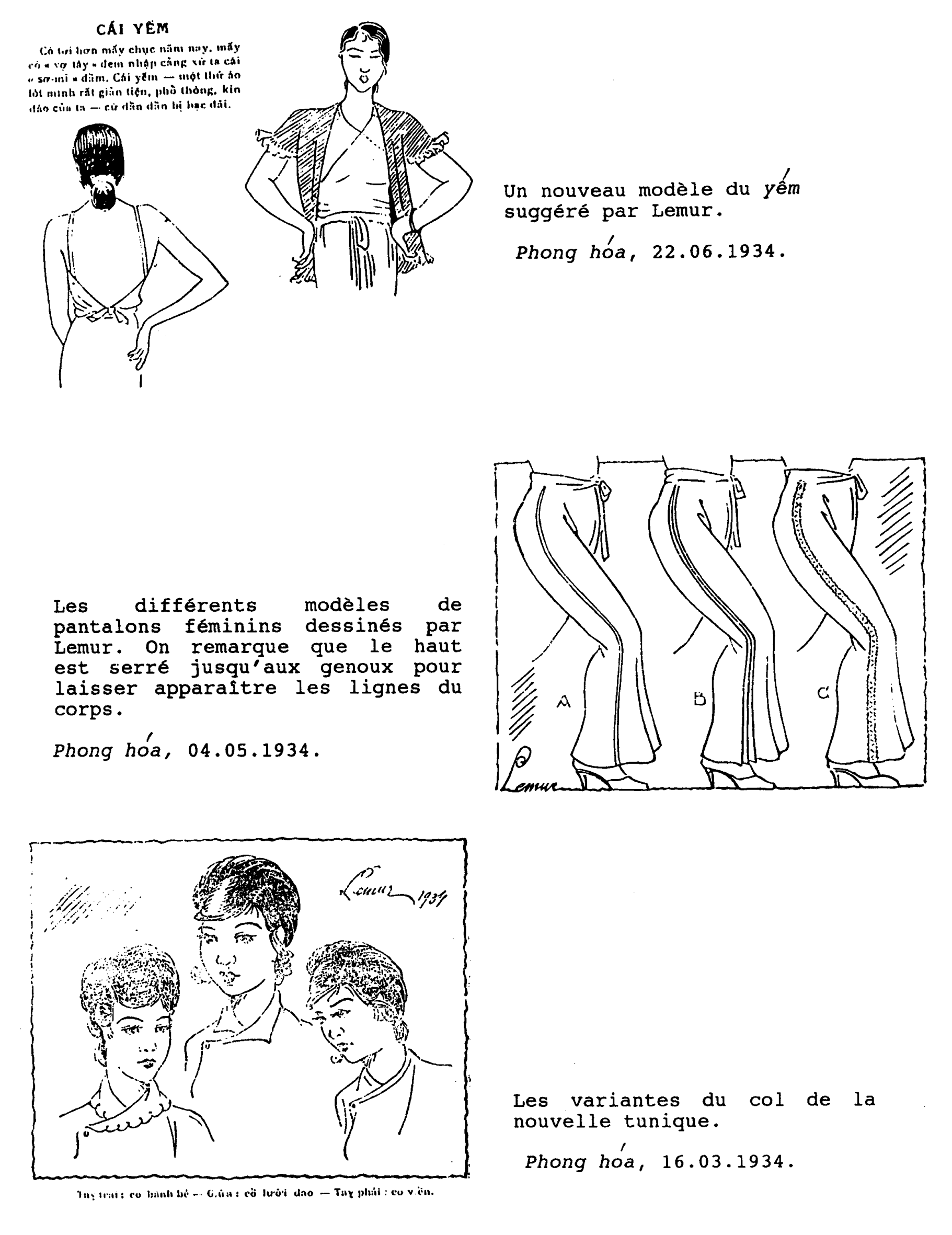

La nouvelle tunique (ao dài) qui met en valeur les lignes du corps, des épaules à la taille.
Phong hoa, 23.03.1934.
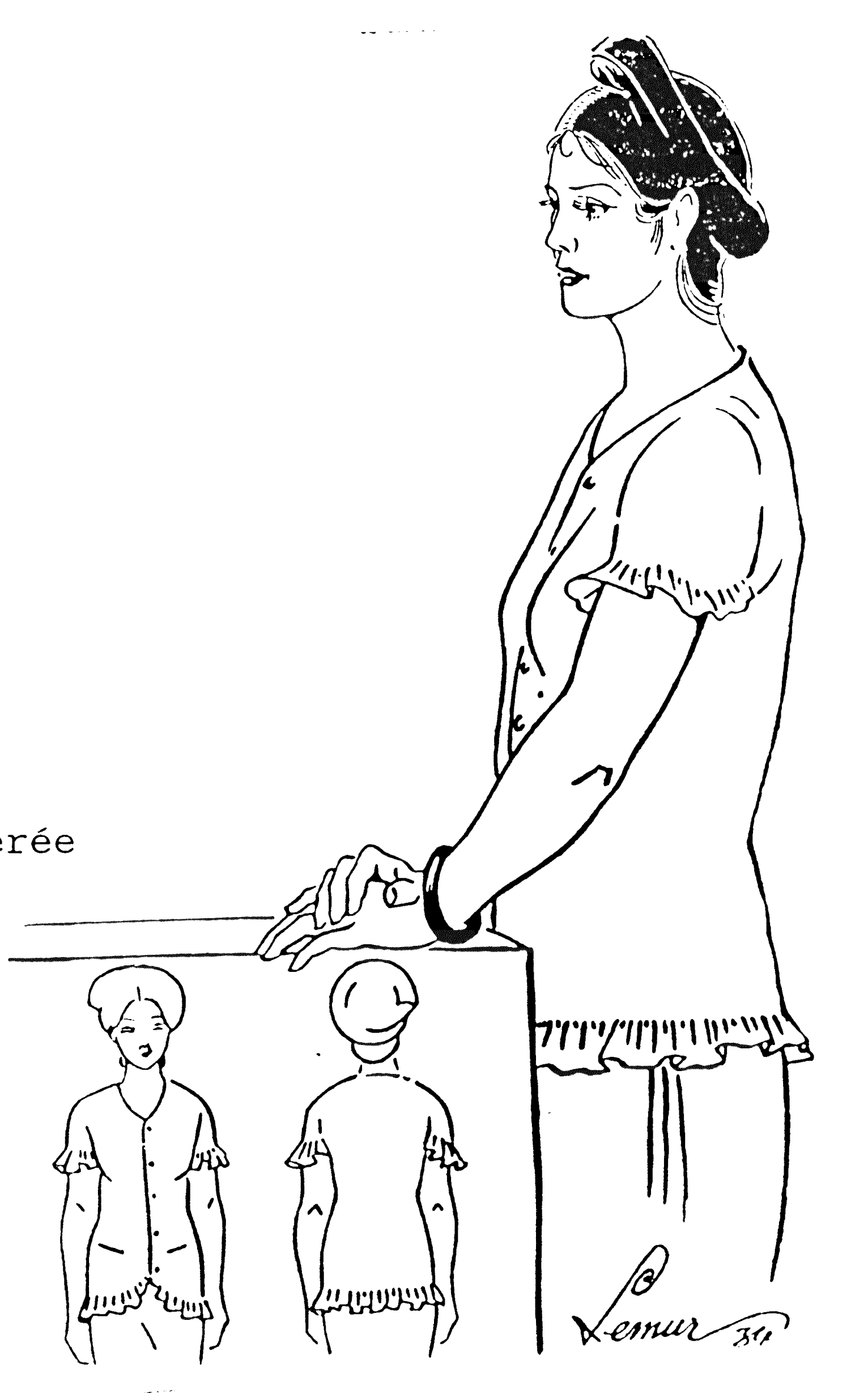
Une tenue d'été chez soi
suggérée par Lemur.
Phong hoa, 25.05.1934.

Une tenue d'été en ville
dessinée par Le mur.

Phong hoa, 13.07.1934.
Une tenue paysanne
suggérée par Phong hoa
du 01.06.1934.
L'évolution de la coiffure féminine.
Le premier dessin, en haut à gauche, porte la légende "à la création du monde", puis vient "l'âge des cavernes". Celui de "1900" montre bien l'ancienne coiffure des Vietnamiennes avec la raie au milieu, en "1933", elle s'est déplacée sur le côté.
Phong hoa, 05.01.1934.
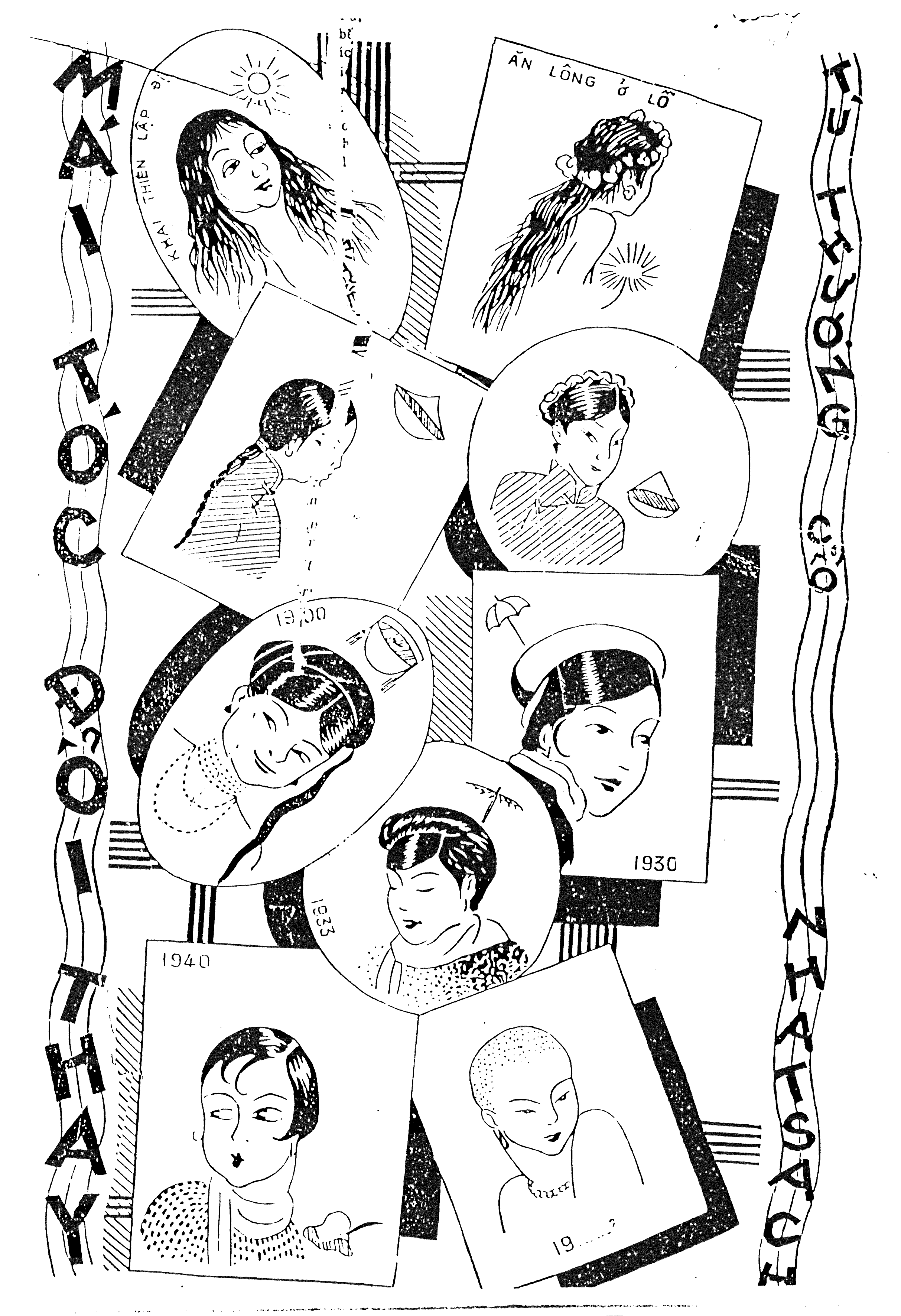
CHAPITRE 7
F E M M E - F A M I L L E
Socialement éclipsée et méconnue, la femme vietnamienne tient pourtant le rôle principal dans la préservation de la famille et des valeurs traditionnelles des couches dirigeantes en particulier. C'est la femme qui subvenait aux besoins matériels et qui entretenait le mari afin qu'il pût passer les concours mandarinaux. Chez les couches populaires, la femme travaillait sans relâche à côté du mari et l'économie familiale reposait sur elle, sans parler de l'éducation des enfants. Dans les traditions populaires, la femme rivalisait avec l'homme dans la représentation cultuelle, car le rapport du nombre des génies légendaires féminins à celui des génies légendaires masculins est d'un contre deux 1. A cet égard, le débat sur la modernité passe inévitablement par la question de la femme. Par ailleurs, le suicide des femmes a défrayé la chronique des années 1930. C'est la raison pour laquelle nous consacrons la fin de ce chapitre à ce sujet encore mal connu en essayant de savoir si le suicide est en rapport ou non avec les temps modernes dans le contexte de la société vietnamienne.
LES DEBATS
Dès la première année de sa parution Dàn bà moi pose au grand jour la question de la femme dans une tribune libre où s'affrontent les différentes opinions. Après avoir publié la lettre d'une lectrice qui s'est plainte d'être délaissée par son mari pour une deuxième femme, alors qu'il lui a fait trois enfants qui vivent avec elle sous la tutelle des parents de parent, Dàn bà moi pose la question de savoir s'il faut qu'elle se libère ou non.
Sur 14 réponses venues des trois régions du Vietnam et publiées dans deux numéros successifs, 10 sont pour la libération, 3 contre et 1 mitigée 1. Optant pour la libération de la femme, deux lectrices suggèrent à la victime de poursuivre son mari en justice pour régler le problème de la garde des enfants et demander le versement d'un pension. Le divorce est explicitement envisagé. Un autre lecteur qui se prononce aussi pour la libération affirme que "la vie est une lutte" et qu'il n'y aurait pas d'autre alternative que "vaincre ou mourir". L'ombre de la morale est bien présente dans beaucoup de réponses, mais elle est considérée comme une entrave à la liberté, une conception injuste et oppressive pour la femme. Ce qui explique que la tendance dominante ait été de passer outre aux "qu'en dira-t-on". Pour d'autres, se libérer veut dire également prouver que le femme est capable de gagner sa vie, d'être autonome sur le plan financier.
Parmi les trois réponses désapprouvant la libération, une provient d'un lecteur, une autre d'une lectrice originaire d'une "bonne famille" de Huê. Leur seul argument, et de taille, s'appuie sur les principes confucéens qui permettent de "préserver la famille des vibrations, des secousses modernes, inconnues des temps anciens".
Pour la femme, peut-elle se libérer en observant le principe confucéen phu tu tong tu, lui dictant de suivre les enfants quand le mari rejoint ses ancêtres dans l'au-delà? Cette fois, Dàn bà moi touche un sujet sensible, pour ne pas dire tabou, en posant aux lectrices la question: Les veuves doivent-elles se remarier? 1. Les réponses ne tardent pas à venir et en abondance, fait apparemment surprenant, mais normal et conforme à la logique du tabou: quand il n'y a plus d'interdits, les opinions déferlent. Le journal en a publié 24, qu'on peut classer comme les précédentes en trois tendances: les POUR, les CONTRE et les SELON 2. Ici encore, on assiste à une confirmation des tendances des lectrices et lecteurs puisque les POUR (16) l'emportent largement sur les CONTRE et les SELON, qui sont à égalité (4 et 4). Les arguments avancés par ceux et celles qui sont POUR sont très variés :
- certaines lectrices considèrent que la femme doit avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, argument dérivé, certes, de l'ordre ancien mais le pas est franchi;
- d'autres évoquent la nécessité de partager l'affection, la tendresse avec quelqu'un car la solitude ne serait jamais une réussite;
- pour beaucoup, il est question d'égalité des droits. Elles ne voient pas pourquoi la femme doit sacrifier sa vie tandis que l'homme ne se pose même pas cette question (de se remarier s'il lui arrive d'être veuf). C'est l'égoïsme de l'homme (exigence de la virginité au mariage, entre autres) qui les enferme dans une morale désuète. Ne pas se marier pour obéir à un précepte serait une hypocrisie. Enfin, une avocate montre du doigt le principe confucéen oppressif phu tu tong tu (quand le mari est mort on suit ses enfants).
De l'autre côté, celles qui répondent négativement à la question posée, se réfugient dans la peur d'être mal considérées par le futur mari qui "n'hésiterait pas à fouiller dans son passé (celui de la femme remariée) pour savoir si elle est encore attachée au mari défunt".
Ayant connu une vie dure avec son mari disparu, une lectrice qui se prononce contre le remariage, renonce à fonder un nouveau foyer.
Malgré la participation relativement faible aux différents débats, (mais pouvait-on procéder autrement sans perdre la richesse des arguments?), les réponses recueillies par le journal confirment donc une certaine évolution dans l'état d'esprit de la nouvelle génération, témoin d'un embarras voire d'un déchirement. Ce désarroi est aussi exprimé par Hoàng Dao dans son "3e voeu" :
Suspendus entre deux cultures antagonistes, nos jeunes désemparés cherchent le sens de la vie. Ils ne sont plus des continuateurs de leurs ancêtres. (...)
Les vieux préceptes ont disparu mais ils (les jeunes) n'ont pas encore assimilé le "nouveau". L'enseignement à l'école les amène dans une direction tandis que l'éducation en famille les oriente vers une autre. D'où les soucis, l'égarement.
Heureusement, cette souffrance morale constitue précisément la base d'un nouvel ordre 1.
On s'aperçoit que les problèmes sont une fois de plus posés, car sur ce terrain le journal Phu nu thoi dàm (PNTD, - 1930-1934 - La chronique des femmes) peut être considéré comme pionnier dans le Nord du Vietnam. Dans un numéro de mai 1931, Thanh Vân (pseudonyme d'une journaliste, sans doute) aborde le conflit entre l'amour et la piété filiale 1. Cette dernière l'a toujours emporté sur l'amour, mais cet ordre de choses est quelque peu bousculé car l'auteur termine son article par la question: "Quel est le plus fort des deux, l'amour ou la piété?" En effet, Thanh Vân constate que bien des fois c'est l'amour qui triomphe. On peut dire aussi que le fait de poser cette question, c'est déjà y répondre, car au-paravant il ne venait à l'esprit de personne de se la poser. Cependant, la réponse sans équivoque à cette question se trouve, quatre ans plus tard, dans un dessin humoristique paru dans Dàn bà moi, et où la balance penche du côté de l'amour (voir la partie "Dessins humoristiques et satiriques" p. XXX). Sur cette question comme sur d'autres, on assiste bien à une inversion des valeurs au bénéfice des nouvelles.
Dès sa parution, PNTD dans son numéro 1 du 8 décembre 1930, fait le constat de deux tendances antagonistes chez les femmes: celles qui sont issues des familles modernes pensent à profiter (huong thu) de la vie, de la liberté et de l'égalité des droits en reléguant la morale ancienne aux oubliettes, et les autres, originaires des familles conservatrices, se plient encore aux valeurs anciennes. Placé devant cette rencontre de la tradition avec le "nouveau" (tân-cuu), PNTD veut s'attribuer le rôle d'arbitre (dia vi trung lâp) pour retenir les uns et encourager les autres afin d'harmoniser les deux tendances. Et l'éditorial de se terminer par une citation en paraphrasant Corneille: "La victoire n'est glorieuse que quand la lutte a été acharnée" 1. Cette attitude prudente s'explique par le fait que ce journal privilégie plutôt les moyens permettant d'atteindre les buts que les buts eux-mêmes. Car "l'égalité des droits est une question importante à propos de laquelle il ne suffit pas de lancer des slogans puis attendre les résultats. Pour occuper une situation d'égalité encore faut-il atteindre l'égalité sur les plans intellectuel et professionnel" 2. De toute façon, pour PNTD, la revendication des droits de la femme ne peut être considérée comme une action individuelle, elle est collective. Le journal conseille aux femmes de s'organiser sans tarder en association voire en syndicat, une tâche urgente à réaliser pour soutenir le mouvement d'émancipation 3. D'un autre côté, comme la tendance conservatrice représente encore une réalité loin d'être négligeable en cette année 1930, PNTD ne peut l'ignorer. Un calcul pour répondre à la rigueur financière n'est pas à exclure non plus: comme toute entreprise, ce journal souhaite toucher le maximum de gens, en l'occurrence de lecteurs; la modération dans les propos permettrait d'atteindre ce but. Par ailleurs entre les buts avoués et ceux qui ne le sont pas, il y aurait un écart. Si on se réfère aux écrits sur cette même question de Mme Nguyên Thi Khang, rédactrice de ce journal passée en 1933 au comité de rédaction du journal en langue française Monde, le ton est tout à fait autre. Il faut dire aussi que Monde est dirigé par Cao Van Chanh, un "retour de France" de tendance communiste. Par exemple, on peut y lire les lignes suivantes:
Le féminisme annamite se développe car les femmes annamites sont tenues dans une situation humiliante et pénible vis-à-vis des hommes, pris dans leur ensemble, et vis-à-vis des classes exploiteuses, en particulier.
Les lois qu'on impose aux femmes ne leur reconnaissent d'autres droits que ceux d'obéir. L'esclavage en ses formes les plus cruelles existe pour les femmes travailleuses annamites (prostitution, domestication, vente, louage).
Pour les filles des bourgeois et féodaux, la polygamie constitue une preuve de leur dépendance sexuelle au profit de l'égoïsme masculin. (...)
Je suis pour l'émancipation féminine; je suis pour l'unité de morale réclamée par les féministes. Mais je leur dis: Faites attention! Il ne faut pas que les vulgaires politiciens canalisent en l'avilissant votre mouvement d'émancipation. (...)
Vous courbez votre tête sous le joug masculin séculaire. Vous êtes privées des droits politiques les plus élémentaires, mesdames et mesdemoiselles 1.
Dans le numéro 6 du même journal, Mme Khang réagit dignement au propos de Nguyên Van Vinh, le rédacteur en chef de la revue Annam nouveau, entre autres, qui approuve la polygamie :
L'Annam nouveau dans son numéro du 4 janvier dernier parle des femmes en général et de leur émancipation, en particulier, en des termes vraiment provocants. (...)
Ainsi donc M. Vinh (Nguyên Van) a la charité spécifiquement bourgeoise de vouloir défendre la polygamie et ceux qui en profitent parce que la polygamie est préférable à la prostitution. Les femmes et ceux qui réclament l'abolition de la polygamie au nom de l'unité morale sauront répondre à leur insulteur public 1.
Dans l'éditorial du n°48 PNTD aborde cette question en des termes aussi convaincus : "L'homme a le droit d'avoir plusieurs femmes, c'est une blessure de la société .Non seulement la polygamie est inhumaine mais elles est encore en opposition avec l'harmonie céleste 2". Dans le numéro 23, PNTD revient sur la question des droits en insistant sur la nécessité d'élever le niveau d'instruction de la femme, ce qui conduirait directement à l'égalité des droits 3. L'attention du PNTD va également aux femmes qui, pour une raison ou une autre, sont devenues objets de désir et de plaisir pour les hommes. Cette catégorie de femmes, de plus en plus nombreuses dans les années 1930, se camoufle, entre autres, sous la dénomination de cô dâu ruou, les "compagnes d'alcool" à côté des chanteuses (cô dâu), elles ont pour rôle de tenir compagnie aux hommes dans leurs soirées dans "les maisons de chanteuses". Elles doivent boire avec eux, entretenir la conversation, et si possible les retenir à dormir en leur compagnie 4. Pour ces femmes de joie, PNTD préconise l'action pédagogique: il faut les raisonner, leur montrer la vie sans saveur qu'elle mènent afin qu'elles renoncent à cette vie et qu'elles n'en entraînent pas d'autres dans cette voie 1. Une autre lectrice, Tô Mi Son, fait le constat de la nouvelle situation en ces termes:
Autrefois, dans notre pays, quand les jeunes se mariaient ils ne pensaient pas à profiter du plaisir. Depuis que la civilisation occidentale déferle sur l'Asie du Sud, il semble que les jeunes sont poussés par quelqu'un jour et nuit leur disant: "Profites-en! Profites-en!" Depuis, l'expression "vivre sa vie" (en français dans le texte) ne quitte plus la cervelle des jeunes 2.
A propos du mariage libre PNTD reste aussi prudent: le journal conseille aux femmes de se préparer (mentalement) au lieu de se précipiter, car du mariage forcé au mariage libre, la route est encore difficile. D'après PNTD, pour parvenir au mariage libre il faut d'abord éliminer complètement (tru tiêt) les raisons du mariage forcé 3. Une lectrice enseignante, sous le pseudonyme de My Khuê, va dans le même sens:
Je me souviens que récemment j'ai parlé avec une enseignante française résidant au Vietnam depuis une trentaine d'années. Évoquant notre lutte pour l'égalité des droits elle dit que: "Avant d'exiger l'égalité des droits, les Vietnamiennes feraient mieux d'apprendre à bien faire la vaisselle et à bien élever les enfants".
Une parole méprisante! Une parole chargée de sens! C'est pourtant quelqu'un qui nous connaît bien 4.
Dans son propos, l'enseignante française fait sans doute allusion, d'une part, à la négligence des Vietnamiennes sur la question d'hygiène au sein du foyer, et d'autre part, sur la santé de leurs enfants qui ne sont pas rigoureusement suivis comme ceux des Français, lesquels bénéficient d'une attention particulière sur tout ce qui concerne le matériel.
L'attitude "réconciliatrice" de PNTD ne l'empêche pas de publier des débats ou des prises de position, certes avec modération, à l'encontre des moralistes. Vuong Kha Tê pose sans détour la question :"Une femme ayant perdu sa virginité peut-elle être pardonnée?" avant de poursuivre sa plaidoirie:
Les moralistes ne peuvent s'empêcher de s'agiter pour répondre à cette question par "impardonnable".
Quant à moi, je dirai :"Non seulement certaines femmes se trouvant dans ce cas sont pardonnables mais elles sont encore aimables".
Ma réponse est un peu brutale, cependant depuis que la vague de la civilisation occidentale arrive en Asie, combien de personnes ont approuvé la liberté dans le mariage?
Excités par l'idée du mariage libre, certains jeunes de notre pays se précipitent dans cette voie. (...)
Si on se place sur le plan psychologique, dans un jeune couple, la fille pense toujours au mariage tandis que la plupart des garçons ne pensent qu'au plaisir passager. Déjà crédules, comment les femmes peuvent-elles ne pas être amadouées par les belles paroles des "professionnels"? Par exemple, "quand on aime on ne regrette pas le corps".
N'est-ce pas l'usage social stérile qui ne sait pas pardonner à la femme imprudente et qui l'enferme dans un univers clos? (...)
Ainsi, la perte de virginité chez la femme est due dans la plupart des cas à l'homme.
Je n'écris pas ces lignes pour encourager les femmes à déconsidérer la virginité (qui est toujours précieuse, et celle qui n'est plus vierge est toujours méprisable), je ne fais que conseiller aux garçons de cesser de tromper pour le plaisir 1.
On constate que la fin cet article est en complète contradiction avec ce que l'auteur écrit au début. Comment faudrait-il comprendre cette volte-face? Sans doute, elle est due à un "compromis" apparent avec les conservateurs permettant à l'auteur d'échapper à la réputation d'immoralité; le manque de soin dans le style serait la deuxième raison de ce revirement d'idées. Ce qui est essentiel c'est que la question soit posée. Quant au tabou, il mettra le temps qu'il faudra pour s'estomper. Un autre auteur, Vu Xuân Thuât, reste persuadé que l'évolution suivra son cours:
Les sciences sont apparues d'une façon éclatante sur la surface de la Terre, la vague des droits de la femme a atteint les rivages de l'Asie du Sud-Est. Les jeunes sont réveillés, c'est pourquoi des conflits acharnés ont lieu dans la famille. Les vieux veulent à tout prix préserver leur droit de marier leurs enfants qui, eux, sont déterminés à choisir le mariage libre. On ne doit être ni triste ni content dans ce "conflit des deux âges" (en français dans le texte), car aucun pays ne peut échapper à ce passage tourmenté du cours du progrès. (...)
Quant à la tradition de marier les enfants en bas âge, elle est encore redoutable (...), surtout à la campagne et chez les familles riches.
Pour abolir ces tares (tê), les parents devraient accorder plus de droits aux enfants en gardant seulement le rôle de guides (huong dao). Je n'ose pas réclamer le mariage libre pour les jeunes car je pense que c'est encore prématuré, mais je suis persuadé qu'un jour viendra, on n'y pourra rien, qu'on le veuille ou non, et ce jour n'est pas lointain 1.
Quant à Luong Xuân Huê, il pense que son époque est complètement différente de celle des aînés, et son opinion est plus radicale. En effet, avant tout, d'après lui, il faut demander aux parents de remettre les droits sacrés (quyên thiêng liêng) du mariage aux enfants. Afin de rompre avec le mariage arrangé par la famille, il préconise une nouvelle démarche qui consiste à se servir des journaux comme intermédiaires pour la publication des annonces. Puis dans une deuxième étape, il convient de demander aux "détectives privés" (mât tham tu) de vérifier si les personnes correspondent bien aux annonces. Si oui, on peut célébrer les fiançailles qui permettent désormais aux intéressés d'échanger leurs idées pour savoir si leur âme soeur leur convient, dans le cas contraire il n'est pas trop tard pour une rupture. Et avant le mariage, cet auteur introduit l'idée d'une visite médicale pour prévenir les maladies héréditaires et dangereuses afin d'épargner ces malheurs aux enfants 1.
On se trouve ici dans une situation de tâtonnements car on est loin de l'idée que les jeunes puissent nouer des relations libres de tout intermédiaire. Le recours aux "détectives privés" peut faire sourire bien des observateurs a posteriori. Néanmoins, l'auteur de ces lignes est décidé à rompre avec la tradition en proposant une nouvelle approche du mariage. Il convient de souligner également l'idée de la visite médicale qui constitue une véritable innovation sur le plan des moeurs pour cette époque. D'autre part, dans un domaine où on s'aperçoit que l'opinion de l'homme est souvent moins radicale que celle de la femme, celui qui se borne à ne penser qu'à la virginité physique de la femme, en oubliant que la "virginité sentimentale est une perle que tout homme ne peut s'approprier", devient l'objet de l'ironie d'une lectrice 2.
Enfin, Melle Nam Huong suggère aux femmes qu'elles demandent à leurs parents d'abandonner lors du mariage la coutume de "fixer un prix" (thach cuoi) comme s'il s'agissait d'un bien vendu sur le marché 3.
En l'espace de quelques années, l'évolution s'affirme de plus en plus, et la modération des propos cède le pas à l'intransigeance des idées. Dans un article intitulé "Détruire la structure de la famille élargie" ( Pha huy chê dô dai gia dinh), une certaine Thu Tâm se livre dans les colonnes de Ngày nay à une véritable attaque contre l'ordre ancien. Rien que les termes utilisés ("détruire", etc.) dans le titre sont déjà révélateurs de cette prise de position. Cet auteur préconise, pour les jeunes mariés, un foyer à part afin qu'ils se sentent responsables de leur vie, et qu'ils cessent de compter sur (y lai) les autres (les parents élargis) avant de poursuivre sa plaidoirie en des termes résolus:
Autrefois nos parents mariaient leurs fils comme s'ils achetaient une domestique de confiance à un prix élevé. Je veux répéter sans cesse cette question : "Est-ce qu'ils prenaient femme pour leurs enfants ou pour eux-mêmes?" (...)
Ainsi, vous les femmes! Votre bonheur ne dépend que de vous. Vous devez en finir avec cette structure de famille élargie (chê dô dai gia dinh) inhumaine (vô nhân dao) 1.
Cette montée de la femme sur la scène sociale ne laissait pas l'Administration coloniale indifférente, surtout pas celle du Front populaire en cette époque de "voeux" pour l'Indochine. Effectivement, du Nord au Sud, la population toute entière remplissait avec enthousiasme les "cahiers de doléances" pour les présenter à l'Administration en espérant qu'elle change le cours des choses. En se référant aux dossiers du "Fonds Guernut" 2, on peut dénombrer 13 "voeux" relatifs aux revendications du "sexe faible" dont les principaux concernent sa situation vis-à-vis de l'homme ou du mari. Par exemple, le premier voeu consiste à demander des clarifications et des précisions sur le régime matrimonial, le deuxième concerne les droits de succession des femmes de deuxième rang et des concubines, tandis que le troisième envisage la suppression de la polygamie, et que le cinquième invoque l'adultère du mari comme cause possible du divorce si la femme le souhaite. Alors que les autres voeux traduisent la volonté de la femme d'être autonome en réclamant les droits sociaux. A titre d'exemple, la femme invoque le droit "de disposer librement du produit de son travail" lorsqu'elle est mariée, demande la création d'"écoles professionnelles pour jeunes filles", d'"offices de placement" (pour l'emploi), de "nouvelles maternités", et "l'accession à la plupart des emplois administratifs", l'application de "la réglementation du travail" ainsi que le congé-maternité. L'Admnistration semble favorable à certaines de ces revendications. Concernant la polygamie, elle émet l'idée que "d'ici une vingtaine d'années, le législateur pourra, sans crainte d'entrer en conflit avec la coutume, interdire les mariages de second rang", et elle pense pouvoir "hâter la disparition des concubines" par des mesures administratives surtout quand l'homme a déjà eu un enfant de son épouse et que la stérilité n'est pas certaine 1. A propos de l'adultère de l'homme comme cause possible du divorce que la femme peut invoquer, l'Administration pense qu'il "semblerait donc juste de reconnaître à l'épouse annamite ce droit". Quant à la création de nouveaux établissements divers, elle reste évasive en invoquant d'éventuelles possibilités budgétaires. Et les réglementations du travail? Elle se borne à dire que ces stipulations (interdiction de tout travail de nuit et de tout travail souterrain, repos nocturne obligatoire au moins de 11 heures consécutives, et repos de 20 minutes pour les mères afin d'allaiter leurs enfants) "sont pleines d'humanité" et qu'elle "doit exiger qu'elles soient observées" 1.
Enfin, évoquant le droit de vote, Dàn bà moi publie dans son numéro 10 du 23 février 1935 la liste des pays qui ont accordé ce droit aux femmes; la France ne figure pas dans cette liste puisque les Françaises n'ont obtenu le droit de vote qu'à la Libération en 1944. Peine perdue donc pour les Vietnamiennes qui réclament ce droit.
DROIT DE VOTE POUR LES FEMMES DANS LE MONDE
-
Australie
1893
Hongrie
1919
Finlande
1906
Afrique du Sud
1919
Norvège
1913
USA
1920
Danemark
1915
Belgique
1920
Pays-Bas
1917
Suède
1921
URSS
1918
Canada
1921
Royaume-Uni
1918
Pologne
1921
Tchécoslovaquie
1919
Inde
1922
Allemagne
1919
Grèce
1930
Autriche
1919
Espagne
1931
Au travers de ces revendications et de la remise en question de l'ordre ancien, on s'aperçoit que la femme vietnamienne poursuit le mouvement de la libération de la femme amorcé en Europe, qui se prolonge jusqu'en Chine où "les attaques contre la famille, toutefois, débutent par une double révolte des femmes et des jeunes qui constituent traditionnellement les groupes les plus défavorisés" 1. Les femmes chinoises des "milieux de fonctionnaires et de marchands" dans les ports du Sud, "les plus exposés aux influences extérieures", ont obtenu gain de cause, non sans mal, au début du siècle avec "l'abolition de la coutume de bander les pieds, l'accès à l'éducation et le libre choix du conjoint" 2. Au Vietnam, cette aspiration provient essentiellement de deux facteurs: la formation moderne plus accessible à la femme, l'éclosion de la presse en général et de la presse féministe en particulier. Le contexte socio-politique joue, à cet égard, le rôle de catalyseur qui canalise les mécontentements de la femme. Ce n'est certes pas un argument en faveur du colonialisme, mais paradoxalement c'est justement par le truchement du régime colonial que les représentants du "sexe faible" ont pu s'exprimer sur cette question précise; car les critiques les plus virulentes s'adressent aux structures familiales traditionnelles qui étouffent leurs membres, (entendons par là, la femme et l'enfant), tandis que celles qui visent directement le régime colonial en invoquant les droits sociaux, ne viennent qu'en deuxième position dans ces revendications. Cette attitude rejoint celle du mouvement Dông kinh nghia thuc du début du siècle, qui a commencé par récuser la tradition dans la lutte contre la domination coloniale. En d'autres termes, on pourrait admettre que les anciennes structures sociales et familiales vietnamiennes ne laissent aucune place à la libre expression, et encore moins à celle de la femme, pourtant indispensable à la genèse des idées modernes et à la marche du progrès. Par ailleurs, l'émancipation de la femme constitue en soi une composante de l'émancipation de l'individu en général contre la tradition séculaire. Or celle-ci repose essentiellement sur la famille, le lieu de prédilection qui lui permet de se perpétuer. Dans cette remise en cause, la famille devient la principale cible de la jeune génération qui se réveille avec un nouvel état d'esprit. A l'échelle de la famille, ce sont les parents, c'est plus particulièrement le père omnipotent qui se voit détrôné de son statut puisqu'il incarne l'autorité. Il va sans dire que les familles les plus dérangées, sans être les plus touchées d'ailleurs, par cette émancipation, sont les familles conservatrices qui observent les principes confucéens ou plus généralement les familles des couches privilégiées, notamment pour ce qui concerne la polygamie, laquelle est l'apanage des riches.
On assiste donc à une mutation de l'esprit : autrefois on raisonnait en termes de devoir, aujourd'hui, en termes de droits, droit à l'amour libre et au mariage par consentement mutuel, droit de la femme à demander le divorce, etc. Quant à l'ampleur du mouvement pour l'égalité des droits de la femme, elle ne diffère pas de celle de tout mouvement progressiste qui est spécifiquement urbain. Les masses paysannes doivent se contenter uniquement de l'écho qui leur parvient de la ville. Mais est-ce que les paysannes ont vraiment besoin d'une libération comme les citadines? Nous examinerons cette question dans la partie suivante.
LA FAMILLE OU L'OBJET DE LA CRITIQUE
Avant de poursuivre l'examen de ces bouleversements, il convient de s'attarder sur les différentes typologies de la famille. Edward Shorter qui a étudié la famille en Occident en propose trois principaux types :
- la famille conjugale de base, sans aucun autre parent sous le même toit;
- la famille souche (l'expression est de Frédéric Le Play, sociologue français du XIXe siècle), constituée d'un couple avec ses enfants et d'un couple de grands-parents;
- la vaste maisonnée regroupe latéralement et verticalement jusqu'à trois générations 1.
Tandis que Peter Laslett, un autre historien américain, suggère une typologie légèrement différente:
- l'unité conjugale simple, couple avec ou sans enfant;
- la famille élargie, formée de l'unité conjugale à laquelle viennent s'ajouter les parents dont le conjoint ou les enfants (éventuels) n'habitent pas sous le même toit;
- la famille multiple, constituée d'au moins deux unités conjugales parentes ou alliées cohabitant sous le même toit 2.
Ni les typologies d'Edward Shorter, ni celles de Peter Laslett ne correspondent vraiment à celles de la famille vietnamienne. En effet, celle-ci est généralement formée de "l'unité conjugale simple" à laquelle viennent s'ajouter les parents du mari, et plus précisément c'est l'aîné de la famille qui a la charge de veiller sur les parents. En d'autres termes quand l'aîné se marie il reste sous le même toit que les parents, tandis que ses frères peuvent aller fonder un nouveau foyer, et ses soeurs suivent leur mari. Il arrive aussi que, pour des raisons d'entente, les parents choisissent celui de leurs enfants avec lequel ils préfèrent habiter. Quand une famille n'a qu'une fille et lorsqu'elle se marie, très souvent la coutume veut que le marié vienne cohabiter avec les beaux-parents pour ne pas les laisser seuls, surtout quand il a d'autres frères, ceci constitue un autre cas de figure: c'est la tradition o rê. Dans les autres cas, quand le marié habite sous le toit des beaux-parents, il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de dignité ni de caractère car il se soumet à l'influence de la famille de sa femme. Nous ne revenons pas sur le rôle de chacun des membres de la famille, que nous avons déjà évoqué à maintes reprises dans différents chapitres.
Il nous reste cependant à savoir comment les remises en question de la tradition par la jeune génération s'opèrent au niveau de la famille. En ce qui concerne l'Europe occidentale, André Burguière et François Lebrun 1 se posent la question de savoir par quel processus la naissance de la famille moderne est arrivée à son terme, car plusieurs schémas sont possibles. La formation du couple moderne fondé sur l'amour romantique serait l'oeuvre des couches populaires qui ont rompu au XVIIIe siècle les amarres avec leur société traditionnelle d'origine pour émigrer dans les centres urbains à la veille de la révolution industrielle. Le mariage sur la base sentimentale vient concurrencer les enjeux de patrimoine traditionnels et aurait fini par conquérir les couches sociales élevées sous l'effet du mimétisme et de la contagion des valeurs individualistes. C'est l'hypothèse défendue par Edward Shorter. Ou à l'inverse, "ce modèle matrimonial aurait pris corps dans les classes supérieures à niveau d'instruction élevé et se serait diffusé par percolation sociale jusque dans les milieux populaires" 1. D'après Lawrence Stone, ce deuxième schéma s'applique au cas britannique où l'aristocratie joue "un rôle pionnier dans la formation d'une nouvelle civilisation conjugale" 2. Dernier schéma, celui de Norbert Elias qui considère que cette mutation constitue "un processus de civilisation", le résultat d'une transformation de l'Etat et de la société, qu'André Burguière et François Lebrun qualifient d'interprétation beaucoup plus globale 3. Sans entrer dans les détails car la réalité s'avère peut-être encore plus complexe, car il n'y a pas un seul schéma qui s'applique d'une façon satisfaisante à chaque pays, nous retenons les facteurs les plus décisifs dans cette mutation, à savoir, l'exode rural vers les centres industriels, qui s'accompagne d'une acculturation, le rôle de l'Etat, l'environnement soci-économique et enfin, sans doute aussi, l'essor intellectuel qu'aucun des auteurs cités ne prend en compte.
Ce détour par l'Europe et particulièrement par la France nous semble utile dans la mesure où cette dernière, pour diverses raisons, a quand même façonné une partie de la société vietnamienne à l'image de la sienne. L'exploitation des ressources minières qui s'accompagne de la mise sur pied d'une infrastructure donne naissance à une nouvelle forme de travail: le salariat; l'économie monétaire pratiquée à l'échelle régionale, nationale et internationale et le développement des industries locales, naguère à dimension villageoise (la fabrication de l'alcool, les filatures de coton et le travail de la soie, etc.) favorisent l'émergence d'une petite bourgeoisie urbaine et commerçante; l'introduction de la culture matérielle avec de nouveaux produits de consommation (parapluies, lampes à pétrole, allumettes, bicyclettes, vins et spiritueux, lait, boîtes de conserve, etc.) et de nouvelles distractions et loisirs (cinéma, théâtre, sport, etc.) vient bousculer les habitudes dans la vie quotidienne. Ici comme ailleurs, le salariat permet de facto à la femme de se sentir autonome sur le plan financier à l'égard de l'homme, dès lors elle se place sur le même pied d'égalité que l'homme dans les revendications des droits sociaux. L'enseignement franco-indigène, si imparfait soit-il, est tout de même plus accessible à la femme que l'enseignement traditionnel. Si l'effectif des jeunes filles dans les écoles représente toujours un pourcentage négligeable par rapport à celui des garçons, cela résulte plutôt de la condition sociale des familles et de leur résistance à l'idée que la femme soit instruite à un niveau acceptable, que du système d'enseignement qui, lui, est ouvert aux deux sexes. A cet égard, on constate avec stupéfaction que depuis l'institution des concours triennaux au XIe siècle jusqu'à leur abolition par le régime colonial (en 1915 pour le Tonkin et en 1918 pour l'Annam), aucune femme n'a pu accéder, pendant ces dix longs siècles, à cette prestigieuse machine mandarinale, sans parler de femmes diplômées. D'un autre côté, dans la période 1927-1935 plusieurs Vietnamiennes ont décroché en France des titres universitaires, et pas les moindres, après avoir terminé leur cursus au Vietnam: en 1927 la princesse Nhu Mai (la fille du roi Hàm Nghi déporté en Algérie) est reçue première au concours de sortie de l'école d'agronomie de Paris 1, en 1934 (?) Henriette Bùi a eu son doctorat en médecine, l'année suivante Hoàng Thi Nga devint la première Vietnamienne qui ait obtenu un doctorat d'Etat (ès Sciences) 1. L'intérêt pour les études et l'émergence de la jeune génération formée à l'école occidentale fera le reste, sans oublier le rôle qu'ont joué les femmes mariées avec des Français, qui étaient de véritables pionnières sur le plan des moeurs . On comprend alors pourquoi les critiques les plus aiguës de la part de la femme sont dirigées contre la tradition, car, pour elle, cette remise en question est la condition sine qua non pour parvenir à la libération totale de la tutelle familiale et sociale sous laquelle elle était enfermée. A cet égard, on constate également que cette remise en cause de la famille s'accompagne, dans les années 1930, de nouvelles expressions pour dénoncer et récuser son rôle. Il y va ainsi de gia dinh ap chê (la famille oppressive), de chê dô gia dinh (la tyrannie familiale).
Dans le contexte du Vietnam, l'évolution ne se limite pas à la transformation de la "famille souche" en "unité conjugale simple", pour la simple raison que cette dernière vient à son tour subir les effets de cette même évolution. Dans un premier temps, pour la période 1925-1935, on ne peut pas dire vraiment que le mariage d'amour a triomphé car c'était l'époque de la prise de conscience et de l'amorçage de l'émancipation. Bien que les débats fussent posés sur la place publique, le mariage arrangé par la famille était encore la règle, avec certes une petite dose de libéralisme qui consistait à demander l'avis des futur(e)s marié(e)s qui se connaissaient plus ou moins, contrairement au passé où les premiers intéressés ne s'étaient jamais rencontrés avant le mariage. Dans les familles aux idées avancées, même si le garçon avait la possibilité de choisir sa future épouse, il devait passer par l'entremise de la famille avant de pouvoir la fréquenter. Si la fille et sa famille ne voyaient pas d'obstacles, la première entrevue de deux familles devenait un rituel pour le mariage projeté. Par timidité et la tradition aidant, très souvent le fille n'assistait pas à cette première "demande" en mariage. Le cas du critique littéraire Vu Ngoc Phan, qui s'est marié en 1926 avec Hang Phuong qu'il avait choisie lui-même, avec son consentement toutefois, illustre parfaitement ce schéma. Si mineure soit-il, le fait qu'il a choisi le jour de Noël pour son mariage marque une autre évolution dans l'état d'esprit de la jeune génération de formation moderne occidentale, car traditionnellement la date du mariage, un jour important dans la vie d'un homme, devait toujours être choisie parmi les jours fastes en fonction de l'âge des mariés dans le calendrier lunaire. Néanmoins Vu Ngoc Phan reconnaît que, heureusement pour lui, le jour de Noël de cette année correspondait bien à un jour faste pour le mariage d'après les calculs des spécialistes 1.
Sur un autre plan, les anciennes générations ne voulaient pas distinguer les sentiments des plaisirs. Il arrivait que la mariée de l'ancien temps refusait à son mari de partager le même lit, s'il était en âge de passer les concours triennaux, tant qu'il n'aurait pas obtenu de titre. Ce défi avait pour but de ne pas détourner l'attention du mari des études au profit des plaisirs charnels. A cet égard la légende du couple Nguu lang-Chuc Nu est riche de renseignements. Nguu Lang n'est qu'un vulgaire "vacher" dont la tâche consiste à surveiller les buffles. Mais cet innocent tombe amoureux de Chuc Nu, la fille de l'"Auguste Ciel" (Ngoc hoàng thuong dê), et elle l'aime aussi. Cette différence sociale ne plaît guère l'"Auguste père" qui finit par consentir à les unir par les liens du mariage. Heureux et toujours innocent, ce couple croyait que désormais plus rien ne pourrait le séparer; Nguu-lang et Chuc-nu négligent leurs travaux, il abandonne ses buffles et elle, le tissage des vêtements, pour ne s'occuper que d'eux mêmes, ce qui rend l'Auguste Ciel furieux. Comme il tient à sa dignité et à la parole donnée il ne peut plus défaire ce lien. En revanche il use de son pouvoir de père omnipotent pour les éloigner l'un de l'autre tout en leur accordant une grâce : désormais ils ne peuvent plus se rencontrer qu'une fois l'an, le septième jour du septième mois : c'est l'origine du jour où on célèbre le fête Thât tich au Vietnam 1. La tradition populaire ne reste pas insensible à cet amour déchirant et déchiré. Quand il pleut ce jour-là (on est à la fin des saisons des pluies) les gens disent que ce sont les larmes de Nguu Lang et de Chuc Nu, dans l'émotion de leurs retrouvailles; si on voit apparaître un arc-en-ciel, (en vietnamien câu vông, littéralement le pont en arc de cercle) après la pluie, on dit que c'est le pont qui permet aux amoureux de se retrouver. Cependant, ni la légende ni la tradition populaire ne disent si ce couple s'est trouvé séparé à cause de l'excès de leurs sentiments, ou pour son penchant au plaisir charnel.
Dans son ouvrage que nous avons cité, Nguyên Vy relate "les" nuits nuptiales de Thanh (le jeune garçon à qui le directeur d'école avait conseillé de se couper les cheveux, et dont le père s'était mis dans tous ses états en apprenant la nouvelle, voir le chapitre sur l'Ecole) et de sa femme; le mariage a eu lieu dans les années 1920. La première nuit nuptiale, les mariés sont encore timides, ils partagent le même lit tout en restant chacun sur un bord. La deuxième nuit, la femme commence à enlever la longue tunique en gardant la petite pour dormir sur le bord du lit. Un moment après, pensant que sa femme s'est déjà endormie, le mari se rapproche d'elle et pose son nez sur la joue de sa femme pour l'"embrasser" 1 tandis qu'elle fait semblant de dormir: cette nuit-là elle ne résiste plus aux tentatives du mari 2.
Il convient de rappeler également que jusqu'aux années 1930 encore, les Vietnamiens se mariaient plutôt jeunes, les filles entre 16 et 20 ans et les garçons entre 18 et 22 ans. Les filles non mariées à 20 ans devenaient un souci pour leur famille qui se demandait si elles finiraient rapidement par trouver un mari ou, dans le cas contraire, par partir de la famille après avoir succombé aux charmes des "professionnels" de la sentimentalité, ou encore par être enceintes de ces derniers. Une véritable "bombe à retardement" que d'avoir une fille à marier, surtout pour les familles moralisatrices. Si dans l'ancien temps, les familles confucéennes préféraient marier leur fille à des étudiants, pratique sociale entrée dans la chanson populaire ("Je n'aime pas les grandes rizières ni les mares au bord de la maison 3, je préfère le pinceau et l'encrier de l'étudiant"), elles n'ont pas vraiment changé leurs critères dans les années 1930. Effectivement, elles recherchaient pour leur fille les étudiants de l'université ou des grandes écoles, les futurs mandarins ou à la rigueur les fonctionnaires du régime colonial, les valeurs sûres socialement. Par l'intermédiaire du Phong hoa, un auteur s'attaque à cette tradition en s'en prenant à la chanson populaire citée:
En entendant cette chanson populaire, on dirait que les filles vietnamiennes qui choisissaient leur mari avait un grand coeur (tâm long cao thuong), car elles refusaient la richesse pour marquer leur préférence pour le pinceau et l'encrier de l'étudiant. Mais en réfléchissant bien, elles étaient très malignes et loin d'avoir un grand coeur. En fait, elles voyaient plus loin en laissant de côté les avantages immédiats au profit des autres plus lointains.
Même si le patrimoine de l'étudiant d'hier ne dépassait pas le pinceau et l'encrier, les filles calculaient que cinq ou dix ans plus tard l'étudiant deviendrait le futur tiên sy, le futur mandarin avec tous les honneurs et avantages qui viendraient avec; les rizières et les mares seraient alors insignifiantes à côté 1.
Quoi qu'il en soit, les autres couches sociales ne suivaient pas les mêmes "valeurs sûres" confucéennes, sinon le mariage d'amour n'aurait pas existé. Le cas du journaliste Hoàng Tich Chu fournit à cet égard un exemple illustre. De retour de France il se lance dans le journalisme et devient le gérant du Dông Tây (Orient-Occident). Le métier de journaliste est encore nouveau pour les décennies 1920-1930, et celui qui exerce ce travail ne jouit pas d'une reconnaissance sociale comparable à celle des fonctionnaires et encore moins à celle des mandarins, puisqu'il est assimilé au chômeur. Pourtant ce "retour de France" bénéficie de l'amour d'une chanteuse du quartier de Khâm thiên, réputée pour son art et sa beauté, mademoiselle Sao. Elle refuse tous ses prétendants du haut de l'échelle sociale, les mandarins qui de toutes parts, attirés par son charme, viennent en vain lui demander son amour, elle refuse avec éclat leurs richesses, pour offrir son coeur à un journaliste de condition modeste, en 1931 (?). Elle est devenue une femme modèle et respectable, le soutien indispensable de Hoàng Tich Chu 1.
Au travers seulement de ces deux exemples de mariages d'amour (le cas de Vu Ngoc Phan et de Hoàng Tich Chu), il est bien difficile d'évaluer l'ampleur du mariage libre, et encore plus difficile de dire que la famille vietnamienne a été disloquée à cause de cette libération sentimentale. Il convient de se demander plutôt dans quelles couches sociales la famille était la plus touchée. Devant les sources rarissimes, et faute de données chiffrées et de témoignages, un détour vers les sources quantifiables quoique relevant d'une autre nature, nous semble difficilement évitable. De toute manière, aucune statistique ne mentionne que tel mariage est un mariage d'amour, ou tel autre, un mariage de "raison". Par ailleurs, l'ethnologue Diêp Dinh Hoa, dans un sourire chargé de sens, affirme que "l'amour, - au Vietnam et à travers son histoire -, est encore un terrain vierge" 2. Si la presse se fait écho des débats relatifs à l'évolution, on ne peut se contenter du peu d'exemples concrets qui ne peuvent servir que d'illustrations à l'ampleur de tel ou tel phénomène social. Effectivement, dans les faits divers, la presse rapporte par-ci, par-là, qu'une telle a quitté la famille, une autre son mari pour partir avec son amant, qu'un tel excédé par la jalousie finit par commettre un crime passionnel, etc. Quoi qu'il en soit, si la famille est destructurée, l'amour libre en serait la cause principale. Or dans l'amour libre, le plaisir et le sentiment constituent deux composantes essentielles.
LA FAMILLE REVISITEE
La multiplication des "maisons de tolérance" dans leurs formes diverses traduisait en fait l'explosion de la recherche du plaisir. Si du côté des femmes, la raison qui les poussait à livrer leur corps au plaisir des hommes était d'ordre social (pauvreté, misère...), il en était autrement chez ces derniers. L'effondrement des barrières sociales traditionnelles les ont livrés à eux-mêmes.
Il convient de distinguer à cet égard deux types de clientèle des maisons de plaisirs : ceux qui cherchaient à s'amuser pour s'amuser, et ceux qui ne récusaient pas les relations amoureuses et durables avec leur compagne d'une nuit: au contraire, ils les recherchaient même surtout avec les danseuses, les chanteuses et dans une moindre mesure avec les "compagnes d'alcool". De toute manière, la tranche d'âge 25-45 ans forme la majorité de la clientèle. D'un autre côté les Vietnamiens se mariaient encore à cette époque relativement jeunes. En d'autres termes, la famille subissait les premiers effets de la fréquentation par les hommes de tous ces lieux de plaisirs. "Que de drames conjugaux et familiaux, écrivent M.H. Virgitti et le Dr. Joyeux, ont été engendrés par ces femmes" (les chanteuses et leurs consoeurs, - on retrouve ici les accusations gratuites visant ces filles de joie -), sans parler des malversations et des cas où l'employé a vidé la caisse de son employeur, dilapidé des fonds publics pour se faire bien voir par elles 1. Des scènes de ménage en public dans les "maisons de chanteuses" n'étaient pas rares non plus 2, on se souvient de celle qui est évoquée plus haut à propos des dessins humoristiques. Laissons dans un premier temps les célibataires de côté. Si les hommes mariés fréquentaient ces lieux c'est sans doute parce qu'ils y trouvaient autre chose que ce qu'ils vivaient dans le quotidien familial, par une recherche de compensation à la monotonie en quelque sorte. Or cette compensation porte un nom: il s'agit soit du plaisir soit des sentiments amoureux. Il est difficile de défendre l'idée que l'amour fut la base sur laquelle reposaient les liens conjugaux chez les Vietnamiens de l'époque qui nous intéresse, car ils se mariaient par devoir et les parents se gardaient bien de demander leur avis aux futurs époux. "Le but du mariage, écrit Nguyên Van Huyên, est de perpétuer la famille. (...) Un ménage est considéré comme d'autant plus heureux qu'il y a plus d'enfants" 3. D'un autre côté, une fois mariés, ce n'était pas non plus l'amour qui liait les époux entre eux, mais toujours le fameux nghia (devoir), une notion morale issue du confucianisme. La promiscuité, l'occupation de l'espace intérieur du lieu d'habitation, et le voisinage interdisaient toute manifestation relative à l'amour romantique. Résultat, ces conditions culturelles ont fini par rejeter l'intimité, la tendresse, les intrigues amoureuses du couple en dehors de la sphère conjugale. La fréquentation des lieux de plaisirs venait alors remédier à ces frustrations. Les hommes y trouvaient un espace privilégié, une personne de l'autre sexe avec qui parler et se livrer aux jeux d'amour. Edward Shorter a bien souligné la dimension "dialogue" dans l'amour :" Le mariage d'amour suppose que l'on ne cesse de parler à son compagnon. Pour avoir des sujets de conversation, il faut que les gens aient une expérience commune. L'appartenance au même groupe d'âge est un facteur puissant de communication" 1. Effectivement, dans un couple vietnamien traditionnel, on ne peut pas dire que la communication soit le ciment qui rapproche les deux époux l'un à l'autre, étant donné la répartition de leur rôle sociale et familiale. L'épouse d'un lettré d'antan n'avait pas la même formation que son mari, rares étaient les femmes qui savaient lire et écrire les caractères chinois. La tradition n'accordait le mérite qu'à celle qui connaissait bien l'art ménager (noi tro), ou le commerce (buôn ban), les deux qualités suffisantes pour subvenir aux besoins familiaux et maintenir un foyer en vie. Dans ces conditions, y-avait-il un terrain d'entente entre les époux, un domaine, mis à part le ménage, qui les impliquait tous les deux à la fois ? La tradition passait outre cette dimension dans la mesure où seul le devoir (nghia) les unissait. Comme le mariage a court-circuité les intrigues sentimentales et inhibé la communication dans la vie amoureuse, ce sont elles que l'on retrouve après. Bref, on chasse le désir par la porte, et il revient par la fenêtre du foyer conjugal. Mais on peut dire aussi que c'est alors l'individu qui se réveillait et qui cherchait à se faire reconnaître à travers ses sentiments. Le rôle de l'homme dans la société, son caractère machiste, et le contact avec la vie moderne à forte coloration occidentale faisaient le reste.
Dans ce contexte, les hommes n'étaient pas les seuls à provoquer des drames et des vibrations familiales. Dans les milieux évolués, entendons par là, chez les couples gagnés aux idées de la vie moderne, la femme, à sa manière, affirmait également son réveil sentimental qui coïncidait avec l'époque de son émancipation et de sa libération du carcan familial traditionnel. A en croire la presse, l'adultère à l'initiative de la femme était monnaie courante. Ce thème apparaît souvent sous forme de caricature dans les journaux sensibles aux problèmes de moeurs tels que Phong hoa, Ngày nay, Dàn bà moi, etc. Les couples dans lesquels il y avait une grande différence de génération, donc de culture, étaient les plus exposés au phénomène. A ces causes, s'ajoutait le renversement des valeurs sociales liées à la femme. Autrefois, on déconsidérait la beauté physique de la femme, que primaient le caractères et l'habileté dans le travail; désormais elle apparaissait comme un ingrédient indispensable à l'amour 1. En France, dans l'ancien temps, on avait la même conception sur la femme et sur sa beauté. Rappelons le dicton :
La beauté ne se mange pas à la cuillère.
Il vaut mieux lui dire :"Laide, allons souper"
Que lui demander :"Belle, avons-nous à manger? 2"
"Aujourd'hui, écrit le journal République en 1938, ils (les Vietnamiens et les Vietnamiennes) s'avisent d'aimer et de souffrir s'il le faut, en tout cas d'être eux-mêmes" 3. Dans cette montée, la femme rivalisait avec l'homme qui n'avait plus l'apanage du plaisir ou de la recherche des sentiments. Avec cette perspective, la famille, autrefois sacrée, ne pouvait plus tenir son rôle de cohésion et de protection sociales contre le monde extérieur. Les barrières s'estompèrent et l'homme comme la femme, chacun à sa façon, essayaient de vivre leur vie. Les jeunes, étudiants pour la plupart, n'échappaient pas à cette règle, eux qui cherchaient à s'initier à l'amour. Mais bien des obstacles les attendaient sur ce chemin parfumé. La première difficulté relevait de l'ordre psychologique. De nature timide, les garçons avaient peur d'essuyer des échecs face à leur préférée, surtout quand ils tombaient amoureux d'elle. Au lieu de surmonter cette difficulté ils se tournaient vers une solution de facilité pour devenir les proies appétissantes d'une certaine catégorie de femmes à la recherche de la jeunesse. C'est ce qu'écrit Dào Dang Vy dans son reportage sur la jeunesse de la fin des années 1930, et de poursuivre ainsi:
Car si beaucoup de gens sont obligés de marchander leurs nuits d'amour et de payer cher leurs plaisirs, certains étudiants se voient miraculeusement attirés dans des couches parfumées. On connaît des "me tây" (les Vietnamiennes qui ont épousé les Français), des "cô" (des dames d'un certain âge) qui sont des amateurs passionnés d'étudiants et qui, pour une heure de griserie avec cette jeunesse fleurie, cherchent par tous les moyens à se concilier leurs bonnes grâces" 1.
Le lieu de résidence de ces dames se trouvait sur le Boulevard Armand Rousseau (actuel rue Lo Duc), à côté de l'école vétérinaire de Hà nôi. Décidément, la femme hantait l'esprit de la jeunesse masculine qui voulait tout découvrir, tout dévoiler chez elle. Les plus prévenus des étudiants avaient leur garçonnière où ils recevaient les amis et leur petite amie, et à l'intérieur de laquelle, comme dans leur chambre d'étudiant, on trouvait de la lecture érotique : L'amant de Lady Chatterley, L'art d'aimer en Orient, Kama Sutra, etc. 1. Dans leur carnets de notes figuraient les adresses des filles avec un signalement : "moderne, romantique, sort avec la petite soeur, accompagnée de la mère, surveillée", etc. Ce nouvel état d'esprit se traduisait aussi par l'adoption d'un nouveau comportement dans la vie amoureuse. Comme le signale Nguyên Vy, au début des années 1920 encore, garçons et filles faisaient bande à part : dans les salles de classe mixtes, la rangée qui se trouvait juste derrière celle des filles restait inoccupée, les garçons n'osaient pas se mettre à côté d'elles; à l'inverse, dans la rue, elles se protégeaient le visage derrière leur chapeau conique de peur d'être vues par les jeunes gens 2. Dans les années 1930, cette timidité et cette pudeur ont fini par laisser la place à la libre expression. "On ne regarde plus avec curiosité, écrit la Chronique coloniale en 1937, les couples indigènes étroitement enlacés qui passent, avec grâce, dans les rues des grandes villes". Et la Chronique de poursuivre : "Si on surprend dans un parc, deux jeunes amoureux en train de s'embrasser, on les dévisage sans surprise, oubliant qu'il y a quelques années à peine, le baiser n'eût jamais scellé, chez les Asiatiques l'échange réciproque d'une affection" 3.
Etant donné les habitudes sociales et culturelles, la recherche du plaisir était souvent indissociable de l'éveil sentimental, surtout chez les jeunes qui confondaient plaisir et sentiment. Cette confusion était habilement entretenue par les professionnelles dans le domaine du "clair-obscur charnel". Il existait à Hà nôi, révèle le reportage de Tràng Khanh et Viêt Sinh (alias Thach Lam, le cadet de Nhât Linh et de Hoàng Dao) des maisons privées, d'apparence respectable, spécialisées dans le commerce des sentiments haut de gamme 1. Chacune de ces maisons était dirigée par une patronne de culture moderne qui "éduquait" ses filles (au nombre de 5 ou 6 par maison) selon les normes "bourgeoises". Elle leur apprenait à chanter, à jouer des instruments de musique, à danser, mais elle leur enseignait aussi les bonnes manières et comment tenir la conversation. Agées de 16 à 18 ans, les jeunes filles parlaient aussi bien français que les étudiantes. Leur cible, les jeunes gens de famille riche. En été, la patronne les envoyait sur les plages (Sâm son, Dô son) pour attirer leurs proies. Les non avertis les confondaient facilement avec des jeunes filles de bonne famille. On nouait des relations et on se donnait rendez-vous à Hà nôi, chez la patronne. Le jeune amoureux retrouvait ainsi sa belle en compagnie d'autres "amies". Jusqu'ici les relations étaient strictement amicales. Les garçons venaient à la maison pour faire des parties de billard, chanter ou écouter les filles chanter et jouer de la musique, pour danser et discuter. Rien de plus normal. Le cours des choses changeait le jour où le jeune homme tomba vraiment amoureux de l'une d'elles qui, sur les conseils de la patronne, le faisait habilement payer petit à petit le prix de l'amour. Plusieurs dizaines de maisons de ce genre existaient à Hà nôi. Elles ne recevaient pas les inconnus. Pour pouvoir y pénétrer il fallait être présenté par les anciens clients.
Au-delà de la prostitution de luxe, la recherche de l'amour chez les garçons révélait en quelque sorte leur désir de rencontrer une compagne sans aucun intermédiaire, une rupture en fait avec les méthodes anciennes faisant des jeunes des deux sexes des personnes assistées ou effacées. Le changement des mentalités se situait aussi à ce niveau. Pour d'autres jeunes couples liés par le sentiment, et qui n'étaient pas tombés dans ces pièges, l'étape de la chambre d'hôtel constituait le dernier pas vers l'amour libre. A en croire les deux reporters Tràng Khanh et Viêt Sinh, la plupart des jeunes Hanoïennes n'ont pas hésité à faire ce pas décisif pour vivre leur amour sous l'influence de la littérature romanesque 1.
Si évolués que fussent les étudiants, d'après Dào Dang Vy, leur mariage était encore l'affaire de la famille, mais eux, ils cherchaient plutôt une maîtresse qu'une femme, de l'amour en somme. "Les conflits étaient inévitables". A propos de leurs relations avec les parents l'un des étudiants se confiait à cet auteur en ces termes :
Nous tâchons d'éviter le plus possible les conflits (s'abstenir si pas de conséquence fâcheuse)... Ces conflits sont cependant inévitables dans certains cas, alors nous luttons et ne cédons pas. Les difficultés viennent souvent des parents qui s'obstinent dans leurs erreurs 1.
Le malentendu s'aggrava avec les "Retours de France" qui ne respectaient plus personne. Certains se mirent à appeler leurs parents no en parlant d'eux. Dào Dang Vy trouve cela "renversant car le mot "no" qui désigne "lui, elle" ne s'emploie que pour les inférieurs, ou encore pour les animaux" 2. Pour d'autres, le label "Retour de France" constituait un titre en soi, voire une profession, qu'ils n'hésitaient pas à mentionner en bas des articles de journaux. Pour eux, les autres compatriotes restés au pays étaient presque tous des nhà quê (des paysans au sens péjoratif). D'après les observations de Dào Dang Vy, les conflits se creusèrent entre "Retour de France" et "locaux", "conflits non seulement dans la vie sociale, mais encore dans la famille même où les parents avec leur intransigeance et les enfants avec leurs transformations radicales, ne peuvent guère s'accorder quand ils sont appelés à vivre en commun sous le même toit" 3. Un autre "Retour de France", Nguyên Manh Tuong, auteur entre autres d'une thèse de doctorat sur l'invividu d'après les codes des Lê 4, fournit un témoignage qui vint relativiser les propos et les attitudes de ses camarades ayant connu la France :
On nous embarque! Il paraît que nous allions travailler en France pour la gloire de notre patrie. En réalité, nous fîmes l'apprentissage du froid, de la faim, de la mort. Lorsque la neige tombait, dans nos chambres sans chauffage, nous dormions avec nos pardessus sous des couvertures insuffisantes. (...) Il nous était arrivé de rester des jours sans un sou, sans une miette de pain. Ayant frappé aux portes amies vainement, bu toute honte, nous nous rappelions que nous avions une dignité humaine. (...) La tuberculose guettait nos squelettes décharnés. Je n'ose point regarder autour de moi : les vides que j'aperçois m'effraient 1.
Afin d'aller jusqu'au bout de cette question, notre reporter a interrogé les étudiants sur leurs relations avec la génération précédente, les "vieux" en général. Le dialogue de deux d'entre eux nous donne une certaine idée sur la question :
- Je vous répète que ce sont des pièces de musée et qu'il convient de les mettre dans les musées...
- ... Les vieux ne sont pas l'élément actif du pays, j'en conviens, mais leur expérience sert quand même à quelque chose...
- Leur inertie nuit plus que leur expérience ne sert. Et qui dit inertie dit ineptie.
- Alors les vieux ne sont bons à rien ?
- Ils sont bons à garder les maisons, à habiter avec les enfants. Mais qu'ils restent neutres et n'interviennent en aucune matière... Vous ne vous rendez pas compte des siècles de retard que nous avons subis dans l'histoire de la civilisation ? N'est-ce pas à ce conservatisme obstiné des vieux qu'est dû tout cet état de choses? ... Ce n'est au fond qu'une prudence exagérée, que de la lâcheté déguisée, et mal déguisée 2.
Mais paradoxalement, les jeunes réclamaient tous "des maîtres, des chefs, une élite". Bref, leurs réclamations signifiaient également qu'ils étaient à la recherche de "guides" appelés à se substituer aux lettrés en perte de vitesse dans la nouvelle conjoncture, et qui ont emporté avec eux les anciennes valeurs. Par ailleurs, cette jeunesse estudiantine était peu encline aux problèmes nationaux. Préférant les salles de cinéma, les théâtres et les dancings au combat national, elle se montra partout avec "une mine d'enterrement", et sa "mélancolie" était considérée par Dào Dang Vy presque comme "un cas pathologique".
Si partiel que soit le reportage de Dào Dang Vy (puisqu'il ne menait son enquête qu'auprès des étudiants masculins, qui représentaient, il est vrai, la majorité écrasante de l'ensemble des étudiants, car les filles ne faisaient qu'exceptionnellement partie de cette population), il met cependant en lumière l'état d'esprit de cette jeunesse, son anxiété devant une société en transformations. D'un autre côté, on s'aperçoit que la confrontation entre les différentes générations, ayant chacune ses propres repères et ses propres intérêts, était réelle. Autrefois lieu de prédilection de préservation et de transmission des valeurs traditionnelles, la famille est ainsi devenue le lieu privilégié des affrontements entre ceux qui représentaient l'époque moderne et ceux qui voulaient préserver à tout prix les pratiques sociales ancestrales.
Si sur le plan statistique on ignore l'ampleur de ces conflits de générations, tous les indicateurs de tendance en matière sociale, que ce soient les échos apparus dans la presse, ou la littérature et la poésie à un moindre degré, ou bien encore la fréquentation des lieux de plaisirs, incitent à croire que la cassure était profonde, voire irrémédiable. Le fait que les jeunes des deux sexes confondus acceptaient encore et à contrecoeur le mariage arrangé par la famille, comme l'a montré Dào Dang Vy à travers son reportage, révélait de fait l'existence de germes de discorde profonde au sein de leur famille et au tréfonds de leur âme. Loin d'étouffer les nouvelles aspirations des jeunes cette sorte de mariage, un compromis pour sauver les apparences, ne faisait que retarder les explosions sociales et individuelles qui se sont traduites concrètement chez les uns par un laisser-aller envers la famille, chez les autres par la recherche de nouveaux/nouvelles compagnons/compagnes, voie ouverte à l'adultère et au divorce. Les tribunaux provinciaux ont jugé 37 cas d'adultère en 1929, 48 cas l'année suivante. Ces chiffres incomplets fournis par l'Annuaire statistique de l'Indochine des années 1930-1931 ne sont certes pas alarmants, cependant il s'agissait uniquement des cas où la justice devait intervenir pour régler les conflits quand les tentatives de réconciliation ou de séparation à l'amiable avaient échoué. Combien d'autres qui n'ont pas été portés devant les magistrats, et combien qui ont échappé au Service des statistiques ? On l'ignore. Toutefois, rien que pour la province de Phu tho dans la période 1917-1922, en moyenne 10 "délits" d'adultère ont été jugés annuellement 1. Les demandes de divorce ont été jugées au tribunal du premier degré qui, le cas échéant, les transmettrait à celui du second degré si les affaires le dépassaient par leurs complexité. Chaque année, toujours pour la même province, une quinzaine de cas de divorce ont été prononcés par les tribunaux, dont la plupart étaient à l'initiative des femmes. Par exemple en 1926, sur 14 demandes de divorce transmises au tribunal du premier degré, 10 ont été formulées par la femme, 2 par le mari, et 2 conjointement par les deux époux 1. Sans entrer dans les détails, car les accusations étaient souvent contradictoires pour les deux parties, le fait que la femme pût invoquer des raisons de divorce constituait déjà un progrès pour les droits de la femme, car dans l'ancien temps seul le mari pouvait répudier la femme, et cela dans les sept cas suivants :
- stérilité;
- adultère;
- manque de piété filiale (bât kinh);
- bavardage et médisance;
- vol;
- jalousie;
- infirmités rendant la femme "impropre à la génération" 2.
Même si les législateurs de l'ancienne époque défendaient à l'homme de recourir à cet acte dans trois situations bien particulières, - quand les époux ont porté ensemble un deuil de trois ans de l'un des parents, si la femme a perdu depuis son mariage ses parents, et enfin lorsque le mari est devenu riche depuis son mariage - , les divers codes anciens avaient pour but de perpétuer les principes confucéens qui régissaient la famille au détriment de la femme. Il est vrai, par ailleurs, que la "loi" protégeait la famille dans les cas extrêmes. Par exemple, un condamné à mort serait gracié si ses parents dépassaient l'âge de soixante-dix ans et qu'ils n'avaient pas d'autres enfants qui pussent les entretenir 1. D'un autre côté, si la "loi" agissait de la sorte c'est parce qu'elle ignorait l'individu. L'épouse principale et les femmes de second rang étaient obligées de suivre le mari lorsqu'il était condamné à "l'exil" afin de "ne pas briser la famille" 2.
Enfin de compte, tous ces bouleversements, tant au niveau familial qu'au niveau social, traduisaient une révolte de l'individu contre la communauté, qui, pendant longtemps, l'avait étouffé dans les règles et les pratiques visant à préserver la cohésion sociale à son détriment. Les individus se sont ainsi libérés, à l'image des notes de musique, qui se détachent de la chaîne de mélodies pour affirmer leur propre existence dans la musique contemporaine, qui privilégie plutôt les sons que la mélodie en soi. Dans ces circonstances la conquête de l'individu et la conquête de l'amour ne faisaient qu'un. Le littérateur Truong Chinh dirait en d'autres termes que le conflit de famille ne constitue qu'une façade qui cache l'essentiel, lequel n'est autre que la conquête de l'amour libre 3. Cependant, la conquête de l'amour conduisait-elle nécessairement à l'amour radieux ? On a vu précédemment que le chemin de l'amour était plein d'embûches, et dans cette course à l'amour, les ravages ne devaient pas être négligés, surtout dans le contexte de la société vietnamienne à la cherche d'une nouvelle éthique. Dans les faits divers, les journaux signalaient des crimes passionnels 4, des avortements clandestins fréquents ou l'abandon des nourrissons à peine nés pour échapper à la sévère opinion des moralistes 1, des suicides quasi-quotidiens. D'après Hippolyte Le Breton, ces dégâts de la modernité étaient identifiés aux effets de l'acculturation qui, lorsqu'elle atteignait un "être faible", le rendait incapable de s'adapter aux nouvelles difficultés posées par la vie matérielle et morale 2.
Loin de fournir un descriptif détaillé sur la famille vietnamienne au contact de la modernité, ou d'épuiser les questions sur les transformations de cette nature, nous nous contentons d'apporter des éléments de réflexion, de signaler dans la mesure du possible, des facteurs susceptibles de faire voler la famille en éclats. Encore une fois, la catégorie de familles la plus exposée au passage du "typhon" demeure celle des citadins au contact avec la vie matérielle et morale moderne. Bien que dans la plupart des cas, les apparences soient sauvées, le rupture entre les générations, et parfois au sein de la même génération, est réelle et profonde. Au premier niveau, les enfants se révoltent contre les parents sur les sujets qui les concernent, le mariage en particulier; au second niveau, les époux se déchirent sur la question du sentimental et du plaisir. L'explosion de la recherche du plaisir constitue la toile de fond, et illustre le réveil de ce qui était tabou, la libération des moeurs. Mais cette explosion peut aussi servir d'indicateur, de témoignage sur une société qui se trouve entre deux courants antagonistes. A ce stade il est bien difficile de dire si c'est le contact avec la vie matérielle qui a fini par modeler les esprits ou le contraire. Faut-il d'ailleurs poser la question de la sorte ? Néanmoins une certitude demeure : les questions pressantes non résolues dans le passé reviennent au jour lorsque le contexte le permet. C'est ce qu'on observe actuellement au Vietnam nous a fait remarquer Trân Dinh Huou, professeur de littérature, dans nos entretiens au cours de l'été 1990 à Hà nôi. Toutes ces questions sur le droit de la femme, sur l'individu, sur l'amour libre posées à la société vietnamienne dans les années 1930 et restées sans réponse, reviennent aujourd'hui, cinquante ans après, à l'ordre du jour. Aussi nous nous intéresserons à étudier les lieux de plaisirs comme une composante de l'amour charnel.
LES LIEUX DE PLAISIRS
Par lettre, n°1258, en date du 28 avril dernier, le général de division, commandant supérieur des troupes du groupe de l'Indochine, me signale qu'un nombre considérable de militaires du 5e bataillon étranger, en garnison à Vietri, sont atteints de maladies vénériennes et me demande de prescrire les mesures préventives en usage en pareil cas.
Lettre du Résident supérieur du Tonkin à l'administrateur-résident de France à Hung Hoà, du 5 mai 1905 1.
Que peut-on dire du "plus vieux métier du monde" (cette dénomination elle-même n'étant pas nécessairement méritée sur le plan historique) dans le contexte du Vietnam ? Sous quelles formes ce métier se camouflait-il dans l'ancien temps et pourquoi devait-il se camoufler? Dans quelle mesure la prostitution pouvait-elle exister et quel était son rôle dans une société qui, apparemment, condamnait le plaisir au nom de la morale? Quelles couches sociales formaient le gros bataillon de la clientèle? Tant de questions, - relatives au temps reculé - , qui demeurent sans réponses, faute de sources. Néanmoins, les sources relatives à l'époque coloniale permettraient de reposer ces questions dans la perspective d'y apporter des éléments de réponses. A cet égard, la rigueur administrative des colonisateurs permet, entre autres, d'envisager une approche quantitative grâce à l'apport de précisions relatives à cette question. Par ailleurs, la littérature vietnamienne de l'Entre-Deux Guerres est beaucoup plus diserte que celle du passé. Ces deux principales sources d'informations apportent, après un traitement éventuel, un éclairage sur les différents aspects de cette question du plaisir charnel. Si l'Administration fait encore la sourde oreille jusqu'aux années 1930 devant les problèmes sanitaires causés par la prostitution et soulevés par la Ligue prophylactique, en charge d'étudier cette question, dès la conquête elle s'est attaquée à la réglementation de la prostitution. L'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1888, signé par le Résident-Maire de Hà nôi, stipule que toute fille publique doit être munie de sa "carte de santé" dont le prix est fixé à 4 piastres, payable par trimestre et d'avance 1. Le prix de cette "carte de santé" est porté à 6 piastres à partir du 1er janvier 1891, en application de l'arrêté du 15 décembre 1890, avant que cette carte soit supprimée par un autre arrêté du gouverneur général de l'Indochine, cette fois-ci, en date du 2 février 1904 2. Enfin, l'arrêté du 25 avril 1907 de l'Administrateur-Maire de Hà nôi vient compléter les précédents pour fixer les conditions de l'exercice de ce métier. L'Administration distingue en effet deux catégories de filles publiques: celles qui demeurent dans les "maisons de tolérance", et les autres, qui ont un domicile particulier (art. 2). Toutes sont astreintes aux visites médicales périodiques, à raison de deux fois par semaine (art. 12). Le traitement des malades se fait aussi dans deux établissements distincts : le dispensaire municipal est réservé aux filles d'origine européenne, et l'hôpital indigène aux autres (art. 17). Les patronnes des "maisons de tolérance" et/ou les filles isolées doivent rembourser les frais de traitement avancés par la ville (art. 17), et payer une taxe de 10 cents à chaque visite médicale (art. 18). Enfin les "maisons de tolérance" sont soumises à la patente selon leur classification (art.22). Si ces articles semblent conformes à la logique administrative et à une certaine morale, il y en a un qui mérite plus d'attention que les autres : on peut se demander ce qui a pu motiver les législateurs prescrivant que "toute fille publique qui demandera sa radiation du registre de la prostitution devra justifier de moyens d'existence assurés, ou prouver qu'elle est réclamée par une personne honorablement connue et en position de lui fournir les moyens d'existence" (art. 7). En dépit d'un certain bon sens, cette mesure administrative n'a-t-elle pas pour effet d'enfermer celles qui essaient de sortir de ce milieu par leurs propres moyens, ou du moins de leurs décourager dans les tentatives de revenir à la vie "normale"?
Quoi qu'il en soit, toutes ces réglementations sont impuissantes devant l'ampleur des problèmes découlant de la prostitution, et en particulier, les maladies vénériennes, la syphilis précisément. Les autorités civiles et militaires se renvoient la balle et s'accusent mutuellement de ne pas se donner les moyens pour enrayer le mal. En 1916, ce problème remonte jusqu'au ministre de la Guerre, qui adresse une lettre le 20 décembre au général commandant supérieur des troupes du groupe de l'Indochine ,lui demandant de "faire exercer une surveillance active sur les militaires rapatriables et de prendre toutes mesures utiles, de concert avec les autorités civiles, pour mettre fin à cet état de choses", après avoir été informé du "grand nombre de soldats de l'Infanterie coloniale ou de la Légion étrangère qui, venant d'Indochine ou du Tonkin, présentent à leur débarquement des chancres syphilitiques contractés avant l'embarquement à Haiphong, Saigon, Hanoi, etc.," 1. On ignore si cette recommandation est prise au sérieux ou non, toujours est-il que le rapport du 5 janvier de l'année suivante du Service des moeurs, souligne que "La réglementation de la prostitution ne pourra être appliquée à Hanoi d'une façon efficace, si l'autorité militaire ne nous vient en aide" 2. En effet, les moyens humains dont dispose l'Administration en 1917 encore sont dérisoires face au "péril", car le service de la police des moeurs de la ville de Hà nôi est assuré par un seul agent "qui du reste accomplit sa tâche de façon parfaite" 3. Sur les conseils du Dr. Cognacq, l'Administration supprime dans la même année la taxe de 10 cents pour les visites médicales hebdomadaires. Ce médecin suggère encore que "toute femme reconnue malade soit conduite à l'hôpital et soignée gratuitement" (souligné dans le texte), mesure non retenue par les autorités. Cependant tout le monde s'accorde pour désigner "l'ennemi public" et commun à tous : les filles publiques insaisissables qui sont la cause de tous les maux. Il faut attendre l'année 1934, un an après la création d'une "commission d'études", pour que le péril soit "officiellement reconnu et publiquement dénoncé". Devant ce laxisme, le président de la "Ligue prophylactique" s'indigne : "Qu'a t-on fait depuis cette date? Rien, absolument rien! 1"
Quelle était l'ampleur du problème des maladies vénériennes? Que connaissait-on des filles publiques? Etaient-elles nombreuses, et sous quelles formes pratiquaient-elles la prostitution? Y-a-t-il un rapport entre prostitution et conditions de vie? Les militaires français étaient-ils les seuls clients de ce commerce?
Les sources incomplètes ne permettent pas de cerner l'évolution de ces problèmes avec précision. Néanmoins, on constate que dans les années 1930 l'Administration fournit plus de détails, y compris des données chiffrées, qu'au début du siècle. Si on se fie à ces données on sera tenté de dire que la prostitution se développe d'année en année tout au long des quatre premières décennies du siècle. Dans les années 1930, la littérature en langue vietnamienne, et particulièrement les reportages, vient compléter ces sources officielles en y versant une autre donnée, la dimension sociale de la prostitution vue de l'intérieur.
A la fin du siècle dernier, en 1896 précisément, le rapport de la Police fait mention d'une petite vingtaine de "maisons de tolérance", situées dans le vieux Hà nôi (rue des Peignes, rue de la Digue, rue des Graines ...), qui habitent officiellement 120 femmes "cartées" dont 30 Japonaises. Les militaires français fréquentent surtout les cinq établissements de la rue des Peignes, les deux autres de la rue de la Digue, et ne semblent pas particulièrement attirés par les maisons japonaises. En dehors de ces lieux, la prostitution clandestine existe et la Police reconnaît qu'"il n'y a aucun moyen de la réprimer" 1. D'après ce même rapport, l'état sanitaire de ces maisons laisse à désirer, exceptions faites de deux ou trois d'entre elles : "Les lits de camp sales, repoussants, sont recouverts de nattes pourries. De véritables cloaques existent dans l'intérieur et dégagent une odeur nauséabonde". Dans ces conditions d'hygiène pour le moins précaires, comment peut-on échapper aux épidémies?
A propos de la clientèle, si les militaires français fréquentent un certain nombre de maisons, on peut en déduire que les civils et particulièrement les Vietnamiens ont une préférence pour les autres pour cette même époque. En 1917 les maisons japonaises sont réduites au nombre de deux, "appelées à disparaître" à la suite d'une campagne menée par la communauté japonaise indignée par le fait que certaines de ses membres livrent leur corps au plaisir des hommes dans un pays qui n'est pas le leur 2.
Ces chiffres "édifiants" et "désolants" montrent l'aggravation du problème des maladies vénériennes qui, d'année en année, ont contaminé de plus en plus de militaires. Ce graphe présente deux sommets: 1907 et 1914. De 1903 à 1906 le nombre de contaminés a quadruplé, passant de 8,28 % à 32,94 %, avant d'atteindre en 1907 le quintuple. A partir de 1908, la contamination diminue progressivement et d'une façon significative, mais le phénomène s'aggrave de nouveau en 1913; l'année 1914 atteint le chiffre record : les trois quarts des troupes sont atteints. On peut se demander si le déclenchement de la Première Guerre y est pour quelque chose. Si oui, ce serait le prix à payer pour les militaires devenus rois dans les situations de guerre. Pour un régiment dont l'effectif varie entre 5.000 et 7.000 hommes, ces pourcentages de contaminés ont de quoi inquiéter les autorités militaires. Le général Riou, commandant de la 1ère brigade de la région de Hung hoà, et le chef du bureau militaire de la résidence du Tonkin, sont unanimes pour reconnaître que la "morbidité vénérienne" représente le tiers de la "morbidité totale" des troupes, dans la période 1903-1905 d'après le premier, et pendant la Première Guerre d'après le second 1.
Pourcentages des affections vénériennes
par rapport à l'effectif du 9e régiment
de l'Infanterie coloniale dans la période 1903-1914 2.
-
1903
8,29%
1907
45,83%
1911
23,82%
1904
16,87%
1908
39,18%
1912
24,68%
1905
19,99%
1909
27,49%
1913
41,98%
1906
32,94%
1910
26,14%
1914
74,66%
Par ailleurs, pour attirer l'attention des autorités civiles sur un autre aspect du problème, les autorités militaires soulignent que ces malades occupent les 9/10 des traitements dans les formations sanitaires 1. Tous ces chiffres sont à mettre en rapport avec l'effectif des filles publiques qui ne cesse de croître. Par ailleurs, le dispensaire créé pour traiter les maladies vénériennes n'existe plus depuis le 1er décembre 1915 pour cause de réorganisation du Service d'après le rapport du chef du Service des moeurs, le brigadier Pierre 2. En 1916, le Service des moeurs dénombre 250 femmes réparties en 21 maisons de tolérance, sans parler des clandestines dans les 46 autres maisons mises en demeure, et sommées de disparaître. La prostitution clandestine constitue un réseau complexe qui englobe les tireurs de pousse-pousse complices qui procurent de la clientèle aux intéressées en échange d'une prime. Clandestines ou non, les filles publiques viennent, la plupart du temps, de la campagne ou d'une autre région en cherchant une vie meilleure. Certaines d'entre elles ne se fixent jamais; on les appelle "les filles errantes" qui vont de place en place, s'arrêtant quelques jours dans un endroit, quelques jours dans un autre, y font des victimes et repartent avant d'avoir pu être signalées et visitées 3. Le rapport du 5 janvier 1917 du Service des moeurs signale l'existence des métisses qui procurent au premier venu, et à sa demande, "des jeunes femmes ou filles annamites" ou mêmes européennes qui sont "très heureusement en assez petit nombre" 4. Le même rapport attire l'attention des autorités en suggérant des "mesures énergiques" contre la pédérastie à laquelle se livrent de nombreux indigènes à Hà nôi. En cette même année 1917, on évalue à plus de 2.000 le nombre de prostituées hanoïennes, dont 909 seulement sont immatriculées. Les trois quarts "des insoumises ou des soumises en fuite" vivent avec des militaires français et se livrent à la prostitution en leur absence avec la complicité des proxénètes. Un bon nombre d'insoumises sont ou ont été vendues aux patronnes, comme dans le cas de Nguyên Thi Tuyên, âgée seulement de 15 ans. Le commissariat de police de Viet tri établit le 25 juin 1912 un procès verbal la concernant dans termes suivants:
- Depuis combien de temps êtes-vous à Viet tri et qu'y faites-vous?
- J'ai été amenée à Viet tri, voilà une quinzaine de jours, par mes parents adoptifs, lesquels ont lié connaissance avec la mère Garcia et m'ont obligée à me prostituer. J'allais chaque soir faire des "passes" chez cette dernière.
- Pourquoi n'êtes-vous pas repartie avec eux (avec vos parents adoptifs) ?
- Parce qu'ils m'ont vendue pour 3 $ à la mère Garcia... La police se retourne alors vers "la mère Garcia":
- Reconnaissez-vous également avoir favorisé et aidé cette fille à se prostituer?
- Oui, j'allais la chercher lorsque des légionnaires me demandent des femmes.
- Comment Tuyên est-elle venue chez vous?
- C'est sa mère adoptive qui me l'a vendue pour 3 $ 1.
On ne peut être plus clair dans ces déclarations. L'Administration relève aussi un autre cas de figure dans lequel la femme devient "la bonne à tout faire" au service de son maître. Le rapport du secrétaire auxiliaire Helbert du 12 juillet 1917 retrace les faits ainsi :
J'ai l'honneur de rendre compte à M. Le Commissaire de police du 2ème arrondissement que ce matin à 9 h 45 s'est présenté devant moi le Maréchal des Logis, fourrier Rigaud, du 4e commandement d'artillerie coloniale, qui m'a déclaré qu'une femme indigène du nom de Nha Ha, dite Pho, dont la famille habite 30, rue du Coton, femme qu'il a à son service depuis quelques jours, lui a communiqué une maladie vénérienne 1.
Le rapport précise que cette femme a été licenciée par son maître le soir même de sa déclaration, avant d'être conduite à "l'hôpital indigène du Protectorat". Quant au contaminé, on ignore s'il a été récompensé par les autorités pour avoir identifié avec ses propres méthodes sa domestique comme une mauvaise fille porteuse de germes honteux.
Dans les années 1920, les sources sont plus rares, ainsi on ignore l'ampleur de ces problèmes. Néanmoins dans les registres de commerce de la ville de Hà nôi figurent une bonne vingtaine de maisons de chanteuses sises dans le rue de Huê, et une petite vingtaine dans la rue du Papier, toutes soumises à la patente de 12,80 $ par mois pour l'exercice 1926-1927 2. Ce sont les seules indications sur cette période qui nous soient parvenues. On peut supposer qu'il existe bien d'autres maisons de chanteuses dans d'autres quartiers de Hà nôi, sans parler des "maisons de tolérance". Il convient également de signaler que, dans les années 1920, les maisons de chanteuses, autrefois lieu de distraction culturelle pour les lettrés, se sont métamorphosées en lieux de plaisir charnel. "Les chanteuses, qui étaient autrefois, écrit en 1925 le Dr. Coppin, Médecin-chef du dispensaire municipal de Hà nôi, des Egéries charmantes et platoniques, chez qui les lettrés venaient chercher leurs plus délicates inspirations, sont bien déchues de leur ancienne splendeur et on peut dire qu'elles constituent une des principales sources de contamination pour les milieux bourgeois annamites" 1. En tout état de cause, l'absence de sources ne signifie pas pour autant que la prostitution cesse de se développer, car dans la décennie suivante, elle devient plus qu'inquiétant par la multiplication des lieux de plaisirs sous de nouvelles formes inconnues jusqu'alors.
Dans "Le projet de lutte antivénérienne à Hanoi", le Dr. Joyeux dresse un tableau sombre et alarmant, car selon lui tout le monde est suspect (d'être contaminé), militaires comme civils, Français comme Vietnamiens 2. Du côté des militaires français, le Dr. Joyeux estime que chaque mois 2.000 hommes, du légionnaire au sous-officier, fréquentent les "maisons de tolérance". D'après la police des moeurs, environ 300 légionnaires y viennent chaque mois, et le Dr. Joyeux se pose la question de savoir ce que font les 900 autres, "célibataires, actifs, jeunes pour la plupart, dont l'emploi du temps sexuel reste une énigme", avant de conclure qu'ils fréquentent "les femmes ailleurs que dans les maisons closes". En effet, on voit apparaître dans les années 1930 de nouveaux repaires de la prostitution qui sont les chambres meublées, appelées encore "les garnis", nhà sam en vietnamien (sam est la déformation de "chambre"). Il existe à cette époque environ 400 chambres, rien qu'à Hà nôi, sans compter plusieurs centaines de chambres dans les dix hôtels tenus par les Européens 1. "Les 9/10 (de l'ensemble de ces chambres) ne sont loués que pour y faire des passes, lit-on dans "Le projet de lutte antivénérienne", et sans ce genre de location aucun ou presque aucun (hôtel) ne pourrait subsister". Si l'une des mesures proposées par ce projet consiste à "supprimer les garnis", il ne va pas jusqu'à demander la fermeture des hôtels mais se contente de suggérer une surveillance administrative à l'entrée de ces établissements. Cette lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, dirait-on aujourd'hui, rencontre les limites imposées, d'une part, par les intérêts privés des patrons d'hôtels, et d'autre part, par la liberté individuelle du milieu colonial qui constitue la majorité de la clientèle de ces hôtels. En dehors de ces lieux, sans doute le gros contingent de la prostitution se trouve dans les fumeries servant de "maisons de passe" ou de rendez-vous. A l'exception de vieux habitués européens, ces endroits sont fréquentés uniquement par la clientèle vietnamienne; les militaires français préfèrent d'autres lieux à leur goût. "Suivant la spécialité de la maison, lit-on encore dans le même projet, on peut trouver tous les genres de consommations désirables : femmes, fillettes, éphèbes; peau blanche ou encore plus ou moins foncée". Dans ces conditions où personne ne se donne de véritables moyens pour lutter contre la prostitution et ses effets, on ne s'étonne plus que le nombre de "femmes en fuite" soit comparé à un "tonneau des Danaïdes". Les statistiques officielles des années 1931 et 1932 dénombrent environ 900 femmes repérées comme prostituées dont les trois quarts sont en fuite. Ces chiffres ne tiennent pas compte de celles qui "travaillent" dans les "maisons de chanteuses", qui sont sans doute plusieurs centaines. Néanmoins, pour cette décennie on enregistre un accroissement du nombre de filles publiques passées par le dispensaire pour les soins, "soumises" ou "insoumises". Dans la période 1930-1937, chaque année de 900 à 1.000 hospitalisées pour maladies vénériennes sont enregistrées par le dispensaire, qui devient aussi un centre de réinsertion sociale. On apprend aux prostituées "les notions pratiques et théoriques concernant la propreté corporelle et sexuelle, les maladies vénériennes et les moyens de s'en préserver" 1. Une quarantaine d'entre elles ont appris à lire et à écrire le quôc ngu, et trois autres même le français, au cours de l'année 1937. La réussite de ce centre s'explique par le changement de son état d'esprit : "autrefois une véritable prison", il est devenu un lieu d'entraide et de soutien moral pour celles qui viennent s'y faire soigner. Mais le mal est endémique, l'unique dispensaire de la ville de Hà nôi et un autre créé par l'Administration à proximité des "maisons de chanteuses" dans le quartier Khâm thiên, sous la pression de la Ligue prophylactique, n'arrivent au mieux qu'à limiter la contamination, car la formation de ces maisons connaît un rythme vertigineux. En 1938, la Ligue prophylactique dénombre à 1.100 le nombre de "chanteuses", estimation minimum, car il s'agit uniquement de celles relevant des maisons acquittant la patente.
NOMBRE DE "MAISONS DE CHANTEUSES"
DANS LA ZONE SUBURBAINE DE HA NOI EN 1938 1
-
Quartiers
Maisons
Femmes
Khâm thiên
40
200
Bach mai
49
150
Nga tu so
75
261
Nga tu vong
22
100
O cau giay
20
152
Gia lâm
36
186
Kim liên
9
40
Thai hà âp
13
60
Thuong cat
12
80
Gia quât *
18
80
Total : 10
294
1309
* (village Phuc xa, sur la route Yên phu, à proximité
du Grand Lac).
Si on ajoute à ce chiffre de 1309, le nombre de femmes dans les "garnis", celui des femmes dans les "maisons de tolérance" proprement dites, et celui des entraîneuses dans les "dancings", - ces trois dernières catégories de femmes ne sont pas comptabilisées dans la brochure de Virgitti-Joyeux - , sans compter les clandestines, on obtient une estimation de l'ordre de 3.000 femmes qui se livraient à la prostitution. Le journal Phu nu thoi dàm révèle dans son numéro 7 du 15/16 décembre 1930, qu'il y a environ dix "maisons de tolérance" dans chaque rue de Haiphong. Pour la ville de Hà nôi dont la population est estimée à 150.000 habitants en 1938 1, il y aurait une prostituée pour environ vingt à trente habitants masculins, en évaluant grossièrement à la moitié le nombre de femmes sur la population totale. Ce fort taux de fréquentation des lieux de plaisirs, impressionnant voire effrayant, signifie aussi que toutes les couches sociales sont impliquées.
On peut aussi se demander pourquoi les "maisons de chanteuses" ont toutes, les unes après les autres, émigré vers la périphérie de Hà nôi à partir de la fin des années 1920. A l'origine, pour diverses raisons ("cherté du terrain, des loyers et conditions générales de vie, surpeuplement, taxes, sujétions administratives et policières", etc.), bon nombre de Vietnamiens fuyaient la ville pour aller s'installer le long des axes routiers et dans les villages aux portes de la ville. Les "maisons de chanteuses" ont suivi ce mouvement vers la périphérie, et autour d'elles venaient s'installer "une foule de commerçants et de boutiques satellites" pour former enfin des quartiers dont les conditions d'hygiène laissaient à désirer (absence d'eau potable, d'éclairage électrique, d'égouts) 2. Nous verrons dans le prochain chapitre l'historique des "maisons de chanteuses", et celui du mode de chant a dào, connu encore sous un autre nom ca tru. A cette époque, ces maisons proposaient en grand nombre de "compagnes d'alcool", appelées plus familièrement cô dâu ruou (cô dâu: la chanteuse; ruou: l'alcool), ayant pour rôle d'assister les vraies chanteuses dans l'accueil de la clientèle, accueil qui allait de la compagnie (conversations, consommation d'alcool) au plaisir charnel. En fait, elles venaient grossir le contingent de la prostitution sous une nouvelle forme. Trong Lang, dans son reportage sur la vie nocturne de Hà nôi, dévoile les différentes méthodes employées par les patronnes à la recherche de filles. Profitant des conditions de vie misérables à la campagne, ces tenancières des maisons de plaisirs promettent une vie meilleure aux innocentes, les jeunes paysannes qui cherchent à échapper à la misère, ou les domestiques qui souhaitent avoir des amants 1. Ces marchandes de plaisirs leur fournissent ainsi de beaux vêtements, un lieu d'hébergement qu'elles paient du prix de leur corps. Les tarifs pratiqués dans les "maisons de chanteuses" concurrencent, à l'avantage de celles-ci, les "vulgaires maisons publiques", car une tournée de chant, pour un groupe, ne coûte qu'une piastre; et si le client se décide à passer la nuit, il paye le supplément en fonction des services demandés (alcool, souper, compagnie de nuit, etc.). Quant aux vraies chanteuses, tous les observateurs étaient unanimes à dire qu'elles n'étaient plus inaccessibles comme avant, ou du moins il n'en restait plus que quelques-unes qui le fussent. Néanmoins elles étaient plus choyées par les patronnes que les autres, car bénéficiant d'un statut d'artiste, elles valaient plus cher que leurs consoeurs, les "compagnes d'alcool".
En réaction à une campagne de lutte contre les maladies vénériennes, à l'initiative d'un membre du Conseil municipal de la ville de Hai phong, en la personne de Nguyên Ngoc Phong, dit Si Ky, qui a émis l'idée d'obliger toutes les chanteuses professionnelles à passer régulièrement la visite médicale, deux d'entre elles ont élevé leur voix pour protester contre cette mesure tendant à les assimiler aux simples filles publiques. Il s'agissait de mesdemoiselles Ngân Phuong et Lê Hông qui se sont exprimées, au nom de toutes leurs collègues, dans une petite brochure publiée sans doute dans la décennie 1930 1. Elles se défendaient contre l'idée que les chanteuses devaient satisfaire leurs clients sur le plan sexuel en échange d'une protection et des cadeaux qui n'étaient que l'expression naturelle d'une attention particulière envers elles de la part des clients haut placés, puisqu'elles étaient leur maîtresse (nguoi yêu). Les relations qui liaient les clients aux chanteuses dépassaient la dimension charnelle, car ils s'agissait des sentiments nobles résultant de leur rencontre du premier jour qui révélait l'entente mutuelle sur le plan artistique et culturelle 2. De l'avis de ces deux chanteuses, si les clients n'avaient recherché que du plaisir bassement charnel, sans aucune coloration sentimentale, ils seraient allés plutôt aux "maisons de tolérance" qui leur auraient revenu beaucoup moins cher et leurs satisfactions auraient immédiatement été récompensées. La compagnie auprès les chanteuses devait renfermer inéluctablement la dimension sentimentale 3.
Autre son de cloche : le rapport de la Ligue prophylactique décrit comment les patronnes les utilisent comme appât:
Lorsqu'à la suite d'une visite dans une maison de chanteuses un amateur s'est amouraché de l'une d'elles, il ne manque pas d'y revenir. Il devient un assidu. Il y invite ses amis. (...)
La patronne surveille discrètement le jeu, elle en prolonge l'évolution et estime le moment extrême où sa "fille" doit s'abandonner pour ne pas lasser définitivement le si bon client. Celui-ci ayant atteint le bonheur, est souvent désillusionné. (...) Si la jalousie par hasard le tenaille, il ne s'offrira plus à lui que la ressource de racheter sa maîtresse à la patronne. Cette dernière alternative est toujours redoutée par la patronne lorsque l'une des pensionnaires a un pouvoir attractif. (...) Elle emploie alors l'astuce suivante qui sert également dans le cas où le client rassasié donne des signes d'infidélité : elle donne des conseils à sa "fille adoptive" pour qu'elle se rende antipathique et vexe même le "pigeon", cependant qu'une autre pensionnaire joue le jeu inverse et se fait désirer. Le coup de la substitution, quoique classique, est souvent couronné de succès 1.
Le reporter Trong Lang, quant à lui, raconte encore comment un client a succombé au charme et à la "gentillesse" d'une chanteuse nommée H :
H est fantastique. Ses armes? La beauté du visage et son comportement. Elle peut faire plaisir à tout le monde. Quand un vieux arrive, elle s'accroupit pour lui enlever les chaussures et les chaussettes. (...) Sa façon de "rançonner" est bien sublime. Elle connaît un certain A dont la femme vient d'accoucher. Elle envoie alors deux paniers de poulets (bu gà) et des oeufs frais pour offrir à la femme. Sachant que son client fait des achats à crédit au magasin Godart (le plus grand magasin de Hà nôi), elle lui propose un jour à se promener dans la rue commerçante Tràng tiên (ex-rue Paul Bert où se trouvait le magasin Godart) et l'entraîne dans le magasin, et ainsi de suite. Un jour où il a vendu son coche avec ses dernières parcelles de terre, il reçoit un mot de H. lui annonçant: "Notre amour a pris fin. Ne reviens plus. 1"
Ce client a-t-il payé cher son amour ? De l'avis des chanteuses, non. Car, lui, il a encore eu droit aux poulets et aux oeufs tandis que les autres devaient se contenter des "piments" et du "poivre" (allusions aux couleuvres qu'ils ont dû avaler). C'est le cas d'un certain "vieux" qui a donné sa voiture à une patronne et qui a dû la regarder conduire la voiture en compagnie d'un jeune 2. Le scénario inverse n'est pas rare non plus. L'aventure d'une certaine K. rétablit "l'équilibre" dans ce monde de faux-semblants. Un soir un homme la désire et lui propose trois billets de 20 piastres qu'elle accepte. Le lendemain le même client se représente en compagnie d'autres hommes, soi-disant de la police, et lui réclame les 60 piastres : il dit qu'on lui a volé cette somme. Pour éviter les histoires K consent à lui rendre l'argent 3.
Afin de connaître les raisons qui ont poussé ces femmes à la débauche, Trong Lang fait une tentative dans son reportage en leur posant des questions. Loin d'avancer dans ses investigations, il doit se contenter de la même réponse unanime de la part de toutes qui se bornent à dire "vi hoàn canh" (à cause des situations), cependant son reportage révèle le dessous du métier. Toutefois, leur nouvelle condition dans les "maisons de chanteuses" ne s'améliore pas pour autant, car elles deviennent prisonnières de leur patronne, pour ne pas dire esclaves. Pour les chanteuses comme leurs consoeurs, les sorties sont interdites, elles doivent rester à longueur de journée entre elles, derrière les barreaux du portail fermé à clef. Celles qui obtiennent l'autorisation, ne peuvent prendre que le pousse-pousse de la maison dont le tireur est un fidèle; le prix de la course est fixé par la patronne. Pour celles qui ne peuvent pas payer comptant, un carnet de crédit est mis à leur disposition. Ce système de crédit, considéré comme une générosité de la part de la patronne, sert en fait à ligoter les filles à leur pension. Pour se laver elles doivent acheter de l'eau à la pension, à raison de trois sous par cuvette. Des sanctions spéciales sont réservées à celle qui transgresse les règles de la maison. Si c'est l'hiver, elle doit se mettre à genoux dans la cour après avoir enlevé tous ses vêtements. Quand une consoeur passe devant la fautive, elle doit lui verser de l'eau froide sur le corps. Si par hasard, une autre prend pitié d'elle et n'exécute pas cette torture, on lui fait subir le même sort. Les têtues sont attachées nues et livrées, avec la bénédiction de la patronne, à un bourreau qui se permet tout avec elles après les avoir rouées de coups 1. Les patronnes, dans leurs moments de colère, n'hésitent pas à dire qu'elles "sont moins utiles que les chiennes". En écrivant ces lignes, le reporter indigné se dit: "On n'est pas annamite pour rien" (en français dans le texte). D'après Trong Lang, 50 à 60 pour cent des clients des "maisons de chanteuses" sont atteints de maladies vénériennes 1. Par ailleurs, ces maisons sont de véritables lieux de débauche. Souvent, les clients transforment leur soirée d'alcool "en orgie à la romaine" (dêm loan dâm dac cô la-ma). Certains d'autres, sans aucun respect ni souci des convenances, n'hésitent pas à faire leurs besoins sur place, d'autres crachent à la figure des "chanteuses" pour se défouler 2.
Ce reportage témoigne, sans aucun doute, d'un certain intérêt de la part de l'opinion pour le sort des chanteuses. En 1932, le journal Tiêng dân du lettré Huynh Thuc Khang publie, dans la rubrique Chuyên doi (Les histoires de la vie), une conversation entre un "mandarin" et une chanteuse. Après lui avoir fait comprendre qu'il n'est pas venu pour s'amuser mais pour écouter ce qu'elle a à dire au fond d'elle-même, le "mandarin" écoute les "confessions" de la chanteuse qui se montre, pour le moins, lucide dans ses réflexions.
Mon mandarin, la nuit souvent quand nous réfléchissons nous ne pouvons qu'être tristes à pleurer à cause de ce qu'on dit de nous. Certes, notre métier est bien humiliant, mais mon mandarin, dans notre société actuelle, il y a bien d'autres métiers qui sont aussi humiliants. En parlant de vendre son corps (ban minh) pour se nourrir, combien de métiers sont différents des nôtres d'après vous? (...) En bas de l'échelle sociale, on a les tireurs de pousse-pousse qui, du matin au soir, courbent le dos péniblement pour transporter quelqu'un d'autre, lequel est aussi un être humain comme nous; n'est-ce pas là aussi vendre son corps pour vivre? En haut de l'échelle... certains ne font qu'attendre l'ordre des autres, soit-il juste ou injuste, pour s'agiter. Ils ont bien un cerveau mais qui ne sert à rien. Vous ne pensez pas, mon mandarin, que là aussi, il s'agit de vendre son corps pour se nourrir ? Seulement on est un peu plus sévère avec nous 1.
Si les jouisseurs se moquent du sort des chanteuses et de leurs assistantes, ils sont loin de représenter l'opinion qui, elle, désigne les vraies causes du mal, comme le fait le journal Tân tiên (Le progrès), à travers l'article d'un certain Dat Vân :
D'après les statistiques récentes des médecins spécialistes des maladies vénériennes, on s'aperçoit que ceux qui sont atteints par ces maladies sont de plus en plus nombreux. Pourquoi? (...) On condamne ainsi les filles de joie; si on pouvait les torturer on n'hésiterait pas.
On se trompe sur toutes la ligne. On ne sait que les condamner sans reconnaître ceux qui les ont poussées dans cette voie. (...) Si la société n'était pas la cause principale, il n'y aurait pas d'autre cause. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quelle injustice de condamner ces femmes sans condamner la société ! En approfondissant, on s'aperçoit que la plupart des filles publiques ont été d'abord trahies en amour. (...) Par ailleurs si elles se trompaient en se laissant entraîner dans cette voie, et s'il n'y avait personne qui vienne les voir pour les plaisirs charnels, elles finiraient par abandonner leur métier. On n'aurait pas besoin de lutter, le phénomène disparaîtrait de lui-même 2.
De ces témoignages et des données statistiques relatives à la prostitution, certes aussi incomplets les uns que les autres, plusieurs enseignements découlent. D'une manière générale, la société vietnamienne tout entière, du moins les milieux urbains, est touchée par le phénomène de la prostitution. Si les contingents militaires français forment une clientèle fidèle des "maisons de tolérance", ils ne représentent pas pour autant la majorité des clients qui sont des nationaux eux-mêmes. On s'aperçoit d'autre part que dans le monde du plaisir comme dans d'autres mondes, la hiérarchie sociale demeure la règle : les différentes couches sociales ne se mélangent pas, chacune a ses préférences pour tel ou tel quartier. Cette ségrégation sociale est imposée par les tarifs pratiqués en fonction de la qualité des divertissements proposés. "L'aristocratique quartier de Khâm thiên" demeure le lieu préféré des couches aisées (particulièrement mandarins et fonctionnaires) et des jeunes de formation moderne, des "Retours de France", entre autres. Cette clientèle sélective est attirée par la réputation des chanteuses - qui se réduit comme une peau de chagrin - et celle des cô dâu ruou ("les compagnes d'alcool") toutes "fraîches" venues de la campagne. Dans l'ancien temps, seuls des lettrés ou des mandarins recherchaient la compagnie des chanteuses qui connaissaient les arts et la bienséance. Désormais il suffit de se munir d'un petit pécule pour accéder à cette distraction. S'agit-il pour autant d'une démocratisation de cette pratique sociale ? On ne peut l'affirmer qu'avec une grande réserve, car cette distraction à la fois artistique et culturelle a été vidée de sa substance. Sous l'appellation de chanteuse se cache en fait la prostitution semi-clandestine. Il est vrai cependant qu'il est plus difficile de s'offrir une chanteuse qu'une "compagne d'alcool" pour une simple raison de convention sociale : les chanteuses bénéficient encore de leur réputation, que les patronnes cherchent à exploiter en les considérant comme des poules aux oeufs d'or.
Par ailleurs, on voit apparaître dans le même quartier de Khâm thiên, vers 1934-1935 des "dancings", cinq au total (Etoile Dancing, Déessa Dancing, Casino, Féérie, Pagode), une innovation importée directement de l'Occident en matière de distraction. Quelques années auparavant même les bars-dancings étaient rares , mais déjà c'était "une réussite contre toute attente" 1. C'est cette réussite même qui a donné naissance à de véritables "dancings". La plupart des "maisons de chanteuses" du quartier sont munies d'une salle de danse, et bon nombre de chanteuses exercent aussi le nouveau métier de danseuse dans le même établissement ou dans un autre. Les "dancings" embauchent les entraîneuses qui doivent s'initier, sans salaire, à la danse dans un premier temps, avant d'être payées suivant un tarif fixé par le patron en fonction de leur "professionnalisme" dans la souplesse, au sens propre et au sens figuré, et dans l'accueil des clients 2. Leur salaire varie de zéro (pour les débutantes) à trente piastres par mois. Celle qui tombe enceinte se voit congédier d'office. Les accidents de travail (perte de conscience, paralysie des jambes) touchant des entraîneuses enceintes se produisent fréquemment 3. Cette nouvelle forme de prostitution semi-clandestine permet aux "maisons de chanteuses" de rajeunir et d'attirer de nouveaux clients, les jeunes en particulier. Les militaires, las des "maisons closes" et plus familiers avec la danse qu'avec le chant, y viennent chercher leurs nouvelles "épouses temporaires". Une entraîneuse se plaint des soirs où elle tombe sur des militaires d'origine africaine, surtout quand ils sont ivres, et dit qu'elle devient "une cochonne pour eux" (chung em là con lon cua ho) 1. Chez les Vietnamiens cette distraction attire surtout la nouvelle vague de "secrétaires, commerçants, journalistes, médecins" 2. On danse la valse, le tango, le rumba, le fox-trot, la java, etc. Par ailleurs, les deux auteurs de la brochure sur le péril vénérien remarquent avec justesse que "le peuple annamite est un des moins danseurs du monde. Il est curieux de constater, en effet, que, en tant que démonstration d'allégresse, il n'existe pas chez eux de danse vraiment populaire" 3. La clientèle française se retrouve plutôt au Noctambules ou au Fantasio en plein centre de Hà nôi, en général les Français y viennent avec leur femme. Selon toute vraisemblance, la danse connaît une popularité qui se propage avec "une incroyable rapidité". Au-delà de la prostitution semi-clandestine qui se cache sous la bannière de la danse, des cours de danse sont ouverts un peu partout et rencontrent un succès total; à telle enseigne que la danse devient un sujet de débat, autour de la question de la femme, dans les colonnes des journaux 4. M.H. Virgitti et le Dr. Joyeux parlent même de "nouvelle religion" en constatant le fait que la jeunesse vietnamienne, "ivre d'européanisation", devient "fanatique" de la danse 1.
Quant aux couches populaires à la recherche du plaisir, elles doivent se contenter des bas quartiers qui leur proposent moins de confort. Leur lieu de rendez-vous se trouve à Bach mai, à proximité du Pont de Papier, aux carrefours Nga tu So, Nga tu Vong, etc. La clientèle est constituée surtout de "boys", de soldats et de paysans. Les ouvriers et les employés des chemins de fer dont le nombre varie entre 500 et 800 se retrouvent de l'autre côté du pont Doumer, à Gia lâm et sur la route de Bac ninh 2.
LE SUICIDE
Chaque société est prédisposée à fournir un contingent déterminé de morts volontaires.
Emile Durkheim.
Quelle est la nature du suicide dans le contexte de la société vietnamienne de l'Entre-Deux-Guerres ? Quel sens faut-il lui donner ? S'agit-il d'une crise sociale ou de la multiplication d'actes individuels et isolés ? Quelles en sont les causes et les motivations ? Pourquoi tant de suicides dans une société où ce geste avait-été qu'une extrême rareté? Nous allons essayer de le comprendre dans un premier temps avant de chercher, dans la mesure du possible, à l'expliquer ou à défaut à l'interpréter.
D'abord, plusieurs remarques préliminaires s'imposent. Aucune trace du suicide comme phénomène important ne se relève dans les livres d'histoire pré ou post-coloniale du Vietnam. Sur la période précoloniale, on peut donner à cette absence autant d'explications qu'on veut : soit que le phénomène ait été inconnu ou rarissime; soit qu'il s'agisse d'un oubli volontaire de la des historiographes et chroniqueurs, soit qu'il faille surtout prendre en compte le fait que l'histoire sociale a été négligée et éclipsée par l'histoire événementielle des dynasties régnantes, etc. Mais sur la période coloniale dont les sources tant françaises que vietnamiennes avaient bien attiré l'attention sur ce problème, nous n'avons pas davantage d'études sur la question. A ce jour, et à notre connaissance, le docteur Vu Công Hoè est le seul qui ait étudié le suicide, dans sa thèse de médecine de 1937, à partir des statistiques officielles et d'enquêtes personnelles 1. Nguyên Van Ung, quant à lui, n'a fait que mentionner le fait dans sa thèse sur la démographie 2. Notons enfin que les sources incomplètes, pour diverses raisons, rendent difficiles l'explication de la mort volontaire dans le contexte de la société vietnamienne de l'Entre-Deux-Guerres.
L'opinion publique se rappelle encore qu'en 1963 le révérend Quang Duc, moine bouddhiste, s'immola par le feu après s'être arrosé d'essence en pleine ville de Saigon, pour protester contre la politique religieuse discriminatoire du régime sud-vietnamien de Ngô Dinh Diêm. Ce cri d'alarme a déclenché une vague de suicides, et une dizaine d'autres bonzes se sont donné la mort de la même façon. Au début de la conquête coloniale, Nguyên Tri Phuong, en charge de défendre la capitale Hà nôi, a volontairement mis fin à sa vie en cessant de s'alimenter, après avoir été blessé et avoir succombé aux attaques de l'armée coloniale. Ces quelques exemples, si réducteurs soient-ils, montrent que le suicide n'était pas inconnu de la société vietnamienne. Faute de sources, nous ne pouvons pas remonter plus loin dans l'histoire, cependant selon toute vraisemblance, toute société humaine, et quelle que soit l'époque, connaît le suicide sous une forme ou une autre, pour une raison ou une autre 1; la société vietnamienne ne pouvait donc pas échapper à cette règle. Reste à savoir quel sens les Vietnamiens donnaient au suicide. Quant à l'ampleur du phénomène, l'absence de sources interdit toute tentative d'investigations.
Dans le cas du révérend Quang Duc, sa volonté de mettre fin à ses jours traduit l'ultime protestation contre l'injustice subie par la communauté bouddhiste et dont les bonzes sont les premières victimes, c'est le dernier recours pour attirer l'attention de l'opinion publique sur la discrimination en matière de religion dans un pays faisant partie du soi-disant monde libre. Le cas de Nguyên Tri Phuong relève d'une autre logique, celle de l'honneur. Le suicide conforte le suicidé dans l'idée de ne pas "perdre la face" devant l'ennemi. Il renoue ainsi avec la tradition héroïque des généraux d'antan, comme Trân Binh Trong (1259-1295), qui à l'époque de l'invasion mongole au XIIIe siècle, a cherché volontairement la mort en défiant envahisseurs leur déclarant, après sa capture, qu'il "préférait être le démon dans le pays du Sud (le Vietnam) que le monarque dans le pays du Nord" (la Chine) [thà làm quy nuoc Nam con hon làm vuong dât Bac]. Peut-on en dire autant des suicidés de l'époque qui nous intéresse ? Bien que ce sujet ait fait couler beaucoup d'encre dans le passé, en France notamment, il ne nous appartient pas de porter à ce propos un jugement moral. "Le procès du suicidé, écrit Jean-Claude Chesnais, instauré par ordonnance pénale de 1670, ne sera supprimé qu'en 1810, à la suite d'une violente polémique, où la philosophie des Lumières n'a pas été sans jouer un grand rôle" 1. Pour ne citer que les plus célèbres des protagonistes, Rousseau considérait le suicide comme "une mort furtive et honteuse, un vol fait au genre humain", tandis que Voltaire adoptait une attitude de tolérance en renvoyant "le ridicule de la persécution des cadavres" à ses adversaires, et que Montesquieu et Madame de Staël prenaient la défense du suicide en proclamant "la légitimité de la mort volontaire" 2.
Notre propos consiste plutôt à comprendre le phénomène en le mettant en rapport avec d'autres facteurs de déstabilisation de la société. En d'autres termes nous cherchons à comprendre le sens du suicide dans une société en prise avec la modernité. Un établissement des faits permettrait sans doute de mieux comprendre la nature et les mobiles de ce phénomène.
L'un des premiers cris d'alarme fut lancé en 1928 par l'éphémère revue Chuyên Phong hoa ("Histoires des moeurs", à ne pas confondre avec le journal Phong hoa dont l'existence est bien ultérieure à cette date), qui signala le suicide d'une jeune fille dans le Lac Truc Bach de Hà nôi 3. Le suicide comme "phénomène social" aurait débuté quelques années au-paravant, d'après le journal Phong hoa dans un numéro de 1932, qui remarqua également la fréquence régulière des suicides de filles et de femmes 4. Le phénomène aurait pris de telles proportions que les gens de cette époque faisaient de l'humour noir en classant les femmes en tête des "quatre mortels" (tu tu) devant les montres (en vietnamien quand une montre ne marche plus, on dit qu'elle est "morte"), les voitures, et, en dernière position, les journaux 1. Ainsi les lacs de Hà nôi ont été surnommés "les tombes de la beauté" (mô hông nhan) du fait que beaucoup de femmes suicidées ont choisi la noyade comme moyen de mettre fin à leurs jours. La revue Khoa hoc tap chi (Revue scientifique), spécialisée dans la vulgarisation technique, n'a pourtant pas oublié de mentionner la gravité du problème en écrivant qu'"il se passe rarement de jour sans qu'on entende parler du suicide, on dirait une maladie contagieuse qui se répand" 2. Le journal Dàn bà moi parle de "saison du suicide" (mùa tu tu) dans son numéro du 12 août 1935. Un coup d'oeil rapide permet de constater que ce mal-être traversait toutes les couches sociales sans distinction, et tous les âges. Un jour c'était un gérant d'un journal, un autre une femme, le jour suivant, un gardien d'école, et ainsi de suite. Le reportage de Dào Dang Vy, cité plus haut, révèle l'existence d'une association informelle de dix jeunes filles âgées de 16 à 25 ans, toutes "aussi romanesques les unes que les autres", qui ont prêté serment d'appliquer à la lettre les "statuts très sévères" établis par les membres fondatrices, statuts dont le premier article stipule : "Nous nous tuerions plutôt que d'accepter des conditions de vie qui ne seraient pas conformes à nos espérances, à notre programme (dont avoir un mari parfait, c'est-à-dire bien bâti physiquement, élégant de manières et surtout ayant au moins le bac" 3. L'une d'elles, Tuyêt Vân, fidèle au serment, s'est donné la mort en se jetant dans le Grand Lac (Hô Tây) après avoir découvert, quelques jours après le mariage, que son mari n'était pas un bachelier sorti du Lycée Albert Sarraut comme elle le croyait mais un simple garçon sans diplôme 1. On peut multiplier les exemples à une grande échelle.
La génération des écrivains des décennies 1930 et 1940 garde encore en mémoire le suicide célèbre de la jeune Phuong, réputée pour sa beauté, et celui de Tuyêt Hông, une autre jeune fille qui a fait beaucoup parler d'elle à son époque; toutes deux se sont jetées dans le Petit Lac (Hô Hoàn kiêm) dans les années 1930 pour témoigner de leur amour contrarié 2. Les écrivains de cette époque, émus par ces deux suicides de même nature, les ont faits entrer dans la littérature. La tragédie qui frappa la belle Phuong a servi de cadre à une pièce de théâtre intitulée Mô cô Phuong (La tombe de mademoiselle Phuong), celle de Tuyêt Hong a donné naissance à un roman portant son nom, Tuyêt Hông lê su (L'histoire dramatique de Tuyêt Hông).
Mais parfois, les sentiments sont moins sincères. C'est le jeu de la mort en quelque sorte. Le reporter Trong Lang rapporte précisément le cas d'un jeune enseignant qui s'est donné la mort avec "sa compagne", une chanteuse, pour témoigner de leur amour intense, ils avalèrent une dose d'opium mélangée avec du vinaigre, recette fort utilisée par les suicidés. L'amoureux succomba sans espoir d'être sauvé, tandis que la chanteuse, après une purge, retrouva la vie et oublia vite ses promesses. En fait, au lieu de prendre une dose "efficace" comme l'avait fait son compagnon, elle n'en avait pris que la moitié, ce qui lui permit d'avoir la vie sauve 1. L'amour qui rime difficilement avec la mort, trouve ici un artefact lui permettant de se substituer à elle. Le journal Monde de Cao Van Chanh s'indigne sur le fait que la presse fait trop de bruit autour des drames "d'amour bourgeois" au détriment des suicides des "travailleurs qu'on opprime et qui se tuent par désespoir" 2.
En matière de sources quantifiables, seul L'Annuaire statistique de l'Indochine, lui-même alimenté des chiffres fournis par la Direction du Service judiciaire, apporte un éclairage relatif. Le volume paru en 1931 sur la période 1923-1929 ne donne aucun chiffre sur ce sujet. Par contre, sur la période 1935-1942, cette publication officielle rend compte du problème en fournissant des chiffres mais bien que partiellement détaillés, ces chiffres ne permettent pas une étude approfondie de la question. Nous avons ainsi le tableau suivant mais les chiffres, globaux pour toute l'Indochine, interdisent toute interprétation détaillée. Nous ignorons par exemple la proportion des suicides dans chacun des "pays" qui la composent. En tout état de cause, les trois régions du Vietnam représentent un poids démographique évident face au Cambodge et au Laos. Ce qui nous incite à supposer que ces chiffres illustrent plutôt , et largement, la question du suicide dans les trois régions du Vietnam, que dans les deux autres pays. Nous devons ainsi tenir compte de la marge d'erreur résultante de ces contraintes.
TABLEAU 1 SUICIDES ET TENTATIVES DE SUICIDES
CLASSES PAR TRANCHES D'AGE ET PAR SEXE.
AGE 1935 1936 1937 1938
H F T H F T H F T H F T
- 16 ans 4 1 5 6 1 7 5 3 8 2 2 4
16-19ans 19 19 38 30 52 82 35 26 61 22 33 55
20-29ans 90 53 143 122 73 195 105 76 181 137 84 221
30-39ans 82 41 123 49 29 78 89 28 117 81 34 115
40-49ans 43 15 58 50 24 74 42 17 59 46 14 60
50-59ans 37 8 45 22 8 30 20 6 26 22 6 28
60-69ans 17 7 24 7 6 13 11 5 16 19 4 23
70-79ans 3 3 6 5 2 7 4 3 7 3 1 4
+ 80ans / 1 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2
inconnu 20 6 26 22 5 27 11 6 17 8 6 14
TOTAL 315 154 469 315 200 515 324 170 494 342 184 526
AGE 1940 1941 1942
H F T H F T H F T
- 16 ans 1 1 2 4 3 7 3 1 4
16-19 ans 20 16 36 14 11 25 20 16 36
20-29 ans 145 60 205 128 53 181 125 53 178
30-39 ans 77 31 108 63 30 93 86 38 124
40-49 ans 58 14 72 52 8 60 57 8 65
50-59 ans 22 14 36 27 4 31 25 8 33
60-69 ans 7 2 9 14 3 17 16 1 17
70-79 ans 4 / 4 7 / 7 3 2 5
+ 80 ans 1 / 1 2 1 3 2 / 2
inconnu 4 / 4 9 4 13 1 1 2
TOTAL 339 138 477 320 117 437 338 128 466
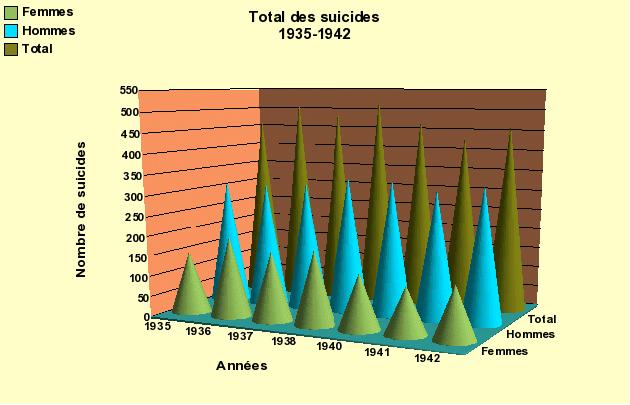
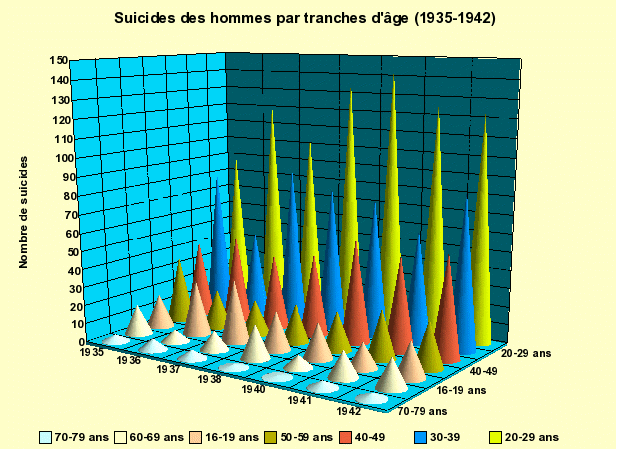
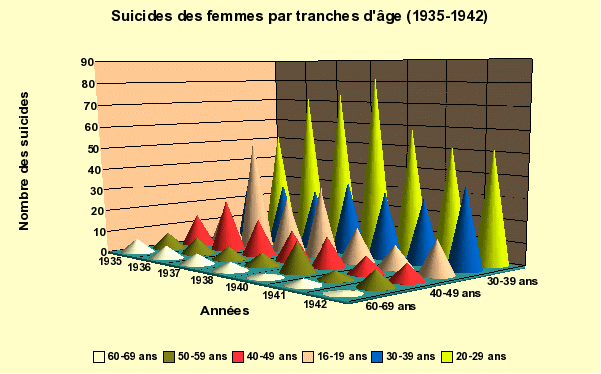
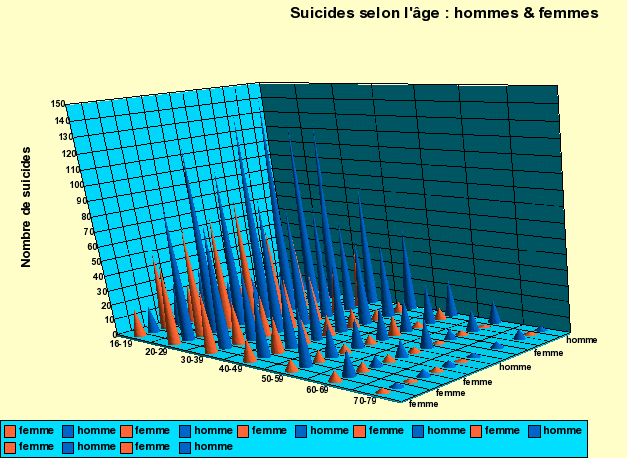
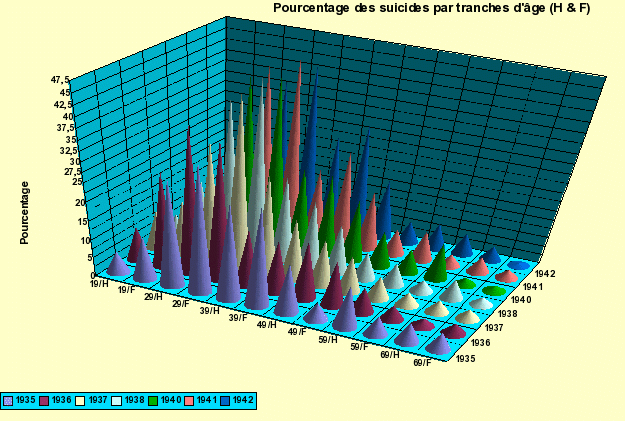
Comme ces chiffres ne permettent pas de distinguer les suicides des tentatives de suicide, on ignore le nombre exact des suicides. Ce n'est qu'un obstacle mineur qu'on peut contourner, car ce que nous cherchons à comprendre, le pourquoi des choses, est bien plus important que les chiffres exacts qui n'ont à cet égard qu'une valeur indicative. D'un autre côté, les suicides et les tentatives de suicide avaient au fond les mêmes mobiles qui ont poussé les uns et les autres à prendre la décision de mettre fin à leur vie. Ce sont justement les mobiles qui nous permettent d'avoir un éclairage sur les problèmes sociaux qui traversent la famille vietnamienne, par exemple. Pour cette raison, nous parlerons donc plutôt de suicide sans faire la distinction avec les tentatives de suicide, et sans pourtant trop risquer de tomber dans des erreurs d'interprétation. Deuxième remarque : ces statistiques nous laissent sur notre soif car aucune précision sur le statut matrimonial ni sur la profession des suicidés n'a été mentionnée. Il nous est donc impossible de savoir par exemple si les célibataires se suicidaient plus ou moins que les mariés, si le suicide est un phénomène strictement urbain ou il dépasse la frontière des villes pour atteindre la campagne.
On constate par ailleurs que les jeunes sont les plus touchés par le suicide, et particulièrement la tranche d'âge 20-29 ans qui totalise annuellement de 30 à 43% du total, soit une moyenne de 38,8% pour la période 1935-1942. Viennent ensuite les 30-39 ans qui représentent une moyenne de 23% du total des suicides, suivis des quadragénaires avec un peu plus de 13%. Les tout jeunes ne sont pas pour autant épargnés puisque les 16-19 ans "s'affirment", à eux seuls, et en moyenne annuelle, avec presque 10%. La courbe baisse progressivement à partir de 50 ans; grosso modo, elle démarre avec les moins de 16 ans et finit avec les septuagénaires au même niveau, entre quatre et huit suicides par an (voir graphe 1). Quant à la part respective de chaque sexe chez les désespérés, les hommes arrivent largement en tête avec une moyenne globale de 68% du total sur cette période (voir graphe 4). On constate certes une exception pour les jeunes de 16 à 19 ans, chez lesquels le nombre de suicides féminins l'emporte (52 contre 30 en 1936, et 33 contre 22 en 1938); en dehors de cette tranche d'âge, les hommes sont plus suicidaires que les femmes : le rapport du nombre des femmes à celui des hommes va du simple au double pour les 30-39 ans, et la disproportion est encore plus grande chez les quadragénaires. Cependant, il convient de nuancer ces résultats en valeurs absolues que nous venons de souligner; les calculs en pourcentages donneront un point de vue tout à fait différent. Ainsi chez les 20-29 ans, le pourcentage des femmes suicidées par rapport au total des suicides féminins tous âges confondus est bien supérieur à celui des hommes, 41,6% en moyenne sur cette période contre 37,5% chez les hommes, avec une pointe en 1941 de plus de 45% (voir graphe 3). Pour la tranches d'âge suivante, il n'y a pas entre eux de grande différence en pourcentage, autrement dit les femmes se suicident presque autant que les hommes en valeur proportionnelle. On remarque aussi qu'à partir de 30 ans jusqu'un âge avancé, les femmes résistent mieux que les hommes, écart plus important cependant en valeur absolue qu'en proportion : de 30 à 39 ans, 22% contre 26,6%. Chez les quadragénaires 13,1% contre 15,1%; chez les quinquagénaires 5,1% contre 7,6% (voir graphes 2 et 3). Faut-il conclure ici que les Vietnamiennes résistent mieux au suicide que leurs compatriotes masculins, ou trouver une autre interprétation de type durkheimien par exemple ? Bien que Durkheim ait poursuivi son étude sur le suicide avec une rigueur prononcée en prenant en compte nombre de facteurs susceptibles d'influer sur la mort volontaire, beaucoup de ses propos et parfois ses termes mêmes sont sujets, à notre avis, à discussion. Par exemple, "On connaît la facilité avec laquelle les Japonais s'ouvrent le ventre pour la raison la plus insignifiante" (p.239), "les sociétés inférieures" (p. 240, et passim) pour désigner les sociétés non occidentales et celles des temps reculés, "le raffiné des villes", pour désigner l'urbain par opposition au "laboureur" (p. 147). Son cadre d'étude est la société occidentale du XIXème siècle qui, à bien des égards, était traversée par toute une série d'événements : révolutions, crises politiques, révolution industrielle, exode rural, urbanisation, etc. Dans ce contexte, le suicide apparaît comme révélateur d'une société en crise 1. Après avoir établi les faits et les chiffres à l'appui qui montraient que les femmes se suicidaient moins que les hommes, Durkheim avance l'idée qu'elles se contentent de peu pour vivre, étant effacées sur le plan social et moins enclines aux ouvertures liées aux connaissances. A la page 167, nous pouvons lire les lignes suivantes :
"....Dans tous les pays du monde, la femme se suicide beaucoup moins que l'homme. Or elle est aussi beaucoup moins instruite. Essentiellement traditionaliste, elle règle sa conduite d'après les croyances établies et n'a pas de grands besoins intellectuels" 2.
On retrouve la même argumentation un peu plus loin:
".... On dit que les facultés affectives de la femme, étant très intenses, trouvent aisément leur emploi en dehors du cercle domestique. (...) En réalité, si elle a ce privilège, c'est que sa sensibilité est plutôt rudimentaire que très développée. (...) Elle n'a que peu de besoins qui soient tournés de ce côté (la société), et elle les contente à peu de frais. Avec quelques pratiques de dévotion, quelques animaux à soigner, la vieille fille a sa vie remplie" 3.
En effet cet auteur soutient l'idée que le taux de suicide augmente avec le niveau d'instruction, chez tous les peuples, sauf chez les Juifs pour des raisons propres à leur histoire, exception qui confirme donc la règle 1. Cette hypothèse se retrouve pourtant quelque peu démentie par ses propres chiffres. Dans le tableau de la page 147, Durkheim donne les pourcentages des suicides en France de la période 1847-1878, classés par mobiles et par professions ("agriculture" et "professions libérales") 2. Si on soustrait les "causes inconnues" et les "maladies mentales", pour les autres motifs, les pourcentages des suicides dans les "professions libérales" sont loin d'être en tête partout devant ceux de la catégorie "agriculture" : le mobile "chagrins de famille" occupe 13,14% chez les premiers contre 14,45% chez les seconds, "perte d'emploi, revers de fortune...", 8,87% contre 8,15%, "amour contrarié", 2,01% contre 1,48%, "ivresse", 6,41% contre 13,23%, etc. A cette époque, le milieu du XIXème siècle, on ne peut vraiment dire que les agriculteurs étaient aussi instruits que ceux qui exerçaient les professions libérales, or les premiers se suicidaient autant voire plus que les seconds en proportion. Il est vrai cependant qu'il s'agit d'un autre mode de calcul en pourcentage qui vient nuancer les calculs en valeur absolue. Pour l'Indochine comme pour les autres pays, bien que les explications sur le fait que les femmes se suicident "moins" que les hommes restent à élucider, nous sommes plus tentés de dire qu'elles résistent mieux qu'eux aux malheurs et à la misère de la vie.
A un autre niveau, pour ne prendre que l'année 1936 comme exemple, le taux de suicide serait alors de 2,2 pour 100.000 habitants pour toute l'Indochine, ou bien de 2,7 pour les trois régions du Vietnam (ce calcul est fait sur les bases de 515 suicides d'une part et de 23 millions d'Indochinois ou de 19 millions de Vietnamiens, d'autre part, chiffres fournis par l'Annuaire statistique de l'Indochine). Qu'on tienne compte ou non des deux autres pays de l'Indochine, ce taux ne varie guère énormément. Dans ce cas nous ne risquons pas une grosse erreur en admettant, pour des raisons de commodité, que les statistiques relatives au suicide concernent uniquement les trois régions du Vietnam. Les 2,7 représentent un taux très faible eu égard au taux de suicide connu dans les autres pays, notamment ceux de l'Europe dans la même période. Entre 1931 et 1938, le taux de suicide en France était de 20,2 (toujours pour 100.000 habitants), un taux moyen par rapport à celui de l'Autriche qui plafonnait à 40,7 et à celui de l'Italie, 8,5 le plus faible connu 1. A cet égard, on ne peut s'empêcher de se poser la question de savoir pourquoi la presse vietnamienne a fait tant de bruit sur le suicide au Vietnam, alors que son taux était loin d'être alarmant si l'on peut dire. Et par ailleurs pourquoi l'opinion et la presse se sont-elles uniquement émues sur le sort des femmes suicidées en faisant abstraction des suicides des hommes ? Comme on ignore tout de la question du suicide dans le passé, à la première question l'explication à donner serait de l'ordre de la nouveauté. Étant donné que la société traditionnelle vietnamienne était fortement structurée, les individus qui la composaient devaient supporter le poids de la communauté qui pesait sur eux sans leur laisser aucune alternative dans le choix devant la vie. Le rôle de l'individu consistait plutôt à renforcer l'édifice social qu'à apparaître comme élément autonome de la communauté. Le non-respect de la tradition conduisait inévitablement l'individu vers la voie de la marginalité. La culture matérielle et idéelle venue de l'Occident a fini par bouleverser l'ordre ancien en livrant les individus à eux-mêmes. Placé devant une société qui ne tient plus sur ses fondements, une société à la recherche de son identité et de ses nouvelles bases, l'individu cherche aussi sa propre voie. Le suicide apparaît alors comme une manifestation des révoltes contre la société, une expression de la liberté individuelle. En ce sens le suicide porte en lui une nouvelle expression pour la société vietnamienne. Beaucoup de philosophes parlent de "manifestations des progrès de la civilisation" 1. Le journal Phong hoa se demande si le suicide n'est pas le résultat de la rencontre des deux cultures, de l'ancien et du nouveau, s'il n'est pas la rançon de la civilisation moderne 2.
On est ici face à un débat à caractère exclusif opposant les sociologues, qui pensent qu'il faut chercher la racine du suicide dans la société, thèse soutenu par Durkheim qui lui a valu de se voir reprocher "les excès du sociologisme", aux psychiatres qui voient son origine dans les problèmes propres de l'individu. La troisième interprétation, la plus récente, met en rapport le suicide avec "la notion de prédisposition génétique" 3, qui reste à être démontrée. Nous partageons l'idée non exclusive de Jean-Claude Chesnais qui pense que "tout suicide est la résultat d'une combinaison de facteurs" 4.
Quant à l'émotion que le suicide des femmes produit dans l'opinion, on est tenté de faire à son sujet un rapprochement avec l'hystérie des femmes dont la France de la deuxième moitié du XIXème siècle était le théâtre. Un peu partout (à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg, en Ardèche) ce "mal-être" frappa les femmes par centaines à chaque crise. Le cas des hystériques de Morzine qui a duré 16 ans (1857-1873) est le plus révélateur du "mal-être féminin du XIXème siècle" 1. Mais ce rapprochement s'avère inadéquat, car le suicide des femmes vietnamiennes n'a pas atteint un seuil critique comme ce fut le cas pour l'hystérie qui frappa les Françaises. L'explication est à chercher plutôt du côté de la subjectivité : le suicide des femmes "existait" à travers la presse, tenue pour la plupart par les hommes qui se sont, sans doute, montrés plus émus pour les femmes que pour les hommes. Néanmoins, pour la société vietnamienne, le fait que des femmes, par centaines, se sont résolues tous les ans à renoncer à la vie révèle un mal de vivre profond chez elles. Quant aux mobiles de leurs actes, les statistiques apportent des éléments d'élucidation permettant de creuser le problème.
TABLEAU 2 SUICIDES ET TENTATIVES DE SUICIDES
PAR MOTIFS ET PAR ANNEE
Années M o t i f s (*)
Misère Perte Chagrin Amour Inconnus
d'emploi de famille contrarié
1 Total
9 Hommes 69 17 48 21 56 315
3 Femmes 32 6 31 19 18 154
5 Total 101 23 79 40 74 469
1
9 Hommes 62 10 77 15 75 315
3 Femmes 37 1 59 21 44 200
6 Total 99 11 132 36 119 515
1
9 Hommes 62 14 78 20 56 324
3 Femmes 21 2 54 21 31 170
7 Total 83 16 132 41 87 494
1
9 Hommes 56 12 57 21 95 342
3 Femmes 17 2 65 27 38 184
8 Total 73 14 122 48 133 526
1
9 Hommes 70 2 43 12 117 339
4 Femmes 20 / 25 20 43 138
0 Total 90 2 68 32 160 477
1
9 Hommes 60 3 62 18 82 320
4 Femmes 21 / 13 15 22 117
1 Total 81 3 75 33 104 437
1
9 Hommes 77 3 46 6 98 338
4 Femmes 29 / 23 9 28 128
2 Total 106 3 69 15 126 466
(*) Ne sont reproduits dans ce tableau que les motifs les plus courants, la liste des motifs est donc non exhaustive. La colonne de droite représente le nombre total des suicides par sexe et par année; on retrouve donc les mêmes chiffres dans le tableau précédent classé par tranches d'âge.
SOURCE : Annuaire statistique de l'Indochine (1935-1942).
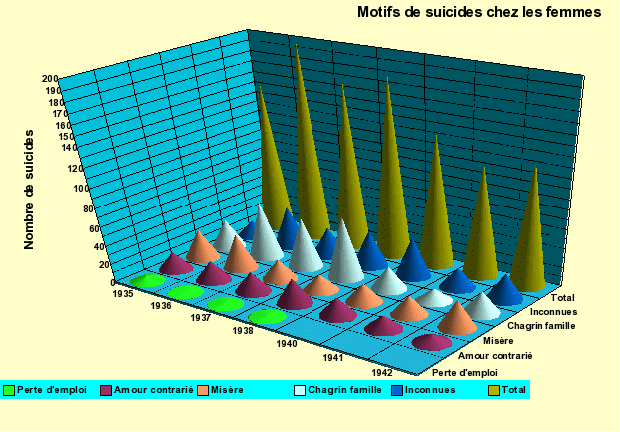
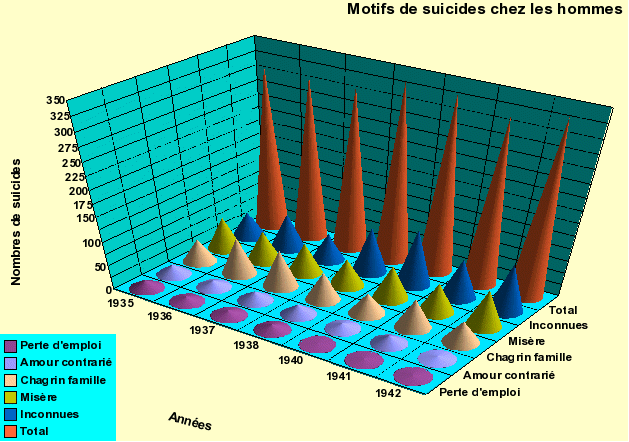
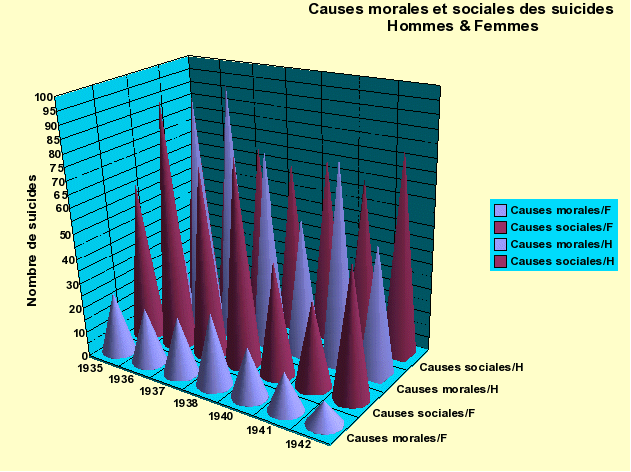
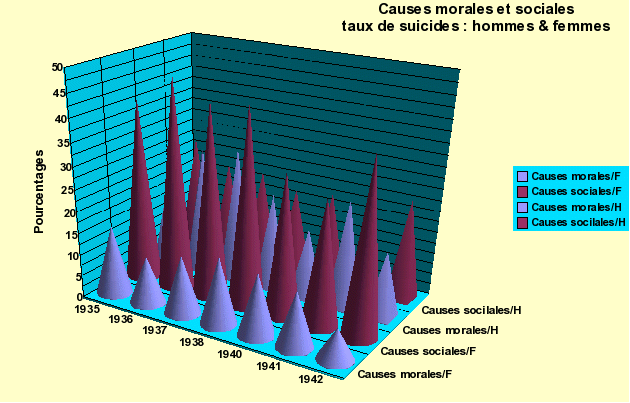
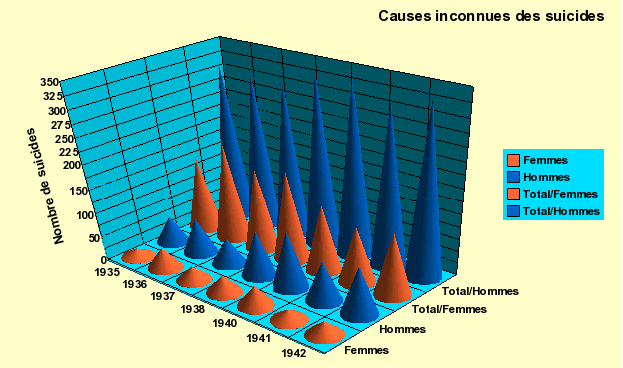
La première remarque qu'on peut faire sur ces chiffres c'est que parmi les motifs connus, la "misère" dispute la première place aux "chagrins de famille" pour les mobiles qui ont causé le plus de suicides durant cette période (voir Graphe1). Néanmoins l'écart entre le minimum et le maximum du nombre de suicides dûs à la misère est moins important (73 en 1938, et 106 en 1942) que le même écart relatif au motif "chagrins de famille" (68 en 1940, et 136 en 1936, soit du simple au double). Ce qui montre sans doute que la misère était pour cette période une donnée presque constante de la société, tandis que les suicides imputés aux chagrins de famille fluctuaient selon des années. En d'autres termes, les causes du suicide d'origine familiale, donc d'ordre moral, pesaient plus sur l'individu que les causes matérielles. Viennent ensuite en troisième position les suicides par "amour contrarié", devant le motif "perte d'emploi", qui ne représentent qu'une faible proportion, de l'ordre de quelques pour cent. En proportion la misère a provoqué en moyenne 18,8% des cas de suicides sur la période; les chagrins de famille, 19,9% et les motifs inconnus au moins autant; l'amour contrarié, 7,2%. Si on regroupe d'un côté les suicides provoqués par les causes matérielles ("misère", "perte d'emploi"), et de l'autre ceux résultant des causes morales ("chagrins de famille", "amour contrarié"), le nombre des seconds dépasse largement celui du premier, en moyenne 132 cas de suicides contre 98 pour cette période (en pourcentage, 27% contre 21%). Ce qui confirme que les causes d'ordre moral pesaient plus sur l'ensemble des suicides que les causes matérielles. A cet égard, le rapprochement de ces données avec les "voeux" de la femme dans les cahiers de doléances à l'époque du Front Populaire devient saisissant. En effet, on a vu que les critiques les plus violentes de la part des femmes ont été adressées à la structure familiale oppressive, tandis que les revendications d'ordre matériel dirigés contre les autorités coloniales ne concernaient que le statut de la femme dans le travail.
D'une manière générale et en valeur absolue, les hommes se suicident deux fois plus voire davantage que les femmes pour des motifs d'ordre matériel ("misère" et "perte d'emploi"), mais en proportion cet écart devient moins grand, la moyenne est de l'ordre de 20% pour les hommes contre 16,5 pour les femmes. Quant au motif "chagrins de famille", bien que le nombre de suicides des hommes soit toujours supérieur à celui des femmes, la moyenne en valeur absolue pour cette période est de 58,7 suicides par an chez les premiers contre 38,5 chez les secondes; en pourcentage ce rapport s'inverse : 23,4% de l'ensemble des suicides chez les femmes sont dûs aux "chagrins de famille" contre 18% pour les hommes. Dans le même ordre d'idée, bien que les suicides par "amour contrarié", aussi bien chez les hommes que les les femmes, représentent en valeur absolue un chiffre beaucoup moins important que celui correspondant aux autres motifs, en pourcentage on trouve en moyenne 5% chez les hommes contre 12% chez les femmes par rapport à l'ensemble des suicides de chaque sexe. Ce grand écart (plus que le double) expliquerait peut-être l'émotion de l'opinion publique devant le suicide de celles-ci. Par ailleurs, le nombre des suicides dont on ignore les motifs correspond à 21% du total chez les femmes et 25% chez les hommes. On peut se demander quelle était dans ce nombre la part des hommes et des femmes qui se sont donné la mort par "amour contrarié" ? Il est sans doute loin d'être négligeable tant en valeur absolue qu'en pourcentage. On remarque aussi que la ville de Hà nôi, à elle seule, compte 67 cas de noyés en 1940, 65 en 1941 et 132 en 1942. Malheureusement les statistiques n'ont pas précisé la proportion des femmes dans ces chiffres. Compte tenu du mode de suicide chez beaucoup de femmes qui consistait à se jeter dans les lacs de Hà nôi, ces noyés ne faisaient-ils pas partie du contingent des suicides ? Il est vrai par ailleurs que le nombre de suicides déclarés survenus à Hà nôi reste faible cependant il augmente d'année en année : 16 en 1930, 10 en 1931, 59 en 1940, 46 en 1941 et 60 en 1942. En l'espace de 12 ans le nombre de suicides à Hà nôi a presque quadruplé. Si l'on admet que les noyés étaient en partie des suicidés, pour la ville de Hà nôi le taux de suicide deviendrait alors plus qu'alarmant en comparaison avec celui des pays d'Europe de la même époque. On obtiendrait ainsi un taux de 126 (pour 100.000 habitants) pour l'année 1940, 74 en 1941 et 128 en 1942. Dans ce cas on comprendrait pourquoi la presse et l'opinion ont été émues par le problème de suicide.
Enfin, contrairement aux années précédentes, les statistiques fournissent pour la période 1940-1942 le mode de suicide qu'ont utilisé les uns et les autres. La pendaison vient largement en tête dans presque les deux tiers des cas: 303 sur un total de 477 en 1940, 252 sur 437 en 1941 et 279 sur 466 en 1942. Le recours à un poison, et particulièrement à l'opium mélangé avec du vinaigre, d'après les échos de la presse, se remarque pour 20% des suicidés, alors que le suicide par noyade n'occupe que 6% des cas. Ce sont les trois principaux mode de suicide enregistrés.
Bien que nombre d'interrogations et d'imprécisions demeurent au sujet du suicide au Vietnam dans l'Entre-Deux-Guerres, il est difficile de ne pas prendre en compte ce phénomène comme un élément du mouvement général de la transformation, voire de la déstructuration sociale et familiale. On a vu dans les chapitres précédents que l'individu commençait à émerger dans le paysage social et familial vietnamien à travers la presse, la littérature et la poésie, que les mentalités ont basculé vers une aspiration libérale, que la femme s'affirmait sur la scène sociale pour mieux revendiquer l'égalité des droits avec l'homme, que la jeunesse gagnée aux idées modernes cherchaient sa propre voie en accord avec ses attentes et ses désirs, que le conflit des générations se creusait de jour en jour. Bref, l'amour libre, le mariage libre, la libération de la femme constituent de véritables manifestations de l'individu révolté contre les structures sociales et familiales traditionnelles jugées trop oppressives. "Quand la société est fortement intégrée, écrit encore Durkheim, elle tient les individus sous sa dépendance, considère qu'ils sont à son service et, par conséquent, ne leur permet pas de disposer d'eux-mêmes à leur fantaisie" 1. A cet égard, le suicide devient une composante de plus de cette révolte incontestable, quoiqu'amère, compte tenu du résultat. Prenons le cas des suicides par "amour contrarié", cet acte n'est-il pas un dernier et ultime cri d'alarme de l'individu confronté à ses tourments, tiraillé d'un côté par son idéal personnel et de l'autre par la morale et le devoir imposés par la famille, étant donné qu'il n'y a pas d'alternative ? Bien que la société, en l'occurrence la famille, ait sa part de responsabilité dans cet acte, l'acte lui-même ne relève que de la décision de son auteur de mettre fin à sa vie. Ce qui signifie en d'autres termes que l'individu revendique le droit d'être propriétaire de son corps et maître de son destin en tournant le dos aux principes traditionnels et à la morale qui faisaient de lui un être subordonné aux structures sociales et familiales. L'attitude du suicidaire révèle par ailleurs que le "moi" devient le centre de ses préoccupations et non le reste ou les autres qui se trouvent en dehors de ce champ. "Le suicide, écrit Michelle Perrot, est la marque ultime de la souveraineté du moi" 1. En ce sens, pour qualifier les suicides par "amour contrarié" et pour "chagrins de famille", on peut reprendre la terminologie de Durkheim, la notion de "suicide égoïste" qui traduit selon Alain Corbin "l'excès de la souffrance individuelle" 2. Ce cri d'alarme est également signalé par la presse coloniale sous la plume d'Hippolyte Le Breton, qui écrit à propos de "la tyrannie familiale", qu'"elle a poussé bien des gens au suicide", à propos de la question du mariage justement 3. En d'autres termes, le suicide constitue bel et bien une des manifestations de l'individu qui s'émancipe pour s'affirmer, pour dire non à l'ordre ancien qui le dissimulait derrière le rideau de l'anonymat pour mieux le contrôler. L'individu qui, autrefois ignoré ou inexistant, profite du nouveau contexte social et culturel pour apparaître comme un élément autonome de l'édifice social. Cependant la conquête faite par l'individu de cette "génération solitude" ne se passa guère sans contrepartie. En un mot, avec le suicide l'individu est bien un mort-né. Reste à savoir si ces morts ont réussi à régénérer l'idée de l'individu ou non.
CHAPITRE 8
VERS L'INDIVIDU MODERNE ?
Comment traiter le problème de l'individu dans la société vietnamienne sans tomber dans le débat interminable opposant, ici et ailleurs, ceux qui font de l'individualisme une valeur à ceux qui le condamnent ? La notion d'individu est-elle une composante de la modernité comme l'a montré Hegel, ou peut-elle exister indépendamment de celle-ci? A cet égard, la référence à l'Occident peut-elle être contournée? Autrement dit, l'individu existe-il dans les anciennes structures sociales vietnamiennes d'avant l'ère coloniale? Tant de questions épineuses qui restent à être éclaircies. Il nous est impossible de faire une anthologie de l'individu et de l'individualisme dans la société vietnamienne faute de sources anciennes et de travaux consacrés à ce sujet. Néanmoins nous essayons de comprendre dans quelle mesure l'individu pouvait y avoir sa place et sous quelles formes il se manifestait.
PROBLEMATIQUE
Dans son anthologie sur l'individu 1, Alain Laurent retrace son histoire, textes à l'appui, depuis l'émergence de l'individu au XVIIe siècle (Louis Dumont, quant à lui, suggère de la faire remonter à la Renaissance avec la montée de la bourgeoisie 1) jusqu'à son apogée, dans les années 1980, en passant par des phases plus ou moins controversées. Le "cocooning", le walkman, les jeux vidéo, le développement et la pénétration de la micro-informatique (en anglais "personal computer") dans les foyers, les sports individuels (le saut à l'élastique dans le vide, le tennis, la planche à voile, etc.), la médiatique image du "battant", les danses modernes qui n'exigent pas une compagnie, et enfin les écrits abondants sur le thème de l'individu 2, témoignent de cette montée de l'individu. On peut se douter qu'un sujet aussi sensible soulève des polémiques et des batailles rangées. En effet, depuis l'affirmation de l'individu comme élément libre du corps social, avec les premiers écrits sur ce sujet à travers la plume de John Locke (1632-1704), philosophe politique anglais défenseur inconditionnel de l'individu 3, le débat s'éternise. Vient ensuite le XVIIIe siècle porteur de modernité qui apporta à l'individu un nouveau souffle. Au siècle suivant, l'idée de l'individu a été attaquée de toutes parts par les tenants des idées sociales voire socialistes. Parmi ses accusateurs on retrouve également des sociologues, dont Emile Durkheim, Auguste Comte et Claude de Saint Simon 4. Alain Laurent qui prend la défense passionnée de l'individu regroupe les "ennemis" de ce dernier en trois courants: "les traditionalistes", "la famille chrétienne à tendance progressiste" et "les marxistes" 1. Pour les défenseurs de l'individu, la notion d'individu est étroitement liée au droit et à la liberté et on ne peut l'ignorer dans un Etat de droit. De l'autre côté, l'individu comme être autonome est associé au mépris de son entourage social. Dans les pays d'obédience stalinienne on oppose facilement l'individualisme au collectivisme bien que par ailleurs ces deux notions ne soient pas vraiment contradictoires 2. Entre ces deux extrêmes, plusieurs variantes et nuances demeurent car on parle aussi "des individualismes" 3. En tout état de cause, l'individu ne peut exister qu'avec l'existence d'un espace propre dans lequel il agit, mais qui ne se confond pas avec "l'espace du privé", thème est développé par Alain Prost dans Histoire de la vie privée. Cet espace de l'individu est par ailleurs en étroite relation avec l'évolution de la vie matérielle et culturelle. Mais sa frontière se heurte à celle de corps social. La difficulté de l'existence de l'individu réside dans le fait qu'il veut à la fois être juge et partie prenante car l'individu ne se définit d'une manière ou d'une autre que par rapport à la société dont il est membre. Un individu qui vit complètement à la marge de la société a-t-il un sens ? Louis Dumont qui a exploré le cas de la société indienne nous livre ses remarques:
Depuis plus de deux mille ans la société indienne est caractérisée par deux traits complémentaires : la société impose à chacun une interdépendance étroite qui substitue des relations contraignantes à l'individu (...) mais par ailleurs l'institution du renoncement au monde permet la pleine indépendance de quiconque choisit cette voie. (...) Lorsqu'il (le renonçant) regarde derrière lui le monde social, il le voit à distance, comme quelque chose sans réalité, et la découverte de soi se confond pour lui, non pas avec le salut dans le sens chrétien, mais avec la libération des entraves de la vie telle qu'elle est vécue dans ce monde.
Le renonçant se suffit à lui-même, il ne se préoccupe que de lui-même. Sa pensée est semblable à celle de l'individu moderne, avec pourtant une différence essentielle : nous vivons dans le monde social, il vit hors de lui 1.
(Louis Dumont a sans doute oublié le cas exceptionnel, et de taille, du Bouddha historique qui incarne parfaitement l'image du "renonçant" dans sa quête de vérité; mais une fois parvenu à l'illumination, il ne délaisse pas la société pour autant, au contraire, il y retourne pour essayer d'expliquer aux autres les choses qu'il a comprises de ce bas monde.) A partir de là et d'un ton détaché, Louis Dumont fait la distinction entre deux modèles de sociétés : l'une de type "holiste" (du grec holos, le tout), l'individualisme sera en opposition avec elle, car "la valeur se trouve dans la société" considérée comme un tout, l'autre de type moderne (?) où l'individu est la valeur suprême. De l'avis de Léon Vandermeersch, "les sociétés communautaires sont des sociétés mieux équilibrés que les sociétés individualistes" 2. Pour compléter cette vision des choses il convient d'ajouter l'analyse de Hegel qui met en relation "les trois instances fondamentales : l'individu, la société civile et l'Etat" 1. Or la société civile ne peut exister que dans un Etat de droit. Cette analyse de Hegel ne peut donc être avalisée qu'avec la prise en considération de cette donnée qui n'est pas la moindre. A un autre niveau, si on partage l'idée de Hegel, cela revient à reconnaître implicitement qu'il ne peut exister d'autre forme d'organisation sociale possible à la fois légitime et acceptable pour l'espèce humaine, que l'Etat de droit. L'interaction des "trois instances fondamentales" qui obéissent au principe des vases communicants caractérise ainsi un groupe humain sous diverses dénominations : la nation, la société, l'ethnie, etc. Ce schéma s'appliquerait-il aux "sociétés sans État" dont parle Pierre Clastres 2 ? Cette trilogie serait tout simplement amputée d'une instance de taille, en l'occurrence l'Etat, et par ailleurs il faut supposer et admettre que les pratiques sociales et les coutumes qui régissent ces sociétés se substituent à la notion de droit. A l'inverse, dans les régimes dictatoriaux la société civile est réduite à sa plus simple expression, et l'individu se demande ce qu'il y représente encore. Les sociétés de type "holiste" forment un autre cas de figure car la "société civile" évince avec tout son poids l'individu et le rejette à la marginalité. L'équilibre des "trois instances fondamentales" ne pourrait être atteint que dans les démocraties de type occidental où chacune d'entre elles dispute le terrain aux autres sans avoir la possibilité de les anéantir. Enfin, dernier cas de figure non encore concrétisé, du moins à nos connaissances, jusqu'à nouvel ordre : l'anarchie, dans laquelle l'individu constituerait le pôle dominant en réduisant le rôle de la société civile et en effaçant celui de l'Etat. A cet égard, le communisme comme société idéale partage avec l'anarchie ce point commun car il prône, entre autres, le dépérissement de l'Etat. Mais la comparaison s'arrête là puisque contrairement à l'anarchie, l'individu ne constitue pas une valeur, du moins dominante, dans une société communiste. On comprend alors aisément pourquoi tous les régimes confondus, des démocraties parlementaires aux dictatures en passant par les oligarchies et les monarchies, redoutent autant le communisme que l'anarchie et les combattent avec tant de férocité. Vue sous cet angle, la disparition de l'Etat et avec lui de tous ses instruments de pouvoir (police, armée, diverses ramifications institutionnelles de violence) serait le déluge pour leurs défenseurs, sans parler du nivellement de la société elle-même. Bien que la société idéale reste à construire pour l'espèce humaine, l'histoire et l'expérience ont montré la possibilité de l'existence d'une société sans État sans que l'individu fasse les frais de cette situation. A cet égard, Pierre Clastres apporte un témoignage incontestable, pour ceux qui veulent bien prêter l'attention à cette question, dans son ouvrage que nous avons cité, bien qu'on puisse se demander si le modèle de société dont il parle est généralisable à l'échelle d'un pays moderne en voie de mondialisation.
Avant de pénétrer dans la société vietnamienne pour voir si l'individu y a sa place, il nous reste à lever la confusion entre la notion d'individu et la notion de personne qui ne sont pas toujours faciles à distinguer. Cette difficulté provient du fait que ces deux notions ne représentent pas deux entités complètement distinctes, ni deux "corps" qui s'opposent inconditionnellement, car elles peuvent, dans certains cas, former deux facettes d'une même entité. Mieux vaudrait peut-être revenir à la source. Le terme "personne" provient du latin d'origine étrusque persona qui veut dire "masque de théâtre" (XIIe siècle). Le masque délimite donc la frontière qui sépare la personne de la société. Une foule de personnes ne représente ainsi qu'une juxtaposition de représentants anonymes appelés personnes. Mais derrière le masque commence un autre univers dont seule la personne détient le mystère; on entre dans l'espace du privé qui est distinct d'une personne à une autre. La liberté de la personne est ainsi circonscrite dans son espace du privé au-delà duquel on tombe dans le domaine public. Le qualificatif "personnel" s'emploie pour souligner cet espace, ce qui est propre à la personne au-delà du "masque" : "les affaires personnelles", "le courrier personnel", etc. Dans le langage courant on parle de "querelles de personnes" lorsque les intérêts des uns sont contestés par les autres, de "en personne" quand on n'a pas besoin de recourir à un intermédiaire, en emploie l'expression "se présenter en personne", et ainsi de suite. Enfin, en matière de droit, on parle bien de la personne morale et non de l'individu moral quand plusieurs individus sont unis dans une même entreprise, par exemple, une institution, une association, une société anonyme, etc. (Le sens de l'individu moral est une autre affaire.)
Quant à individu, terme provenant du latin individuum ("corps indivisible", XIIIe siècle), il s'impose dans les relations sociales pour marquer la différence palpable, donc sans masque, affichée par chacun des membres de la société. La grande différence avec la "personne" réside sans doute dans ce trait identitaire. "Sans la personne, qui en est l'âme, écrit Alain Laurent, l'individu ne serait que la coquille vide; mais sans l'individu, qui l'habille, l'englobe et la fortifie, la personne serait transparente et donc infiniment vulnérable, exposée à toutes les dépendances et vite absorbée dans la totalité sociale"; il poursuit sa rhétorique en disant que "respecter la personne humaine, c'est la traiter en individu" 1. Pour résumer, si la notion d'individu est chargée d'idéologie, la notion de personne relève plutôt de la morale et de la métaphysique 2. En effet, depuis son émergence, la notion d'individu ne cesse d'envahir le champ social pour imprégner sa marque comme un état de fait. Les expressions traduisant aussi bien de l'abstrait que du concret telles que "liberté individuelle", "salaire individualisé", "maison individuelle", en sont la preuve.
Phan Thi Dac qui s'est intéressé à cette question, dans le contexte du Vietnam, a commencé à l'ébaucher dans son ouvrage 3 à travers des Codes dynastiques, la culture, les structures sociales, les croyances, la langue, la littérature. A la fin de l'ouvrage, elle conclut "que la notion d'individualité en tant qu'être perpétuel et indécomposable", tel que le définit M. Mauss, n'existe pas au Vietnam" 4. Là-dessus tous les spécialistes vietnamiens ne sont pas unanimes. Pour n'en citer que quelques-uns avec qui nous avons discuté sur cette question, l'ethnologue Diêp Dinh Hoa reste prudent en nuançant ses propos et en disant que l'état actuel des recherches ne permet ni d'affirmer ni d'infirmer l'existence de l'individu. Cependant il souligne que dans la sociabilité, le prénom d'une personne prévaut sur son nom de famille, on évoque le nom de quelqu'un seulement quand il y a un risque de confusion dans les homonymes; et que si l'individu -vietnamien s'entend - ne s'affirme pas en tant que tel c'est pour mieux s'adapter aux différentes circonstances. En d'autres termes, quand on se donne plusieurs facettes cela reviendrait à se doter d'un moyen de défense; l'individu devient alors insaisissable 1. A cet égard, on ne peut pas dire que les lettrés d'antan qui pratiquaient systématiquement le pseudonyme, tradition étendue jusqu'à la nouvelle génération d'intellectuels (journalistes, écrivains, poètes, militants), cherchaient vraiment à attirer l'attention sur eux, à s'affirmer en tant qu'individu. Cette "antidote à la valorisation de l'individu", pour reprendre les termes de Jean Chesneaux 2, venait cependant brouiller les cartes dans le contexte de la société vietnamienne. Peut-on dire pour autant que cette pratique dénote déjà une opposition à une société de type capitaliste qui, elle, pousse l'individu à s'affirmer à tort ou à raison ? Rien n'est simple.
Quant à Trân Dinh Huou, professeur de lettres, il affirme sans détour que l'individu n'existe pas dans la société vietnamienne 3, si ce n'est par son côté moins glorieux qui se manifeste à travers les bassesses d'esprit, l'égoïsme à outrance, visibles dans les querelles intestines. D'autres préfèrent garder le silence. Nous avons vu par ailleurs que le groupe Tu luc van doàn - voir les chapitres précédents sur "Les milieux porteurs de modernité" et "La vie culturelle" - était dans les années 1930 le porte-parole de l'idée de l'individu et a fait d'elle une devise pour rompre avec la tradition séculaire. A la même époque, Nguyên Manh Tuong, un "Retour de France", se dégage de toute responsabilité au cas où le "mouvement individualiste" trouverait des "armes" dans son ouvrage sur l'individu à travers le Code des Lê 1. Dans la période suivante, Nguyên Van Huyên était d'avis que "l'individu n'est rien" dans la société vietnamienne 2. Rappelons à cet égard quelques faits relatifs à "la situation de la personne" à travers l'histoire du Vietnam. Nguyên Trai (1380-1442), homme de lettres qui fit aussi une carrière militaire et qui avait contribué à la victoire de Lê Loi sur les Minh, a été soupçonné, par la suite, sous le règne de Lê Thai Tôn (1438-1442), d'être l'instigateur de l'empoisonnement du successeur de Lê Loi, et fut condamné à la peine capitale la plus redoutable selon le Code de cette même dynastie : tru di tam tôc (extermination de trois générations, cette peine a également été maintenue par les autres dynasties ultérieures). Il ne fut innocenté, puis amnistié à titre posthume, qu'avec la venue du nouveau souverain, le célèbre Lê Thanh Tôn, qui régna sous le nom de Hông Duc (1460-1497). Sous cette même dynastie, les descendants des chanteuses et des comédiens ont été interdits de concours mandarinaux 3. Cette interdiction s'applique sous les Nguyên aux descendants (trois générations) de ceux qui ont collaboré avec les Tây Son 1. Au niveau de la commune, on retrouve cette même idée : quand un hors-la-loi s'enfuit du village c'est sa famille qui doit payer ses fautes. L'administration coloniale a très bien saisi cette "coutume" et n'hésitait pas à faire payer les parents quand l'enfant se montrait subversif. En 1935, le Phong hoa rapporta une anecdote relative à cette pratique : un jeune garçon soupçonné d'avoir des liens avec le parti communiste a été arrêté, mais comme il était trop jeune, sa mère devait subir à sa place les peines prononcées 2. Cette pratique est bien ancrée dans l'esprit des Vietnamiens puisqu'on la retrouve même dans l'adage "quand l'enfant commet une erreur, les parents supportent les conséquences" (con dai cai mang).
Au travers de ces quelques exemples (qu'on peut par ailleurs multiplier à une grande échelle), on s'autorise à se demander si "la personne est bien traitée en individu", pour reprendre les termes d'Alain Laurent, dans les coutumes et les Codes vietnamiens. Apparemment le statut de l'individu n'existe pas dans la société vietnamienne telle qu'elle est décrite. Cependant avant d'aller à une conclusion plus appuyée, attardons-nous sur deux exemples pour en dégager des indices qui permettraient de confirmer ou d'infirmer une telle idée. Nous nous proposons ainsi d'explorer deux modes de chant traditionnel, l'un célèbre dans la culture des lettrés, il s'agit du Ca trù, et l'autre qui est un pilier de la culture régionale et populaire, le Quan ho.
Pourquoi donc ce choix ? D'abord, nous voulions avoir des éléments de comparaison entre la culture académique et la culture populaire sur cette question précise de l'individu. Parmi celles des traditions culturelles des classes dirigeantes qui peuvent traduire un certain esprit de liberté individuelle, le Ca trù nous semble la plus représentative. Car, si la libre expression des sentiments, et le plaisir, constituent deux versants nécessaires à la réalisation du moi, autrement dit deux composantes de l'individu, le Ca trù répond bien à ces critères; tandis que les autres traditions telles que la poésie, les échecs, la passion pour les plantes ornementales ne remplissent que partiellement ces critères. Quant au choix du quan ho, il nous a été imposé par l'existence d'une documentation relativement abondante par rapport à celle qui concerne les autres traditions populaires, non moins intéressantes mais dont les sources deviennent aujourd'hui rarissimes. On peut citer par exemple le chèo, une sorte de théâtre chanté et dansé, le hat trông quân, un autre mode de chant alterné dont l'inspiration repose également sur l'amour, le hat gheo de la région de Phu tho, littéralement le "chant de drague". Ces traditions régionales aussi vivaces que le quan ho dans le passé et aussi riches par leur répertoire n'ont pas pu se maintenir à l'épreuve du temps. C'est la raison pour laquelle nous avons contourné ces difficultés pour nous tourner vers le quan ho.
LE CA TRU
Ce sous-chapitre s'inspire, pour la partie historique, des travaux des deux co-auteurs de l'ouvrage Viêt Nam ca trù biên Khao ("Etude sur le mode de chant ca trù du Vietnam"), Dô Bang Doàn et Dô Trong Huê, qui ont retracé les origines de cette tradition, et retranscrit les chants les plus célèbres laissés par les lettrés de différentes époques. Nous compléterons cette partie historique par des renseignements recueillis au cours de notre séjour au Vietnam pendant l'été 1990. Nous y avons rencontré en effet le musicien Nguyên Xuân Khoat, qui s'est passionné pour ce mode de chant dans sa jeunesse, et qui en est devenu aujourd'hui un des rares spécialistes, et la chanteuse Kim Dung, une figure artistique de la musique traditionnelle du Vietnam. Par ailleurs, nous laissons délibérément de côté l'aspect musical, qui relève des compétences des musicologues qui nous font défaut, pour nous pencher particulièrement sur les particularités du ca trù en tant que tradition.
Mode de chant encore célèbre sous la colonisation, le ca trù tombe aujourd'hui en désuétude; les chanteuses et les musiciens ne sont plus aujourd'hui que quelques "spécimens" et deviennent ainsi une "espèce en voie de disparition". Pour la ville de Hà nôi, les survivants de la période coloniale se comptent sur le bout des doigts. La chanteuse Kim Dung, âgée d'une quarantaine d'années, est presque l'unique représentante de cette tradition. Elle s'efforce à l'heure actuelle de transmettre ses talents à sa fille; tandis que son mari l'accompagne comme musicien dans les représentations.
Le terme ca trù est formé de ca, qui veut dire chant (chanter) en sino-vietnamien, et de trù (terme sino-vietnamien qui veut dire "ticket", the, en vietnamien), qui désignait les morceaux de bambou portant des caractères chinois, qu'on offrait aux chanteuses à des moments précis des soirées artistiques pour les récompenser. En fin de spectacle, les trù ou "tickets" sont convertibles en monnaie. Aussi le ca trù était-il encore populairement connu sous les termes de hat the ("chant au ticket") 1. Ce mode de chant porte encore le nom de hat a dào : hat, terme vietnamien signifie chant (ou chanter), alors que a dào a deux origines historiques possibles :
* Sous le règne de Ly Thai Tô (1010-1028), fondateur des Ly, on connaît une chanteuse réputée du nom de Dào Thi. Par la suite, les chanteuses sont appelées Dào nuong (du nom de cette chanteuse), où nuong, terme sino-vietnamien signifie jeune fille;
* Dans la période 1400-1407, sous les Hô, on connaît une autre chanteuse dont le nom de famille est Dào, du village de Dào-dang. Comme elle avait contribué par ses idées à évincer les troupes des Minh, à sa mort, on a fondé un temple pour la vénérer, et on a baptisé son village A-Dào en souvenir de ses contributions patriotiques 2.
Remarquons aussi que a est le synonyme de nuong en sino-vietnamien. Au temps de la colonisation on parlait plutôt de cô dâu à la place de a-dào. En vietnamien cô est l'équivalent de a; dâu originellement désignait la somme d'argent que les chanteuses versaient à la fin de chaque représentation à leur maître qui les avaient formées. Ainsi a-dào, la chanteuse, est encore appelée cô dâu. Pour des raisons de commodité d'usage, nous parlerons de ca tru quand il s'agit du mode de chant, et de cô dâu pour nommer les chanteuses.
D'après les deux auteurs cités, l'origine de cette tradition de chant remonte à la dynastie des Ly (1010-1225), mais à cette époque le ca trù n'était pas tout à fait le même que celui que l'on connaît aux époques ultérieures. Comme les faits ou les événements survenus au Vietnam, qu'ils fussent sociaux ou politiques, culturels ou artistiques, étaient accompagnés de mythification pour expliquer leur origine, le ca trù n'échappe pas à cette règle. D'après le recueil de Nguyên Xuân Lan, un descendant de Nguyên Công Tru (1778-1858), - lettré, réputé pour ses poèmes et son esprit d'indépendance, qui connaissait bien le milieu des cô dâu -, la légende de la première chanteuse (Tô cô dâu) remonte à l'époque de fondation des Lê postérieurs (à partir de 1428) 1.
Il était une fois un nommé Dinh Lê qui, originaire de Hà tinh et poussé par l'élan de son indépendance d'esprit, préféra la musique comme activité aux contraintes imposées par une situation sociale enviable. Il passait ses journées à aller chanter en compagnie de sa "guitare" (dàn nguyêt, instrument de musique en forme de "lune" d'origine chinoise) dans la forêt de pins. Un beau jour, à la sortie de la forêt, sur le chemin du retour, il fut surpris par la présence de deux vieillards qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant, et qui tenaient à la main l'un, un morceau de bois, et l'autre une feuille de papier. L'un d'eux se présenta et lui dit : "Nous savons que tu as des talents, c'est pourquoi nous t'offrons ceci pour que tu les transmettes aux générations suivantes". Ils lui présentèrent le morceau de bois et la feuille de papier, et avant de disparaître ils ajoutèrent ces bonnes paroles : "Tu vas chercher un bon luthier et tu lui diras de fabriquer un instrument suivant le modèle dessiné. Les sons de cet instrument éloignent les mauvais esprits, chassent la tristesse, et guérissent les malades".
Dinh Lê écouta ces conseils et alla demander à un artisan de lui fabriquer l'instrument de musique avec le bois de ngô dông qu'il avait reçu des vieillards. Les sons de cet instrument se révélaient magiques : ils égayaient tous ceux qui écoutaient, les malades incurables retrouvaient petit à petit leur santé. Cette réputation le rendit ainsi célèbre. Un jour, il décida d'aller dans le district de Thuong-xuân de la province de Thanh Hoa. Hoa, la jeune fille du mandarin de ce district, alors âgée de 19 ans, était réputée pour sa beauté mais elle avait perdu sa voix depuis l'âge de 10 ans. Ayant entendu parler du passage de Dinh Lê dans la région, les parents de Hoa l'invitèrent à venir jouer de la musique. Aux sons de l'instrument, Hoa, qui était en train de manger dans une autre pièce, abandonna son repas et prit ses baguettes pour frapper sur un presse-papier de bois au rythme de la chanson. Quand Dinh Lê eut fini de jouer, Hoa reposa les baguettes et s'exclama : "Cette musique est formidable !". La servante qui avait entendu ces paroles s'empressa de rapporter au mandarin la bonne nouvelle. Celui-ci demanda alors au musicien de continuer à jouer. Puis il l'invita à venir auprès de sa fille qui, dès que son regard eut croisé celui du musicien, se comporta comme si elle l'avait toujours connu et se mit à converser avec lui. Cet heureux événement décida les parents à proposer leur fille en mariage au musicien, qui l'accepta.
Quelque temps après, le jeune couple se retira dans le village de Dinh Lê, et tous deux se consacrèrent au métier d'artiste en formant de nouveaux mélomanes à jouer de l'instrument et à chanter. Ainsi l'instrument fétiche fut fabriqué à une grande échelle sur le modèle prescrit. Il s'agit du dàn day (dàn : terme générique désignant les instruments à cordes, day : le nom de l'instrument; voir illustration page....). Un beau jour, Dinh Lê retourna à la forêt avec ses deux disciples. En fin de journée, sur le chemin du retour à la sortie de la forêt, ils croisèrent encore les deux vieillards. Dinh Lê les reconnut et se mit à genoux pour les saluer. L'un d'eux montra du doigt l'instrument et lui dit :" Ceci est un objet sacré, il ne peut rester longtemps dans ce bas monde", et il le reprit. L'autre, lui touchant l'épaule en signe de familiarité, lui dit :
- Tu es par tes vertus digne d'être mon disciple. Tu as bien transmis ton art aux autres et tu t'en es servi pour aider ton prochain, sans en abuser et sans attendre des récompenses ou des éloges en retour. Grâce à cela ton nom est inscrit dans le "registre des enchanteurs" (tiên-pha). Ta vie sur terre se termine là, suis-moi sur la montagne pour apprendre la voie immortelle afin de devenir indestructible comme les monts et les eaux.
Voyant que Dinh Lê hésitait encore, il poursuivit :
- La vie est une dette, l'amour un péché. Si tu te laisses prendre par des attachements tu ne seras pas digne de nous, et tu le regretteras.
A ces paroles Dinh Lê consentit à les suivre et dit à un de ses disciples de rapporter cette histoire à sa femme. Hoa écouta la nouvelle avec sérénité, sans un digne de tristesse ni de protestation, au contraire elle fut comblée que son mari ait rejoint les "enchanteurs" (tiên). Le lendemain elle organisa un grand repas pour les représentants du village en les prenant à témoin de sa séparation d'avec tous ses biens : elle les donna aux pauvres. Cependant elle continua à donner ses cours de chant. Peu de temps après elle tomba malade et mourut. La chronique royale a rendu un hommage posthume à ce couple légendaire en l'érigeant au rang de prince et de princesse 1.
Dans l'ancien temps, les musiciens et chanteuses se regroupaient au niveau du village en quartiers (phuong), et l'ensemble de ces quartiers formait la "corporation" (giao phuong). Chaque quartier avait son représentant appelé ông trùm (monsieur le représentant) et la corporation choisissait parmi ces représentants un vétéran, nommé quan giap, en charge de gérer et diriger les affaires de la corporation. Ce dernier était reconnu par les autorités centrales comme interlocuteur sur les affaires concernant ce domaine de l'art.
Ne pouvait pas cependant devenir chanteuse qui voulait. Celle qui n'était pas descendante d'une famille de chanteuses et qui voulait s'initier au ca trù devait trouver une famille adoptive qui l'aiderait à s'intégrer dans le milieu avant de suivre un cursus bien réglementé. La tradition considérait que la chanteuse adoptive ne pouvait avoir une éducation comparable à celle d'une "chanteuse de souche" (cô dâu noi) même si sa voix pouvait être aussi excellente. La transmission se faisait ainsi au sein de la corporation. La formation de chanteuse durait en moyenne cinq ans au cours desquels l'éducation morale tenait une place aussi importante que l'éducation artistique proprement dite. Si dans l'ancien temps l'enseignement était l'apanage des hommes, les chanteuses constituaient une exception, car elles devaient apprendre les caractères chinois indispensables à l'exercice du métier. Soulignons aussi que la formation se faisait surtout le soir chez les confrères et consoeurs, car dans la journée les futures chanteuses, - et même les chanteuses attitrées - , avaient la même occupation que les autres paysannes. En fin de parcours et avant d'exercer pleinement son métier, la chanteuse devait se présenter à toute la corporation suivant les rituels en vigueur. En effet, elle devait venir devant le quan giap avec des chiques de bétel, indispensables à toute cérémonie dans la tradition vietnamienne, qu'il faisait distribuer par la suite à tous les membres de la corporation pour leur annoncer la venue d'une nouvelle artiste. Les confrères expérimentés se retrouvaient ainsi pour lui faire passer un examen final : si le résultat était concluant la corporation la reconnaisserait comme membre actif. A la suite de quoi, elle choisissait un jour faste en accord avec la corporation pour organiser un festin en invitant un personnage réputé de la région à assister à cette grande première. C'est le rituel du Mo xiêm ao (mo : ouvrir ; xiêm : vêtement luxueux couvrant le haut pour les hommes aux temps anciens, ou jupe très distinguée que portait les femmes des classes dirigeantes; ao : vêtement couvrant le haut). Il s'agit sans doute d'une cérémonie au cours de laquelle on remettait à la chanteuse un nouveau vêtement symbolisant son entrée dans le cercle des chanteuses.
Mais sans le musicien, la chanteuse ne pouvait exister. La formation de musicien se faisait parallèlement avec celle des chanteuses. Effectivement le musicien, par son soutien instrumental, participait également au chant. Le couple musicien/chanteuse était ainsi inséparable. Comme ce milieu d'artistes était un milieu fermé sur lui-même d'une part, et pour fixer les limites et le statut des chanteuses qui les mettaient à l'abri des risques de déraillement, d'autre part, la tradition voulait que le musicien fût soit le mari, soit le père ou le frère de la chanteuse. Ces prescriptions visaient à préserver l'image et la réputation des chanteuses : on a affaire aux artistes et non aux filles de moeurs légères.
Si la beauté physique de la chanteuse était prise en compte dans les examens de sortie, elle devait cependant passer au second plan derrière l'attitude et le comportement moral. Dans les concours organisés à la maison communale (dinh) lors de la fête du village, celle dont la beauté physique était remarquable mais dont l'attitude morale faisait l'objet de critiques, devait céder la place d'honneur de thu khoa ("major") à une autre, certes moins jolie mais dont l'attitude morale était irréprochable.
A propos des instruments, si élaboré et si raffiné qu'il fût, le ca trù ne se pratiquait qu'avec trois instruments assez simples dans leur réalisation.
* le phach était composé de deux morceaux de bois, de forme rectangulaire, d'une épaisseur d'environ un centimètre, sur lesquels la chanteuse tapait, pour rythmer son chant, avec une autre baguette en bois ou en bambou appelée sênh;
* le dàn day une sorte de "guitare" faite avec du bois de "ngô dông". La caisse de résonance est de forme rectangulaire et surmontée d'un manche sur lequel reposent les trois cordes originellement en soie. Le musicien nommé kep joue en les pinçant avec un plectre. A cet égard, cet instrument présente quelques similitudes, quant à la forme et au nombre de cordes, avec le shamisen dont se servait les geishas 1 (voir illustration p. ..).
* le trông ou tambour : il y avait en tout sept sortes différentes de tambours dont chacun avait sa propre fonction. On peut dire pour simplifier que cet instrument était réservé au participant, appelé quan viên, qui faisait de fait partie de la représentation en battant le tambour d'après des règles bien précises. Les sons du tambour permettaient d'ailleurs de le situer s'il fut amateur, vétéran ou ignorant de cet art. Avec une baguette longue, le quan viên battait le tambour, en termes techniques on dit câm châu. Le rythme du tambour dépendait en fait de la "ponctuation" des vers qui composaient les poèmes chantés d'une part, et d'autre part, à chaque fois que le quan viên trouvait que la chanteuse chantait bien à un endroit donné, il tapait sur le bord du tambour pour la faciliter. En somme un art qui demandait également des années de pratique.
Autrefois, les artistes se déplaçaient pour se rendre chez les particuliers ou aux différentes cérémonies publiques. La fête du village était l'exemple le plus courant. Le village qui souhaitait les divertissements que procureraient les chanteuses et les musiciens, s'adressait au représentant de la corporation, lequel se mettait d'accord avec les autres membres avant de désigner les artistes qui participeraient aux représentations. Celles-ci avaient lieu le soir devant le dinh, d'où l'appellation de hat cua dinh ("chanter devant la maison communale"). Il convient de signaler que les chanteuses professionnelles dansaient également selon les morceaux de musique. Le lendemain des fêtes, le village remettait au représentant de la corporation la somme d'argent correspondant aux "tickets" (trù) que la chanteuse avait reçus la veille en guise de récompense. Cette somme était par la suite partagée ainsi:
* une part à la corporation pour subvenir aux frais de fonctionnement;
* une part pour la chanteuse pour ses prestations;
* une part revenait au musicien pour qu'il ait de quoi acheter les cordes de son instrument;
* le reste à partager équitablement entre toutes les chanteuses participant aux représentations, même si elles n'y assistaient qu'à titre de figurantes pour soutenir la consoeur.
Quand la Cour organisait les grandes fêtes, elle faisait appel également aux chanteuses pour divertir les convives. Elles devaient être sélectionnées au préalable par les différentes corporations lors des concours organisés à cet effet, avant de pénétrer dans l'enceinte impériale. Les meilleures d'entre elles recevaient, après leurs prestations à la Cour, des félicitations du ministère des Rites.
Quant aux particuliers, et dans la plupart des cas il s'agissait de mandarins, lorsqu'ils faisaient appel aux chanteuses c'était pour célébrer leur promotion sociale (khao vong) ou leur avancement en âge (mung tho). Les lettrés, pour leur part, recherchaient la compagnie des chanteuses pour partager une entente à caractère littéraire en les invitant chez eux, ou bien ils organisaient des soirées privées sur une pirogue en suivant le cours d'eau sous la pleine lune, par exemple. Ils composaient des poèmes, non selon les règles de la poésie classique empruntée à la vie littéraire chinoise ,mais selon les règles spécifiques du ca trù. En général, les représentations avaient lieu en groupe de trois ou quatre lettrés. Au plus doué et expérimenté des quan viên (participants) revenait la baguette pour battre le tambour en tant que participant actif. La chanteuse avait en charge de transcrire en musique les paroles écrites en les chantant, ou à défaut de nouvelles inspirations, elle reprenait les morceaux connus. Ainsi, elle faisait vivre les sentiments cachés que le lettré avait enfouis dans ses poèmes. L'entente réciproque entre lettré et chanteuse se situait à ce niveau, et leurs relations étaient fondées sur ces sensibilités artistiques puisque le respect mutuel demeurait la règle de conduite pour l'un comme pour l'autre. En dehors de ces cadres privés (chez les mandarins ou chez les lettrés) et des représentations à caractère public, il n'y avait pas d'autres lieux d'expression pour les artistes du ca trù. Car dans l'ancien temps, les maisons de chanteuses n'existaient pas, celles-ci ne se sont développées qu'au début du XXe siècle avec la migration des chanteuses à la recherche d'une vie meilleure dans les centres urbains. Cette ruée vers la nouvelle vie matérielle a donné ensuite naissance aux fameuses "maisons de chanteuses", avec tout ce qu'elles comportaient comme déboires et dégradations de la culture artistique et dont il a été question dans le précédent chapitre. Ainsi en quelques décennies, sous l'effet de différents facteurs de la vie moderne, le ca trù comme mode d'expression artistique et culturelle fort ancré dans la tradition était devenu une vulgaire distraction à caractère charnel; alors que dans plusieurs provinces du Nord Vietnam (Hung yên, Hà dông, Nam dinh, Hà nôi) il existait un temple dédié à la fondatrice des chanteuses (Tô cô dâu). Annuellement le 11e jour du 12e mois lunaire, les différentes corporations du pays célébraient une fête en souvenir de cette fondatrice. Bien que la popularité des chanteuses ait gagné tout le territoire du Vietnam, le pays du ca trù se limitait à ces quelques provinces.
On ne peut pour autant idéaliser le sort des chanteuses d'antan car vis-à-vis de la société, elles formaient avec les musiciens une "classe à part" (xuong ca vô loài). Sous les Ly les chanteuses étaient vulgairement appelées con hat (con: spécificatif désignant les femmes avec une forte connotation péjorative, hat : chanter). Sous les Lê postérieurs, les mandarins qui prenaient des chanteuses comme femmes légitimes ou comme concubines étaient passibles de 70 coups de bâton; les fils de mandarins, de 60 coups de bâton, et le divorce devait se prononcer. Les descendants des chanteuses étaient interdits aux concours littéraires. Ce qui n'empêchait pas la Cour de faire appel à elles pour des représentations à caractère distrayant, ou d'en garder quelques- unes pour les besoins de la cause. Il fallut attendre le règne de Lê Du Tông (1706-1729) pour voir disparaître cette interdiction 1. A l'origine de ce changement, l'opinion jugeait injuste le fait que Dào Duy Tu (1572-1634) ait été interdit au concours pour la simple raison que son père était responsable d'une corporation de ca trù, alors qu'il avait les capacités requises. Devant cette injustice Dào Duy Tu finit par émigrer dans le Sud pour servir la seigneurie des Nguyên 2. Il fut par la suite le maître d'oeuvre des fortifications dans la région de Quang binh, appelées encore Luy Thây, dans le centre du Vietnam actuel.
Mais l'histoire retient encore le nombre de chanteuses célèbres qui ont d'une manière ou d'une autre établi leur réputation. Tel était le cas de Nguyên Thi :
L'histoire d'amour entre Nguyên Thi et Vu Khâm Lân remonte au XVIIIe siècle. A l'âge de 16 ans, le jeune Lân fut contraint d'abandonner ses études sous la pression de sa belle-mère. Il finit par quitter sa famille pour prendre la fuite. Il fut alors recueilli par un lettré, qui découvrit ses potentiels et son assiduité dans les études, et qui l'aida à les poursuivre. Un soir de fête, Lân se rendit à la maison communale pour assister aux divertissements. Il était mal vêtu et il se cacha derrière un poteau à l'écart des autres jeunes gens qui étaient bien habillés. Pendant que les chanteuses dansaient, l'une d'entre elles, Nguyên Thi, âgée d'environ 18 ans, découvrit Lân blotti dans un coin, et tomba évanouie sans qu'on sût pourquoi. Le lendemain elle chercha à le retrouver et lui remit une somme de dix ligatures. Devant cette générosité Lân accepta cette aide. Peu de temps après, Nguyên Thi revint le voir, toujours avec des vivres et des subsides. Il lui arrivait de passer la nuit chez lui pour l'aider dans les tâches matérielles. Devant tant de délicatesse et de sentiments chaleureux, Lân souhaita passer la nuit avec elle, mais Nguyên Thi fit alors une mise au point : " Si je n'étais qu'une chanteuse de moeurs légères, les hommes qui voudraient en profiter ne manqueraient pas. Ce n'est pas non plus parce que je suis chanteuse que je recherche un futur lettré. Si telle était ton opinion, alors je m'en vais". Et Nguyên Thi se retira, le laissant avec ses remords. Deux ans après, alors que Lân s'apprêtait à se présenter au concours, elle reparut en lui offrant encore une somme d'argent, pour couvrir les frais occasionnés par son séjour dans la cité des concours. Lân chercha par tous les moyens à savoir où elle habitait, mais les larmes aux yeux elle refusa de le lui dire : "Plus tard, si tu ne changes pas d'avis, je viendrai te retrouver. Pour l'instant mes origines pourrait te causer des soucis aux yeux des autres. Alors ne me demande rien à ce sujet". Puis elle s'en alla de nouveau. Sorti "major" (thu khoa) du concours provincial, Nguyên Lân fut, sous la pression de son père, contraint de se marier, car entre-temps il avait regagné sa famille. Quelques années après, lors de son passage au concours de la capitale, il retrouva Nguyên Thi qui vint le voir pour lui souhaiter bonne chance. En la voyant, il ne sut que lui dire, gêné par sa nouvelle situation conjugale. Nguyên Thi lui dit qu'elle connaissait bien sa situation, et qu'il n'y avait pas de quoi être gêné. Par contre, la route était encore longue et il devait consacrer ses efforts à servir le pays. La destinée faisait qu'elle ne pouvait pas rester à ses côtés. Elle se retira. Le temps passa. Lân fut promu mandarin d'armes, titre doublé d'un titre civil. Vingt ans après, au cours d'un repas chez un ami qui avait fait venir une chanteuse, Lân redécouvrit celle qui avait failli devenir la compagne de sa vie. Nguyên Thi lui raconta qu'elle s'était elle aussi mariée dix ans auparavant mais que son mari était déjà décédé. Elle continuait à chanter pour pouvoir faire vivre sa mère. Lân, qui l'estimait toujours, lui proposa alors de venir avec sa mère habiter chez lui, ce qu'elle finit par accepter. Peu de temps après, la mère de Nguyên Thi mourut, et elle se décida de partir. Avant son départ Lân lui proposa une somme d'argent, mais elle refusa en disant que l'argent n'avait pas de sens quand elle-même ne pouvait pas être en sa compagnie en tant que femme légitime, et la chanteuse poursuit son chemin vers l'inconnu sans que personne ne sût où elle allait.
D'une manière générale, les lettrés célèbres de toutes les époques avaient plus ou moins des relations sentimentales avec des chanteuses. Les lettrés avaient besoin d'elles pour échapper à la vie quotidienne; ils trouvaient en elles une source d'inspiration littéraire et artistique puisqu'elles mettaient en valeur, à travers les chants, ce qu'ils avaient écrit. Plus important encore, elles leur permettaient de se réaliser sur le plan émotionnel et sentimental. A l'inverse, elles s'appuyaient sur les lettrés pour se faire connaître auprès du public initié ou non. Cette relation de complémentarité aboutissait naturellement à une relation sentimentale plus ou moins explicite. Malgré le fait que le mariage avec une chanteuse ait été proscrit durablement pour les classes dirigeantes dont faisaient partie les lettrés, les "transgressions à la règle" n'étaient pas rares pour autant chez eux, à commencer par les dignitaires de la Cour ou par les monarques eux-mêmes : Trân Duê Tông (1372-1377), et plusieurs seigneurs des Trinh ont épousé des chanteuses (Trinh Trang, Trinh Doanh, Trinh Cuong) 1. Si l'interdiction, pour les descendants des chanteuses, de passer les concours littéraires, a été supprimée sous le règne de Lê Du Tông, c'est surtout grâce à la présence de l'épouse de Trinh Cuong qui était une chanteuse. Elle a été érigée en "mère de la patrie" (quôc mâu). Sous ce même règne, une autre chanteuse nommée Nguyên Thi Huê a été retenue pendant vingt ans à la Cour. L'histoire n'a pas précisé de quel membre de la Cour elle était concubine, toutefois Trinh Cuong l'appréciait, et elle n'a pu regagner sa famille qu'après la mort de celui-ci 2.
Le poète Nguyên Du (1765-1820) célèbre pour avoir laissé le roman en vers Kiêu, avait de même dans sa jeunesse une relation sentimentale avec la chanteuse Câm-Nuong. Mais le plus renommé des lettrés passionnés par le ca trù fut sans conteste Nguyên Công Tru (1778-1858), qui a laissé un nombre considérable de poèmes chantés. (Il sortit "Major" (Giai nguyên) de la promotion 1819 du concours au palais royal sous Gia Long. On raconte à son sujet l'anecdote suivante : dès sa tendre jeunesse il était déjà amoureux d'une chanteuse réputée à la fois pour ses talents artistiques et pour sa beauté, du nommée de Hiêu-Thu. Mais les prétentions de celle-ci lui interdisaient toute tentative de séduction. Un beau jour, comme il jouait bien le dàn day, il s'autodésigna instrumentiste pour pouvoir l'accompagner dans une représentation chez un particulier. Il élabora alors un plan pour pouvoir rester seul avec elle pendant un moment, en oubliant volontairement les cordes de l'instrument chez lui le jour où il se rendait, avec elle et un jeune novice, au lieu du rendez-vous chez le particulier. Sur la route, il fit semblant de se rendre compte de son oubli. Le voyant embarrassé, Hiêu-Thu envoya le jeune novice chercher les cordes. Le voilà enfin seul avec elle. Il s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Prise de faiblesse, Hiêu-Thu ne se défendit que pour la forme en poussant de petits cris. Puis, il la laissa seule sur la route et s'éloigna dans une autre direction 1. Dix ans après, devenu mandarin de la province de Hai duong, il organisa son anniversaire en invitant des chanteuses à la fête. L'une d'elles l'apostropha allusivement en chantant :
Je me suis retrouvée seule un jour dans les rizières,
J'ai dû pousser de petits cris, le héros s'en souvient-il?
Le lettré se rappela en effet sa jeunesse turbulente et dédia un poème à Hiêu-Thu qui lui avoua qu'elle était encore célibataire car elle l'attendait.
Autre figure célèbre, l'indigné Cao Ba Quat (1809-1854) qui se vantait de ses capacités en déclarant qu'il était dépositaire de la moitié des connaissances littéraires (un quart revenait à son frère jumeau Cao Ba Dat et à son ami Nguyên Van Siêu, aux autres le dernier quart). Il appréciait également la compagnie des chanteuses. Son éloquence et sa fierté ne plaisaient pas aux mandarins de moeurs conservatrices, d'où ses échecs aux concours littéraires et son indignation. Plus près de nous le poète Tan Dà, de son vrai nom Nguyên Khac Hiêu 1, a laissé également des poèmes composés en mode ca trù, qui témoignent de son admiration pour les chanteuses, sans parler de ses fréquentations.
Pour des raisons liées à la forme spécifique du ca trù riche en allusions littéraires, il nous est impossible de traduire les poèmes de ce mode de chant sans les dénaturer (en les transformant en pur style narratif, par exemple). Cependant nous essayons de le faire pour les poèmes les plus accessibles afin d'en dégager l'esprit du ca trù, de même que son côté sentimental. Par ailleurs, il va de soi que les poèmes chantés à la Cour ou à la fête du village ne sont pas chargés du même sens que ceux composés par les lettrés en vue des soirées privées avec les chanteuses. Nous nous intéressons plus particulièrement à la deuxième catégorie de poèmes qui nous semblent révélateurs de la liberté d'expression, voire de la liberté individuelle. Nous n'entrerons pas non plus dans les détails techniques qui caractérisent cette forme de poésie (structure, rimes, etc.). Signalons simplement au passage que contrairement aux poèmes classiques composés intégralement en sino-vietnamien (en fait, du chinois tout court), les poèmes en mode ca trù sont écrits en vietnamien avec cependant des allusions littéraires ou historiques, (souvent il s'agit de reprises de vers classiques en sino-vietnamien), qui n'occupent qu'une petite partie, en général deux ou quatre vers sur un total d'une bonne dizaine de vers libérés des règles contraignantes.
Ainsi voici l'Adieu de Nguyên Công Tru :
L'un s'en va l'autre reste,
Quels tourments que ces moments de séparation;
L'amour a bien su embêter les gens,
Le feu d'adieu ne peut se refroidir.
(...)
Il est facile de se séparer mais difficile de se revoir,
La passion pour le chant et la musique,
A rendu cet amour inachevé,
Plus tard, loin de tout cela,
Je regretterai les années d'attachement.
Le rire et les paroles d'un instant à l'autre,
Ne serait-ce qu'un jour, ça suffit pour être intimes.
Pourquoi l'un est-il triste et l'autre pas?
L'amoureux se sent les épaules chargées;
Il pense à celle qui habite dans un village lointain,
Cette pensée envahit son chemin.
Comment faire pour tout faire ? 1
Cao Ba Quat, réputé pour son orgueil, a laissé ce poème intitulé Ngan doi (Le dégoût de la vie") :
Ne me demandez pas sur les péripéties de la vie,
La pirogue s'avance dans le brouillard sur l'eau
mouvementée.
Allongé, la main sur le front 2 je divague.
La vie n'est qu'un rêve.
Il n'y a que du vent sur la rivière, la lune sur la
montagne,
Cet univers commun en fait n'appartient éternellement qu'à
moi.
Les uns vivent à la ville, les autres dans la forêt.
Je bats le rythme et je chante "Ne voyez-vous pas que l'eau
du Fleuve Jaune provient du ciel?"
Pourquoi se fatiguer dans la vie 1 ?
Le malchanceux aux concours Trân Tê Xuong, alias Tu-Xuong (1870-1907), n'est pas étranger aux plaisirs que procure le ca trù. Un de ces poèmes s'appelle Hat cô dâu :
Ce qui compte dans la vie c'est de parvenir à ses voeux,
Rien ne vaut la "distraction" 2 en compagnie des
chanteuses.
Quand on s'amuse, elles sont là disponibles et serviables,
On boit, on joue aux cartes, on bat le tambour.
Après l'alcool on contemple les fleurs sans se lasser,
L'alcool devant les fleurs, quel plaisir !
Amusez-vous, vous autres,
Qu'on s'amuse ou qu'on ne s'amuse pas, c'est pareil.
Ce qui appartient à la nature, pas la peine de se gêner,
Ainsi, on se délivre des dettes liées à la gloire.
Et l'on s'amuse à défoncer la peau du tambour 3.
Trân Lê Ky (1864-1920), un auteur peu connu, est encore plus explicite à propos du plaisir dans son poème Choi cho thoa thich ("S'amuser à assouvir sa faim") :
Jusqu'à quinze ans on n'est qu'un gamin,
A quarante-cinq ans, la vieillesse commence;
Si on faisait les comptes du temps qu'occupent
les attachements amoureux,
On s'épuiserait au bout de trente-cinq ans.
Et pourtant,
On continue à aller à l'école, à passer des concours, à
être mandarin 1,
C'est rare qu'on ait le temps dans cette vie occupée !
Comme la nature a créé l'homme,
Si on ne s'amuse pas, les autres nous prendront pour des cons
On s'amuse tant qu'on peut, jour après jour,
Poliment à la manière des jouisseurs pour être digne
d'être un homme.
On s'amuse comme tout le monde.
Ne traitez pas la lubricité de bêtise,
Sans elle comment la pudeur pourrait-elle exister ?
Je te (à la chanteuse) conseille de te préserver 2 !
Le poème Cai dai (la bêtise) du tiên si Duong Khuê (1836-1898), un autre amateur avisé du ca trù va dans le même sens:
Qui n'a pas les cheveux blancs à l'âge de cent ans ?
Personne ne peut tout savoir.
Quand on regarde la lune, elle sourit,
Quand on regarde la fleur, la fleur fait des commentaires.
Lorsqu'on repense aux années passées,
Aucune bêtise ne ressemble à une autre.
Quand on se réveille on croit que c'était un rêve,
Ainsi on réalise que les souhaits sont des passe-temps.
On en vient aux reproches envers la nature qui ne se lasse
pas d'enquiquiner les autres,
En les poussant vers la bêtise sans limite.
On s'amuse, la barbe en bataille, l'oeil égaré,
la ceinture défaite,
On s'enfonce encore dans la vie.
Arrêtons à partir de maintenant ces bêtises,
Libertinage n'est qu'indifférence.
Si on se revoit, on fera semblant de ne pas se connaître 1.
Enfin, Nguyên Van Binh (1885-après 1962) a remarqué que certaines chanteuses avaient blanchi leurs dents, il leur dédia donc le poème que voici "A la chanteuse aux dents blanches" :
Il y a plein d'histoires dans la vie,
Dramatiques à faire sourire les dents.
Sans parler des femmes modernes,
Même chez les hommes on voit des meneurs.
La vie préfère le blanc, qui n'aime pas le blanc ?
Les dents noires redevenues blanches sont pourtant aimables.
(...)
Lisse comme le coton, blanche comme la neige, brillante
comme la broche en ivoire des mandarins,
Cette beauté on ne l'échange pas même contre de l'or,
Dommage qu'il ne me reste que la moitié de ma dentition,
Sinon je blanchirais mes dents comme les autres.
(...) 1.
Cette présentation succincte du ca trù mérite dans un deuxième temps quelques remarques qui feront l'objet de la dernière partie de ce chapitre consacrée aux discussions. Pour l'heure, continuons à explorer l'univers culturel vietnamien en nous rendant dans la région de Bac-ninh, le berceau du quan ho qui complétera ce panorama. Nous aurons ainsi des éléments de comparaison des deux traditions, l'une littéraire basée sur les textes écrits et l'autre populaire transmise uniquement par la voie orale.
LE QUAN HO
De même que pour le ca trù, nous laisserons de côté l'aspect musical du quan ho, - d'ailleurs fort riche et fort intéressant à bien des égards - , pour nous consacrer uniquement à ses particularités qui l'ont érigé en véritable tradition culturelle. En d'autres termes nous privilégions la recherche du sens, caché ou affiché, de cette tradition pluricentenaire.
Par ailleurs, cette partie a été élaborée à partir des travaux, des articles et des reportages plus ou moins récents sur ce sujet, et l'ensemble sera complété par une enquête sur le terrain que nous avons menée au cours de l'été 1990 dans deux villages de la région de Bac-ninh (l'actuelle province de Hà-bac) réputés pour le quan ho, et qui se disputent son origine : Lung-giang, plus connu encore sous son nom populaire de Lim 2, et Hoài thi. Enfin, les échanges avec l'ethnologue Diêp Dinh Hoa, un spécialiste de cette tradition, nous a permis de mieux la saisir dans sa globalité.
Comme pour bien d'autres sujets, l'origine du quan ho, à commencer par son origine étymologique, pose problème. L'approche la plus directe qui consiste à chercher les différents sens de chaque terme qui composent ce mot n'apporte pas plus de précisions ni d'éclaircissements :
* quan : pourrait être la contraction ou le diminutif de quan quân, quan cach qui désignent en général les mandarins, ou de quan viên qui signifie "convives", "invités";
* ho : diminutif de ho hàng, qui désigne la grande famille dont les membres portent le même nom; ho veut dire encore "s'arrêter".
L'une des innombrables hypothèses (pas moins d'une quinzaine) 1 soutient l'idée que quan ho avait pour origine "l'amitié spéciale" (kêt nghia) qui liait deux mandarins (quan), mais aucune d'entre elles n'est basée sur des fondements solides et crédibles. Les artistes (nghê nhân) du village Hoài-thi nous affirment que leur village et Viêm xa, le village "allié" (voir plus loin sur le sens particulier de ce terme), étaient le point de départ du quan ho, et qu'ils sont actuellement les représentants de la treizième génération. Ce qui ferait remonter grossièrement l'origine au XIV-XVe siècle. Le village Lim revendique tout autant l'origine sans fournir aucune précision, si ce n'est le fait que sa fête annuelle est la plus importante du quan ho et celle qui rassemble le plus d'artistes. Devant cette impasse, les spécialistes vietnamiens font un détour vers les peuples frères, notamment les Muong et les Thai, les plus proches des Vietnamiens sur le plan culturel. Il s'avère que si l'on se borne à s'intéresser uniquement au quan ho comme mode d'expression artistique, - encore appelé d'une façon réductrice "chant alterné" sous la colonisation, - cette forme d'expression existe bien, à quelques variantes près, chez ces deux ethnies et au-delà même des frontières du Vietnam, car il est répandue un peu partout dans toute l'Asie du Sud-Est 1. Pour ne citer qu'un exemple : dans la région de Luang-Prabang au Laos, il existe bien un mode de chant similaire appelé khap thoum qui se pratique surtout lors du nouvel an. Si le khap thoum se pratique également en groupe, à la différence du quan ho (voir plus loin pour les détails techniques), seul le porte-parole du groupe, - celui qui est reconnu pour ses qualités artistiques et pour sa vivacité d'esprit, car un bon chanteur doit être toujours capable d'improviser les paroles de circonstance -, chante en s'adressant à l'hôte ou à l'hôtesse, avec certes l'indispensable participation du groupe qui ponctue son chant de paroles et de mélodies bien définies en apportant ainsi toute la vivacité de cet art. L'alternance homme-femme n'est pas non plus une règle absolue, l'alternance dans le chant s'applique plutôt à l'hôte ou l'hôtesse par rapport aux invités. Autre différence encore avec le quan ho dont les mélodies sont en nombre incalculable, le khap thoum se reconnaît à son unique mélodie musicale qui habite les paroles, lesquelles sont d'une variété illimitée car elles représentent le fruit de l'improvisation suivant les circonstances. Il convient de souligner également un autre point commun entre le quan ho et le khap thoum : ils ne nécessitent ni l'un ni l'autre l'accompagnement d'instruments de musique, le chant se suffit à lui-même.
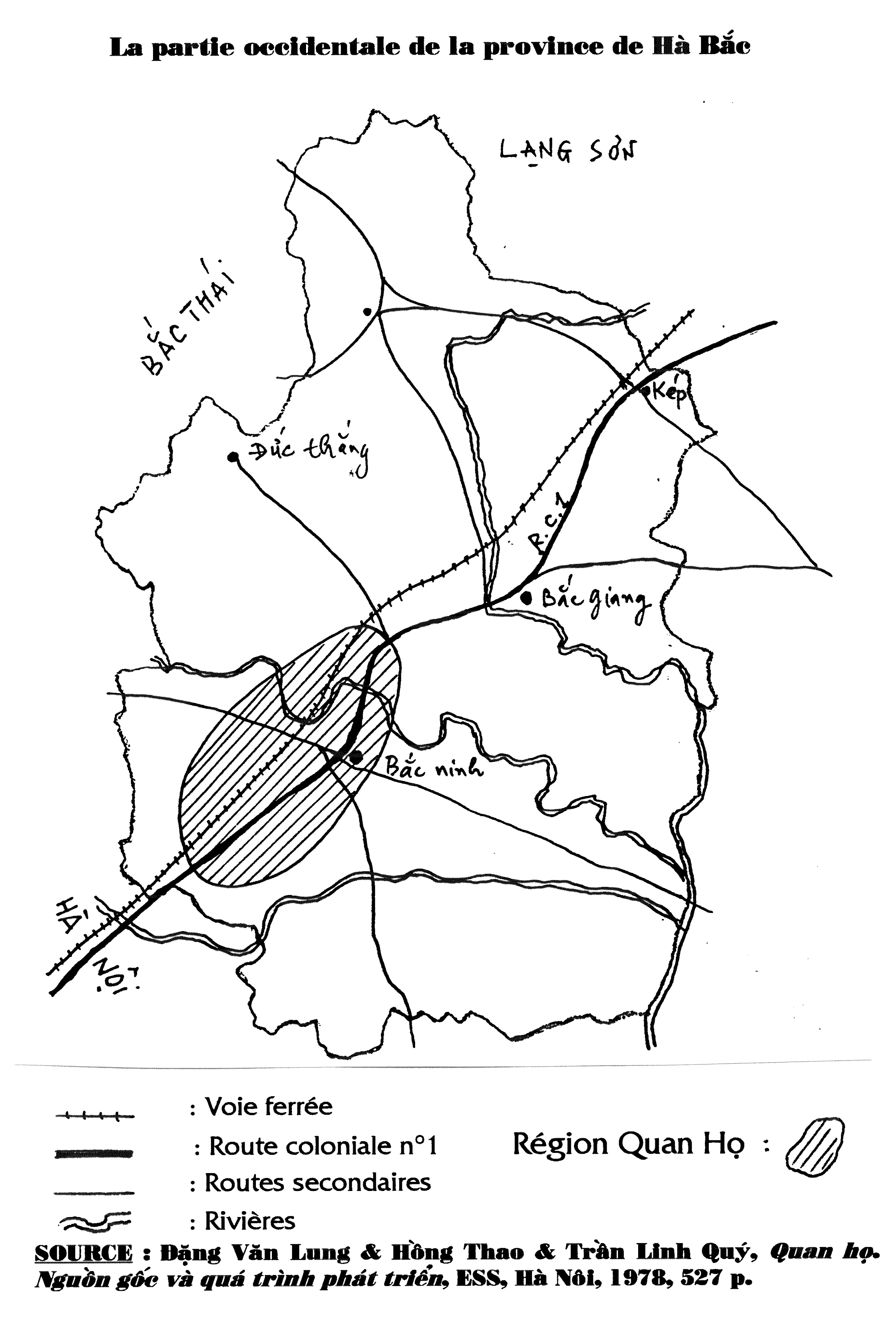
Dans l'attente d'une réponse plus plausible à toutes ces questions relatives à l'origine de ces traditions, si réponse il y aura, nous partageons le point de vue des auteurs de l'ouvrage cité, Quan ho. Nguôn gôc và qua trinh phat triên ("Le quan ho. Ses origines et son développement"), pour admettre que les termes quan ho désignaient dans un temps très reculé un mode d'expression du folklore, et que leur sens d'origine échappe aujourd'hui à tout le monde. Dans cette perspective, quan ho signifierait tout simplement bon ta, c'est-à-dire, "nous", "notre bande", si on le compare avec les termes équivalents des autres minorités ethniques (les Muong, les Thô, etc.) 1.
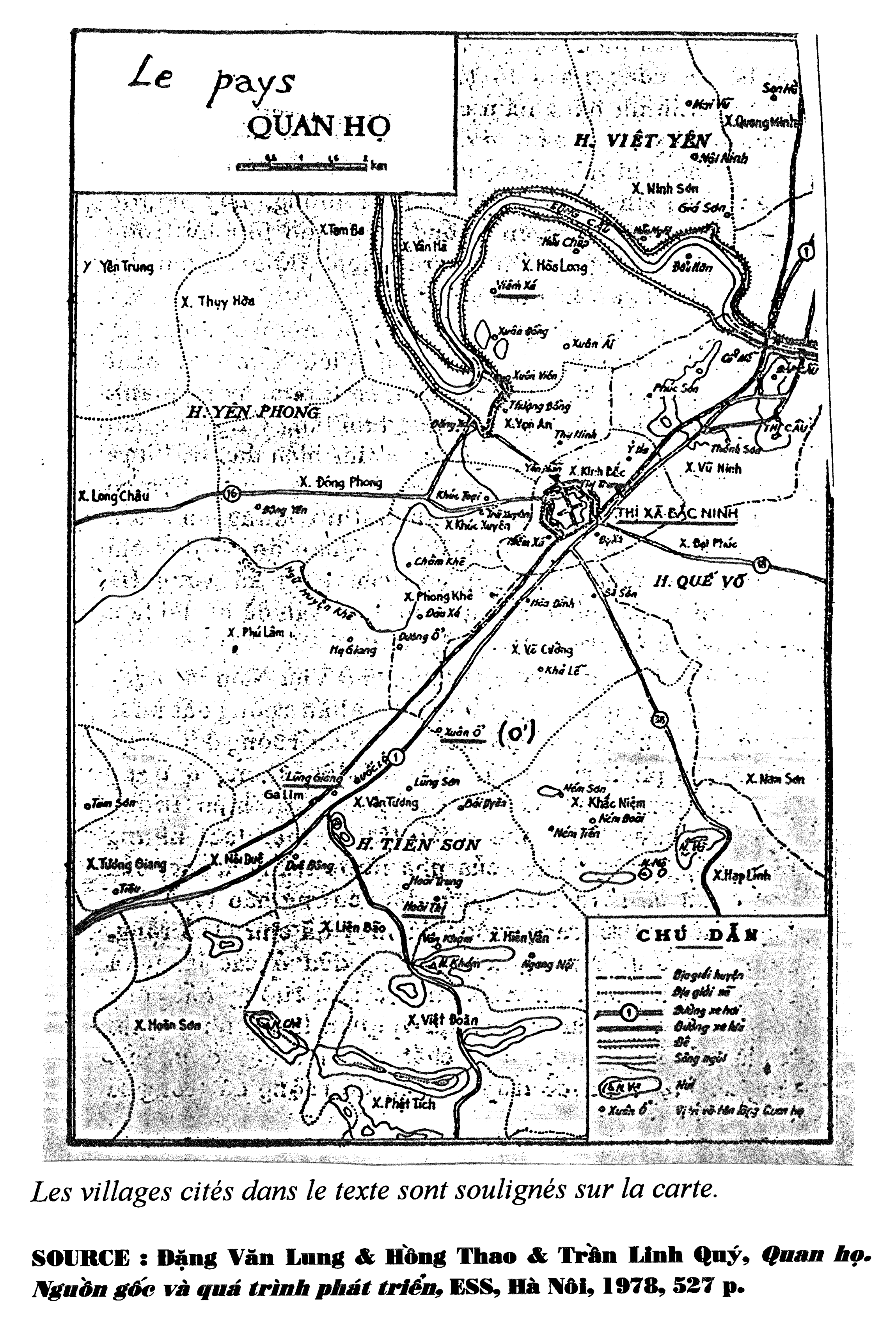 D'ailleurs,
les artistes (nghê nhân) du quan ho
regroupés au sein de chaque village étaient appelés
jusqu'à une date récente bon quan ho, ("la
bande quan ho"). Après l'indépendance du
Vietnam en 1954, le terme bon ("bande"), pourtant
sans connotation particulière à son origine, a été
jugé trop familier et trop vulgaire par les autorités
politiques qui ont fini par le faire remplacer par tô
("cellule"), une terminologie communiste plus conforme à
l'air du temps. Cette imbrication du politique dans le culturel va
parfois encore plus loin. L'ethnologue Diêp Dinh Hoa nous a
raconté que pendant la guerre contre les Américains,
les autorités politiques, pour des raisons économiques,
ont voulu avancer de dix jours la date de la fête du village
Lim en la ramenant du 13e au 3e jour du premier mois lunaire, en
pleine période du Têt qui pouvait durer plusieurs
semaines en milieu villageois. Elles espéraient avec ce
changement que les villageois se mettraient au travail plus tôt,
et qu'ils porteraient ainsi la production agricole à un niveau
supérieur. Résultat, les villageois n'ont certes pas
organisé la fête comme les autres années, mais au
lieu d'aller au travail ils sont restés chez eux pour faire la
fête dans l'intimité. Les artistes de Hoài-thi
nous ont raconté un autre fait similaire. La fête du
village Diêm (Viêm xa) - le village de leurs
"amis-alliés" avait lieu le 6e jour du huitième
mois lunaire, ce qui correspond, suivant les années, à
peu près au début du mois de septembre. Les autorités
politiques, dans le feu de la victoire contre les Français en
1954, ont décidé de déplacer la date de la fête
du village Diêm au 2 septembre pour qu'elle coïncidât
avec la fête nationale - cette date avait été
choisie depuis la déclaration d'indépendance du Vietnam
par Hô Chi Minh le 2 septembre 1945. Si cette méthode
autoritaire a été appliquée dans le passé
pour d'autres circonstances, on imagine les complications dans les
recherches sur les traditions populaires. Il est par ailleurs plus
que vraisemblable qu'elle ait été appliquée.
D'ailleurs,
les artistes (nghê nhân) du quan ho
regroupés au sein de chaque village étaient appelés
jusqu'à une date récente bon quan ho, ("la
bande quan ho"). Après l'indépendance du
Vietnam en 1954, le terme bon ("bande"), pourtant
sans connotation particulière à son origine, a été
jugé trop familier et trop vulgaire par les autorités
politiques qui ont fini par le faire remplacer par tô
("cellule"), une terminologie communiste plus conforme à
l'air du temps. Cette imbrication du politique dans le culturel va
parfois encore plus loin. L'ethnologue Diêp Dinh Hoa nous a
raconté que pendant la guerre contre les Américains,
les autorités politiques, pour des raisons économiques,
ont voulu avancer de dix jours la date de la fête du village
Lim en la ramenant du 13e au 3e jour du premier mois lunaire, en
pleine période du Têt qui pouvait durer plusieurs
semaines en milieu villageois. Elles espéraient avec ce
changement que les villageois se mettraient au travail plus tôt,
et qu'ils porteraient ainsi la production agricole à un niveau
supérieur. Résultat, les villageois n'ont certes pas
organisé la fête comme les autres années, mais au
lieu d'aller au travail ils sont restés chez eux pour faire la
fête dans l'intimité. Les artistes de Hoài-thi
nous ont raconté un autre fait similaire. La fête du
village Diêm (Viêm xa) - le village de leurs
"amis-alliés" avait lieu le 6e jour du huitième
mois lunaire, ce qui correspond, suivant les années, à
peu près au début du mois de septembre. Les autorités
politiques, dans le feu de la victoire contre les Français en
1954, ont décidé de déplacer la date de la fête
du village Diêm au 2 septembre pour qu'elle coïncidât
avec la fête nationale - cette date avait été
choisie depuis la déclaration d'indépendance du Vietnam
par Hô Chi Minh le 2 septembre 1945. Si cette méthode
autoritaire a été appliquée dans le passé
pour d'autres circonstances, on imagine les complications dans les
recherches sur les traditions populaires. Il est par ailleurs plus
que vraisemblable qu'elle ait été appliquée.
Quoi qu'il en soit, dans sa forme actuelle, les enquêtes que nous avons menées permettent de mieux comprendre le quan ho d'une façon plus globale. A cet égard, nous essayons de lui donner deux définitions qui se complètent l'une l'autre. Au niveau musical, il s'agit d'un mode de chant alterné qui se pratique en groupe, et dont l'inspiration repose sur l'amour. Au niveau culturel, le quan ho est une tradition orale, régionale et populaire ayant comme support le chant alterné, et qui se manifeste par un certain nombre de règles de conduite et de qualités artistiques visant à cultiver l'amitié. Ces définitions veulent à la fois tout dire et ne veulent rien dire. C'est pourquoi il faut pénétrer dans cette tradition orale afin de pouvoir saisir ses particularités et sa profondeur, car son versant musical, bien qu'indispensable, ne constitue en fait qu'une de ses composantes, l'arbre qui cache la forêt en fait.
Tout d'abord, quelques repères.
En tant que tradition régionale, le quan ho couvre une superficie de 250 kilomètres carrés de la province de Hà-bac, et surtout autour de la ville de Bac-ninh (voir cartes aux pages suivantes). Avant 1945, il y avait au total 49 villages sur 619 de l'ancienne province de Bac-ninh dépositaires du quan ho regroupés dans les quatre districts (huyên) :
* Huyên Tiên-son : 17 villages dont Lim et Hoài-thi;
* Huyên Yên-phong : 17 villages dont Diêm (Viêm-xa);
* Huyên Viêt-yên : 5 villages;
* La ville de Bac-ninh : 10 villages 1.
Dans les années 1970, sur ces 49 villages il en restait seulement la moitié (27 exactement) qui continuaient à maintenir la tradition. Par ailleurs, nous n'avons pu trouver aucun chiffre sur le nombre d'artistes d'avant 1945. La seule indication à cet égard ne date que de 1956. Le recensement lors de la fête du village Lim de cette année révéla le chiffre de 200 artistes quan ho 2. Dans les années 1970, ce nombre avait été réduit de la moitié. Si on projette dans le passé en tenant compte de la vivacité de cette tradition, d'une part, et du nombre d'artistes qui composent une "bande" quan ho, d'autre part, on pourrait avancer un chiffre de l'ordre de 1500 artistes reconnus (en supposant qu'en moyenne il y avait 6 artistes par "bande", et 5 "bandes" dans chacun des 49 villages dépositaires) sans compter ceux qui étaient initiés sans faire partie d'aucune "bande". Le chiffre de 1500 serait un minimum si on prend le village Hoài-thi comme repère, quoi que ce village ne soit certes pas un bon exemple car cette tradition y est encore assez forte : actuellement un bonne quinzaine d'artistes, hommes et femmes, âgés de trente à plus de soixante-dix ans, essaient de la maintenir. A l'époque coloniale, du quatrième jour du premier mois (fête du village Bo) au vingt-huitième jour du deuxième mois lunaire (fête du village Dang Xa), il ne se passait guère un seul jour sans qu'il y ait de fête quelque part dans un de ces 49 villages 1. Comme en principe chaque village célébrait sa propre fête à une date déterminée on imagine la vivacité de la tradition du quan ho. Signalons au passage que les filles de la région de Bac-ninh sont, depuis toujours, réputées pour leur beauté et leur caractère quelque peu volage. Au temps de la monarchie, beaucoup d'entre elles ont été, sous différentes dynasties (les Ly, les Lê, les Trinh particulièrement), "sélectionnées" pour devenir des courtisanes 2.
Quant à l'organisation interne de chaque "bande", les membres choisissent celui ou celle qui a le plus contribué à son essor (co công) pour lui attribuer le rôle de coordinateur, appelé aussi ông trùm (il s'avère que ce rôle est assuré la plupart du temps par un homme, d'où l'appellation ông, monsieur et trùm, le représentant). Il s'agit d'une place purement honorifique dépourvue de toute hiérarchie et autorité réelles. Car il convient de souligner la nature des rapports internes de chaque bande ainsi que celle des rapports inter-bandes, qui sont basées essentiellement sur le respect mutuel et sur l'amitié. Il règne en effet une certaine démocratie dans le monde du quan ho que bon nombre de vietnamologues ont soulignée. A l'inverse de la culture académique, le quan ho ne prend en compte ni de l'âge ni du sexe. Homme et femme sont à cet égard sur le même pied d'égalité. Ce respect mutuel se traduit immanquablement dans la façon dont chacun et chacune se situe par rapport à l'autre. Quel que que soit son âge et son sexe, un nghê nhân (artiste) du quan ho appelle son confrère liên anh, et sa consoeur liên chi. Les hommes se nomment tôi (moi, je) en s'adressant aux autres confrères et consoeurs, et les femmes, em (petite soeur), ou également tôi dans les conversations. Cette appellation est encore respectée par l'ensemble du village. Lors des fête ou des cérémonies liées au quan ho, les villageois appellent volontiers les membres de cette tradition liên anh ou lien chi suivant leur sexe. Cette façon de se situer par rapport à l'autre est complètement inconnue à la fois dans la culture académique des classes dirigeantes pour qui l'âge est un critère de respect et chez qui la femme n'a pas droit de cité, et dans la vie quotidienne. En effet, liên anh et liên chi - termes de politesse spécifiques à la culture quan ho et dont on ignore aujourd'hui l'origine étymologique, - ont à peu de chose près le même sens que anh (grand frère) et chi (grande soeur) tout court. Exception faite du quan ho, on ne voit dans aucune autre circonstance de la vie, ni dans aucun autre milieu, un Vietnamien plus âgé que son interlocutrice lui parler en l'appelant chi de cette façon respectueuse. A cet égard, liên anh et liên chi résument en deux mots l'esprit et la fierté du quan ho; les artistes du village Hoài-thi, avec raison, n'ont pas oublié de nous faire remarquer cet aspect. Par ailleurs, le quan ho ne constitue pas un monde à part au sein du village, un microcosme hermétique, au contraire, il représente aussi un sujet fierté pour tous les villageois pour qui les nghê nhân (artistes) bénéficient d'un statut honorable. Une pratique qui confirme cette distinction, les membres des "bandes" du quan ho étaient exemptés de participer aux cortèges de procession qui portaient le lauréat du concours mandarinal à son retour au village natal après sa réussite (il s'agit du rituel vinh quy), au temps où les concours littéraires n'étaient pas encore supprimés par les autorités coloniales 1. Les vétérans du quan ho de Hoài-thi ont attiré notre attention sur le fait que les amis quan ho du village "allié" ont toujours droit aux places les plus prestigieuses dans le dinh lors des cérémonies et des fêtes auxquelles ils ont été invités, c'est-à-dire à la même natte que les représentants officiels du village. Pour souligner cet aspect, nos vétérans de Hoài-thi nous ont fait encore savoir que les amis "alliés" arrivent en pleine cérémonie, et que le village suspend alors les rituels pour les accueillir. Quand on sait combien les places au sein du dinh sont symboliques quant au prestige dans la culture villageoise, on comprend à cet égard la fierté du quan ho vis-à-vis de son entourage qui la partage également. Ces particularités profondément ancrées dans la culture villageoise font du quan ho une véritable identité régionale, reconnue tant par les uns que par les autres, qu'ils soient habitants de cette région ou non.
Contrairement au ca trù qui était l'apanage des classes dirigeantes (lettrés et mandarins), les amateurs du quan ho se recrutaient et se recrutent encore dans le milieu populaire, et plus précisément, chez les paysans de condition sociale moyenne : les trop pauvres n'auraient pas eu les moyens de subvenir aux frais occasionnés par les cérémonies rituelles et les dépenses diverses, tandis que les paysans riches ne se sentaient pas particulièrement attirés par cette tradition, comme nous l'a fait remarquer l'ethnologue Diêp Dinh Hoa. Cette observation a bien été vérifiée par notre enquête dans les deux villages cités, et elle reste valable encore de nos jours. Ces conditions sociales vont de pair avec le niveau d'instruction. Les nghê nhân du quan ho sont loin d'être les mordus des concours littéraires. Jusqu'au début du siècle, dans les années 1920-1930, aucun d'entre eux ne possédait un titre d'enseignement enviable, que ce fût dans l'enseignement traditionnel ou dans l'enseignement moderne franco-indigène. La plupart d'entre eux possédaient tout au plus quelques rudiments des connaissances classiques, quant à l'enseignement moderne, ils avaient le niveau du primaire 1. L'exercice du pouvoir ne semblait pas non plus les attirer particulièrement; aucun d'entre eux ne faisait partie d'une institution officielle locale (conseil des notables, représentants du village ou ly truong, etc.) 2.
A part ces singularités, le quan ho n'en renferme-t-il pas d'autres ? Pour les découvrir, cette fois nous allons suivre pas à pas le cursus de formation d'un artiste et sa vie de la naissance à l'âge de la retraite sociale. Soulignons tout d'abord que le milieu quan ho est un milieu ouvert, on n'a pas besoin de parrainage ni d'adoption particulière (comme dans le milieu du ca trù) pour y accéder. En principe donc, tout le monde peut faire partie d'une "bande" quan ho, cependant qu'on parvienne à se faire reconnaître comme nghê nhân ou non, cela dépend des qualités artistiques d'une part, du respect des règles de conduite et du savoir-vivre spécifiques du quan ho, d'autre part. Rien de plus normal que tout cela, car la discrimination de quelque nature qu'elle soit est inconnue. La formation d'un artiste comprend essentiellement deux volets indissociables aussi importants l'un que l'autre : le chant et le savoir-vivre (lê lôi).
Si l'on est né de parents eux-mêmes artistes, dès la naissance on est bercé par les chants quan ho qui se substituent aux berceuses ordinaires. L'enfant grandira avec cette sensibilité et connaît facilement de mémoire quelques paroles et quelques mélodies. "En règle générale, les parents artistes encouragent leurs enfants à poursuivre la tradition", disent les vétérans de Hoai-thi. Si l'enfant a des dons et s'il le souhaite, il participera à des soirées de formation collective organisées la plupart du temps chez ông trùm (le représentant d'une "bande"). Dans le cas inverse, si on n'est pas né de parents artistes, ce n'est pas vraiment un handicap en fait, on baigne tout de même dans l'atmosphère du quan ho au sein de son village. Le plus souvent, ce sont les vétérans du village qui, ayant découvert les jeunes talents, suggèrent et demandent à leurs parents l'autorisation de les laisser fréquenter les cercles de formation. Les plus âgés et les plus avertis deviennent de facto les guides sans avoir pour autant le statut de "maître", notion pourtant sacrée dans les autres disciplines pour les Vietnamiens. Rappelons que dans la culture confucéenne le "maître" (thây), l'enseignant, celui qui dispense les connaissances, a un statut plus élevé que les parents sur le plan social. La trilogie quân (le roi) su (le maître) phu (le père) en est la preuve : le roi est placé au-dessus du maître qui est lui-même au-dessus du père. Aussi la notion de "maître-disciple" n'existe donc pas dans le quan ho qui s'établit sur d'autres types de relations plus égalitaires. Comme les artistes sont par ailleurs aussi des riziculteurs, le calendrier des soirées-formation dépend de celui de la riziculture. Ainsi les aîné(e)s ne peuvent être disponibles que dans la période qui sépare les deux cultures (mùa). Leur présence est plus qu'indispensable étant donné que le quan ho relève d'une tradition strictement orale jusqu'à une date récente où un certain intérêt a sensibilisé les chercheurs vietnamiens d'origines diverses à se pencher sur la question en organisant des colloques, en menant des enquêtes, et en publiant des articles et des écrits divers 1. Pour un jeune qui souhaite s'initier au quan ho, l'âge requis est environ 14-15 ans. Mais le jeune ou la jeune n'arrive pas pour autant complètement démuni(e) le premier soir de l'apprentissage, compte tenu de la tradition ambiante qui règne dans le village. On apprend bien entendu à chanter en mémorisant les paroles par répétition, à maîtriser les techniques propres et nécessaires à chaque genre de chanson, lui-même étant fonction des circonstances. On ne chante pas la même chose au dinh au cours d'une cérémonie que chez un particulier. Les genres sont très diversifiés et très codifiés. A titre d'exemple, on a des chansons:
* d'accueil;
* d'adieu;
* rituelles (anniversaire, mariage, etc.);
* d'évocation cosmique (la pluie, le soleil particulièrement);
* de séduction amoureuse, le genre le plus riche par son répertoire.
Comme il s'agit d'un mode de chant alterné, chaque amateur doit connaître la "chanson-réplique" (dôi) la mieux circonstanciée afin de pouvoir répondre au défi qui lui sera lancé par ses pairs de sexe opposé une fois rentré dans le cercle des initiés. Réplique tant sur le plan musical que sur le plan technique, sans parler du sens des paroles. A côté de l'apprentissage artistique on cultive aussi l'esprit quan ho basé sur le respect mutuel, sur un savoir-vivre (lê lôi) et un certain savoir-faire aussi. Dans le langage quan ho, liên anh et liên chi sont les maîtres-mots. On cultive l'humour, l'esprit poétique et on apprend un certain langage (loi an tiêng noi) qui soit agréable à entendre, et qui est qualifié par le terme kheo (agréable, délicat). La joie et la douceur doivent être de mise car la politesse et l'oubli de soi au bénéfice de l'autre sont primordiaux. Quand on s'adresse à l'autre on cherche toujours à le "positiver", comme nous dirions aujourd'hui, en gardant l'humilité pour soi. Le langage quan ho est à la fois imagé, symbolique et codifié. Par exemple, lors des retrouvailles, les hommes invitent les femmes à chanter les premières, marque de politesse et d'estime connue de tous. Celles-ci n'acceptent pas cet honneur et le renvoient aux confrères en disant avec humilité qu'"elles ne connaissent pas le chemin menant au marché qui se trouve au loin (chung em không biêt di cho xa), mais seulement celui qui aboutit sur le marché d'ici près" (chung em chi biêt di cho gân thôi). Il faut comprendre qu'elles ne prétendent pas être des chanteuses calées qui connaissent par coeur tout le répertoire, mais seulement quelques petites chansons. Il s'agit bien entendu d'une réponse typiquement quan ho. Modestie oblige. Sur ce, les confrères trouvent le moyen de mettre en valeur ces paroles en leur disant que "le marché qui se trouve au loin ne vaut pas les soixante-treize marchés qui sont tout près" (cho xa không bang bay muoi ba cho gân) 1. (Les traductions ne permettent pas de retranscrire les rimes, ce qui "aplatit" le chant, alors qu'en vietnamien, ces conversations, bien que codifiées, sont bien rimées et renferment leur propre musicalité.) Ce balancement dure jusqu'au moment où l'une des deux parties consent à chanter la première. Tout artiste prévenu ne peut manquer d'avoir recours à ce rituel, sous peine d'être mal considéré, voire ignoré. Il en est ainsi pour toute autre conversation et dans toute situation. D'un autre côté, ces répliques de circonstance révèlent la vivacité d'esprit et la capacité d'improvisation chez les artistes du quan ho, qui sont de vrais poètes en fait. Soulignons tout de même que ces qualités ne nuisent en rien au côté cocasse qui vient enrichir la personnalité de ces poètes. A titre anecdotique, nous pouvons raconter le petit fait suivant : lors de notre enquête au village de Hoài-thi, le premier soir après la prise de contact avec l'ensemble des membres de la "bande", et après d'inévitables chants d'accueil sous le clair de lune, arriva le temps de se séparer. Nous avons été surpris par le raccourci pris par un sexagénaire, qui, au lieu de rentrer chez lui par le chemin tout tracé, préféra escalader en pleine nuit les murs qui séparaient les habitations pour prendre le chemin de retour. On ne peut attribuer ce geste au souci de gagner du temps, car il n'aurait sans doute gagné au plus que deux ou trois minutes (Hoài-thi est un petit village d'environ six cents habitants sur une petite superficie), mais c'est plutôt l'esprit aventureux et ludique, bien vivant chez ceux qui relèvent de la culture quan ho, qui s'est manifesté ici.
Sur le plan physique, la tenue vestimentaire fait partie de l'identité quan ho. Les hommes gardent encore de nos jours la tunique noire par-dessus le pantalon blanc et large, et portent le "turban" (khan xêp). Le parapluie enfin symbolise à la fois la galanterie et l'élégance. Il arrive cependant à certains de se mettre à l'heure de la modernité en s'habillant à la manière occidentale. Quant aux femmes, elles gardent de même la tenue traditionnelle avec la longue tunique ceinturée, la tête est couverte d'une sorte de châle (chit khan). Le large chapeau rond (non quai thao), qu'il ne faut pas confondre avec le chapeau conique ordinaire, et qu'elles pendent suspendu sur une épaule ou qu'elles gardent à la main avec grâce, complète l'uniforme. Si pour une raison ou une autre, l'on ne souhaite pas devenir un véritable nghê nhân tout en restant attaché à cette tradition, on peut tenir alors le rôle d'assistant dans les cérémonies : accueil, préparation des repas et des chiques de bétel, c'est un travail d'intendance en somme. Ces tâches, certes moins valorisantes, nécessitent pourtant un apprentissage, car les repas du quan ho ne se préparent pas de la même façon qu'un repas ordinaire ou même qu'un repas de fête. Le soin et le beau sont essentiels : les plats une fois bien cuisinés doivent être disposés sur les assiettes d'une manière qui rende le savoir-faire traditionnel, le reflet du beau (my thuât). Les chiques de bétel sont préparés avec un grand soin artistique qui tranche sur l'ordinaire : elles portent également le nom de trâu canh phuong (chiques de bétel aux ailes de phénix). Plus précisément, l'écorce verte à moitié détachée de la noix d'arec coupée en petits quarts, est repliée en forme de pétales de fleurs, l'ensemble est piqué sur une petite tige de bambou, sur laquelle on enfile aussi une feuille de bétel enroulée et repliée en forme d'ailes d'oiseau. Enfin on dispose l'ensemble en fichant les petites piques de longueur différentes sur un fruit, pamplemousse par exemple, pour composer une figure artistique. Autrement dit, cette façon de préparer les chiques de bétel constitue une autre caractéristique du quan ho qui cultive l'esprit esthétique. Un repas quan ho, appelé simplement com (repas) et non cô (festin) est un rituel inévitable mais surtout une épreuve redoutable pour les débutants. Contrairement à la tradition villageoise ordinaire pour qui le repas ou le festin occupe une grande place dans toutes les circonstances, le repas dans la culture quan ho reste symbolique. On mange très peu; malgré tout, l'hôte qui reçoit ses amis doit préparer un repas conforme à la tradition tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Si ce repas tombe en un moment où la famille de l'hôte est en difficultés matérielles, on se débrouille par tous les moyens pour parvenir à l'organiser, quitte à s'endetter sans que les amis le sachent. Il ne faut surtout pas laisser apparaître le moindre signe d'économie, l'avarice n'en parlons pas. Les plats les plus conseillés demeurent le poulet, le "pâté" de porc (gio), les gâteaux de riz (banh chung), les sucreries (banh mât, banh su-sê), le riz, etc. On évite les plats trop gras. Comme boisson, du thé, de la limonade, mais surtout pas d'alcool qui abîme la voix. Pendant le repas un silence relatif est la règle, les discussions ne peuvent se faire qu'à voix basse, naturellement on manie les couverts d'une manière attentionnée pour éviter de faire du bruit. Dernière singularité du repas quan ho, quel que soit le nombre de personnes présentes, le repas se prend toujours autour d'un seul plateau (mâm), bien couvert jusqu'à la dernière minute, une délicatesse à laquelle l'hôte doit veiller. Le plateau unique symbolise la solidarité entre les participants. Le repas n'est fini que quand le plus honorable de la "bande" en donne le signal, en posant ses baguettes sur le bord du plateau avec un petit bruit. Cette codification renverse les manières habituelles des Vietnamiens à table, et le quan ho en fait une fierté.
Ainsi, au bout de quatre ou cinq années, le jeune ou la jeune novice aura appris l'art et la manière (lê lôi) du quan ho. Il ou elle atteint maintenant dix-huit, vingt ans, l'âge d'entrer dans le cercle des artistes confirmés. Mais l'urgence consiste d'abord à trouver un partenaire (ou une partenaire si l'on est fille), du même sexe, indispensable pour le chant. Les partenaires se choisissent par affinité et deviennent inséparables lors des tournées ou des circonstances diverses. L'amitié profonde qui attache l'un à l'autre prévaut souvent sur les relations familiales entre frères ou soeurs, par exemple. Effectivement dans le quan ho en tant que mode d'expression artistique, on chante par binômes, de garçons d'un côté et de filles de l'autre. A l'intérieur du binôme, l'un(e) chante la voix principale (giong chinh) et l'autre la voix de soutien (giong luôn). Cependant le binôme constitué est loin d'avoir parcouru toutes les étapes de la vie d'artiste. Il lui faut maintenant trouver les amis de l'autre sexe d'un village voisin, avec qui chanter dans différentes situations et si possible avec qui lier des relations d'amitié spéciale. Le contexte le plus propice à la découverte des ami(e)s demeure les fêtes de village, la fête du village Lim, par exemple. Le binôme se rend ainsi à la fête, les yeux attentifs aux susceptibles futur(e)s ami(e)s. De toute manière, les chanteurs ou chanteuses quan ho se reconnaissent facilement à leur costume. D'un autre côté, dans ce milieu comme dans tant d'autres, on saura rapidement repérer les uns les autres. Si un binôme de garçons commence à être connu tant sur le plan artistique que sur le plan du savoir-vivre, il arrive que des filles fraîchement formées et à la recherche d'amis n'hésitent pas à faire remarquer leur présence et prennent l'initiative dans le rapprochement, en empruntant bien sûr des détours habiles. Si les garçons se décident à répondre à cet "appel de pied", ils s'avancent vers elles et leur demandent de quel village elles sont originaires 1. Les conversations s'engagent et prennent très vite une tournure de séduction. Les vieux( cac cu) de Hoài-thi nous ont bien précisé que l'amour constitue le mobile principal de la conversation (noi chuyên, chu yêu là tinh). Si l'on s'aperçoit que les filles ne manifestent pas de réactions particulièrement antipathiques et qu'elles se présentent bien sur tous les plans, alors on leur tend les chiques de bétel et on les invite à en prendre. Il convient de souligner que les garçons ne sont pas les maîtres de la situation, car ils sont également confrontés au défi, et les rôles peuvent s'inverser. Bref, garçons et filles se choisissent mutuellement en fonction de leurs affinités et de leur estime réciproque. La chique de bétel est à la fois un prétexte - les Vietnamiens disent que "la chique de bétel est le début de toute conversation" (miêng trâu là dâu câu chuyên) - et un langage codé. L'invitation à la chique de bétel traduit l'estime et l'invitation au chant. Si l'estime est réciproque, alors les filles acceptent les chiques de bétel et se préparent ainsi au chant. Sinon, on se sépare pour de nouvelles aventures.
Admettons que filles et garçons se choisissent pour une partie de chant, ils se mettent ensuite d'accord pour aller chanter dans un endroit retiré et se mettre à l'abri du bruit, et aussi à l'abri des regards curieux. La partie de chant peut durer jusqu'à l'épuisement de l'inspiration, c'est-à-dire plusieurs heures, et les chanteurs sont entièrement libres d'exprimer leurs sentiments; car les chants reposent essentiellement sur l'amour et la séduction. Une personne non prévenue qui les écoute les prend facilement pour des amoureux ou des couples déjà formés. En fin de soirée de fête, si l'envie de chanter ne tarit pas et qu'ils souhaitent se connaître un peu mieux, ils s'invitent alors chez les uns ou chez les autres pour continuer le duo d'amour entre eux ou en présence d'autres confrères et consoeurs du village. Vers quatre heures du matin, on fait une pause "souper" avec des sucreries, des fruits, du thé et de la limonade. Comme l'alcool n'est pas d'usage, les risques de disputes ou de déboires sont ainsi éliminés. D'ailleurs les disputes ne se font guère en public par respect de la tradition du quan ho. Le jour pointe et la fête se poursuit quelque part dans un autre village. Les jeunes amis se mettent d'accord pour continuer la fête ou se séparer.
Cette étape de tâtonnements dans le choix des ami(e)s peut se répéter plusieurs fois dans la même année à diverses occasions, ou sur plusieurs années, jusqu'au jour où les uns et et autres sont sûrs de leurs sentiments d'amitié et de leur estime. L'étape suivante revêt d'une importance primordiale dans la vie d'un nghê nhân, car il s'agit de la cérémonie du kêt nghia, une sorte d'alliance, au caractère sacré dans la culture quan ho. (Cette "alliance" ne s'applique qu'aux jeunes, les garçons d'un village d'un côté, et les filles d'un village différent de l'autre.) On informe les vétérans de sa propre "bande", qui se chargent de concrétiser ces relations par des cérémonies prescrites suivant les règles de la tradition. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un mariage mais les rituels revêtent tous les signes d'une union entre les quatre jeunes gens des deux binômes. Les jeunes sont présentés à tous les membres du quan ho de leurs villages réciproques, ces derniers sont pris à témoins de leur amitié. Naturellement on fait la fête et on chante pour marquer cet heureux événement, d'abord à la maison communale avant de déplacer la fête vers le lieu d'habitation des intéressés. Mais, les jeunes (garçons et filles) sont prévenus que cette alliance qui les rapproche à bien des égards, qui officialise leurs relations d'amitié, leur interdit aussi de se marier entre eux. Dans la pratique, cette interdiction n'altère en rien les sentiments sincères et réciproques qu'éprouvent les uns pour les autres; leurs fréquentations, bien que mesurées et espacées témoignent de leur attachement disons platonique. Au fond d'eux, le sentiment d'amour est indéniable. La façon et le ton dont un des vétérans du village Hoài-thi nous a évoqué sa jeunesse en disent long. Tout se résume dans son expression nho nhau lam (on pense très fort à l'autre). Attardons-nous un instant sur le sens du terme nho comme tant d'autre termes vietnamiens qui n'ont pas d'équivalent en français, et reste donc intraduisible. Nho veut dire suivant le contexte "penser (très fort) à", ou "manquer" (dans "tu me manques"), ou bien "se rappeler", ou encore "avoir la nostalgie, le mal du pays" dans nho nhà (nhà : la maison), mais il peut aussi englober tous ces sens à la fois suivant l'intonation qu'on lui donne. Dans le contexte que nous venons d'évoquer nho s'emploie pour exprimer le sentiment amoureux éprouvé pendant l'absence. Celui qui l'emploie laisse comprendre implicitement aux autres qu'il est amoureux, en fait. Que faire dans ce genre de situation quand on est amoureux et qu'on a envie de revoir ses ami(e)s, mais que la prochaine fête est encore loin ? Les vieux de Hoài-thi nous ont un peu dévoilé leur secret de jeunesse. On se met d'accord avec son partenaire pour aller rendre visite aux amies liées par le kêt nghia dans leur village. Le moment le plus approprié est la fin de l'après-midi. Mais avant cette mise en scène, on prévient les consoeurs de son propre village, faisant partie de la même "bande", et qui ont des amis kêt nghia dans le même village voisin, de ses intentions pour qu'elles ne viennent pas le même jour voir leurs amis à elles; ce qui dévoilerait le côté "planifié", car il faut garder une apparence de spontanéité et de surprise. En fait, aussi bien les filles que les garçons recourent à ce prétexte, et quand on est du même village on ne peut qu'être complices dans ce genre d'aventure. On arrive donc vers six ou sept heures au village "allié", en disant aux amies qu'on revient d'une tournée, d'une affaire dans la région, qu'on en profite pour passer leur dire bonjour. Ainsi on a raccourci le temps d'attente avant la prochaine fête. En bonne tradition du quan ho on ne reçoit pas les amis sans un minimum d'accueil ritualisé par un repas, prétexte à garder les amis plus longtemps. Par ailleurs, ces retrouvailles ne sauraient se passer d'une partie de chant. En général, les "invités-surprise" passent la soirée chez les amies à chanter jusqu'à l'aube, avant de regagner leur village.
En principe, les jeunes artistes à la recherche d'amis peuvent "s'allier" (kêt nghia) avec quiconque appartient à un autre village, pourvu que les uns et les autres s'entendent. Dans la pratique, on "s'allie" plutôt avec les confrères ou avec les consoeurs du village ayant déjà des liens avec le sien depuis des générations. Ce qui explique pourquoi les liens entre Hoài-thi et Viêm-xa sont ininterrompus depuis treize générations, bien que ce dernier ait eu d'autres liens plus ou moins éphémères avec d'autres villages. Pour montrer combien ces liens sont sacrés, les vieux (cac cu) de Hoài-thi nous rappellent qu'en 1945, en pleine guerre et en pleine famine, le village Hoài-thi étant de plus ravagé par une inondation, ces catastrophes ne les ont pas empêchés de se rendre à Viêm-xa qui se trouve à une petite dizaine de kilomètres quand celui-ci célébra ses fêtes. Car si on manquait à cette occasion, la fête annuelle du village, on serait considéré comme négligent et lunatique, et la confiance réciproque serait rompue, situation que personne ne pourrait souhaiter en bon défenseur de la tradition. Bien que ces liens ne s'établissent pas au niveau du village, car ils reposent uniquement sur des liens inter-personnels, ils sont reconnus par les autorités locales du fait de l'ancrage du quan ho dans la vie villageoise comme nous l'avons signalé plus haut.
Il nous semble important, à cet égard, de préciser les limites et la nature des relations entre les sexes découlant du kêt nghia. Les explications données par les vieux de Hoài-thi nous informent par la même occasion sur la fréquence des retrouvailles, sur les différentes occasions où les uns invitent les autres à venir chanter. Sur le plan du respect de la tradition, le rituel du kêt nghia "oblige" les intéressés à se rendre au village "allié" quand celui-ci célébre sa fête (vào dam), et dans le cas contraire à inviter les amis quan ho à venir quand son propre village organise la fête. L'invitation se fait au moins trois jours à l'avance. Ceux qui sont chargés de cette tâche arrivent en général en fin d'après-midi au village des amis, et passent par la même occasion la soirée à chanter jusqu'au lendemain avant de rentrer. Naturellement, lors de la fête du village, les amis quan ho siègent à la place d'honneur au dinh en divertissant le public par des chants de circonstance. Quand cette cérémonie est terminée les "bandes" quan ho invitent les amis venus du village "allié" à une visite familiale; séparément les filles reçoivent les garçons chez l'une d'entre elles et vice-versa. Dans ces retrouvailles comme dans toute autre manifestation, on passe son temps à chanter, autrement dit à exprimer ses sentiments. Si l'hôte est déjà marié, son épouse doit s'éclipser devant la présence des amis pour leur laisser leur espace de liberté dans l'expression. Il en est de même pour l'époux de l'hôtesse. Bref, qu'on soit l'époux ou l'épouse, on doit s'effacer devant l'ami(e) quan ho dans ces circonstances comme à chaque fois qu'il y a une visite de courtoisie. En cas de conflit ou de jalousie qui sont fort compréhensibles, les artistes du quan ho préfèrent le divorce à l'abandon de la tradition. Faut-il comprendre par là que l'amie tissée avec qui on a les liens du kêt nghia est plus importante que l'épouse ? (Cette question est aussi valable pour l'ami et l'époux.) L'ethnologue Diêp Dinh Hoa qualifie, en langage moderne, les relations qui retiennent les amis unis par le kêt nghia, de bô bich, il s'agit d'"amants" en quelque sorte. Toujours est-il que les artistes du quan ho ont souvent connu une vie familiale hors-norme. Le peu de femmes que nous avons rencontrées ont, soit divorcé sans jamais se remarier, soit reconstruit plusieurs fois un foyer conjugal, et personne n'a définitivement abandonné le quan ho. L'une d'elles a divorcé il y a vingt ans, trois ans après son mariage, car son mari ne supportait pas qu'elle continuât à chanter. Par ailleurs, quand on se marie, on s'abstient d'annoncer la nouvelle aux ami(e)s avec lesquel(le)s on a tissé par les liens du kêt nghia, et de les inviter au mariage. Pourquoi donc cette discrétion ? Devant cette question, les vétérans de Hoài-thi se bornent à répondre que "ça ne se fait pas". La nouvelle du mariage parvient pourtant aux oreilles des intéressé(e)s, mais par la voie du ouï-dire. Par contre, on invite les amis quan ho au mariage de ses enfants, avec naturellement d'interminables parties de chant. Il en est de même pour la disparition d'un membre de la famille. A la différence des autres circonstances, on ne chante pas au foyer en deuil, mais chez un autre de la même "bande" après avoir présenté ses condoléances à la famille endeuillée.
Les vieux de Hoài-thi tenaient à souligner d'autre part que les relations du kêt nghia reposent exclusivement sur les liens d'amitié et sur le respect mutuel, qu'il ne fallait absolument pas confondre avec certaines alliances entre deux villages qui reposent, elles, sur la solidarité et l'entraide. En d'autres termes, les liens du kêt nghia n'avaient rien à voir avec l'aspect matériel. Jamais on ne demanderait de l'aide matérielle, ou quoi que ce soit, aux ami(e)s à qui on est uni(e)s par ces liens.
Quand les liên anh et liên chi (autrement dit les artistes du quan ho) approchent de l'âge de trente ans, ils arrêtent de parcourir les fêtes à la recherche d'ami(e)s car il faut bien laisser la place aux jeunes, et ils considèrent tous qu'ils ont dépassé l'âge (qua thi). On n'abandonne pas le quan ho pour autant, au contraire on participe aux autres aspects pour maintenir la tradition : organisation des concours de chant, participation à ces concours, (les vétérans deviennent jury), formation de jeunes talents et transmission de la tradition, les plus doués contribuant par la composition de nouvelles chansons à enrichir le répertoire, etc. Quoi qu'il en soit, l'âge "avancé" ne remet nullement en cause les relations du kêt nghia et les rituels qui en découlent (réceptions, visites de courtoisie, etc.).
Tout ceci révèle que le quan ho était présent dans tous les actes touchant aux événements importants de la vie, du mariage à la mort en passant par les fêtes diverses. Quant aux manifestations, elles prenaient des formes variées d'un village à l'autre. Nous avons déjà évoqué, dans un chapitre précédent 1, la forme que prenait le quan ho du village O; bien d'autres formes existaient ailleurs. Pour résumer, l'essence du quan ho peut être contenue dans le terme choi qui renferme une panoplie de sens différents. Le sens le plus courant de ce terme est "jouer", "s'amuser", mais dans le quan ho, ce terme devient un maître-mot. On le retrouve dans les expressions : nghê choi (littéralement le "métier de jouer"), lôi choi ("la manière de jouer"), choi quan ho pour dire "pratiquer le quan ho".
Dans le langage courant choi rentre dans les expressions suivantes :
* di choi : sortir, aller se promener;
* làng choi : "la confrérie" des "joueurs" (ceux qui ont des
penchants pour les vices);
littéralement :"village de joueurs" ;
* tay choi : un joueur;
* choi boi : qui ne pense qu'à jouer dans la vie, qui a un
penchant pour les vices;
* choi gai : (en parlant des hommes) action qui traduit le
libertinage, qui considère la femme comme un
objet de plaisir;
* choi cho : série verbale qui veut dire se sortir d'une
situation en infligeant une "défaite" à
l'adversaire;
* choi ac : se comporter, jouer un tour avec méchanceté;
* choi dêu : être salaud;
* choi nhau : s'affronter, ou plus familièrement "baiser";
* choi ngang : en parlant d'une femme, avoir des relations
extra-conjugales, ou communément se
comporter d'une façon non conformiste et
téméraire, dans les situations difficiles.
Bien que le terme "jouer" ne corresponde pas exactement à celui de choi qui est intraduisible, nous ne trouvons pas mieux. Ainsi dans les traductions, à chaque fois que le terme choi est employé dans la version originale des chansons, nous le traduirons par "jouer", pour une raison de commodité.
Enfin, pour clore cette visite, nous illustrons cette tradition du quan ho par les traductions de quelque chansons, les unes rapportées par des spécialistes, les autres recueillies au cour de notre enquête. Signalons en passant que contrairement aux poèmes classiques et même aux poèmes du ca trù qui sont fort riches d'allusions littéraires et historiques, les paroles des chants quan ho ont pour cadre la vie matérielle et émotionnelle des paysans. Ainsi les poèmes chantés qui reflètent le côté concret et imagé de la vie quotidienne sont pour la plupart construits sur le modèle du luc bat (succession de vers de six et de huit pieds), la seule forme de poésie reconnue comme typiquement vietnamienne avant l'avènement de la poésie moderne. La différence avec la poésie classique se situe aussi au niveau de la "transgression" de la règle des rimes, sans doute pour répondre aux besoins de la mélodie. Les poèmes chantés sont relativement courts, parfois très courts. On remarque aussi qu'ils sont enrichis de sons qui n'ont pas de sens en soi, telles que i, a, u, o, la, et d'expressions n'ayant pas de significations en soi comme tinh tang, tang tinh, tinh tinh tang, etc., sans doute aussi pour répondre aux besoins de la mélodie.
Voici une chanson d'accueil chantée à l'occasion de la venue des visiteurs :
Aujourd'hui les quatre océans communient,
Bien que venus des quatre horizons, nous sommes issus de
la même famille.
L'est et l'ouest, séparés par des milliers de lieues,
Se réjouissent pourtant dans le même foyer.
Cette joie d'aujourd'hui, nous nous en souviendrons (...) 1.
Comme les chiques de bétel sont indispensables en toute circonstance, elles entrent ainsi dans la tradition quan ho à travers une chanson d'accueil, chantée par les femmes qui invitent leurs confrères à les chiquer :
Mes deux mains portent la boîte à chiques de bétel,
J'invite d'abord les amis du quan ho puis tout le monde.
Nous sommes des filles du pont Lim,
Nous sommes allées à Hà nôi pour ramener nos amants,
(...)
Les jeunes gens à côté de jolies filles,
Garçons talentueux et jolies filles chantent
tumultueusement.
Le treizième jour du premier mois, on vient s'amuser à la
fête de Lim,
Bien que joyeux, ce n'est pas comme si nous étions
ensemble (entre amis quan ho) 1.
La chanson suivante est chantée par les hommes, lors de l'accueil de leurs amies chez un particulier :
Ce n'est pas tous les jours qu'on nous rend visite,
J'allume le feu, je prépare le thé pour les invité(e)s.
Ce thé, vous le savez, est très bon;
Prenez-en pour me faire plaisir.
J'aimerais que la rivière soit desséchée pour que la
route continue,
Je pourrais ainsi la prendre sans avoir à payer la
traversée.
(...)
La lune éclaire même le jardin de pêchers;
Y en a-t-il pas là une parmi vous qui soit encore libre ?
Pour que je prépare la chambre nuptiale ?
La nuit ne dure que l'espace d'un quartier de lune 2.
Les chants quan ho s'inspirent pour la plupart de l'amour. Filles comme garçons, on n'hésite pas à faire comprendre à l'autre ses sentiments. La chanson qui suit exprime le sentiment de la fille amoureuse :
Je suis allée partout,
Personne n'est aussi poli que les gens d'ici.
Je rencontre quelqu'un aux joues roses,
Aux dents noires bien brillantes, aux cheveux onduleux.
Hier j'étais occupée,
J'étais tourmentée, je croyais que les amis quan ho
pensaient à moi.
J'entendis les sons d'une cloche en cuivre dans l'après-
midi,
Je vis tourner une hirondelle-messagère.
De qui suis-je amoureuse pour attendre avec ce tourment ? 1.
Une chanson qui exprime la tristesse d'une fille qui apprend que son ami (uni à elle par le lien du kêt nghia) se marie :
J'ai pourtant promis devant les eaux et les monts,
Je me presse de finir la bobine de fil à tisser puis
celle de soie.
Quand on file la soie on retient la bobine,
Le temps de filer est le temps d'attendre.
On "joue" à en faire casser les galets par les oeufs,
On joue à en faire déborder les océans dans les forêts.
Tu es comme une fleur sur une branche,
Je suis comme un papillon qui tourne autour de la fleur.
Maintenant que tu te maries avec elle,
Je sens comme un couteau qui fend mon coeur en dix
morceaux 1.
L'inversion des schémas et le défi aux lois de la nature sont encore plus explicites dans le poème suivant, chanté par les nghê nhân de Hoài-thi 2 :
On joue à en faire gronder les tonnerres, à en faire
tomber la pluie,
On joue à en recoller le miroir cassé en trois morceaux.
On joue à en faire entendre le ciel,
On joue à en faire tomber les feuilles dans le temple du
roi des Ngô (Chinois). (...)
On joue jusqu'à tant que l'océan se transforme en une mare.
On joue à en faire passer cent montagnes à travers le trou d'une aiguille.
On joue jusqu'à ce que les bulles d'air restent au fond de l'eau,
Et que flotte le bois de Lim 3.
On joue à en faire pondre les anguilles 4 au sommet de l'arbre,
Quand les merles pondront leurs oeufs dans l'eau 5 alors
je t'épouserai.
A Bac-ninh même, il existe une autre chanson où le terme choi est remplacé par celui de hat (chanter), néanmoins l'intensité reste la même :
On chante à en faire trembler la terre et le ciel,
On chante pour être reconnu par les autres.
On chante depuis le village,
A travers les provinces du Nord jusqu'aux provinces de l'Est.
On chante à en assécher la rivière,
A en faire exploser la montagne, à en rendre le coeur
passionné 1.
Arrive le moment de la séparation, les ami(e)s quan ho chantent encore les dernières chansons pour exprimer les sentiments que vont provoquer la séparation et l'absence. Ce chant d'adieu est chanté par les femmes :
Je reste ici pour te regarder partir.
Que j'aimerais que tu me laisses un mouchoir rouge 2.
J'aimerais que tu restes ici
Ou que j'aille là-bas (avec toi), pour qu'on soit unis
comme l'arbre qui retrouve ses branches.
Le printemps arrive même au pied du jardin de
citronniers,
Je voudrais cueillir les fleurs mais j'ai peur des épines
qui sont sur les branches 3.
Je grimpe sur le mont éternel,
Et je vois deux hirondelles qui mangent une mangue sur
l'Océan de l'Est.
Je traverse la rivière 1 les épaules chargées,
Je transpire et le vent fait battre mon coeur 2.
Un autre chant d'adieu chanté également par les femmes, est connu actuellement de tout Vietnamien. Ce chant est devenu célèbre, entre autres, grâce aux chanteurs modernes qui l'ont adopté puis popularisé :
(...)
Mon bien-aimé 3, reste, ne rentre pas !
Si tu rentres je te recommande ceci :
Ne traverse pas à la nage si la rivière est profonde,
Ne prends pas la pirogue si elle est bondée.
Mon bien-aimé, reste, ne rentre pas !
Si tu rentres je te recommande ceci :
Si tu m'aimes alors ne fréquente personne.
Reste, ne rentre pas !
Si tu rentres je te recommande ceci :
Garde ton sous-vêtement et laisse-moi ta chemise en gage.
Mon bien-aimé, reste, ne rentre pas !
Si tu rentres je te recommande ceci :
Si tu trouves mieux que moi, alors marie-toi,
Mais ne vaudrait-il pas mieux m'attendre ?
Mon bien-aimé, reste, ne rentre pas 4!
Sur ces quelques chansons du répertoire quan ho, plusieurs remarques s'imposent. En premier lieu, le quan ho comme mode d'expression reflète gracieusement l'univers émotionnel et sentimental de l'individu qui retrouve dans ce cadre la liberté refoulée dans la vie quotidienne. L'amour est abordé sans détour tout en gardant le côté poétique du langage imagé. Dans ce duo d'amour, le rôle des filles et celui des garçons sont entièrement interchangeables. On sort ainsi du schéma habituel qui fait de la femme une figure passive vis-à-vis de l'homme qui propose. Dans une des chansons transcrites ci-dessus, les représentations de l'homme et de la femme sont complètement inversées : l'homme est comparée à une fleur immobile, et la femme, à un papillon qui symbolise l'action. Nulle part ailleurs, aussi bien dans la littérature classique que dans la littérature moderne des années 1930 dont nous avons parlé dans un chapitre précédent, on n'est allé aussi loin. Cet état d'esprit n'a été rendu possible que grâce à la culture quan ho qui place l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Par ailleurs, les paroles d'amour dans les répliques que les uns et les autres se renvoient sont comparées, certes l'image est beaucoup moins poétique, à des cordelettes d'une même corde "serrées" (xoan) les unes contre les autres et qui ne laissent aucun vide entre elles. Ce qui signifie aussi que le duo d'amour occupe tout l'espace relationnel situé dans son champ et dissuade toute tentative d'intégration d'une tierce personne dans ce champ. A un autre niveau, cette forme d'expression donne au quan ho une existence propre, solidement préparée pour affronter le monde extérieur. A écouter les paroles de certaines chansons telles que "on chante à en faire trembler la terre et le ciel", " on chante à en faire gronder les tonnerres, à en faire tomber la pluie", "on joue jusqu'à ce que les bulles d'air restent au fond de l'eau, et que flotte le bois de lim", etc., on dirait que le quan ho défie même les lois de la nature, et par là il abolit les barrières sociales. Même le ciel, qui est une représentation sacrée dans la vie ordinaire, n'échappe à son interpellation. Cependant on remarque que cette liberté, si ravageuse soit-elle à l'égard des conventions sociales, se heurte à une limite infranchissable : la question du mariage, explicitée entre autres, par le vers "Quand les merles pondront leurs oeufs dans l'eau, alors je t'épouserai", autrement dit jamais, à moins que les lois de la nature finissent un jour par s'inverser. Il est significatif à cet égard que cette limite soit à la fois respectée sur le plan formel (interdiction du mariage entre les garçons et les filles unis par le lien du kêt nghia qui caractérise le quan ho), et sur le plan de l'expression artistique. D'où pouvait venir cette interdiction ? De qui ou de quelle classes sociale émanait-elle ? Pourquoi les filles et les garçons du quan ho, qui avaient tout pour se plaire mutuellement, devaient-ils consentir à se soumettre à cette loi ? Pourquoi l'interdiction tombait-elle juste sur la chose la plus sensible de cette tradition ? Pourquoi les corporations du ca trù formaient-elles une classe à part de la société ? Pourquoi les descendants des cô dâu et des musiciens étaient-ils interdits aux concours littéraires ?
En ce qui concerne les deux dernières questions, la réponse est à chercher du côté des classes dirigeantes, les tenants du pouvoir, eux seuls pouvaient interdire aux autres de passer les concours. Sans doute au nom de la morale et du puritanisme. Mais les normes de conduite individuelle qu'imposait le pouvoir central aux gouvernés, il se gardait bien de se les appliquer à lui-même. Ici comme ailleurs, ce sont toujours les faibles qui doivent payer et se soumettre à la loi du plus fort : deux poids, deux mesures. Les cô dâu pouvaient-elles exister sans la participation et la complicité des lettrés et des mandarins qui étaient d'ailleurs les clients les plus passionnés ? D'un autre côté, les dirigeants, à commencer par les monarques ne rataient aucune occasion de s'amuser en compagnie de ces filles maudites. Quoi qu'il en soit, si les autorités, qu'elles soient politiques, religieuses, morales ou autres, doivent recourir à l'arme du pouvoir pour interdire telle ou telle pratique sociale de cette nature, c'est parce qu'au fond elles sont désarmées face à celle-ci : c'est un signe de faiblesse en fait. Le véritable religieux (si l'on s'inscrit dans cette perspective du spirituel) doit pouvoir défier toute séduction venant de la part de la femme, et non se sauver à toutes jambes en voyant une figure féminine, qu'on cherche à diaboliser. Si beaucoup de religieux redoutent tant les femmes ou du moins le contact avec elles, c'est parce qu'ils cherchent à nier leur faiblesse intérieure en inventant les pires calomnies pour les culpabiliser. Peut-on fonder une morale sur cette attitude hypocrite devant la vie ? Quelle est la finalité de cette morale si ce n'est celle d'une arme servant aux tenants du pouvoir pour réprimer ce qui vient du tréfonds de l'individu, afin d'asseoir leur position de dominants?
Il est vraisemblable que le quan ho ait subi la même répression. L'interdiction du mariage entre filles et garçons liés par le kêt nghia ne pouvait être que la marque de la foudre confucéenne des classes dirigeantes qui était tombée sur cette tradition. Car on ne voit pas pourquoi, à l'origine, les pratiquants du quan ho se seraient inventé cet interdit pour se faire violence à eux-mêmes. Cette hypothèse ne peut qu'être renforcée eu égard aux autres traditions similaires des minorités ethniques du Vietnam dont la culture n'était pas entachée de la marque confucéenne. Les différentes formes de chant alterné chez ces peuples, les fêtes et les divertissements divers conduisent naturellement aux rapprochements des jeunes des deux sexes, qui peuvent aller jusqu'au mariage s'ils s'estiment. Cela ne veut pas dire pour autant que les conventions sociales n'existent pas chez ces peuples, au contraire elles existent bien mais n'ont pas les mêmes attributs. La volonté des classes dirigeantes d'imprimer leur marque de pouvoir sur la société est une constante de la culture dominante. Cette violence faite à la liberté individuelle, ce terrible viol des sentiments d'autrui avaient pour but de niveler les particularités hors-normes afin de les faire entrer dans le moule culturel des classes dirigeantes. Cette homogénéisation des traditions populaires faisait apparaître de facto la reconnaissance formelle de la culture dominante comme seul référent possible. En ce qui concerne le quan ho, la tradition pouvait-elle s'opposer à l'ordre venant d'en-haut ? Compte tenu de la mentalité paysanne, et de l'histoire de la paysannerie, l'affrontement direct n'était jamais considéré comme le meilleur moyen pour faire reculer l'emprise des autorités centrales en cas de conflit avec celles-ci. En effet, les paysans cherchaient plutôt, soit à contourner les problèmes, soit à trouver une solution de compromis. Par contre, si le contexte le permettait et si leurs intérêts étaient pris en compte, alors ils se joignaient aux révoltes déjà nées pour leur apporter le soutien nécessaire. Bref, les paysans avaient besoin d'un leader qui pût canaliser leurs mécontentements; et ce leader ne pouvait être qu'un lettré ou un mandarin en conflit ouvert avec le pouvoir central. Le soutien dont bénéficia Dê Tham de la part des villageois gagnés à sa cause au début du siècle, illustre ce cas de figure. Les paysans mécontents de leurs notables s'appuyaient sur lui et faisaient bloc contre les autorités locales servant de relais au pouvoir colonial. Il existe bien d'autres procédés que les paysans utilisent pour faire échec aux autorités centrales sans passer par l'affrontement direct. Plus près de nous, avant le VIe congrès du PCV en décembre 1986, point de départ du Dôi moi (le Renouveau), beaucoup de villages du Nord, qui s'estimaient spoliés par la multitude de taxes agricoles versées à l'Etat, ont fini par rendre les terres cultivables aux coopératives en disant qu'ils ne pouvaient plus supporter les charges. Cette révolte douce mais radicale a néanmoins contraint les dirigeants à mettre en place la nouvelle politique agricole 1, plus connue sous le nom de khoan 2, qui consistait à rendre aux paysans une certaine liberté dans la vie agricole en attribuant à chaque famille paysanne un lopin de terre. L'Etat continuait à prélever des taxes, cependant les paysans étaient libres de faire du surplus de production. A l'heure actuelle, les coopératives sont réduites à leur plus simple expression.
La forme du quan ho qui survit jusqu'à nos jours serait le résultat de ce compromis entre gouvernants et gouvernés, compromis de taille, car il ne s'agissait pas de n'importe quel interdit mais de celui du mariage, processus de socialisation sur lequel repose la famille qui est gardienne de la tradition. D'un côté, on laissait vivre la tradition tout en interdisant les pratiques jugées immorales, de l'autre on se résignait à se soumettre à la censure morale décrétée par le pouvoir en place pour permettre à la tradition de survivre. Ce compromis se reflète à un autre niveau à l'intérieur même de la tradition du quan ho par une certaine "confusion" volontairement maintenue entre l'amitié et l'amour. On ne peut se marier avec l'amie avec qui on partage les sentiments et l'estime réciproque, par contre elle bénéficie d'un statut particulier par rapport à la conjointe qui doit s'effacer devant elle lors des rencontres ou des visites à domicile. Tout compte fait, l'amour et les sentiments venant du tréfonds de l'individu ne peuvent se réaliser qu'en dehors du cadre de la famille, tandis que le mariage constitue le cadre formel des conventions sociales. La sauvegarde d'une certaine liberté d'expression par laquelle l'individu se réalise, ne serait-ce que le temps d'une fête, se mesure à ce prix.
Sur un autre registre, force est de constater que l'évolution du ca trù et celle du quan ho à l'époque coloniale n'ont pas suivi la même trajectoire. Le premier, en cherchant à s'implanter dans les centres urbains a fini par se vider de son essence pour devenir une simple distraction pour ceux qui étaient à la recherche du plaisir. Cette évolution était-elle inévitable ? A regarder de près les poèmes laissés par les lettrés d'antan, la marque du plaisir était déjà bien imprimée dans la tradition du ca trù. L'allusion qu'a faite Duong Khuê dans le poème intitulé Cai dai (La bêtise), à travers des termes évocateurs tels que "On s'amuse, la barbe en bataille, l'oeil égaré, la ceinture défaite", etc., témoigne bien du libertinage dans les moeurs mandarinales. De l'autre côté, le quan ho qui ne dépassait pas les limites du village a survécu tant bien que mal sans perdre son âme. Mais on pourrait dire également que c'est grâce à son ancrage solide en milieu villageois, et uniquement dans ce milieu, que le quan ho a pu survivre. Par ailleurs, les chansons quan ho, pour dévastatrices qu'elles fussent à l'égard des conventions sociales, affichaient toujours une certaine retenue et une certaine pudeur, car l'expression des sentiments demeurait et de loin la principale préoccupation des nghê nhân. Cependant les choses sont dites d'une manière à la fois poétique et feutrée. Le langage direct, brusque et brutal n'a pas de place dans le quan ho. La façon d'exprimer l'amour est d'autant plus délicate que les chansons constituaient la seule voie permettant à l'individu de transcender l'interdit, c'est ce que Georges Boudarel appelle "sublimation artistique" 1. On a pu constater par ailleurs que la modernité aussi bien matérielle qu'idéelle ne franchissait les frontières du village qu'à de rares exceptions. En d'autres termes la culture villageoise était en quelque sorte à l'abri des effets de la modernité, qu'ils fussent bénéfiques ou dévastateurs. Bien que les statistiques sur le suicide ne fournissent pas de précisions sur les proportions des suicidés d'origine paysanne, tout nous incite à supposer que ce phénomène était une manifestation propre à la vie urbaine où l'individu était déchiré entre le respect des conventions sociales et l'épanouissement personnel. Du moment où les structures sociales étaient mises en cause par la jeune génération gagnée aux idées modernes, l'individu en profitait pour se libérer de son cadre traditionnel. Mais la quête de la liberté est toujours une longue épreuve dont le résultat n'est jamais connu à l'avance. Le suicide illustre alors la perte de contrôle de la société sur les individus en lutte pour leur existence. La vie paysanne avec toutes ses pratiques anachroniques et ses "coutumes pourries", "monstrueuses" qu'on connaît et qu'on déplore, et dont parlaient Ngô Tât Tô et les journaux Phong hoa et Ngày nay, possède en soi ses propres défenses. Le paysan, en qui l'individu est refoulé en temps normal, trouve néanmoins des occasions, comme l'espace d'une fête, lui permettant d'affirmer qu'il existe quelque part comme individu. Indépendamment du sens ou de la valeur qu'on peut attribuer à la notion d'individu, celui-ci trouve un terrain plus favorable à son existence et à son épanouissement, avec certes des restrictions, dans la vie villageoise que dans la vie urbaine du contexte colonial. A une autre échelle, l'individu a plus de chance d'exister en milieu populaire que dans le milieu des classes dirigeantes. Si on admet, d'une part, que le quan ho dans sa forme actuelle est un vestige d'une tradition plus ancienne, au temps où l'interdit moral n'avait pas encore rétréci son champ d'action, et d'autre part, que la libre expression des sentiments, et le plaisir, forment deux composantes de l'individu, il est difficile de nier l'existence de l'individu dans ce contexte. Sur ces bases, on peut dire que le ca trù aussi, a contribué à l'affirmation de l'individu. A cet égard, l'ethnologue Nguyên Tu Chi n'a pas tout à fait tort de suggérer que chez certains lettrés, à travers leurs poèmes, notamment ceux de Cao Ba Quat et de Nguyên Công Tru, l'individu est une réalité sociale 1. En effet, Nguyên Tu Chi fait allusion aux deux vers de Nguyên Công Tru : "J'aimerais ne pas être un homme dans ma prochaine vie, mais un pin qui siffle en plein ciel" (kiêp sau xin cho làm nguoi, làm cây thông dung giua troi mà reo), et à un vers de Cao Ba Quat : "Cet univers commun en fait n'appartient éternellement qu'à moi" (Khu troi chung mà vô tân cua minh riêng). A regarder de plus près on s'aperçoit que ces deux figures littéraires étaient des lettrés hors normes : le premier, mandarin de haut rang, a été rétrogradé plusieurs fois pour n'avoir pas appliqué les décisions venant d'en-haut, et a fini par se réfugier dans son village natal comme simple paysan, dans une retraite où il passait la plupart de son temps en compagnie des cô dâu; le deuxième, plusieurs fois recalé aux concours à cause de son orgueil et de son mépris pour les règles conventionnelles des concours littéraires, a fini par renoncer à la carrière mandarinale, non sans indignation. Dans cette perspective, l'individu ne pouvait exister dans la culture des lettrés qu'au prix de la rupture avec le milieu d'origine, faisant de lui un marginal. On retombe alors sur la notion d'"individu-hors-du monde" en opposition avec la société dont parlait Louis Dumont. Quant à ce qui concerne l'expression des sentiments, le ca trù était aux lettrés ce que le quan ho était aux paysans. C'était avec les cô dâu et non pas avec leurs épouses que les lettrés réalisaient leur vie émotionnelle et sentimentale. Là aussi, les sentiments et le plaisir ne pouvaient s'épanouir qu'en dehors de la sphère familiale qui représente dans la culture des classes dominantes l'unité même de la société. A cet égard, les cô dâu avaient, à quelques détails près, le même rôle que les geishas dans la société japonaise traditionnelle 1. En effet, les unes et les autres étaient à la fois, artistes, confidentes, maîtresses, voire conseillères écoutées. Cette situation de fait n'a été rendue possible que par la vision misogyne des classes dirigeantes, qui faisaient de la femme une figure accessoire écartée de toute institution représentative de la société. Du moment où seuls les hommes avaient accès à l'enseignement traditionnel, unique voie menant aux carrières mandarinales sur lesquelles reposait le pouvoir, et où les femmes, entre autres les épouses des classes dirigeantes (mandarins et lettrés), étaient cantonnées aux tâches ménagères ou aux activités économiques (agriculture, artisanat, petit commerce principalement), pour subvenir aux besoins matériels du foyer conjugal, le fossé qui se creusait entre les époux sur le plan culturel apparaît alors comme une simple conséquence directe de cette dichotomie sociale. D'un autre côté, comme le mariage dans les classes dirigeantes n'était pas fondé sur l'amour mais constituait une affaire de famille, un devoir de l'enfant envers les parents qui choisissaient leur bru ou leur gendre en fonction des critères sociaux (môn dang hô dôi), comment dans ces conditions les sentiments pouvaient-ils exister sans être refoulés? Par ailleurs, comme les cô dâu constituaient une exception à la règle par leurs connaissances des caractères chinois, les lettrés trouvaient naturellement plus d'affinités avec elles qu'avec leurs épouses. Dans ce contexte, le rapprochement de deux milieux, lettrés et cô dâu, dicté par le désir de communiquer, de partager les mêmes émotions et les mêmes sensibilités littéraires, s'inscrivait inévitablement dans la logique des choses. Quand on voit la place qu'occupe la dimension communication dans l'amour des temps modernes, on ne s'étonne plus que les relations sentimentales entre lettrés et cô dâu aient été fréquentes, car celles-ci leur permettaient de se réaliser à la fois sur le plan sentimental et émotionnel d'une part, et sur le plan littéraire, cette réalisation de soi étant le facteur valorisant qui contribuait à faire des lettrés des individus "libres" vis-à-vis de la société. A cet égard, les lettrés n'échappaient pas toutefois à la règle qui séparait l'amour de la vie conjugale, l'un relevant de la sphère privée et l'autre constituant l'étoffe de la vie publique.
Dans ces conditions, peut-on reprocher aux lettrés leur libertinage sans remettre en cause les structures sociales rigides qui étouffaient l'individu ? Si l'on pose cette question cela revient à accorder une certaine valeur à la notion d'individu. Mais quelle valeur faut-il lui attribuer ? Une société qui écrase l'individu est-elle digne de l'espèce humaine dotée d'inestimables capacités de réalisation ? A l'inverse, sur quelles bases peut-on fonder une société dans laquelle l'individu passe avant toute autre considération ? Ces questions sont d'autant plus complexes que la notion d'individu est indissociable de celle de la liberté. Que recouvre donc cette dernière ? S'agit-il de la liberté d'entreprendre ou de la liberté de penser ? La liberté comme zone protectrice dans laquelle l'individu agit ou comme stade suprême qui délivre l'individu de toute dépendance, soit-elle politique ou morale, religieuse ou affective ? La liberté pour quoi faire et au nom de quoi ? La liberté est-elle un simple jeu d'esprit ? Par ailleurs, le problème de liberté ne se pose que quand l'être humain se trouve face à d'autres et sur le même terrain. Autrement dit, penser la liberté revient à penser l'organisation sociale dans laquelle l'individu est à la fois juge et partie prenante. La société humaine devient ainsi le reflet de la dynamique impulsée par l'individu qui, à la recherche de la liberté, se trouve en confrontation permanente avec les règles et les lois qui régissent cette même société. Que l'individu gagne, la société s'écroulera sous le poids de ses propres individus; que la société gagne, l'individu deviendra un simple rouage organique à la merci de sa propre société. La solution à cette contradiction déterminera le type de société. On retombe ainsi sur le champ politique qui dépasse le cadre de ce travail.
Par ailleurs, la modernité peut-elle influer sur ces rapports contradictoires entre l'individu et sa société ? Si elle a permis à l'individu de mieux s'affirmer elle ne diminue pas pour autant les risques de voir une société érigée en une structure aliénante et répressive. Ainsi, la question de l'individu, donc celle de la liberté, relève de sa propre dialectique indépendante du débat opposant tradition à modernité.
Encore faudrait-il savoir si l'on accepte de s'inscrire dans un antagonisme tradition-modernité. Car d'après Georges Balandier, "toute société porte en elle des potentialités alternatives", elle possède sa propre dynamique pour se mouvoir en modernité, si les circonstances l'exigent; et d'autre part, la modernité a sa propre tradition, celle du changement perpétuel.
A la croisée de ces deux antagonismes, individu-société et tradition-modernité, on peut donc s'apercevoir, à travers le quan ho, que l'individu dans la société villageoise vietnamienne, n'a pas attendu l'ère de la modernité pour affirmer son existence, certes avec les limites qu'on connaît. D'un autre côté, que la vie moderne des centres urbains a favorisé l'émergence de l'individu, perceptible à travers la presse, la littérature, la poésie, le théâtre. Mais que l'individu sorti de ce contexte n'a pu résister à l'épreuve du temps, et d'une société qui face à lui ne renonçait pas complètement à ses anciennes exigences, le suicide comme phénomène social venant illustrer cette faiblesse de l'individu livré à lui-même, l'impossibilité pour l'individu d'exister sans ancrage dans la société dont il est membre.
Au terme de ce travail, bien que la question de l'individu et sa nature dans le contexte de la société vietnamienne nécessitent d'autres investigations plus approfondies, notamment des études sur d'autres traditions populaires qui impliqueraient une approche pluridisciplinaire, et dans l'attente du résultat de ces travaux, nous admettons provisoirement que le Vietnamien en tant qu'individu, toutes traditions confondues, a bien laissé des traces de son existence, sous une forme ou sous une autre. Que ces traces soient trop fragmentaires et incomplètes pour autoriser la reconstitution de son existence, nous en convenons. D'ailleurs, nous n'avions pas pour but d'élucider cette question jusqu'à son épuisement. Ce travail s'inscrit uniquement dans le cadre d'une contribution à l'étude de l'individu dans la société vietnamienne de l'époque coloniale. Enfin, nous formulons de même notre voeu de voir un jour cette question aller jusqu'à son terme, car il y va de la liberté d'un peuple, et dans une certaine mesure elle pourrait contribuer à dessiner l'avenir d'une société.
CONCLUSION
Faire de l'histoire relève souvent d'une véritable activité acrobatique. Les outils si élaborés soient-ils et les méthodes si pertinentes soient-elles ne suffisent ni les uns ni les autres à accréditer un travail. L'itinéraire personnel et l'évolution sur le plan de l'esprit de celui qui étudie l'histoire sont difficilement dissociables d'une entreprise de cette nature. Cela ne revient-il pas à reconnaître que toute histoire est entachée de subjectivité malgré la meilleure volonté du monde d'objectiver les connaissances ? On retombe encore sur le vieux débat opposant le renouveau du scientisme au "soupçon". D'ailleurs il est plus facile de décrire un coucher de soleil qu'une activité humaine, et encore plus difficile de porter un jugement sur la seconde que sur le premier.
Si on devait attribuer une valeur à l'histoire, quand elle y parvient, ce serait sa capacité de reconstituer la vérité dans son ensemble et dans son contexte. Que cette vérité déplaise à certains, cela va de soi. D'ailleurs la vérité est toujours blessante quand on veut la fuir. La dignité de l'homme et sa grandeur, voire celles de la société tout entière, se mesurent à leur capacité de surmonter cette épreuve douloureuse. Douloureuse à tel point que le spectacle auquel se livre à nos yeux la politique politicienne consiste la plupart du temps à se détourner de cette réalité pour se réfugier derrière des discours détournés de leur objet.
Si l'histoire a un sens, dans quelle mesure peut-on conférer des lettres de noblesse à ceux qui font l'histoire ? Etant donné qu'elle représente toujours l'oeuvre des plus forts, quelles que soient l'époque et les frontières spatiales. A l'heure où l'on célèbre le cinq centième anniversaire de la "découverte" de l'Amérique, on peut se demander si le vocable "découverte", avec tout ce qu'il recouvre et ce qu'il véhicule comme représentations, a un sens, du moment où les Amérindiens sont arrivés et se sont installés sur cette terre bien avant le héros Colomb. On peut se demander également s'ils parviendront un jour à se faire admettre comme des êtres humains à part entière comme les autres. Il ne s'agit pas uniquement d'une querelle sur l'authenticité d'un fait historique mais, bien plus grave, de l'appropriation et de la récupération de l'histoire par les plus forts devenus maîtres, de l'effacement de la mémoire collective avec tout ce qu'elle comporte. En fait, d'où viennent-ils ces sous-hommes ? Dans L'Atlas du monde, édité en 1990 par le groupe Sélection du Reader's Digest, si les auteurs ont bien consacré un chapitre aux migrations des peuples à travers l'histoire, est-ce par oubli qu'on tait celles des Amérindiens ? Ce silence est révélateur d'une situation embarrassante par laquelle les uns sont parvenus à la position dominante et les autres ont été acculés à la soumission totale. Ce silence est de la même nature que celui des trois magistrats chargés de l'affaire Touvier, qui ont envoyé paître les journalistes venus leur poser des questions, après le non-lieu concernant le chef de milice lyonnais aux ordres de la Gestapo. Peut-on dormir la conscience tranquille quand ce genre de silence prend toute sa signification ? On constate par ailleurs, - et avec quelle stupéfaction - , que de tout temps l'Eglise a protégé, et continue à protéger, ses Archives plus religieusement que ses reliques, et qu'elle est prête à déployer les moyens nécessaires pour faire échec à quiconque tente de fouiller dans sa mémoire. Quand on a si peur de dévoiler son passé qu'on l'habille avec le silence de la mort, que peuvent valoir les bonnes paroles de circonstance ? L'histoire a ainsi des silences dont elle a honte. En d'autres termes, Jean Chesneaux dirait que "L'occultation du passé est un procédé favori du pouvoir" 1. En effet, cette volonté de réécrire l'histoire, qui est d'ailleurs l'une des diverses manifestations possibles de cette "occultation du passé", n'est pas propre à une société donnée, car elle se généralise à travers l'espace et le temps, à l'échelle de la planète même. On s'aperçoit ainsi que la modernité a ses propres limites car elle se heurte aux frontières du silence. En dépit de ses forces tant innovatrices que dévastatrices, le monde moderne n'a pas pu révolutionner cet aspect. En d'autres termes et sur cette question précise, la modernité, si louangée qu'elle soit, fait-elle autre chose que se conformer à une tradition, celle de maintenir le silence autour des questions gênantes, tradition qui, bien vivante dans toutes les sociétés humaines, traverse toutes les frontières temporelles ? On sait aussi par ailleurs que certaines choses ne seront jamais dites ni écrites, et que l'histoire doit se débrouiller avec cela.
A cet égard, qu'y avait-il au fond de véritablement moderne dans l'entreprise de la colonisation à part la modernisation matérielle et quelques idées "généreuses" affichées ? La colonisation, sous un masque civilisateur, ne suivait-elle pas la logique éternelle dictée par la soif de dominer, sentiment qui existe chez tous les peuples et de tout temps? La tradition à vocation dominatrice suppose par ailleurs l'occultation des buts non avoués (enterrés sous le silence) au profit de la mythification des idées pacifiques. Cet écart entre les buts non avoués et les buts avoués détermine le fossé qui sépare la réalité vivante de la vérité à chercher. Plus l'écart est grand, plus la vérité est difficle à rétablir. Aussi, l'histoire n'est-elle pas un fleuve dont les méandres suivent le cours du silence ? Tradition et modernité ne sont-elles pas synonymes à certains égards ?
L'envers de la médaille, qui constitue une autre réalité de l'histoire, est ainsi renvoyé aux oubliettes au fur et à mesure que le temps passe. La grandeur d'une nation ne se mesure-t-elle pas aussi aux événements tragiques qui ont entraîné les opprimés vers un destin funèbre ? La splendeur des grands ouvrages monumentaux ne se mesure-t-elle pas à la misère, à l'effroyable aliénation de ceux qui les ont bâtis avec leur force de travail ? Qui étaient-ils ces oubliés de l'histoire ? Des rois sans doute ?
Force est de constater par ailleurs que l'histoire moderne de quelque société que ce soit, est toujours dominée par ses tendances rétrogrades et non par ce qu'elle a de meilleur. L'espèce humaine est-elle condamnée à vivre avec cette maladie qui paralyse une bonne partie de son corps sans espoir de trouver un jour un remède quelconque ? Ceux qui sont nourris de complaisance, diraient sans doute : "Après la pluie, le beau temps" pour ménager la pluie en attendant le beau temps. Mais seul naturellement le seigneur dans son château doré peut se permettre d'attendre la fin des pluies. Les pauvres paysans démunis pourraient-ils attendre dans la misère avec une tranquillité religieuse le retour du beau temps promis ou prévu? Quand l'urgence est renvoyée aux calendes grecques, on peut être certain que ce renvoi ne profite qu'aux privilégiés, et les autres peuvent fêter leur défaite dans l'attente du "beau temps".
Avant de fermer cette parenthèse pour revenir à la réalité non moins amère d'ailleurs, on peut souligner également le courage et la dignité de tous ceux et toutes celles qui se sont rangés sans complaisance du côté de la raison humaine, et qui ont donné de leur vie dans le combat contre les aberrations de l'histoire, contre les frontières qui séparent les hommes, et contre les injustices, pour rendre à l'humanité la place qui lui revient. A cet égard, on ne peut passer sous silence la contribution à ce combat d'innombrable individus, les anonymes dans l'ombre, dont l'histoire, pour ne pas changer, n'a pas retenu les noms.
Le Vietnam à cet égard représente un cas d'école. Que connaît-on sur l'élimination physique des trotskystes et des nationalistes par le Viêt minh, à part qu'ils sont considérés comme des traîtres et des ennemis de la révolution par leurs accusateurs ? On peut citer naturellement d'autres exemples de cette nature. Les manuels scolaires qui traitent cette époque observent un silence pieux sur cette face cachée de l'histoire du Vietnam.
Plus terre à terre, quel bilan peut-on tirer de la rencontre forcée de deux cultures pendant la période coloniale au Vietnam ? Ce bref rappel historique circonscrit dans le cadre des transformations sociales et culturelles permet néanmoins de dégager quelques repères.
Si cette rencontre a été forcée dans un premier temps, car tout a commencé par l'implantation du régime colonial qui, pour justifier sa présence et pour asseoir son emprise, s'érigeait en maître du territoire conquis en reproduisant certains schémas de production capitaliste (mise en place d'une infrastructure permettant l'exploitation des ressources, introduction de l'économie de marché, établissement du régime du salariat, mise sur pied d'une nouvelle administration et des moyens de contrôle, etc.), les effets produits ont quelque peu dépassé toute prévision, voire surpris autant les colonisateurs que les colonisés. On pourrait représenter les transformations sociales et culturelles nées de cette rencontre par trois phases successives, intercalées de deux dates décisives : 1907 et 1930.
* Phase de cohabitation douloureuse allant du début de la colonisation à 1907. C'est une phase de révélation pour la société vietnamienne qui, trop longtemps enfermée sur elle-même, se retrouvait décalée par rapport à la réalité. Face à l'entreprise colonisatrice et au discours colonisant qui désarment toute tentative de résistance, qu'elle soit politique ou morale, armée ou non violente, la société vietnamienne intériorisait par là même la prise de conscience de ses faiblesses inculquée par les nouveaux maîtres. D'un autre côté, les colonisateurs s'efforçaient de consolider leurs assises politiques, puis économiques et culturelles. Ils déployaient des moyens nécessaires pour soumettre les colonisés à leur volonté dominatrice, à défaut de se faire accepter, par une politique de neutralisation afin de les détourner progressivement du passé. L'enseignement, entre autres, était ainsi conçu pour répondre à cette idéologie, car le savoir servait à justifier le pouvoir.
* L'année 1907 marquait la fin de cette phase de cohabitation soldée par la défaite des lettrés, qui, animés par le patriotisme, s'étaient engagés dans la résistance. Plus significatif encore, 1907 bouleversa les données. La fraction progressiste de cette génération des lettrés, consciente de la voie sans issue prise par ses aînés, fit un examen du passé récent, examen qui déboucha sur une remise en question de l'héritage culturel. La rupture avec cette composante du passé apparut alors comme un préalable à une société moderne fondée sur de nouvelles bases. La création du Dông Kinh Nghia Thuc comme intrument modernisateur axé sur l'enseignement moderne, illustrait cette volonté de s'éloigner du passé. Plus concrètement, cette génération de lettrés se donnait en exemple en appellant la population à couper les cheveux longs enroulés en chignon, jadis symbole de la piété filiale et devenu métaphore de l'ignorance. Cette mobilisation et cette évolution sur le plan des esprits dissimulaient au fond la préparation d'un terrain culturel sur lequel s'appuierait le futur soulèvement contre les colonisateurs. On remarque au passage que ces lettrés et leurs partisans ont intégré les nouvelles valeurs venues de l'Occident pour s'armer contre le représentant de ce même Occident qui était la France colonisatrice. Cette entreprise n'a pas échappé au contrôle de celle-ci qui a réagi avec la détermination d'en découdre avec les subversifs. Les portes de l'école du Dông Kinh Nghia Thuc ont été fermées au bout de quelques mois d'existence, et les leaders arrêtés, puis neutralisés. Cette apparution-éclair d'un mouvement de pensée, si éphémère fût-elle, fixait néanmoins les bases et les conditions de tout soulèvement contre la présence coloniale : le combat contre celle-ci devrait se doubler d'un combat contre son propre passé culturel.
* 1907-1930 : la phase d'assimilation des idées venues de l'Occident. La jeune génération qui a grandi dans cette période se retrouvait dans un nouveau contexte où les anciennes valeurs, sous la pression de l'entreprise colonisatrice, ont petit à petit fini par céder le pas aux nouvelles. L'enseignement traditionnel a été définitivement supprimé et les lettrés de l'ancienne école se retrouvaient sur un nouveau terrain qui échappait à leur contrôle. La généralisation de l'emploi du quôc ngu, adopté à la fin du siècle dernier, se substituait aux caractères chinois, et le français comme langue véhiculaire dans les autres matières de l'enseignement franco-indigène faisait le reste. L'intelligentsia vietnamienne de cette époque se tourna ainsi vers l'Occident et s'efforça de s'y rendre afin de découvrir ses secrets. Si les sciences et les techniques ont quelque peu séduit certains, les autres y trouvèrent un terrain d'apprentissage de nouvelles formes de luttes basées sur l'analyse marxiste du développement capitaliste dont la colonisation n'était qu'une ramification. Sur le terrain de la colonisation, la majorité du peuple vietnamien constituée de paysans, vivait à l'écart de l'entreprise modernisatrice cantonnée dans les zones urbaines. Malgré des efforts consentis dans le domaine de la santé publique pour enrayer les épidémies, les villageois continuaient à ignorer les règles élémentaires de l'hygiène. Leur univers demeurait celui prescrit par les traditions, tant sur le plan des croyances que sur le plan des pratiques sociales, qu'elles fussent morales ou culturelles. Les notables chargés par l'Administration de veiller sur la bonne marche de la machine coloniale ne se contentaient pas d'appliquer les décisions prises, mais ils cherchaient par la même occasion à se faire une place en or afin de satisfaire leurs convoitises aux dépens de leurs administrés. Les excès de toute nature de leur part, sous couvert du pouvoir colonial, conjugués aux difficultés matérielles de survie ont conduit nombre de paysans, qui à l'émigration vers des régions lointaines pour grossir le contingent de la main-d'oeuvre bon marché en abandonnant leur terre natale pourtant sacrée, qui sur la voie de la prolétarisation, qui à la mendicité dans les centres urbains, et qui vers la prostitution pour assouvir la faim des jouisseurs. A cet égard, la modernité de la vie matérielle et culturelle qui commençait à porter des fruits dans les centres urbains ne parvenait à franchir les frontières qui la séparaient de la campagne qu'à de rares exceptions.
* 1930 renouait avec la tradition de résistance contre les forces envahisseuses. La tentative de soulèvement armé lancée par les nationalistes du parti VNQDD (Viêt Nam Quôc Dân Dang), sous la conduite de Nguyên Thai Hoc et de ses compagnons, la formation des soviets du Nghê Tinh suivie des révoltes paysannes sous l'impulsion du parti communiste fraîchement constitué, deux événements diamétralement opposés sur le plan idéologique, faisaient entendre cependant la même voix, celle du peuple exaspéré qui passait à l'action. Si les nationalistes ont été décimés par la répression à cause de leur coup de force prématuré, les communistes, plus prudents, préparaient le terrain de lutte en consolidant leur base sociale. Ils apparaissaient de fait comme révolutionnaires sur deux plans à la fois : rupture avec la tradition et rupture avec l'ordre colonial. Dans le contexte de ces années, entrer dans la clandestinité en tant que révolutionnaire impliquait inévitablement la rupture avec la famille, lieu de transmission des valeurs traditionnelles. En ce sens, les révolutionnaires étaient des modernes, cependant l'analyse du passé culturel ne constituait pas à leur yeux une urgence, ni une condition préalable à tout changement. Ce qui explique l'absence du débat sur la modernité dans leurs discours politiques, fussent-ils révolutionnaires.
* 1930-1939, la phase de remise en cause de la tradition et l'ébauche d'une société moderne. Etant donné que les révolutionnaires désertaient le terrain culturel, les réformistes ou d'une manière générale les progressistes de la nouvelle génération formée aux idées modernes de l'Occident s'en emparaient en reprenant les analyses des lettrés de la génération 1907. En effet, durant cette période, aux yeux des progressistes, la question nationale ne pouvait se régler qu'avec une transformation radicale de la société. Sur ce terrain, les journaux Phong hoa et Ngày nay s'imposaient de fait comme les porte-paroles de cette rénovation sociale en attaquant à la fois les valeurs anciennes léguées par le confucianisme, et les traditions populaires, les deux principales entraves à la marche du progrès. Malgré le fait que la plupart des rédacteurs de ces journaux apparaissaient comme nationalistes, leurs analyses ne laissaient sous-entendre aucun sentiment de haine ou de xénophobie à l'égard de l'étranger. Par contre, leurs critiques les plus virulentes étaient adressées aux structures sociales et familiales vietnamiennes, responsables de tous les retards.
Parallèlement à ces débats, la jeune génération émancipée et non engagée politiquement dans la clandestinité mettait en oeuvre une nouvelle vision du culturel. La poésie moderne, la littérature à tendance sociale, le théâtre devenaient les substituts de la littérature classique tombée en désuétude. Cet essor littéraire, certes circonscrit dans les milieux intellectuels modernes, débouchait sur la prise de conscience de l'existence de l'individu étouffée dans le passé. La femme, autrefois éclipsée, se réveilla pour accuser la tradition séculaire oppressive. Cette révélation faisait froid dans le dos à ceux qui arrivaient à la formuler et entraînait les autres vers le désespoir. Si les anciennes structures sociales et familiales n'ont pas succombé à cette épreuve de la modernité, elles étaient tout de même traversées par ses secousses. L'édifice tenait tant bien que mal sur ses fondations mais les dégâts n'étaient pas négligeables. La libération des moeurs s'accompagnait de la désintégration des foyers et de la multiplication des lieux de plaisirs, et la libération de l'individu, d'une vague de suicides dont l'ampleur dépassait ce qu'on avait connu jusqu'alors.
Faut-il attribuer ces effets à la modernité ou au contraire à la faiblesse de la tradition qui n'a pas pu résister aux temps modernes ? Une étude comparative avec d'autres sociétés à l'épreuve de la modernité permettrait de mieux appréhender cette question. Quoi qu'il en soit, une société qui ne laisse pas de place à l'individu pour s'exprimer finira par exploser le jour où celui-ci retrouvera sa liberté.
Annexe1
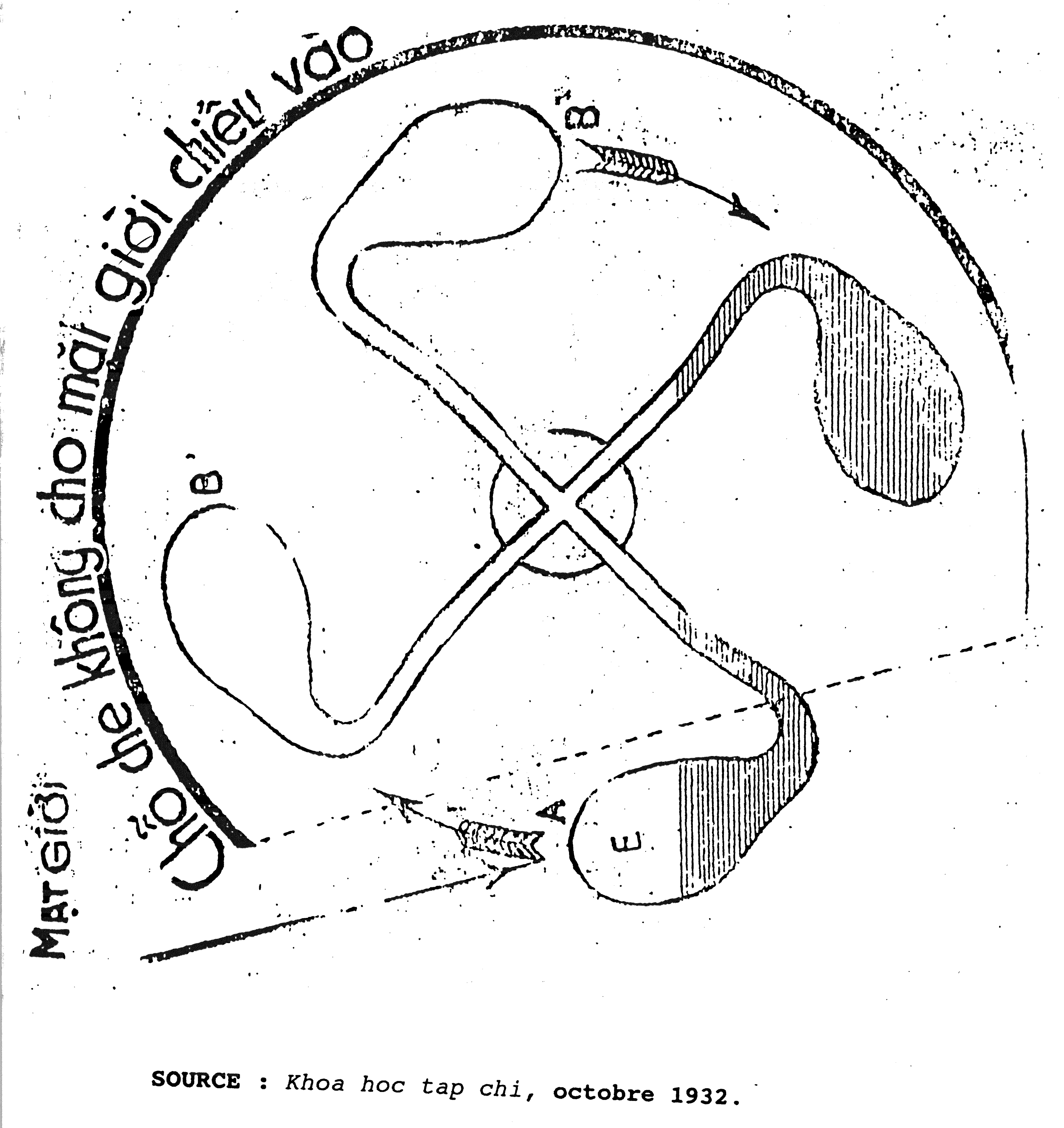
La turbine solaire
inventér par Nguyên Công Tiêu,
directeur de la revue Khoa hoc tap chi
ANNEXE 2.
Lettre du Ministre de la Guerre au Ministre des Colonies, au sujet du mariage mixte.
Paris, le 18 février 1917.
Le ministre de la Guerre
à Monsieur le Ministre des Colonies
Services militaires, 1er Bureau, 1ere Section.
J'ai l'honneur de vous adresser à titre de renseignement, une copie des instructions confidentielles adressées par Mr. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à tous les Parquets Généraus de France, d'Algérie et de Tunisie et du Maroc, dans le but d'enrayer, dans la mesure du possible, les mariages entre des femmes françaises et des indigènes de nos Colonies venus en France, comme tirailleurs ou travailleurs, pour coopérer à la Défense Nationale.
Je prends, en ce qui me concerne, toutes dispositions pour faire exercer une surveillance discrète sur les projets d'union de cette nature.
Jusqu'à ce jour, cinq ou six travailleurs indochinois m'ont été signalés comme ayant l'intention de se marier avec des femmes françaises, les mesures prises semblent ajourner définitivement ces projets de mariage./.
Pour le Ministre et P.O.
Le Général Directeur des Troupes Coloniales.
Signé : A. FAMIN.
P.C.C
L'Administrateur chargé du
Service de la Sûreté Générale
signature illisible.
SOURCE : AN - Hà nôi, Fonds Hà dông, D83 - 376.
ANNEXE 3.
Lettre confidentielle du Garde des Sceaux au Procureur Général, au sujet du mariage mixte.
Paris, le 2 février 1917.
CONFIDENTIELLE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
à Monsieur Le Procureur Général.
Il m'a été signalé que des projets de mariage auraient été formés entre des femmes françaises et des Indigènes de nos Colonies d'Afrique ou d'Extrême-Orient, venus en France, comme militaires ou ouvriers, pour coopérer à la Défense Nationale.
Soit qu'on se place au point de vue politique, soit qu'on envisage seulement l'intérêt particulier, de telles unions ne doivent pas être encouragées.
D'une part, en effet, pour des motifs sur lesquels je crois inutiles d'insister, elles ne peuvent que porter atteinte à notre prestige, dans les milieux indigènes et, d'autre part, elles sont de nature à causer à nos compatriotes les plus graves désillusions.
Dans nos possessions d'Outre-mer et notamment en Indochine, les mariages sont précoces et le nombre de célibataires âgés de dix huit ans est pratiquement des plus restreint. Tout indigène indochinois qui vient en France doit donc être présumé marié.
S'il contracte mariage avec une Française, celle-ci, dans la plupart des cas, ne peut être à ses yeux et aux yeux de ses compatriotes qu'une femme de second rang.
D'autre part, s'il est célibataire, la loi annamite lui permet, même après son mariage, d'introduire à son foyer une "femme de second rang" et même des concubines.
A Madagascar, dans la Nouvelle Calédonie, dans l'Afrique du Nord, dans l'Afrique Occidentale et au Maroc, la situation de la femme est également très inférieure à celle de la femme européenne de la plus basse condition.
Pour ces divers motifs, il importe de protéger, dans la mesure du possible, les compatriotes imprudentes ou trop crédules contre les dangers éventuels qu'elles ne soupçonnent pas.
Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien faire connaître la situation que je viens de vous exposer aux maires des communes de votre ressort où, par suite de la présence d'Indigènes militaires ou civils, des mariages mixtes pourraient être célébrés. Vous les inviterez à en faire part, le cas échéant, aux intéressées en appelant leur attention sur l'intérêt majeur qu'elles ont à être exactement renseignées sur la situation de leur futur.
Au cas où elles persisteraient dans leur dessein, le maire devrait exiger la production par l'indigène de toutes les pièces qui sont nécessaires en France, à la validation du mariage. Ces pièces devraient être légalisées par le Ministre des Colonies qui pourra ainsi recueillir des renseignements précis au vue de les faire communiquer à la future et à ses parents.
J'appelle votre attention sur le caractère confidentiel des présentes instructions. Il importe, pour éviter tout froissement chez nos protégés indigènes qu'elles ne reçoivent aucune publicité ; elles ne devront être communiquées aux maires qu'en cas de nécessité, si, dans leur commune il se trouve des militaires ou des travailleurs indochinois et en prenant toutes précautions utiles pour qu'elles ne soient pas divulguées./.
signé : René VIVIANT
Pour Ampliation,
Le Directeur des Affaires Civiles et du Sceau,
P.C.C.
L'Aministrateur chargé du
Service de la Sûreté Générale,
signature illisible.
SOURCE : AN - Hà nôi, Fonds Hà dông, D 83 - 376.
ANNEXE 4.
Réclamation de Vu Thi Giuong contre le remariage de son mari avec la fille du Tông dôc de Hà dông, adressée au Résident de Hà dông, mai 1924.
Hung yên, le 29 mai 1924.
Monsieur le Résident de France à Hà dông.
Monsieur le Résident,
Je soussignée Vu Th Giuong, femme du Docteur en médecine Joseph Nguyên Xuân Mai, domiciliée au village de Cao xa, canton de Ba dông, huyên de Phu cu, Hung yên, ai l'honneur de vous exposer ce qui suit:
En 1906 Mr. Nguyên Xuân Mai s'est marié avec moi, notre mariage a duré 18 ans. A la fin de 1923 Mr. Mai a introduit une instance contre moi devant le tribunal civil de Hà nôi en vue d'obtenir le divorce. J'ai chargé en cette occasion maître Berthelot de me représenter devant le tribunal, mais ce dernier de concert avec Mr. Mai ne défend aucunement ma cause. C'est pourquoi le Tribunal a prononcé le divorce à mes torts et griefs. Je suis donc victime d'une injustice.
Je vous serais, dans ces conditions, très reconnaissante de faire retarder le mariage de Mr. Mai avec Mademoiselle la fille du Tông dôc de Hà dông, ce qui me laisse le temps de faire appel du jugement prononçant notre divorce devant la Cour d'Appel.
Votre reconnaissante servante
Signé : Vu Thi Giuong
SOURCE : AN - Hà nôi, Fonds Hà dông, D 83 - 377.
ANNEXE 5.
Liste des maisons de tolérance avec le nombre de femmes dans chacune d'elles, Hà nôi, 1932.
NOMS DES PATRONNES ADRESSES NOMBRE
de FEMMES
Nguyên Thi Hai dite Nam 1, ruelle de Yên thai 4
Nguyên Thi Ba dite Yên 32, rlle Pavillons noirs 7
Nguyên Thi Truong 65, r. de la Citadelle 10
Trân Thi Hai 43, r. des Briques 15
Nguyên Thi Hai 2, rlle Tam thuong 10
Nguyên Thi Nguyêt Passage Sâm công 8
Nguyên Thi Long 5, r. Tour de la Citadelle 20
Nguyên Thi Hô 4, rlle Hàng thit 9
Nguyên Thi Hop 52, r. Tour de la Citadelle 13
Mac Si Hâu 17, r. de Hà trung 9
Dô Thi Thai 1, rlle Nam Ngu 5
Trân Thi Thinh 47, Bd. Maréchal Pétain 10
Vu Thi Nho 17, rlle Yên Thai 14
Hoàng Thi Loi 21, rlle Yên thai 4
Nguyên Thi Ba 43, Bd Maréchal Pétain 7
Nguyên Thi Thuân 4, r. Tirant 12
Nguyên Thi Ba 23, rlle Yên thai 8
Sanh Thi Ty 26, rlle Pavillons noirs 6
Nguyên Thi Cuc 17, r. Tirant 18
T O T A L 189.
SOURCE : AN - Hà nôi, Fonds Mairie de Hà nôi, T12 - 4920.
ANNEXE 6.
Extrait de la lettre du Gouverneur général de l'Indochine
adressée au Secrétaire général de l'Institut colonial international à Bruxelles, au sujet des médias dans les colonies.
Hà nôi, 11 mai 1932.
Le Gouverneur Général de l'Indochine
Monsieur le Secrétaire Général de l'Institut
Colonial International,
72-A, Boulevard de Waterloo,
à Bruxelles
Monsieur le Secrétaire Général,
Me référant à la demande de renseignements que vous avez bien voulu m'adresser sur les problèmes relatifs à la diffusion de la pensée en Indochine, j'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus quatre notes portant sur les sujets suivants:
I. La presse indigène;
II. Le cinéma;
III. La radiophonie;
IV. La d'iconographie.
La brièveté des trois derniers de ces notes s'explique par le développement relativement restreint qu'ont reçu jusqu'à présent les modes d'expression qu'elles concernent auprès de la population indigène d'Indochine, néanmoins, au cas où cette communication ne vous semblerait pas satisfaisante, je serai heureux de répondre à toutes les questions complémentaires que vous voudrez bien me poser.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma considération très distinguée./.
I. LA PRESSE INDIGENE
Il existe en Indochine, et principalement en Cochinchine et au Tonkin, non seulement une presse indigène de langue indigène, mais en outre une presse indigène de langue française. Journaux et revues y sont d'ailleurs de création assez récente; les plus anciens ne remontent guère à plus de vingt cinq ans.
Le tableau suivant donne le nombre des écrits périodiques déposés au service du Dépôt légal pendant le premier semestre 1931 :
Bulletins & Revues Journaux
En français 92 38
En annamite 20 31
En français et annamite 4 /
En cambodgien 3 1
En laotien 1 /
En chinois 2 3
TOTAL 122 73
Ces publications comprennent :
1. quelques revues générales, malheureusement trop peu répandues, qui accomplissent un remarquable effort d'assouplis-sement et d'adaptation de la langue indigène;
2. des périodiques techniques (agriculture, commerce, enseignement, sports ...) dont les rédacteurs trop souvent incompétents se bornent en fait dans la plupart des cas à un simple rôle d'information;
3. des feuilles politiques plus ou moins avancées (politique générale, féminisme ...) publiées parfois en français, et généralement éphémères;
4. des organes conservateurs travaillant à maintenir chez leurs lecteurs les goûts, les coutumes et la culture traditionnels;
5. enfin des feuilles d'informations pure dont certaines ne sont que l'édition indigène de journaux français. [....].
Signé : Pasquier.
SOURCE : AN - Hà nôi, Fonds Gougal, D 61/F 09 - 6608.
ANNEXE 7.
L'avis d'opposition de la Commission d'examen des films cinéma-tographiques du Tonkin à la projection d'un film retraçant l'histoire de "La commune de Paris" -"Dawns of Paris"-, juillet 1938.
NOTE
pour Monsieur le Résident Supérieur
(S/c de Monsieur le Directeur des Bureaux)
Sur la demande du cinéma Trung Quôc, 42 rue des Changeurs, la Commission d'Examen des Films Cinématographiques s'est réunie le 22 juin dernier à 17 h 15 pour visionner le film "Dawns of Paris" d'une longueur de 2.500m édité par le Gouvernement officiel des Soviets.
Vu le caractère particulier de ce film, dont l'action se passe en 1871, pendant la Commune de Paris, la Commission avait demandé à M. Acarlat, Président Suppléant et M. Nguyên Manh Tuong, membre suppléant, de bien vouloir assister également à cette projection.
Il s'agissait en effet du premier film officiel russe dont la présentation ait été demandée en Indochine.
L'examen du film a donné lieu aux observations suivantes faites à l'unanimité des membres.
1. Le film est entièrement parlant en russe ; les paroles sont donc incompréhensibles pour le public indochinois, ce qui enlève à ce film la plus grande part de son intérêt.
2. Les images qui se succèdent pendant deux heures de projection montrent successivement les principaux acteurs de la Commune de Paris et du Gouvernement de Versailles (en particulier M. Thiers, Généraux Dambrowsky, Ckusère, M. Clémenceau, et.). Le film est néanmoins difficilement compréhensible même pour des personnes connaissant l'histoire de la Commune de Paris, à plus forte raison par un public indigène.
3. Le film fait évidemment l'apologie de la Commune, met en évidence l'esprit d'abnégation et le courage du peuple de Paris par opposition aux hommes de Versailles, mais l'ensemble est néanmoins des plus confus et faute de comprendre les paroles, ne contient rien de particulièrement répréhensibles. Cependant les scènes de guerre civile, les luttes à armes blanches, les constructions de barricades, et la défense de celles-ci, font comprendre au spectateur qu'il s'agit d'une véritable révolution commandée par les éléments ouvriers et qui s'effectue à l'encontre des éléments bourgeois.
4. A ce titre la Commission estime que la projection de ce film peut être l'occasion pour certains éléments indigènes turbulents, en particulier, pour le parti communiste, de manifester ouvertement sa sympathie pour les défenseurs de Paris ; ce film est ainsi susceptible de provoquer dans les salles où il sera projeté et plus spécialement en Cochinchine, une certaine agitation qu'il importe d'éviter.
5. En conséquence, et vu sous cet angle, la Commission estime que la projection de ce film est indésirable en Indochine et que le refus de Visa doit être opposé.
6. La Commission suggère toutefois à Monsieur le Résident Supérieur, s'il l'estime utile, de faire visionner à nouveau ce film par la commission d'Appel./.
Le Président de la Commission d'Examen
des Films cinématographiques du Tonkin.
Signé : Millies-Lacroix
P.S. Personnellement j'estime que la Commission d'Appel ne pourra que partager l'avis de la commission d'Examen en raison de l'agitation que la projection de ce film est susceptible de provoquer dans toutes les salles d'Indochine où il sera passé. Les éléments avancés de la population ne manqueront pas en effet de monter en épingle ces événements douloureux de notre histoire et d'en tirer des conclusions tendancieuses qu'il convient essentiellement d'éviter.
Le Président de la Commission d'Examen
des Films cinématographiques du Tonkin.
Signé : Millies-Lacroix
SOURCE : CEDAOM, Service économique, C43 - c 27.
ANNEXE 8.
L'avis du Résident supérieur du Tonkin sur la projection du film "Dawns of Paris", juillet 1938.
Hà nôi, le 6 juillet 1938.
Le Résident Supérieur au Tonkin
Officier de la Légion d'Honneur
à Monsieur le Gouverneur Général de l'Indochine
(Direction des Affaires politiques)
Hà nôi
A.s. Film cinématographique
"DAWNS OF PARIS"
J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite des observations présentées par la Commission d'Examen des Films Cinématographiques du Tonkin dont ci-joint copie, j'ai décidé de refuser mon visa à la projection en public du film "Dawns of Paris" édité par le firme U.S.S.R., importé par le Cinéma Trung Quôc./.
Le Résident Supérieur au Tonkin
Signé : Yves C. Chatel.
SOURCE : CEDAOM, Service économique, C 43 - c 27.
ANNEXE 9.
Ordre d'interdiction du Ministre des Colonies au Gouverneur général de l'Indochine au sujet de la projection du film "Tempête sur l'Asie", mai 1938.
Paris, le 5 mai 1938.
Le Minsitre des Colonies
à Monsieur le Gouverneur Général de l'Indochine.
Censure cinématographique
"TEMPETE SUR L'ASIE"
La commission de censure cinématographique a examiné dernièrement un film de la maison française SEFERT intitulé "Tempête sur l'Asie".
Il a paru aux représentants des Départements intéressés qu'il y aurait un certain danger à ce que ce film où l'on voit des Indigènes torturés par des Blancs et se révolter contre eux, fût représenté dans nos pays de protectorat ou dans nos Colonies.
Le Ministre des Affaires Étrangères m'a fait connaître qu'il avait déjà des instructions utiles au Haut-commissaire de la République à Beyrouth et à nos Résidents Généraux à Tunis et à Rabat.
Je vous prie, en conséquence, d'interdire la projection de ce film sur le Territoire que vous administrez en vertu des pouvoirs qui vous sont reconnus par le décret du 20 juin 1928.
P. le Ministre et p.o.
Le conseiller d'Etat
Directeur des Affaires Politiques
Signé : Joseph.
P.S. Il y aurait sans doute intérêt à prévenir les entreprises cinématographiques de votre colonie pour qu'elles évitent la location de ce film./.
P.C.C.
Le chef du Bureau des Archives
Signé : Georges Monod.
SOURCE : CEDAOM, Service économique, C 43 - c 27.
L E S S O U R C E S
I. LES ARCHIVES
Les différentes sources et la bibliographie rassemblées ici sont indiquées à titre de suggestion. Si nous en avons consulté une bonne partie, - dans ce cas les références sont signalées dans les notes -, le reste n'a pu être examiné de près pour diverses raisons (l'éloignement des centres d'Archives, par exemple). Ce travail inachevé permet néanmoins d'évaluer l'ampleur et de situer le contexte de la question qui est traitée.
LES ARCHIVES DU CENTRE DES ARCHIVES D'OUTRE-MER (CEDAOM), à Aix-en-Provence, ancien et nouveau fonds (NF) confondus.
A. LES ARCHIVES DU GOUVERNEMENT DES AMIRAUX ET DU GOUVERNEMENT
GENERAL DE L'INDOCHINE
A 20(65) - C 10 : Rapports trimestriels du Gouverneur général
Sarraut.
D.A20(63) - C 10 : Rapport trimestriel du Gouverneur général
Klubokowski, 1910.
D 02 - 21360 : Notices et monographies du Tonkin.
D 02 - 21361 : Questions annamites. Politique française en
Indochine.
R - 5715 : Enseignement en Cochinchine. Affaires diverses
1898-1905.
R - 2579 : Instruction publique : correspondances diverses
1901-1909.
R 0 - 2625 : De la réforme du quôc ngu.
R 0 - 44215 : Grèves d'écoliers en Annam, 1927.
R 0 - 51211 : Inspection des écoles au Tonkin.
R 0 - 51528 : Admission des Indochinois dans les grandes
écoles du gouvernement 1928.
R 0 - 51529 : Création d'une académie indochinoise des
Sciences, des Belles Lettres et Beaux-
Arts, 1928.
R 02 - 23728 : Commission chargée d'organiser l'instruction publique en Indochine. Question du français, du quôc ngu et du chinois. Réponses aux questionnaires par l'inspecteur des Colonies en mission, Bideau, 1890-1891.
R 03 - 23733 : Rapport sur l'enseignement franco-annamite
en Annam -Tonkin, 1895.
R 27 - 5921 : Collège du Quôc hoc de Huê. Création et
fonctionnement 1896-1903.
R 58 - 19090 : Envoi des boursiers indigènes dans la
métropole, 1917.
R 58 - 26727 : Etat des étudiants indigènes qui se rendent
en France, 1918.
R 58 - 51360, 51319, 51362, 51366, 51392, 51402, 51410, 51418, 51420, 51448, 51452, 51474, 51487, 51490, 51510 : Etudiants indochinois en France.
R 58 - 51523 : Admission de jeunes Indochinois dans les
établissements d'enseignement supérieur de la
Métropole, 1921-1925.
R 58 - 51536 : Etudiants indochinois en France.
Correspondances diverses, 1920-1933.
R 58 - 51537 : Correspondances diverses relatives aux bourses
d'études dans la métropole accordées à des
indigènes, 1911-1917.
S 0 - 49600 : Assistance médicale. Correspondances
diverses, 1921-1929.
S02 - 6712 : Organisation du Service médicale de l'Indochine,
1904-1905.
S 03 - 6741 : Rapports médicaux en Indochine, 1904-1906.
S 07 - 18022 : Mesures à prendre pour propager la vaccine
aux Colonies, 1899.
S 09 - 6701 : Etat sanitaire du Tonkin, 1897-1900.
S 111- 6758 : Organisation d'un hôpital indigène local au
Tonkin à Hà nôi, 1904.
S 111 - 16347 : Hôpital indigène de Hà nôi, 1910.
S 12 - 16353 : Hôpitaux provinciaux, 1911.
S 22 - 2787 : Vulgarisation de la quinine, 1908.
S 42 - 23875 : Epidémie cholérique au Tonkin et en Annam, 1888.
S 45 - 6766 : Rapport sur la variole et la vaccination en
Indochine, 1903-1907.
S 5 - 6118 : Cessions de vaccinations faites au Tonkin par
l'Institut bactériologique de Saigon, 1895-1897.
S 53 - 2522 : Vaccins et sérums, 1904-1905.
S 55 - 6734 : Organisation du Service vaccinogène, 1904-1905.
S 60 - 6755 : Création de l'assistance publique en Indochine,
1905.
X 21(1) - C 316 : Enseignement primaire, secondaire.
Statistiques et instructions, 1906-1908.
1. Fonds de la Direction des affaires économiques
(Ce fonds rassemble 61 Caisses contenant chacune 7 cartons)
C 4 - c 23 : Police de la médecine.
C 10 - c 61 : Electricité. Force hydroélectrique.
C 10 - c 62 : Electricité : Tonkin, Annam, Laos, Cochinchine,
Cambodge.
C 19 - c 124 : Photo.
C 19 - c 125 : Cinéma. Liste des films.
C 35 - c 236 : Hôpitaux. Service d'hygiène. Epidémie et
vaccinations.
C 43 - c 27 : Photo, cinéma.
C 49 - c2(2) : Travaux de la commission de la pharmacopée
indochinoise.
- c2(3) : Note sur le prolétariat en Indochine.
F 03 - 19a & 19b : Rapports politiques et économiques mensuels
par province, 1908. Tonkin.
- 20a & 20b : Rapports généraux annuels des provinces.
situation politique et économique des
provinces, 1909. Tonkin.
FA - E6 : Eclairage urbain : adjudication 1917-1924.
Installations d'eau.
FA - F1 : Rapports politiques sur les affaires particulières
(1907-1917). Rapport politique par des
administrateurs des provinces (1900-1914).
FA - F1 : Instituts scientifiques : création de l'Institut
ophtalmologique A. Sarraut à Huê, 1924. Institut de
microbiologie 1924-1925. Vaccinations 1912.
P 32(1) c 263 : Police des moeurs.
NF 890 : Installation radiophonique en Indochine, 1911-1912.
NF 1374 : Notice de la province de Son la, 1932.
NF 1384 : Notice de la province de Hai duong.
NF 1387 : Rapport d'inspection sur Hai phong, 1943
2. Fonds du SLOTFOM (Service de liaison avec les originaires
des territoires de la France d'Outre-Mer).
Série 3 - C 39 : Grèves scolaires de 1927.
- C 128 : Incidents de Yên bai.Propagande à la suite
des événements de Yên bai.
- C 133 : Relations entre le PCF et les Indochinois.
Protestations du PC contre la répression en
Indochine.
Série 5 - C 1-11, 15-22, : Presse.
- C12-13 : Tracts en quôc ngu.
Série 6 - C 5 : Immigration clandestine.
3. Fonds de l'Agence économique de la France d'Outre-Mer
(Agence FOM)
C 167 - D 20 : Conditions d'existence. Coût de la vie, 1921-
1954.
C 169 - D 25 : Grèves 1936-1953.
- D 26 : Chômage 1931-1937.
C 230 - D 277 : Automobiles, cycles, pousses, 1910-1953.
C 231 - D 279 : Chemins de fer 1893-1953.
C 236 - D 293 : Electricité 1919-1953.
C 242 - D 322 : Boursiers scolaires, 1921-1953.
C 244 - D 330 : Etudiants indochinois en France et à l'étranger
1920-1953.
C 244 - D 331 : Enseignement privé, 1927-1952.
C 245 - D 342 : Conditions juridiques et sociales de la femme
indigène, 1936- 1952.
C 246 - D 346 : Institutions et recherches scientifiques et
culturelles, 1898-1954.
C 248 - D 360 : Activités intellectuelles diverses 1905-1951.
C 248 - D 363 : Cinéma 1922-1953.
C 249 - D 367 : Elite annamite intellectuelle, 1927-1949.
4. Fonds Guernut (ou Fonds de la Commission d'enquête dans les
territoires d'Outre-Mer)
Ba 22 : L'action de l'EFEO au point de vue social. Rapport de
G. Coedès, Hà nôi, 1937.
Bc 23 : Etat social de la Cochinchine, rapport de Belisaire, administrateur 2e classe des Services en Indochine. Note sur l'état social de la population du Tonkin. Les solutions locales à apporter au problème du surpeuplement du delta du Tonkin, rapport de P. Gourou). Note de M. Eckert, Résident supérieur honoraire, sur le surpeuplement du delta tonkinois.
Bd 24 : Condition de la femme et l'enfant.
Be 24 : Note sur le niveau de vie des travailleurs agricoles au
Tonkin.
Bh 25 : Notes sur les institutions communales en Annam, 1938.
Bl 24 : Notes sur la Mutualité au Tonkin. Coopératives.
Bl 26 : Notes sur le paysannat en Annam. Rapport sur l'organisation du Crédir agricole. Les opérations des caisses de Crédit agricole de 1929 à 1936. Conditions des fermiers et salariés agricoles. Rapport sur les relations entre propriétaires fonciers et la main d'oeuvre qu'ils emploient.
Bq 29 : Justice indigène au Tonkin. Mémoires sur les coutumes
indigènes en pays colonial par René Maunier, 1937.
Bx 33 : Notes confidentielles sur l'état de la presse au
Tonkin.
B. FONDS DE LA RESIDENCE SUPERIEURE DU TONKIN (RST)
D 17 - 34505 : Etablissements des tableaux statistiques, 1905.
D 610 - 36298 : Articles de journaux divers sur la politique et
la représentation indigène, 1920-1923.
- 36300 : Articles de journaux et renseignements divers
sur les menées révolutionnaires, 1920.
D 62 - 36420 : Liste de membre de l'AFIMA.
D 88 - 34562 : Population du Tonkin, 1905.
E 4 - 10919 : Envoi en France des mandarins annamites, 1906.
F 11 - 21413 : Rapport sur la situation politique du Tonkin,
1911-1918.
F 31 - 20195 : De l'avènement du jeune roi Duy Tân, 1907.
- 20196 : La fuite du jeune roi Duy Tân et de sa
déposition, 1916.
- 38395 : Propagande révolutionnaire à Hà nôi, 1914.
- 38402 : Affiches séditieuses appelant la population
annamite à la révolte trouvées dans les
provinces du Tonkin, 1914-1915.
- 38403 : Mouvements politiques de la province de Hoà
binh, 1914-1915.
- 55272 : Renseignements sur les indigènes qui sont
réfugiés chez Dê tham et sur ceux qui se sont
mêlés aux mouvements révolutionnaires, 1908.
G 5 - 7250 : Condamnation à mort prononcée contre les
indigènes, 1883-1888.
S 2 - 36617 : Séances de vaccinations, 1922.
S 42 - 34580 : Santé publique. Mesure à prendre contre la
peste et le choléra, 1903.
- 47829 : Choléra, Yên bai, 1926.
V 8 - 34510 : Abonnement au journal L'Annam publié par M.
Babut.
C. FONDS PRIVES : "PAPIERS D'AGENTS" (PA)
PA 28 : Papiers Marius Moutet
C 2 - D 50 à D 56 : Agitations antifrançaises, 1937.
C 3 - D 69 à D 76 : Les grèves, 1937.
C 5 - D 77 : Rapport de mission de Justin Godart.
C 5 - D 131 : Notes sur la commune annamite.
II. LES ARCHIVES DU DEPOT DES ARCHIVES NATIONALES DE HA NOI (AN
- Hà nôi).
Malgré les transferts en France, les Fonds d'Archives de Hà nôi sont encore assez riches. On y trouve par exemple, des séries complètes sur le fonctionnement de l'Ecole des mandarins, et sur tout ce qui relève généralement des "affaires indigènes" (réformes communales et leurs applications, justice, administration locale, etc.)
Si l'attente de l'autorisation de consultation demande plusieurs semaines, le travail sur place est confortable (peu de lecteurs, ambiance amicale et possibilité d'arrangements).
A. Fonds du Gouvernement général
E 7 - 4858 : Au sujet de la réforme des coutumiers des villages
du Tonkin. Réforme dans les villages de la
province de Thai binh, 1909.
F 09 -6608 : Presse indigène. Problème relatifs à la diffusion
de la pensée en Indochine. Renseignements demandés
par l'Institut colonial international de
Bruxelles, 1932.
F 3 - 5739 : Envoi d'élèves indigènes à l'école coloniale,
1902.
F 41 - 3953 : Abdication du roi Thành thai et élévation au
trône du roi Duy tân, 1907.
F 74 - 2228, 2229, 2230, 2231, 2232 : Indochinois en France.
Rapatriement des étudiants, 1929-1938.
R 52 - 6512 : Liste des candidats (province de Hà yên) au
concours Hôi thi à Huê, 1892.
S 41 - 5536 : Régime sanitaire. Cas de peste à Hà nôi et Hai
phong, 1906-1907.
B. Fonds de la Résidence supérieure du Tonkin (RST)
D 89 - 71297 : Servitude et esclavage au Tonkin, 1931.
D 631 - 4734 : Réglementation des hôtels garnis à Hà nôi, 1907.
D 638 - 1990 : Maisons de tolérance à Nam dinh, 1901.
- 1993 : Demande d'ouverture d'une maison de tolérance
japonaise à Bac ninh, 1901.
- 4830 : Prostitution clandestine à Hà nôi, 1904.
- 5585 : Hà nôi. Maisons de tolérance. Incendie allumée
par des sous-officiers, 1892.
- 6436 : Emplacements à désigner aux maisons de
prostitution à Hà nôi, 1902.
E 7 - 28989 : Projet d'arrêté portant réorganisation du Conseil
administratif des communes annamites du Tonkin,
1921.
- 57263 : Résultats de l'examen de sortie de l'Ecole des
secrétaires communales à Hà dông, 1921.
- 57284 : Difficultés rencontrés dans la pratique de l'application de l'arrêté du 12 août 1921 relatif à l'élection des présidents et vice -présidents du conseil communal, 1924.
- 57309 : Circulaire relative à la constitution du conseil
de Ky muc, 1927.
F 41 - 76238 : Dossier du roi Bao dai. Adoption du chiffre de
règne, prise de pouvoir à son retour de France,
son mariage), 1926-1934.
G 02 - 71740 : Rapports mensuels sur le fonctionnement de la
justice française au Tonkin, 1913-1920.
G 09 - 72351 : Statistiques judiciaires, 1921.
G 33 - 71736, 71737, 71738, 71739 : Etats statistiques des affaires portées devant les tribunaux du 2nd degré des provinces du Tonkin, 1930-1934.
- 81728 - 81754 : Etats numériques des affaires civiles et pénales jugées par les tribunaux provinciaux, 1920-1929.
C. Fonds de la Mairie de Hà nôi
C 7 - 622 : Demande d'emploi des indigènes, 1904-1927.
D 615 - 3051 : Demandes d'autorisation d'organiser des
représentations théâtrales : refusée 1933-1945.
- 3167 : Cinéma Palace, 1920-1938.
- 3171 : Cinéma Tonkinois, 1933-1938.
- 3172 : Cinéma Olympia, 1933-1940.
- 3173 : Cinéma Philharmonique, 1933-1940.
- 3175 : Cinéma Majestic, 1937-1943.
- 3175 : Cinéma Moderne, 1938-1942.
- 3177 : Cinéma Eden, 1939-1944.
D 88 - 3258 : Recensement de la population de la ville de Hà
nôi en 1889.
- 3260 : Etats statistiques de la population de la ville
de Hà nôi 1890-1918.
D 638 - 2573 : Réglement concernant la prostitution.
- 2574 : Arrêtés concernant la prostitution et les débits
de boissons, 1889-1911.
- 2580 : Rapport du commissariat de police sur les
maisons de tolérance sises à Hà nôi, 1896.
- 2587 : Correspondances relatives à la prophylaxie des
maladies vénériennes, 1917.
- 2588 : Demandes de radiation du registre de la
prostitution, 1920-1921.
- 2590 : Projet de lutte antivénérienne à Hà nôi, 1932.
F 68 - 3548 : Renseignements sur la société d'enseignement Dông
kinh nghia thuc, 1907.
M 11 - 4792 : Du recensement des chômeurs intellectuels, 1937.
R 29 - 5247 : Notes du Service de sûreté sur les professeurs de
l'école privée "Thang long" (Vo Nguyên Giap,
Hoàng Minh Giam, Nguyên Xiên), 1928-1936.
R 52 - 5142 : Concours triennaux à Nam dinh, 1903-1915.
- - 5146 : Examens du doctorat à Huê, 1910-1916.
R 53 - 5201, 5202, 5203 : Ecole des mandarins, 1897-1916.
S 03 - 5771 : Etat sanitaire de la ville de Hà nôi au temps où
la faim fait son rage, 1945.
S 42 - 5840 : Mesures contre les épidémies de choléra en 1937-
1938.
- 5841 : Choléra à Hà nôi, 1937.
- 5889-5894 : Liste des mendiants invalides envoyés au
dépôt de mendicité, 1933-1945.
S 45 - 5844 : Campagne de vaccination antivariolique 1933-1934.
T 01 - 4908, 4909 : Liste des patentes de l'exercice 1926, 1927
- - 4914 : Liste des commerçants astreints à l'inscription
obligatoire au registre de commerce 1930-1932.
- - 4920 : Liste des maisons de tolérance en 1932 en vue de
l'établissement du rôle des patentes, 1932.
T 23 - 4990 : Etats des pousse-pousse de louage, 1929-1931.
D. Fonds de la province de Hà dông
C 01 - 20 : Renseignements concernant les Cu nhân et Tu tài
domiciliés dans la province, non encore pourvus
d'emploi, susceptibles d'être recrutés
éventuellement dans l'administration, 1905.
D 83 - 377 : Réclamation de Vu thi Giuong, femme de Nguyên Xuân
Mai, docteur en médecine contre la célébration du
mariage de celui-ci avec la fille de Hoàng Trong
Phu, Tông dôc de Hà dông, 1924.
D 88 - 386-398 : Etat civil indigène. Relevé des naissances,
mariages, décès, 1906-1924.
K - 3176 : PTT. Organisation et fonctionnement du Service
postal dans la province de Hà dông, 1904-1927.
- 3177 : Organisation du Service postal rural dans la zone
suburbaine de Hà nôi, 1901-1910.
S 45 - 3924 : Epidémie de choléra en 1903.
- - 3946 : 2pidémie de choléra, 1927-1928.
- 3947 : Epidémie de variole, vaccinations. Pièces de
principe, 1902-1914.
E. Fonds de la province de Phu tho
D 638 - 102-103 : Surveillance de la prostitution à Viêt try,
1904-1917.
D 80 - 126-129 : Relevés trimestriels des registres d'état
civil des Phu, Huyên, 1916-1918.
G 09 - 979-981 : Tribunal indigène. Etats mensuels des
condamnations prononcées pendant les années
1911-1926.
G33/G5 - 1000-1014 : Affaires civiles. Divorce, restitution des
frais de mariage, 1918-1930.
III. LES PUBLICATIONS DU GOUVERNEMENT GENERAL classées
par ordre chronologique
Annuaire de la Société des anciens élèves de l'Ecole coloniale, 1906-1928.
Statistiques commerciales (1ère année : 1906).
Annuaire statistique de l'Indochine, publication annuelle de 1913 à 1938.
Recensement général des populations indochinoises en 1921, Imp. Taupin, Hà nôi.
Arrêtés portant création à Hà nôi d'une école des Beaux Arts de l'Indochine (27 oct. 1924), Hà nôi, 1924.
Bulletin général de l'instruction publique (BGIP), 1924 et après.
Arrêté n° 784-I portant réorganisation du conseil administratif des communes annamites au Tonkin, 25 fév. 1925, Imp. Ngô Tu Ha, Hà nôi, sd.
Arrêtés n° 784-I et 785-I du 25 février 1927 et circulaire n° 28-I du 25 février 1927 relatifs à l'administration des communes annamites du Tonkin, Imp. Ngô Tu Ha, Hà nôi, 1927.
Société Indochinoise d'électricité, IDEO, Hà nôi, 1928.
Circulaire n° 172-I et arrêté n° 2892-I du 3 juillet 1930 régelmentant les conditions de recrutement et d'élection des autorités cantonales et communales au Tonkin, Imp. Ngô Tu Ha, Hà nôi, 1930.
Exposition coloniale internationale. Paris 1931, IDEO, Hà nôi, 1931.
Direction de l'Instruction publique, Annam scolaire : de l'enseignement traditionnel annamite à l'enseignement franco-indigène, Hà nôi, 1931.
Arrêté du Gouvernement général de l'Indochine du 27 décembre 1933 relatif à l'habillement du personnel indigène de certaine administration, IDEO, Hà nôi, 1933.
Réseaux téléphoniques du Tonkin et au Nord Annam, 1933.
Inspection générale de l'hygiène et de la santé publique, Saigon 1937.
Exposition internationale des arts et techniques. Paris 1937. Section coloniale, IDEO, Hà nôi, 1937.
Instruction publique en Indochine 1938-1939, IDEO, Hà nôi, 1939.
Travaux de la ligue prophylactique de la ville de Hà nôi. Procès verbal de la 7e réunion du comité de la "Ligue prophylactique de la ville de Hà nôi, IDEO, Hà nôi, 1938.
Souvenirs et notabilite d'Indochine, IDEO, Hà nôi, 1943.
L E S P E R I O D I Q U E S
Nous avons particulièrement consulté les journaux et revues suivants à l'annexe de la Bibliothèque nationale à Versailles:
Dàn bà moi (1935-1936), édité à Saigon.
Khoa hoc phô thông (1934-1942), édité à Saigon.
Khoa hoc tap chi (1931-1940), édité à Hà nôi.
Nam phong (1917-1934), édité à Hà nôi.
Ngày nay (1935-1945), édité à Hà nôi.
Phong hoa (1932-1936), édité à Hà nôi.
Phu nu thoi dàm (1930-1934), édité à Hà nôi.
La revue Van Su Dia (1954-1959) devenue Nghiên cuu lich su (1960-19..) ne présente pas à cet égard un intérêt particulier, étant donné qu'elle privilégie la question politique au détriment des autres questions.
ENTRETIENS ET TEMOIGNAGES
De nombreux indications nous ont été fournis par :
- Bùi Hiên, écrivain, membre de l'Association des écrivains à Hà nôi,
- Buu Tiên, dramaturge à Hà nôi,
- Diêp Dinh Hoa, archéologue et ethnologue de l'Institut d'ethnologie de Hà nôi,
- Dào Thê Hùng, journaliste-historien aux Editions en langues étrangères de Hà nôi,
- Dinh Xuân Lâm, historien de Hà nôi,
- Hoàng Xuân Han, personnalité historique du Vietnam contemporain,
- Mme Kim Dung, chanteuse du mode ca trù, une des figures artistiques du folklore vietnamien,
- Lê Trung Vu, spécialiste de la littérature populaire de l'Institut de Littérature populaire de Hà nôi,
- Nguyên Du Chi, spécialiste des Arts populaires, du Musée des Beaux Arts de Hà nôi,
- Nguyên Tu Chi, ethnologue de l'Institut Sud Est d'Asie de Hà nôi,
- Nguyên Xuân Khoat, musicien, spécialiste du ca trù,
- Phan Huy Lê, historien, directeur du Centre de coopération sur les étdes vietnamiennes,
- Tô Hoài, écrivain, membre de l'Association des écrivains à Hà nôi,
- Trân Dinh Huou, professeur de littérature à Hà nôi,
- Truong Chinh, professeur de littérature à Hà nôi,
B I B L I O G R A P H I E
I. LES OUVRAGES EN LANGUE OCCIDENTALE
A. LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL
BONET J., Dictionnaire annamite-français, IN, Paris, 1899.
- , Quelques notes surla vie extérieures des Annamites, Ed. Leroux, Paris, 1905.
BOUDET P. & BOURGEOIS R., Bibliographie de l'Indochine française. 1913-1926, IDEO, Hà nôi, 1929, VII-271 p.
- Bibliographie de l'Indochine française. 1927-1930, en 2 vol., Pub. de l'EFEO, Hà nôi, 1932, 1933, 196 p et 240 p.
- Bibliographie de l'Indochine française. 1930-1935, Paris 1967, 708 p.
CORDIER H., Bibliotheca indosinica, Pub. de l'EFEO en 4 vol., Paris, 1967.
DESCOURS-GATIN C. & VILLIERS H., Guide de recherches sur le Vietnam. Bibliographies, archives et bibliothèques de France, L'Harmattan, 1983, 259 p.
GANTER D., Recueil des lois, décrets, arrêtés, décisions et circulaires en vigueur en Annam et au Tonkin depuis le 7 juin 1883 au 1er juillet 1890, Hà nôi, 1891.
NGUYEN Thê Anh, Bibliographie critique sur les relations entre le Vietnam et l'Occident, Ed. Maison Neuve-La Rose, Paris, 1967.
NGO Vi Liên, Nomenclature des communes du Tonkin classées par cantons, phu, huyên ou châu, et par province, suivant d'une table alphabétique détaillée contenant la transcription des noms en caractères chinois et divers renseignements géographiques, Imp. Lê Van Tân, Hà nôi, 1928, 427-VIII p.
RAVIER M.H., Dictionarium latino-annamiticum completum et novo ordine dispositum, cui accedit appendix praecipuas voces proprias cum brevi explicatione contineus, Ninh phu, 1880.
TRUONG Vinh Ky (J.B.P.), Petit dictionnaire français annamite, nouvelle édition, Saigon 1920, XIII-712 p.
B. OUVRAGES DE REFERENCE
BRAUDEL F., Civilisation matérielle. Economie et capitalisme : XV-XVIIIe siècle, A.Colin, Paris, 1979, en 3 vol.
DURAND M. & HUARD P., Connaissance du Vietnam, Pub de l'EFEO, Hà nôi, 1954, 356 p.
GODELIER M., Le matériel et l'idéel, Fayard, Paris, 1984,
348 p.
GOUROU P., Les paysans du delta tonkinois. Etude de géographie humaine, Ed. d'Art et d'Histoire, Paris, 1936, 666 p.
HEMERY D., Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine. Communistes, trotskystes, nationalistes à Saigon de 1932 à 1937, Maspero, Paris, 1975, 526 p.
MARR D.G., Vietnamese tradition on trial : 1920-1945, Presse universitaire de Californie, 1981, 468 p.
NGUYEN Van Huyên, La civilisation annamite, 1944, 279 p.
SHORTER E., Naissance de la famille moderne, traduit de l'anglais par Serge Qradruppani, Seuil, Coll. Points-Histoire, Paris, 1977, 379 p.
C. OUVRAGES GENERAUX
AMOS H., La politique coloniale : un technicien de la colonisation, Le Myre de Vilers (1833-1918), thèse de 3e cycle, Paris 7, 1974, 290 p.
ARMANTIER L. Orientalisme et linguistique. Introduction aux principales langues continentales de l'Extrême-Orient, Les Editions Univers, Québec, 1980.
BEAU P., Situation de l'Indochine (1902-1907), Imp. Rey, Saigon, 1908.
BLANCHARD De La Brosse P., "Une année de réforme dans l'enseignement public en Indochine : 1924-1925", in supplément au BGIP, n°2, oct. 1925.
BONNAFONT L., Types tonkinois, (Dessins de A. Cezard), Hà nôi, imp. Schneider, 1903.
BOUDAREL G., "Phan Bôi Châu et la société vietnamienne de son temps", in France-Asie, n°199, vol. XXIII, 1969, pp. 355-436.
BOURDE G. & MARTIN H., Les écoles historiques, Seuil, Coll. Points-Histoire, Paris, 1983, 341 p.
BREKILIEN J., La vie quotidienne des paysans en Bretagne, Hachette, Paris, 1966.
BROCHEUX P., L'économie et la société dans l'Ouest de la Cochinchine pendant la période coloniale, thèse de 3e cycle, Fac des Lettres, Paris, 1969.
BUI Xuân Bào, Le roman vietnamien contemporain : tendances et évolution du roman vietnamien contemporain. 1925-1945, sl, 1972.
CHANDET H., "Jeunesse d'Annam", in Revue de Paris, 15 nov. 1938.
CHARMELL P., Les gouverneurs généraux dans les colonies françaises, leurs pouvoirs et leurs attributions, Ed. Ernst Sagot & Cie, 1922, 142 p.
CHESNEAUX J., Du passé faisons table rase ?, Maspero, Paris, 1976, 191 p.
- Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne, Les Editions Sociales, Coll. La culture et les hommes, Paris, 1955, 208 p.
- Le Vietnam : étude de politique et d'histoire, Maspero, Paris, 1968, 191 p.
CLASTRES P., La société contre l'Etat, Ed. de Minuit, Paris, 1974.
COEDES G., Les peuples de la péninsule indochinoise. Histoire et civilisation, Ed. Dunod, Paris, 1962, II-229 p, cartes.
CONDOMINAS G., L'exotique est quotidien, Plon, Coll. Terre humaine, Paris, 1965, 568 p.
CORDIER H., La politique coloniale de la France au début du 2nd empire (Indochine 1852-1858), extrait du T'oung Pao, vol. X-XII, Leide, 1911, 264 p.
CREVOST CH. & LEMAIRE CH., Produits alimentaires de l'Indochine, IDEO, Hà nôi, sd, 488 p.
DAO Dang Vy, L'Annam qui nait, Imp. du Mirador, Huê, 1938,
227 p.
DAUPHINOT G., Le Tonkin en 1909, IDEO, Hà nôi-Hai phong, 1909, 101 p.
DE LANESSAN J.L., La colonisation française en Indochine, Ed. Felix Alcan, 1895, 360 p.
- L'expansion coloniale de la France, Ed. Felix Alcan, 1886, XXIII-1016 p.
- Principes de colonisation, Ed. Felix Alcan, 1897, 284 p.
DEVILLERS Ph., Histoire du Vietnam de 1940 à 1952, Seuil, Coll. Esprit, Paris, 1952, 471 p.
DOAN Quang Tân, L'évolution de la civilisation vietnamienne et le problème franco-vietnamien, Saigon, 1949, 15 p, extrait de France-Asie, n°39, juin 1949.
DOSSE F.P., L'école des Annales dans les médias depuis 1968, thèse du 3e cycle, Paris 7, 1984, 512 p.
DOUMER P., Situation de l'Indochine (1897-1901), Imp. Schneider, Hà nôi, 1902.
DUBY G., Histoire de la France urbaine, Seuil, Paris, sd.
- Histoire de la France rurale, Seuil, Paris, 1975.
DUMAREST A., La formation des classes sociales en pays annamite, thèse de droit, Paris, 1935.
FOURNIAU CH., Annam-Tonkin 1885-1896. Lettrés et paysans vietnamiens face à la conquête coloniale, L'Harmattan, Paris, 1989, 294 p.
- Les contacts franco-vietnamiens en Annam et au Tonkin 1885-1896, thèse d'Etat de l'université d'Aix-en-Provence, 1983, 2629 p.
FRIESTEDT S., Les sources du code civil du Tonkin, thèse de la Faculté de Droit, 1935.
GARAUDY R., Parole d'homme, Coll. Point-Actuels, Ed. R. Laffont, Paris, 1975.
GERNET J., Le monde chinois, Armand Colin, Coll. Destin du monde, Paris, 1980.
GOLDMANN L., Sciences humaines et philosophie, Ed. Gonthier, Paris, 1978, 165 p.
GOUROU P., Esquisse d'une étude de l'habitation annamite dans l'Annam septentrional et central du Thanh hoa au Hoà binh, Ed. d'Art et d'Histoire, Paris, 1936, 80 p.
- La terre et l'homme en Extrême-Orient, A. Colin, Paris, 1940, 244 p., illustrations, cartes.
- Utilisation du sol en Indochine française, Ed. Centre d'Etudes de politique étrangère, Paris, 1940, 466 p.
- Riz et civilisation, Fayard, Paris, 1984, 299 p.
(Dr.) GRALL Ch, L'hygiène coloniale appliquée. Hygiène de l'Indochine, Ed. Baillière, Paris, 1908.
HEADRICK D.R., The tentacles of progress. Technology transfer in age of imperialism, 1850-1940, Oxford University Press, 1988, 405 p.
HEMERY D., "Du patriotisme au marxisme : l'immigration vietnamienne en France de 1926 à 1930", in Le mouvement social, n° 90 jan-mars 1975.
- "Ta thu Thâu : l'itinéraire politique d'un révolutionnaire vietnamien pendant les années 1930", in Histoire de l'Asie, 1981, pp 193-222.
- Hô Chi Minh. De l'Indochine au Vietnam, Découvertes-Gallimard, Paris, 1990, 192 p, iconographie.
HO Chi Minh, Ecrits 1920-1969, Ed. en langues étrangères, Hà nôi, 1976, 386 p., 2e Ed.
HOUIS M. & BOLE-RICHARD R., Intégration des langues africaines dans une politique d'enseignement, Unesco, juin 1977.
(Dr) HUARD P., "Culture vietnamiene et culture occidentale", in France-Asie, n°141-142, fév-mars 1958, pp. 6-21.
- , "Le noircissement des dents en Asie orientale", in France-Asie, n°28-29.
HUYNH Van Tông, Hitoire de la presse vietnamienne des origines à 1930, thèse du 3e cycle, Paris 7, 1971, en 2 vol., 189 p. et 245 p.
KUISEL R.F., Le capitalisme et l'Etat en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle, traduit de l'anglis, Gallimard, Paris, 1984.
LANGLET PH., La tradition vietnamienne : un Etat national au sein de la civilisation chinoise, thèse du 3e cycle, in BSEI, nlle série, tome XLV, n° 2-3, 1970.
LE ROY DES BARRES, Rapport sur la mortalité à Hà nôi en 1904, Hà nôi, 1905.
LE Thành Khôi, Le Vietnam. Histoire et civilisation, Ed. de Minuit, Paris, 1965, 588 p.
LE Trung Chanh, Eléments essentiels du droit pénal du Dai nam, thèse de doctorat, Bordeaux, 1935.
LE Van Nuu, Essai sur l'évolution de la langue annamite, Qui nhon, 1941.
MARSEILLE J., Empire colonial et capitalisme français. Histoire d'un divorce, Ed. A. Michel, Coll. Points-Histoire, 1984,458 p.
MASSON A., Notes bibliographiques sur les débuts de la presse périodique en Indochine, in BGIP, n° du 9 mai 1929.
MONET P., Français et Annamites, en 2 tomes, PUF, 1925, 1928, 258 p, 424 p.
MUS P., Vietnam. Sociologie d'une guerre, Seuil, Coll. Esprit, Paris, 1952, 373 p.
NGO Kim Chung & NGUYEN Duc Nghinh, Propriété privée et propriété collective dans l'ancien Vietnam, traduction et présentation de Georges BOUDAREL, Lydie PRIN, et VU Cân avec la collaboration de TA Trong Hiêp, L'Harmattan, Paris, 1987,
227 p.
NGUYEN Thê Anh, "L'élite vietnamienne et le fait colonial dans les premières années du XXe siècle", in Revue française d'histoire d'Outre-Mer, n° 268, 1985.
NGUYEN Thi Khang, "Le féminisme annamite", in Monde, n° 3, 21.12.1933.
NGUYEN Van Phong, La société vietnamienne de 1882 à 1902, PUF, 1971, 388 p.
NGUYEN Van Tuyên, La question des logements insalubres à Hà nôi, thèse de doctorat de médecine, Hà nôi, 1938, 72 p.
NGUYEN Van Ung, Evolution démographique du Vietnam, thèse de doctorat, 1953.
O'HARROW St, L'histoire socio-littéraire de la langue vietnamienne jusqu'au XXe siècle et le rôle de Pham Qùynh (1917-1932), thèse du 3e cycle, Institut national des langues et des civilisations orientales, 1972.
PASQUIER P., L'Annam d'autrefois. Essai sur la constitution de l'Annam avant l'intervention française, Ed. A. Challamel, 1907, 339 p.
PETITJEAN H., Répertoire chronologique et alphabétique des lois, ordonnances ... promulguées ou appliquées en Indochine depuis l'occupation de la Cochinechine (1861) jusqu'au 31 décembre 1917, Saigon 1918, 913 p.
PHAM Qùynh, L'évolution intellectuelle et morale des Annamites depuis l'établissement du protectorat français, conférence faite à l'Ecole coloniale le 31 mai 1922.
- , "Mandarinat", in Nam phong, n°103, mars 1926, supplément en français.
- , "Influence française", in Nam phong, n° 108, août 1926, supplément en français.
- , "L'évolution annamite", in Impartial, 03.11.1939.
PHAN Thanh Son, Le mouvement ouvrier vietnamien, des origines à 1945, thèse de 3e cycle, 1968, 340 p.
TABOULET G., La geste française en Indochine. Histoire par les textes de la France en Indochine des origines à 1914, Ed. A. Maison neuve, Paris, 1955, 937 p.
TAVERNIER E., Le régime de la presse au Tonkin, Imp. Long quang, Hà nôi, 1937, 21 p.
TRINH Van Thao, Vietnam du confucianisme au communisme, L'Harmattan, 1990, 346 p.
- , "Le marxisme et les religions au Vietnam. Actualités au début des années 1930", in Tiers Monde, juil-sept 1990.
TSUBOI Y., La dynastie des Nguyên au Vietnam face à l'expansion française et à la pénétration chinoise, Paris, 1982.
VIET CHUNG, "La naissance du théâtre moderne au Vietnam", in Etudes vietnamiennes, nlle série n° 17(87), 1988.
VU Công Hoè, Du suicide dans la société vietnamienne, thèse de l'Ecole de médecine de Hà nôi, Hà nôi, 1937, 63 p.
(Dr.) VU Ngoc Hùynh, Le laquage des dents en Indochine, Hà nôi, imp. Lê Van Phuc, 1937.
VU Quôc Thuc, "Civilisation occidentale et comportement économique des Vietnamiens", in France-Asie, n° 146-147, juil-août 1958.
VU Xuân Thuât, "Du mariage forcé au marige libre", in PNTD, n° 32, 17.01.1931.
Ouvrages collectifs
Tradition et révolution au Vietnam, sous la direction de J. CHESNEAUX, G. BOUDAREL, D. HEMERY , Ed. Anthropos, Paris, 1971, 509 p.
La nouvelle intelligentsia au carrefour de l'occidentalisation, Edition en langues étrangères, Hà nôi, 1989, 125 p.
Ancient town of Hoi an, Acte de symposium, Editions en langues étrangères, Hà nôi, 1991.
D. SUR LES DES MOEURS
AKIYAMA A., Geisha girl, Yokohama-Yoshikawa bookstore, 1937.
ARIES PH., L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Seuil, Coll. Points-Histoire, Paris, 1975.
- Essais sur l'histoire de la mort en Occident, Seuil, Coll. Points-Histoire, Paris, 1975.
- Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle, Seuil, Coll. Points-Histoire, Paris, 1971.
- L'homme devant la mort, Seuil, Coll. Points-Histoire, Paris, 1977.
- & DUBY G., Histoire de la vie privée, tome 4, dirigée par M. PERROT, tome 5 dirigé par A. PROST & G. VINVENT, Seuil, Paris, 1987.
- AUBURTIN J., La belle vie. Etude des milieux saigonnais, Ed. Aspar, Saigon, 1937, 294 p.
BEILLEVAIRE P., "La famille, instrument et modèle de la nation japonaise", in Histoire de la famille, tome 2, pp. 237-266, A. Colin, Paris, 1988.
- "Le Japon, une société de maison", in Histoire de la famille, tome 2, pp. 479-517, A. Colin, Paris, 1988.
BURGUIERE A. & KLAPISCH-ZUBER CH. & SEGALEN M. & ZONABEND F., Histoire de la famille, tome 1, 639 p., tome 2, 559 p, A. Colin, Paris, 1988.
CADIERE L., La famille et la religion en pays annamite, Paris, 1931.
CARTIER M., "En Chine, la famille, realis du pouvoir", in Histoire de la famille, tome 1, pp. 445-477, A. Colin, Paris, 1988.
- "La longue marche de la famille chinoise", in Histoire de la famille, tome 2, pp. 211-236, A. Colin, Paris, 1988 .
CHAMBERLAIN B.H., Moeurs et coutumes du Japon, traduction de Marc LOGE, Payot, Paris, 1931.
CHESNAIS J.C., Histoire de la violence, R. Laffont, Coll. Pluriel, Paris, 1981, 497 p.
CHIVAS-BARON Cl., La femme française aux colonies, Ed. La rose, Paris, 1929.
(Col) DIGUET E., Les annamites. Société - Coutumes - Religions, Ed. A. Challamel, 1906, 367 p.
DUMOUTIER G., Le rituel funéraire des Annamites. Etude d'ethnographie religieuse, Hà nôi, 1904, 267 p.
DURRWELL G., "La famille annamite et le culte des ancêtres", in BSEI, 2e semestre 1908.
ELIAS N., La civilisation des moeurs, Calman Lévy, Paris, 1974.
FLANDRIN J.L., Les amours paysannes : amour et sexualité dans les campagnes de l'ancienne France (XVI-XIXe siècle), Gallimard-Julliard, Coll. Archives, Paris, 1975, 256 p.
- Famille : parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Hachette, Paris, 1976.
- Le sexe et l'Occident, Seuil, Paris, 1981.
FREDERIC L., La vie quotidienne au Japon au début de l'ère moderne (1868-1902), Hachette Paris, 1984, 404 p.
FOUCAULT M., Histoire de la sexualité. La volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976.
GERVAIS M. & JOLLIVET M. & TAVERNIER Y., "La fin de la France paysanne de 1914 à nos jours", in Histoire de la famille, tome 4, Seuil, Paris, 1976.
GULIK R.V., La vie sexuelle dans la Chine ancienne, traduit de l'anglais par Louis EVRARD, Gallimard, Paris, 1971, 466 p.
JAMMES H.L., Au pays annamite. Notes ethnographiques, Ed. Challamel, Paris, 1898, 280 p.
(Dr) JOYEUX B. & VIRGITTI H., Le péril vénérien dans la zone suburbaine de Hà nôi, IDEO, Hà nôi, 1938, 36 p.
JUNG E.M., Mademoiselle moustique. Moeurs tonkinoises. Terre d'Annam, Flammarion, Paris, 1895.
LANGLET E., Le peuple annamite. Moeurs, croyances et traditions, Ed. B. Levrault, Paris, 1913.
LEMIRE CH., Les moeurs des Indochinois d'après leurs cultes, leurs lois, Paris, 1901.
LE Van Dinh, Le culte des ancêtres en droit annamite, Paris, 1934, 176 p.
LE Van Hô, La mère de famille en droit annamite, Paris, 1932, 94 p.
LE Van Phat, "La vie intime d'un annamite de Cochinchine et ses croyances vulgaires", in BSEI, n° 52, 2e sem. 1906, p. 3-142.
LUSTEGUY P., "La femme annamite de 2e rang", in Bulletin de la Société d'enseignement mutuel, tome XV, oct-déc 1934.
- La femme annamite du Tonkin dans l'institution des biens culturels, Paris, 1935, 126 p.
MEAD M., Moeurs et sexualité en Océanie, Plon, Coll. Terre humaine, Paris, 1963, 606 p.
NGUYEN Huy Lai J, Les régimes matrimoniaux en droit annamite, thèse de la Faculté de Droit, Paris, 1934, 226 p.
- La tradition religieuse spirituelle et sociale au Vietnam. Sa confrontation avec le christianisme, Ed. Beauchesne, Paris, 1981, 528 p.
NGUYEN Tân Thanh, La condition de la femme mariée au Vietnam, thèse de la Faculté de Droit, Paris, 1953.
OMORI St., Journaux intimes des danses de la Cour du vieux Japon, traduit de l'anglais, Plon, Paris, 1925.
REARICK CH., Pleasures of the Belle époque, Yale university press, 1985, 239 p.
SEGALEN M., Amours et mariages de l'ancienne France, Ed. Berger-Levrault, Coll. Arts et traditions populaires, Paris, 1982, 175 p.
SOLE J.P., L'amour en Occident à l'époque moderne, A. Michel, Paris, 1976.
TAVERNIER E., La famille annamite, Saigon, 1927, 107 p.
TRESMIN-TREMOLIERES, La cité d'amour au Japon, A. Michel, Paris, , sd.
VOVELLE M., Mourir autrefois, Archives-Julliard, Paris, 1974.
(Dr) VU Ngoc Huynh, Le laquage des dents en Indochine, Imp. Lê Van Phuc, Hà nôi, 1937.
VU Ngoc Liên, Moeurs et coutumes du Vietnam, Hà nôi, 1942,
219 p.
WERTH N., La vie quotidienne des paysans russes de la révolution à la collectivisation (1917-1939), Hachette, Paris, 1984, 410 p.
YAMATA K., Trois geishas, Ed. Domat, Paris, 1953.
- Au pays de la reine. Etude sur la civilisation japonaise et les femmes, IDEO, Hà nôi, 1942.
JUNG E.M., La vie européenne au Tonkin, Flammarion Paris, 1901.
ZELDIN Th., Histoire des passions françaises : 1848-1945, en 5 tomes, Seuil, Coll. Points-Histoire, Paris, 1980, 1981.
Histoire des moeurs, Coll. La Pléiade, Gallimard, Paris, 1990, 1758 p., ouvrage collectif.
E. SUR LA MODERNITE
ALLIOT B., Le monde du 9 nov. 1984.
BALANDIER G., Anthropologie politique, PUF, Coll. Quadrige, Paris, 1984, 4e Ed., 240 p.
- Le détour. Pouvoir et modernité, Fayard, Paris, 1985, 266 p.
BAUDELAIRE Ch, Oeuvres complètes, Coll. Bouquins, Robert Laffont, 197.
BAUDRILLARD J., "Modernité", in Encyclopédie universalis, corpus 12, 1985.
BLANCHE T., Chemin de fer de l'Indochine, Paris, 1902.
BOLLAERT E. & BOURGOIN, Le plan d'équipement de l'Indochine. Haut commissariat de France pour l'Indochine. Comité économique, 1947, 12 p.
CHESNEAUX J., De la modernité, Découverte-Maspero, Paris, 1985, 269 p.
- Modernité-Monde, La Découverte, Paris, 1989, 233 p.
DROIT R.P., "Un mot détestable", in Le monde du 9 nov. 1984.
FAVRE M., Un milieu porteur de modernisation : travailleurs et tirailleurs vietnamiens en France pendant la Première Guerre mondiale, thèse de l'Ecole nationale des Chartes, 1986, 769 p.
GAUSSEN F., "Compte rendu de lecture" de l'ouvrage de Gilles
LIPOVETSKY, L'ère du vide, in Le monde du 9 nov. 1984.
GODBOUT J., "En quête de la modernité", in Possible, 8-3, Montréal, 1984.
HABERMAS J., Le discours philosophique de la modernité, traduit de l'allemand par C. BOUCHINDHOMME & R. ROCHTITZ, Gallimard, Bibliothèque philosophique, Paris, 1988, 488 p.
- La technique et la science comme idéologie, Donoël, Coll. Médiations, Paris, 1968, 211 p.
JAUSS H. R., Pour une esthétique de la réception, traduit de l'allemand par C. MAILLARD, Gallimard, Paris, 1978, 305 p.
LEFEBVRE H., Introduction à la modernité, Ed. de Minuit, Paris, 1962, 373 p.
- Critique de la vie quotidienne, L'Arche Edition, en 2 tomes, Paris, 1977.
LEIRIS M., "Modernité/Merdonité", in Le monde du 9 nov. 1984.
LIPOVETSKY G., L'empire de l'éphémère, Gallimard, Paris, 1987.
MANDROU R., Introduction à la France moderne 1500-1640, A. Michel, Paris, 1974.
POLANYI K., La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, traduit de l'allemand, Gallimard, Coll. Bibliothèque des Sciences humaines, Paris, 1983, 419 p.
POULAT E., "Modernisme", in Encyclopédie universalis, corpus 12, Ed. 1985.
RICHET D., La france moderne : l'esprit des institutions, Flammarion, Paris, 1973.
RINCE D., Baudelaire et la modernité, PUF, Coll. Que sais-je, Paris, 1984.
RIOUX J.P., "Une place royale perdue dans l'histoire", in
Le Monde du 9 nov. 1984.
SIMONI H, Le rôle du capital dans la mise en valeur de l'Indochine, Ed. A. Lebrun, Helm 1929, III-190 p.
SUMUEL G., Philosophie de la modernité, Payot, 19...
F. SUR L'INDIVIDU
ALTAR J., "Les grands lay", in BAVH, avril-juin 1915, pp. 171-172.
BUI Tuong Chiêu, La polygamie dans le droit annamite. Contribution à l'étude du droit comparé, thèse de doctorat, Paris, 1933.
CORBIN A., "Le secret de l'individu", in Histoire de la vie privée, T.4.
- , "Cris et chuchotements", in Histoire de la vie privée, T.4.
CUNG Giu Nguyên, "L'homme vietnamien", in France-Asie, sept 1954, pp. 1169-1174.
DINH Van Trung, La psychologie du paysan du delta. Etude sur la culture vietnamienne, thèse de l'Université de Lille, 1971, 825 p.
DUMONT L., Essai sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, Seuil, Coll. Esprit, Paris, 1983.
DURAND M., Eléments de l'univers moral des Vietnamiens, Conférence au Centre de formation tactique des officiers vietnamiens, 1952, 16 p.
DURKHEIM E., Le suicide. Etude de sociologie, PUF, Coll. Quadrige, Paris, 1991, 463 p., 6e édition.
LAURENT A., L'individu et ses ennemis, Hachette, Coll. Pluriel, Paris, 1987, 571 p.
LEBRUN F., "Le prêtre, le prince et la famille", in Histoire de la famille.
LIPOVETSKY G., L'ère du vide. Essai sur l'individualisme contemporain, Gallimard, Coll. Essais, Paris, 1989, 313 p.
NGUYEN Manh Tuong, L'individu dans la vieille cité annamite. Essai de synthèse sur le code des Lê, Montpellier, 1932, 410 p.
NGUYEN Tiên Lang, "Regards sur l'Annam actuel. Un aspect de l'évolution sociale : l'individu dans la famille", in Nam phong, n° 96, 16 mai 1934, supplément en français.
PERROT M., "La famille triomphante", in Histoire de la vie privée, T.4.
PHAN Thi Dac, Situation de la personne au Vietnam, Ed. du CNRS, 1966, 208 p.
PROST A., "Frontières et espaces du privé", in Histoire de la vie privée, t.5.
TA Van Tai, The vietnamese tradition of human rights, Berkeley, Insititute of East Asian Studies, University of California, 1988, 292 p.
ZONABEND F., "De la famille", in Histoire de la famille.
G. SUR LA CULTURE VILLAGEOISE
BONET J., Quelques notes sur la vie extérieure des Annamites, Ed; Leroux, Paris, 1905.
BONNAFONT L., Types tonkinois (Dessins de A. CEZARD), Imp. Schneider, Hà nôi, sd, III-91 p.
BOUDAREL G., "L'insertion du pouvoir central dans les cultes villageois au Vietnam : esquisse des problèmes à partir des écrits de NGO Tât Tô", in Cultes populaires et sociétés asiatiques, ouvrage collectif dirigé par A. Forest, Coll. Recherches asiatiques, l'Harmattan, 1991.
BOUINAIS, Le culte des morts dans le céleste Empire et l'Annam, comparé au culte des ancêtres dans l'antiquité occidentale, Paris, 1893.
BUI Dinh Ta, Une commune annamite. Dialogues. Certains notables discutent sur les affaires de leur commune, Imp. Schneider, Hà nôi, 1904.
FOREST A. & ISHIZAWA Y. & VANDERMEERSCH L., Cultes populaires et sociétés asiatiques. Appareils cultuels et appareils de pouvoir, L'Harmattan-Sophia university, Paris, 1991, 266 p.
JOBBE-DUVAL E., La commune annamite, Paris, 1896.
NGO Vinh Long, Before the revolution : the vietnamese peasants under the French, Cambridge, Mass. MIT, 1973.
NGUYEN Huu Khang, La commune annamite. Etude historique, juridique et économique, Paris, 1946.
NGUYEN Huy Giai, La personnalité de la commune annamite, thèse de la Faculté de droit, Paris, 1937.
NGUYEN Van Huyên, Le problème de la paysannerie annamite au Tonkin, Hà nôi, 1939, 32 p.
- , Recherches sur la communes annamites. Communication faite à l'Institut indochinois pour l'étude de l'homme, Imp. Taupin, Hà nôi, 1939, 10 p.
NGUYEN Van Vinh, Coutumes et institutions annamites. Les sociétés d'épargnes et de prêts mutuels (ho), Imp. Trung Bac Tân van, Hà nôi, 1931.
ORY P., La commune annamite au Tonkin, Hà nôi, 1894.
PHAM Qùynh, Le paysan tonkinois à travers le parler populaire, Hà nôi, 1930, 126p.
H. SUR LES SCIENCES, LES TECHNIQUES, L'ENSEIGNEMENT
BARRERE M., "La science", "La science en Inde", in La Recherche, n° 180, sept 1986.
- , "Chine : la science au service de la modernisation", in La Recherche, n° 179, juil-août 1986.
BERNARD P.N., Les Instituts Pasteur d'Indochine, Saigon 1922, 249 p.
CORDIER G., Cours de langue annamite. 3e année. Testes administratifs, Imp. Ngô Tu Ha, Hà nôi, 1934.
DAC LAP, Catalogue des livres et fournitures scolaires, Huê, 1926.
DAHAN-DALMEDICO A. & PEIFFER J., Une histoire des mathématiques. Routes et dédades, Seuil, Coll. Points-Sciences, Paris, 1986, 308 p.
DUMERY H., "Science", in Encyclopédie universalis, corpus 16, Ed. 1985.
DUMOUTIER G.E., Rapport à M. Le ministre de l'Instruction publique sur uen mission scientifique dans l'Indochine, Paris, 1896.
GERNET J, "La chine, aspects et fonctions psychologiques de l'écriture", in L'écriture et la psychologie des peuples, Paris, 1963.
HUARD P., "Les chemins du raisonnement et de la logique en Extrême-Orient", in BSEI, 3e trim. 1949, p. 9-32.
- , La science et l'Extrême-Orient. Cours et conférence de l'EFEO, 1948-1949.
- & DURAND M., "La science au Vietnam", in BSEI, nelle série, tome XXXVIII, n°3-4, 1963.
JACOTOT H., Le docteur Yersin (avec des notes inédites du Dr. Yersin), in BSEI, 1er trim. 1944.
LADRIERE J., "Sciences et discours rationels", in Encyclopédie universalis, corpus 16, Ed. 1985.
MA Thành Công, L'enseignement traditionnel et l'enseignement franco-annamite de 1861 à 1930, thèse du 3e cycle, Ecole pratique des hautes études, 1973, 132 p.
MANH Qùynh, Croquis tonkinois, Ed. A. de Rhodes, Hà nôi, 1944.
MICHEL R.E., La lecture française au cours supérieur, Société des Ecoles publiques, Nam dinh, 1927.
NEEDHAM J., La science chinoise, Coll. Points-Science, Seuil, 1973.
NGUYEN Công Tiêu, 1928 Communication au 4e congrès scientifique du Pacifique à Java, slnd.
NGUYEN Danh Sanh, Contribution à l'étude des concours littéraires et militaires au Vietnam, thèse de doctorat ès Lettres, Faculté des Lettres et Sciences humaines de Rennes, 1961.
NGUYEN Tao - SAMY S., Nouveaux textes annamites, Hà nôi - Vinh, 1921.
NGUYEN Tiên Lang, Pages française par un jeune éléève annamite, Ed, Tân dân, Hà nôi, 1929.
NGUYEN Van Tô, L'argot annamite de Hà nôi, IDEO, Hà nôi, sd.
PHAM Ta - LE Van Lê, Le petit écolier, ed. Nam ky, Hà nôi, 1928.
(Ct) QUENNEDY, Album de dessins tonkinois : métiers, marchands, artisans, paysans, pêcheurs, fêtes, supplices, scènes de moeurs, musiciens, chanteuses. Souvenirs de mon voyage au Tonkin, 1899.
SCHATZMAN E., "Science : le statut de la science", in Encyclopédie universalis, corpus 16, Ed. 1985.
THUILLIER P., D'Archimède à Einstein, Fayard, Coll. Le temp des sciences, Paris.
- , "Darwin chez les samouraï", in La Recherche, n° 181, oct 1986.
VAN XUAN, Photo artistiques, Catalogue de 1923, Hà nôi, 1923.
Association pour la diffusion du quôc ngu. Statuts, Imp. Lê Van Tân, Hà nôi, 1938, 11p.
Catalogue des livres scolaires, IDEO, Hà nôi, 1928.
Catalogue indochinois des disques à aiguilles, IDEO, Hà nôi, 1926.
Catalogue. Janvier 1930 de l'Imprimerie Qui nhon, Qui nhon, 1930.
Ville de Hà nôi. Catalogue de la foire de 1918, IDEO, Hà nôi, 1919.
I. SUR LA MEDECINE ET LA PHARMACOPEE TRADITIONNELLE
(Dr) DELBOVE P., "Notes pour servir à l'histoire médicale de la campagne de Tourane (1958-1859)", in BSEI, 3e-4e trim. 1947.
(Dr) DO Nhuong, "La pharmacopée sino-vietnamienne, le ginseng et les cornes molles du cerf", in Mondes et cultures, tome XL, 1980.
DUMOUTIER G.E., Essai sur la pharmacie annamite. Détermination de 300 plantes et produits indigènes avec leur nom en annamite, en français, en latin et en chinois et l'indication de leurs qualités thérapeutiques, Hà nôi, 1887.
- , Medecine et pharmacie annamites, Hai phong, 1908.
DUONG Ba Bành, Histoire de la médecine du Vietnam, thèse de l'Ecole de médecine de Hà nôi, Hà nôi, 1947.
- (Dr) , "La médecine traditionnelle du Vietnam au contact de la médecine européenne", in Archives de l'Institut d'Histoire et de Sciences sociale, 1951.
- , "Panorama médical du Vietnam d'autrefois", in BSEI, 3e trim 1951.
FERRER M., Essai sur la présence médicale française en Indochine de 1858 à nos jours, thèse de doctorat en médecine, Faculté de Médecine, Marseille, 1972.
(Dr) HUARD P. & DESTOMBES M., "Un traité des plantes médicinales exotiques du XVIe siècle conservé à Hà nôi", in BSEI, 1er trim. 1948.
(Dr) HURD P. & DO Xuân Lâp, "Un peu de médecine chinoise", in Indochine, 1944.
(Dr) HUARD P. & DURAND M., "Lan ông et la médecine sino-vietnmaienne", in BSEI, n° 3, 3e trim. 1953.
JAMMES L., "L'art de guérir chez les Annamites. Quelques préparations pharmaceutiques", in BSEI, 1er sem, 1896.
LE Van Long, Les maladies des femmes dans la médecine vietnamienne, thèse de l'Ecole de Médecine de Hà nôi, 1952.
LE Van Trien, Les préjugés des Vietnamiens dans la conception de la médecine occidentale, thèse de l'Ecole de Médecine de Hà nôi, 1952.
MING Wong, La médecine chinoise par les plantes, Editions Tchou, 1976.
NGUYEN Trân Huân, Contribution à l'étude de l'ancienne thérapeutique vietnamienne, thèse de l'Ecole de Médecine de Hà nôi, 1951.
PHAM Dinh Hô, "La médecine vietnamienne au XVIIIe siècle. Texte original traduit par NGUYEN Trân Huân, in BEFEO, tome LX, 1973.
PHAM Phu Khai, Contribution à l'étude de l'introduction de la médecine occidentale au Vietnam, thèse de l'Ecole de Médecine de Hà nôi, 1952.
(Dr) REGNAULT J., Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites, Ed. Challamel, Paris, 1902.
TRAN Dinh Nam, "Essais sur les concepts fondamentaux de la médecine sino-annamite, in Nam phong, 1922.
WONG M., La médecine chinoise par les plantes, Ed. Tchou, Paris, 1976, 278 p.
II. OUVRAGES EN LANGUE VIETNAMIENNE
A. LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL
DAO Duy Anh, Han-Viêt tu diên (Dictionnaire sino-vietnamien), Ed. Truong thi, Saigon, 1957, 3e Ed. en 2 vol. reliés, 592 p. et 605 p.
- , Tu diên truyên Kiêu (Dictionnaire sur le roman Kiêu), ESSH, Hà nôi, 1989, 623 p.
DAO Dang Vy, Viêt-Phap tân tu diên (Nouveau dictionnaire vietnamien-français), Ed. Khai tri, Saigon, 1956, 1458 p.
DO Tât Loi, Nhung cây thuôc và vi thuôc Viêt Nam (Les plantes médicinales et les remèdes vietnamiens), Ed. des Sciences et Techniques, Hà nôi, 1986, 1250 p.
HOANG Xuân Han, Danh tu khoa hoc (Vocabulaire scientifique), Ed. Minh tân, Paris 1951, 191 p.
HUYNH Tinh Cua (P.), Dai nam quôc âm tu vi (Dictionnaire de la langue du Dai nam), Imp. de Rey Curiot et Cie, Saigon, 1895, 1896, en 2 vol.
NGUYEN Q. Thang & NGUYEN Ba Thê, Tu diên nhân vât lich su Viêt Nam (Dictionnaire des personnages historiques du Vietnam), ESSH, 1991, 1094 p., photos.
NGUYEN Lân, Tu diên thành ngu và tuc ngu Viêt Nam (Dictionnaire des expressions et des proverbes vietnamiens), Ed. "Culture", Hà nôi, 1989, 323 p.
NGUYEN Van Ngoc, Tuc ngu, phong dao (Proverbes et chansons populaires), Saigon, 1967, en 2 vol. reliés, 375 p. et 286 p.
VU Ngoc Phan, Tuc ngu, ca dao, dân ca Viêt Nam (Proverbes, chansons populaires et folklores du Vietnam), ESSH, 1978,
802 p., 5e Ed.
- Dia chi Hà bac (Monographie de la province de Hà bac), Pub. de la bibliothèque de Hà bac, 1982, 739 p.
- Dia chi van hoa dân gian. Thang long, Dông dô, Hà nôi (Monographie de la culture populaire de la région de Hà nôi), Pub. du Centre culturel et d'information de Hà nôi, 1991, 315 p, photos.
- Dia chi Vinh phu (Monographie de la province de Vinh phu), Pub. du Centre culturel et d'information de Vinh phu, 1986, 329 p.
- Institut d'Archéologie, Van hoa hoà binh o Viêt Nam (La civilisation hoabinhienne au Vietnam), Ed. du Comité des Sciences sociales, Hà nôi, 1989, 259-XII,
- Muoi lam nam hoat dông khoa hoc cua viên dân tôc hoc, 1968-1983 (Quinze ans d'activités scientifiques de l'Institut d'ethnologie, 1968-1983), Pub. de l'Institut d'ethnologie, Hà nôi, 1983, 215 p.
- Tên làng xa Viêt Nam dâu thê ky XIX. Thuôc cac tinh tu Nghê tinh tro ra (Les noms des villages vietnamiens du début du XIXe siècle. De Nghê tinh jusqu'au Nord Vietnam), ESSH, 1981, 653 p.
- Tông muc luc và sach dân tap chi Van Su Dia và tap chi Nghiên cuu lich su. 1954-1974 (Index général des revues "Littérature-Histoire-Géographie" et "Recherche historique". 1954-1974), Hà nôi, 1975, 429 p.
- Tuc ngu, dân ca, ca dao, vè Thanh hoa (Proverbes, chansons populaires et folklore de la province de Thanh hoa), Ed. de Thanh hoa, 1983, 173 p.
- Tuc ngu, phuong ngôn, ca dao (Proverbes, adages et chansons populaires), ESSH, 1987, 227 p.
B. OUVRAGES DE REFERENCE
DANG Van Lung & HONG Thao & TRAN Linh Quy, Quan ho. Nguôn gôc và qua trinh phat triên (Le quan ho. Origines et développement), ESSH, Hà nôi, 1978, 353 p.
DO Bang Doàn & DO Trong Huê, Viêt Nam ca trù biên khao (Etudes sur le ca trù au Vietnam), Saigon, 1962.
HOAI THANH & HOAI CHAN, Thi nhân Viêt Nam (Les poètes vietnamiens), Ed. Littaraire de Hà nôi, Hô Chi Minh-Ville , 1988, 365 p, 1ère Ed., 1942.
TRAN Tu, Coc câu tô chuc cua làng Viêt cô truyên o Bac Bô (Structures d'organisation du village vietnamien traditionnel du Nord Vietnam), ESSH, Hà nôi, 1984, 168 p.
VU Ngoc Phan, Nhà van hiên dai (Les écrivains modernes), Ed. Thanh long, en 5 vol., Hà nôi, 1942.
C. LES MEMOIRES
DAO Duy Anh, Nho nghi chiêu hôm, Ed. "Jeunesse", Hô Chi Minh-Ville, 1989, 282 p.
HO Huu Tuong, 41 nam làm bao. Hôi ky (41 ans de journalisme. Mémoires), Sudestasie, Paris 1984, 189 p.
NGUYEN Công Hoan, Doi viêt van cua tôi (Ma vie d'écrivain), Ed. Littéraire, Hà nôi, 1971, 403 p.
NGUYEN Hiên Lê, Hôi ky (Mémoires), Ed. Van Nghê, Westminster, Californie, en 2 vol., 1989.
NGUYEN Tuong Bach, Viêt Nam nhung ngày lich su (Vietnam les jours historiques), Montréal, 1981, 159 p.
PHAM Duy, Hôi ky thoi cach mang khang chiên (Mémoires sur l'époque révolutionnaire et de résistance),2dité aux USA, 1989,340 p.
VU Ngoc Phan, Nhung nam thang ây (Ces années-là), Ed. Littéraire, Hà nôi, 1987, 387 p.
D. OUVRAGES GENERAUX
AN KHE, "Quôc tuy và van minh" (Essence nationale et civilisation), in Nam phong, n°78, déc. 1923.
CAT TUONG, "Y phuc cua phu nu" (Les habits des femmes), in Phong hoa, n°87, 02.03.1934.
CO DUYEN, "Dàn bà ngày nay" (La femmes d'aujourd'hui), in Ngày nay, n° 21, 10.08.1936.
- , "Bô nguc dàn bà" (La poitrine de la femme), in Ngày nay, n° 36, 29.11.1936.
DUY TAC, "Vê sinh và cach an mac cùng nhà o cua ta" (L'hygiène, l'habillement et l'habitat de chez nous), in KHTC, n° 12, 15.12.1931.
DUONG Kinh Quôc, Viêt Nam nhung su kiên lich su (Vietnam les événements historiques), ESSH, en 2 vol. Hà nôi, 1982.
DAO Duy Anh, Thuc dân lich su (Histoire du colonialisme), Imp. Tiên dân, Huê, 1928, 88 p.
- , Viêt Nam van hoa su cuong (Esquisse de la civilisation vietnamienne), Huê, 1938, 224 p.
- , Chu nôm. Nguôn gôc, câu tao, diên biên (Le chu nôm [écriture démotique] Origines, structures et transformations), ESSH, Imprimé en France par Sudestasie, 1979.
DAT VAN, "Nguyên nhân cua nan mai dâm" (Les causes de la prostitution), in Tân tiên, n° 36, 30.05.1936.
DOAN Thi Tinh, Tim hiêu trang phuc Viêt Nam (Recherches sur les costumes vietnamiens), Ed. Littéraire, Hà nôi, 1988, 199 p.
DONG KINH NGHIA THUC, manuel scolaire de l'école du même nom, slnd.
DONG KINH NGHIA THUC, Van minh tân hoc sach (Manuel moderne de la civilisation), slnd.
DO Quang Chinh, Lich su chu quôc ngu (Histoire du quôc ngu), Ed. Ra khoi, Saigon, 1972.
HAC DINH, "Nu quyên", in Nam phong, n°159, fév. 1931.
H.G.T.P., "Vân dê binh dang voi chi em ta" (Le problème de l'égalité et nous [les femmes]), in PNTD, n° 1, 08.12.1930.
HOANG Dao, "Muoi diêu tâm niêm cua ban tre" (Les dix voeux de la jeunesse), in Ngày nay, n° 25 du 13.09.1936.
HO Dac Khai, "Les concours littéraires à Huê", in BAVH? N°3, juil-sept 1916.
HUYNH Van Tông, Lich su bao chi Viêt Nam tu khoi thuy dên 1930 (Histoire de la presse vietnamienne des origines à 1930), Saigon, 1973.
INSTITUT D'ETHNOLOGIE, Vê vân dê xac dinh thành phân dân tôc thiêu sô o miên Bac Viêt Nam (A propos du problème de détermination des minorités ethniques au Nord Vietnam), ESSH, Hà nôi, 1975, 551 p.
LUONBG Xuân Huê, "Môt y kiên vê viêc cai cach chê dô hôn nhân trong xa hôi Viêt nam" (Une idée de réforme du régime de mariage dans la société vietnamienne), in PNTD, n° 79, 18.03.1931.
NGUYEN Công Hoan, Nho và ghi (Souvenirs), Hà nôi, 1978.
NGUYEN Huu Khang, La commune annamite. Etude historique, juridique et économique, thèse de la Faculté de Droit, Paris, 1946.
NGUYEN Huu Tiên, "Hôn lê" (Les rites de mariages) ,in Nam phong, n°86, fév. 1924.
N.H.T., "Nu hoc" (La femme et l'enseignement), in Nam phong, n°159, fév. 1931.
NGUYEN Manh Bông, Bac nam duoc diên (Catalogue des produits pharmaceutiques sino-vietnamiens), Ed. Huong son, Hà nôi, 1943.
- & HA Van Dôc, Phuong duoc chi nam. Sach day xem bênh và bôc thuôc (Guide des médicaments, diagostic et thérapeutique), Ed Huong son Hà nôi, 1942.
NGUYEN Hiên Lê, Dông kinh nghia thuc, Sigon, 1968.
NGUYEN Ngoc Xuân, Phap tu diên âm ca (vocabulaire français en vers),Ed. Thuc nghiêp, Hà nôi, 1918.
--- , Phap tu so hoc diên ca (Prononciation du vocabulaire français élémentaire), Hà nôi, 1927.
NGUYEN Phan Quang, Phong trào nông dân Viêt Nam nua dâu thê ky XIX (Les mouvements paysans vietnamiens de la première moitié du XIXe siècle), ESSH, Hà nôi, 1986.
NGUYEN Thành, Bao chi cach mang Viêt Nam 1925-1945 (La presse révolutionnaire vietnamienne 1925-1945), ESSH, Hà nôi, 1984.
NGUYEN Van Hiêu, "Cuôc tiên hoa cua dân tôc Viêt Nam" (La marche vers le progrès du peuple vietnamien), in Nam phong, n° 206, 16.10.1934.
NGUYEN Van Xuân, Phong trào Duy tân (Le mouvement royaliste), Ed. La bôi, Saigon, 1969, 375 p.
NGUYEN Vy, Tuân chàng trai dât Viêt (Tuân le jeune homme du Vietnam), en 2 vol., Saigon, 1971.
NHI LINH, "Au hoa dân quê. Quan niêm moi" (Européanisation de la paysannerie. La nouvelle conception), in Phong hoa du 20.07.1934.
- , "Môt ban chuong trinh" (Un programme), in Phong hoa, n° 84, 02.02.1934.
PHAM Qùynh, "But sat và but lông" (Le stylo et le pinceau), in Nam phong, n°78, dec. 1923..
- , "Influence française", Suppément en français, in Nam phong, n° 103, août 1926.
PHAM Thi Ngoan, Index analytique du Nam phong, thèse de 3e cycle, Paris 7, 1978.
- , "Introduction au Nam phong", in BSEI, nlle série, T. XLVIII, n° 2-3, 2e-3e trim. 1973.
PHAN Bôi Châu, Nu quôc dân tu tri (L'autonomie des citoyennes), Ed. Dôc lâp, Huê, 1927.
- Chung diêt du ngôn (Prévisions sur l'extermination), ESSH, Hà nôi, 1991.
PHAN Huy Lê, Chê dô ruông dât và kinh tê nông nghiêp thoi Lê so thê ky XV (Le régime foncier et l'économie agricole sous les premiers règnes des Lê, XVe siècle), Ed. Lettres-Hsitore-Géographie, Hà nôi, 1959, 219 p.
- Dai Viêt su ky toàn thu (Histoire complète du Dai Viêt) ESSH, en 2 vol, Hà nôi, 1983.
- & TRAN Quôc Vuong & HA Van Tân & LUONG Ninh, Lich su Viêt Nam. Thoi ky nguyên thuy dên thê ky thu X (Histoire du Vietnam. Des origines au Xe siècle),tome 1, Hà nôi, 1991, 367 p.
PHAN Kê Binh, Viêt Nam phong tuc (Moeurs et coutumes du Vietnam), Hà nôi, 1990, 365 p., réédition.
PHAN Thi Nga, "Chi em Hôi-an voi phong trào Cat Tuong" (Les femmes de Hôi-an et le mouvement de la tenue Lemur), in Ngày nay, n° 5, 10.03.1935.
QUANG DAM, "La presse vietnamienne depuis sa naissance jusqu'à 1930", in Etudes vietnamiennes, nlle série n° 15(85), 1986.
THAI Van Kiêm, Dât Viêt troi Nam (Le ciel et la terre du Vietnam), Ed. Nguôn sông, Saigon, 1960.
THANH VAN, "Hiêu-tinh" (Piété - amour), in PNTD, n°134, 23.05.1931.
THIEN CAN, "Yêu ang dô" (l'amour pour l'étudiant), in Phong hoa, n° 54, 07.07.1934.
THU TRANG, Nhung hoat dông cue Phan Bôi Châu tai Phap 1911-1925 (Les activités de Phan Bôi Châu en France 1911-1925), Ed Sudestasie, 1983, 301 p.
TO HOAI, "Câu chuyên môt dê tài" (Histoire d'un sujet), in Nguoi hà nôi, n° 21(219), 25 mai 1er juin 1991.
TRAN Trong Kim, Nho giao (Le confucianisme), Ed. Trung Bac tân van, Hà nôi, 1930, 345 p.
TRONG LANG, Hà nôi lâm than (Hà nôi, la misérable), reportage, Imp. Thuy ky, Hà nôi, 1938, 263 p.
TRUONG Vinh Ky, Chuyên di Bac ky nam ât hoi (Voyage au Tonkin en 1876), Saigon, 1881.
TU LY, "Quôc hôn quôc tuy" (Essence nationale), in Phong hoa, n° 125, 23.11.1934.
VAN TAN, "Nguyên Truong Tô và nhung dê nghi cai cach" (Nguyên Tuong Tô et ses propositions de réformes), in NGhiên cuu lich su (Recherche historique), fév. 1961.
VIET SINH, "Quân ao moi" (La nouvelle tenue), in Ngày nay, n° 1, 30.01.1935.
VIET SINH - TRONG KHANH, "Hà nôi ban dêm" (Hà nôi by night), in Phong hoa, n° 51, 16.06.1933.
VO Nguyên Giap, Nhung nam thang không thê nào quên (Les années inoubliables), Ed. de l'Armée populaire, Hà nôi, 1975, 2e édition.
VU Huy Phuc, Tim hiêu chê dô ruông dât Viêt Nam. Nua dâu thê ky XIX (Recherches sur le réfime foncier au Vietnam. Première moitié du XIXe siècle), ESSH, Hà nôi, 1979, 415 p.
E. SUR LA CULTURE VILLAGEOISE
ACTE DE COLLOQUE, Nông thôn Viêt Nam trong lich su (La paysannerie vietnamienne dans l'histoire), ESSH, en 2 vol. Hà nôi, 1977, 1978.
CAO Huy Dinh, Tim hiêu tên trinh van hoc dân gian Viêt Nam (Etudes sur l'essor de la littérature populaire vietnamienne), ESSH, Hà nôi, 1976, 426 p.
CHU Ngoc Chi, Hat quan ho (Le chant quan ho), Hà nôi, 1928.
HOANG Thi Châu, "Thô ngu và làng xa Viêt Nam" (L'accent linguistique et le village vietnamien), in Nông thôn Viêt Nam trong lich su, Acte de colloque.
LE Minh Ngoc, "Tin nguong thân hoàng và y thuc tâm ly công dông làng xa" (Le culte du génie tutélaire et la conscience collective villageoise), in Nông thôn Viât Nam trong lich su, Acte de colloque.
LE Thi Nhâm Tuyêt, "Môt hinh thuc sinh hoat van hoa xa thôn: hôi làng" (Une formez d'activité culturelle villageoise : la fête du village), in Nông thôn Viet Nam trong lich su, Acte de colloque.
NGAN PHUONG & LE HONG, Cô dâu không phai là gai mai dâm. Tra loi ông sy Ky vê viec xin bat cô daû phai di kham bênh (Les chanteuse ne sont pas des filles publiques. Réponse à M. Sy Ky à propos de l'obligation des chanteuses à passer la visite médicale), Hà nôi, 1934.
NGO Tât Tô, "Tâp an cai dinh" (Le procès de la maison communale), in Tac phâm (Oeuvres), Ed. Littéraires, Hà nôi, 1977, pp. 143-208.
- "Viêc làng", (Récit sur le village), in Tac phâm (Oeuvres), Ed. Littéraires, Hà nôi, 1977, pp.209-304.
NGUYEN Dông Chi, "Quan hê giua nhà nuoc và làng xa o Viêt Nam truoc cach mang" (Rapports entre l'Etat et le village au Vietnam avant la révolution), in Nông thôn Viêt Nam trong lich su, Acte de colloque.
NGUYEN Duc Nghinh, "Mây net phac thao vê cho làng qua nhung tài liêu cac thê ky XVII-XVIII (Esquisse sur le marché du village à partir des documents datant des XVII et XVIIIe siècles), in Nghiên cuu lich su (Recherche historique), n° 5 (194), 1980.
NGUYEN Khac Tùng, "Le village des paysans du Bac Bô", in Etudes vietnamiennes, n°65, 1981.
NGUYEN Van Huyên, Recherche sur la commune annamite. Communication faite à l'institut indochinoise pour l'étude de l'homme. Hà nôi, imp. Taupin, 1969, 10 p.
PHAM Quang Duyêt, Hat a dào (Le chant a dào), Hà nôi, 1923.
PHAM Van Duyêt, Hat a dào (Le chant a dào), Hà nôi, 1923.
THU LINH & DANG Van Lung, Lê hôi truyên thông và hiên dai (Les fêtes, tradition et modernité), Ed. Littéraire, Hà nôi, 1984.
TRAN Quôc Vuong & LE Van Hao & DUONG Tât Tu, Mùa xuân và phong tuc Viêt Nam (Le printemps et les traditions vietnamienne), Hà nôi, 1970.
TRUC Khê, Vân dê cai cach lê tuc Viêt Nam (Le problème des réformes des rites au Vietnam), Imp. Lê Cuong, Hà nôi, 1943.
F. PIECES DE THEATRE
DOAN Phu Tu, Nhung buc thu tinh (Les lettres d'amour), Imp. Trung Bac tân van, Hà nôi, 1937, 133 p.
- , Nga ba duong (La patte d'oie).
- , Ghen (Jalousie, inspirée de la pisèce portant le même nom de Sacha Guitry), Ed. Nguyên Du, Hà nôi, 1942.
KHAI HUNG, Dông bênh (Les mêmes maladies), Ed. Doi nay, Hà nôi, 1942.
NAM XUONG, Chàng ngôc (L'idiot), Hà nôi, sd.
- , Ong tây annam (Le Franco-Vietnamien), Ed. Nam ky, Hà nôi, 1931.
NGUYEN Huu Kim, Ban và vo (L'ami et la femme), Ed. Lê Van Thu Hà nôi, 1927.
NGUYEN Van Lôc, Chêt vi tinh (Mourir d'amour), Hà nôi, 1929.
NGUYEN Van Nam, Cô tân (Mademoiselle Tân), Hà nôi, 1935.
PHAM Van Duyêt, Ep duyên (Mariage forcé), Hà nôi, 1923.
VI Huyên Dac, Cô dâu Yên (La chanteuse Yên), Hà nôi, sd.
- , Uyên uong (Les amoureux), Hai phong, 1927.
- , Hai tôi tân hôn (Les deux nuits de noces), Hai phong, 1928.
- , Cô dôc Minh (La directrice Minh), Hai phong, 1930.
VU Dinh Long, Dàn bà moi (La femme moderne), Ed. Tân dân, Hà nôi, 1944, 133 p.
- , Toà an luong tâm (Le tribunal de la conscience), Hà nôi, 1923.
G. POESIE ET LITTERATURE
HOANG Ngoc Phach, Tô tâm, roman, Hà nôi, 1968 réédition, 1ère édition, Hà nôi, 1925.
KHAI HUNG, Gia dinh (La famille), roman, Ed. Littéraire réédition, Hà nôi, 1989, 240 p., 1ère édition 1936.
- , Nua chung xuân (Le printemps inachevé), roman, Hà nôi, 1988, réédition, 1ère édition 1934.
LUU Trong Lu, Tiêng thu (Chant d'automne), recueil de poésie, Hà nôi, 1939.
NGO Tât Tô, Tac phâm (Oeuvres), Les Editions littéraires, 2 tomes, Hà nôi, 1977.
- Lêu chong (La tente et le bat-flanc), roman, Ed. Littéraire, Hà nôi, 1972, 280 p., réédition.
- , Tac phâm (Oeuvres), romans, reportages et écrits divers, Ed. Littéraire, en 2 vol., Hà nôi, 1977, 685 p. 623 p.
NGUYEN Công Hoan, Buoc duong cùng (La dernière chance), roman, Hà nôi, 1958, 226 p., réédition.
NHAT LINH, Doan tuyêt (Rupture), roman, Hà nôi, réédition, 1988, 1ère édition 1935.
- , Dôi ban (Les deux amis), roman, Hà nôi, réédition 1988, 1ère édition 1939.
VU Hoàng Chuong, Ta da làm chi doi ta (Qu'a-t-on fait de sa vie?), nouvelles, Saigon, 1974, 222 p.
VU Trong Phung, Ky nghê lây Tây (Techniques de se marier avec les Français), reportage, Hà nôi, 1936, 126 p.
- , Giông tô (La tempête), roman, Hà nôi, 1936.
- , Sô do (La chance), roman, Ed. Littéraire, Hà nôi, 1988, 199 p.,réédition;
- , Trung sô dôc dac (Gagner à la loterie), roman, 1938.
- , Vo dê (Les digues s'effondrent), roman, Hà nôi, 1936.
TO HOAI, Chuyên cu Hà nôi (Les vieilles histoires de Hà nôi), Hà nôi, 1986, 200 p.
Tuyên tâp DANG Thai Mai (Morceaux choisis de Dang Thai Mai), écrits divers, Ed. Littéraire, en 2 vol. Hà nôi, 1984.
Tuyên tâp Nguyên Binh (Morceaux choisis de Nguyên Binh), recueil de poésie, Ed. Littéraire, Hà nôi, 1986, 198 p.
Tuyên tâp Nguyên Công Hoan (Morceaux choisis de Nguyên Công Hoan), nouvelles, Ed. Littéraire, en 2 vol., Hà nôi, 1981, 383p. et 430 p.
Tuyên tâp Nguyên Tuân (Morceaux choisis de Nguyên Tuân), nouvelles, Ed. Littéraire, vol. 1, Hà nôi, 1983, 534 p.
Tuyên tâp Tan Dà (Morceaux choisis de Tan Dà), poèmes et écrits divers, Ed. Littéraire, Hà nôi, 1986, 487 p.
Tuyên tâp Thê Lu (Morceaux choisis de Thê Lu), Ed. Littéraire en 3 vol., Hà nôi, 1983.
Tuyên tâp tho ca trù (Morceaux choisis des chansons du mode ca trù), Ed. Littéraire, Hà nôi, 1987, 263 p.
Tuyên tâp Vu Trong Phung (Morceaux choisis de Vu Trong Phung), Ed. Littéraire en 3 vol., Hà nôi, 1987, 503 p, 343 p., 362 p.
XUAN DIEU, Dây chùm thuong nho (La grappe d'amour), recueil de poésie, Dà nang, 1986, 174 p.
- , Gui huong cho gio (Confidences du parfum au vent), recueil de poésie, réédition, slnd.
Enfin, les lieux de débat tels que :
* le séminaire sur "la modernité", animé par Jean Chesneaux entre 1984 et 1986, à Paris 7;
* le séminaire sur l'Asie, organisé et animé annuellement par les responsables du Labo Tiers-Mondes de Paris 7,
* l'exposé fait par Nguyên Du Chi sur le Dinh à l'Institut de la Littérature populaire, Hà nôi, 03.09.1990.
* l'interview de Jacques Lizot sur France Culture sur les Yanomami, en novembre 1991.
nous ont permis de mûrir les réflexions, et d'être au courant des événements et des débats touchant à l'Asie dont le Vietnam fait partie .
LA SOCIETE VIETNAMIENNE FACE A LA MODERNITE
LE BAC BO DE LA FIN DU XIXe SIECLE
A LA SECONDE GUERRE MONDIALE
page
Remerciements 2
Abréviations & sigles 3
AVANT-PROPOS 4
INTRODUCTION : 7
* Qu'est-ce que la modernité ? 7
* Présentation des sources 15
1ère PARTIE :
PROBLEMATIQUES DE LA MODERNITE
CHAPITRE 1 : LES STRUCTURES CULTURELLES TRADITIONNELLES 26
La culture comme instrument de pouvoir. 27
Le village ou la contre-culture. 36
I. Généralités 38
II. L'appareil administratif 46
III. Le giap 61
IV. Le Dinh 69
V. La question des cultes 73
A. Le culte des ancêtres 73
B. Le culte du génie tutélaire 77
VII. Les moeurs villageoises à travers les fêtes 93
CHATITRE 2 : TROIS AGENTS DE MODERNISATION 123
I. L'enseignement. 125
A. Les réformes ou l'enseignement franco-indigène 125
B. Qu'as-tu appris à l'école ? 137
C. La rupture 147
II. Les sciences et les techniques. 168
A. Le paradoxe de la colonisation 168
B. Les sciences et les techniques à travers la
revue Khoa hoc tap chi (KHTC) 179
III. La médecine 196
A. L'assistance publique 197
B. La médecine traditionnelle à l'épreuve 212
CHAPITRE 3 : FORCES ET MILIEUX PORTEURS DE MODERNITE 228
Les forces. 230
Les milieux. 237
* Les journalistes. 238
* Les écrivains. 272
* Les poètes. 287
2ème PARTIE :
LES CINQ MODERNISATIONS DE LA SOCIETE 298
CHAPITRE 4 : LA VIE CULTURELLE 298
La langue 299
La littérature 322
La prose 323
La poésie 360
CHAPITRE 5 : LES INNOVATIONS ARTISTIQUES À CARACTERE VISUEL 381
Le théâtre. 382
Le cinéma. 402
Les dessins humoristiques et satiriques. 421
* Les caricatures politiques. 424
* Ly Toet ou l'inadapté social. 440
* Autour de la femme. 455
NOTES DU CHAPITRE 2
CHAPITRE 6 : DE L'INTIMITE A LA VIE SOCIALE. 479
Les identités corporelles. 479
La couleur des dents. 482
Le vay ou "l'essence nationale". 496
La coupe "carrée" désacralise le chignon. 499
Le costume trois-pièces. 509
La mode illustrée. 527
CHAPITRE 7 : FEMME - FAMILLE. 533
Les débats. 534
La famille ou l'objet de la critique. 551
La famille revisitée. 562
Les lieux de plaisirs. 577
Le suicide. 603
CHAPITRE 8 : VERS L'INDIVIDU MODERNE ? 631
Problématique 632
Le ca trù (a dào) 643
Le quan ho. 665
CONCLUSION. 712
ANNEXES. 723
1. La turbine solaire
2. Lettre du Ministre de la Guerre au Ministre des
Colonies au sujet des mariages mixtes, février 1917.
3. Lettre confidentielle du Garde des Sceaux à M. Le Procureur
général au sujet des mariages mixtes.
4. Réclamation de Vu Thi Giuong contre le remariage de
son mari avec la fille du Tông dôc de Hà dông,
adressée au Résident de Hà dông, mai 1924.
5. Liste des maisons de tolérance avec le nombre de femmes
dans chacune d'elles, Hà nôi, 1932.
6. Extrait de la lettre du Gouverneur général de l'Indochine
adressée au Secrétaire général de l'Institut colonial
international à Bruxelles, au sujet des médias dans
les colonies.
7. L'avis d'opposition de la Commission d'examen des films
cinématographiques du Tonkin à la projection d'un film
retraçant l'histoire de "La commune de Paris" - "Dawns of
Paris" -, juillet 1938.
8. L'avis du Résident supérieur du Tonkin sur la projection
du film "Dawns of Paris", juillet 1938.
9. Ordre d'interdiction du Ministre des Colonies au Gouverneur
général de l'Indochine au sujet de la projection du film
"Tempête sur l'Asie", mai 1938.
10. Liste des films cinématographiques de l'Agence économique
de l'Indochine à Paris.
SOURCES & BIBLIOGRAPHIE. 735
TABLE 779
INDEX 783
Index des noms propres
Anh Tho 292, 369
Archimbaud L. 124
Au Co 93, 482
Bà Dà (voir aussi Ong Dung-Bà Dà) 104
Babut E. 284
Balandier G. 9, 14, 164, 510, 709
Balzac H. de 322
Bao Dai 265, 267
Barthes R. 10
Baudelaire Ch. 8, 10, 362
Baudrillard J. 11
Beau P. 127, 129, 133
Bernard Cl. 223
Bert P. 411, 595
Berthelot M. 186, 223
Berthollet Cl. 186
Bill Buffalo 418
Blanchard de la Brosse P. 166
Bonard Amiral 238
Bonifacy A. 462
Bonnafont L. 431
Bonnet J. 522
Bouchindhomme Ch. 12
Bouddha 31, 271, 633
Bui Trinh Khiêm 370
Burguière A. 553
Buu Tiên 384
Calmette Dr. 197
Câm-Nuong 657
Cao Ba Dat 658
Cao Ba Quat 658, 660, 705
Cao Van Chanh 539, 608
Carnot 24
Cat Tuong 517
César 417
Charlot 417
Charner Amiral 123
Charvet 142
Châtel Y. 344, 414
Chesnay 161
Chesneaux J. 12, 638, 713
Chuc Nu (Voir aussi Nguu Lang-Chuc Nu) 557
Clastres P. 634
Clémenceau G. 415
Cluseret, 415
Cô Duyên 519
Coedès G. 180
Cognacq Dr. 580
Comte A. 631
Condominas G. 20
Confucius 125, 334, 489, 501
Coppin Dr. 587
Corbin A. 522, 628
Corneille P. 538
Cuong Dê 157, 162
Da Costa B. 196
Dambrowsky 415
Dang Thai Mai 245
Dào Dang Vy 566, 569, 572, 607
Dào Duy Anh 179, 254, 314
Dào Duy Tu 653
De Courcy, général 160
De Gaulle Ch. 426
Dê Tham 131, 160, 701
Diêp Dinh Hoa 19, 79, 561, 638, 668, 674
Diêp Van Ky 288
Dô Bang Doàn 641
Dô Trong Huê 642
Dông Son (voir Nhât Linh) 244, 421, 443, 452
Doumer P. 55, 161, 602
Doumergue G. 210
Dumas A. 279, 322
Dumont L. 494, 631
Duong Ba Trac 151
Duong Canh Công 82
Duong Khuê 662
Durand M. 168, 177, 217
Durkheim E. 602, 615, 619, 627, 631
Duy Tân 131, 156, 163, 253, 502, 507, 511
Edison Th. 186
Flandrin J-L 113
Frédéric L. 485
Galilée G. 186
Gauthier Mgr. 228
Gia Long 169, 657
Giong 92
Godart J. 435
Godelier M. 29, 334
Gourou P. 78
Grall Ch. (Dr) 442
Habermas J. 12, 257
Hai Triêu 291
Hàm Nghi 160, 555
Han (dynastie) 483
Hàng Chi 501
Hang Phuong 283, 556
Hegel F. 11, 630, 634
Helbert 586
Hiên Vuong 196
Hiêu-Thu 657
Hô (Chi Minh) 154
Hô (dynastie) 643
Hô Chi Minh 88, 136, 154, 318, 357, 669
Hoai Chân 237, 242, 294, 379
Hoài Giang Thuy 186
Hoai Thanh 237, 242, 291, 294, 379
Hoàng Cao Khai 430
Hoàng Dao 245, 248, 251, 256, 536, 568
Hoàng Hoa Tham 160
Hoàng Minh Giam 245
Hoàng Ngoc Phach 267, 323
Hoàng Thi Nga 189, 555
Hoàng Tich Chu 275, 278, 284, 560
Hoàng Trong Phu 430
Hoàng Xuân Han 183, 474
Hông Anh 369
Huard P. 147, 168, 177
Hugo V. 322
Hùng (les rois) 27, 82, 111, 488
Hùng Duê Vuong 82
Huu sào 189
Huy Cân 289
Huynh Thuc Khang 597
Hùynh Thuc Khang 163
Joyeux (Dr.) 590
Joyeux Dr. 562, 587, 602
Khai Hung 23, 245, 252, 312, 335, 344
Khuc Thua Hao 39
Kim Dung 642
Klobukowski 123, 127
La Boétie 291
La Bruyère 382
La Fontaine 302, 322
Lac Long Quân 86, 93, 482
Lafont Amiral 123
Lan ông 216
Langlet E. 486, 498, 518
Langlois R.P. 169
Laslett P. 552
Laurent A. 630, 632, 637, 640
Lavoisier A. L. de 186
Lê (dynastie) 69, 80, 570, 639, 644, 653, 671
Le Breton H. 576, 628
Lê Dinh Ky 316
Lê Du Tông 656
Lê Duân 26
Lê Hông 593
Lê Loi 47, 517, 639
Lê Nhu Hôc 186
Le Play F. 551
Lê Thai Tôn 639
Lê Thanh Tôn 186, 639
Lê Van Nuu 304
Lebrun F. 553
Lefbvre H. 10
Lefebvre H. 9
Leiris M. 12
Lemur 518
Locke J. 631
Long M. 172, 404, 407
Luong Huu Thât 410
Luong Van Can 151
Luong Xuân Huê 544
Luro 39
Luu Trong Lu 289, 291, 362
Ly (dynastie) 34, 69, 481, 643, 671
Ly (dynstie) 73
Ly Thai Tô 643
Ly Toet 424, 440, 444, 454
Ly Toet 454
Mac (dynastie) 69
Manh Manh 292
Marr D.G. 178, 243, 275
Marseille J. 175
Marty L. 264
Marx K. 10
Mauss M. 637
Mead M. 117
Meïji 485
Merlin M. 136
Michel R.E. 498
Minh (dynastie) 47, 496, 639, 643
Minh Mang 498
Minh Mênh 497
Molière 323, 384
Montaigne 291
Montesquieu 302
Nam Xuong 399
Napoléon 135, 302
Needham J. 169
Nehru 173
Newton I. 186
Ngân Phuong 593
Ngô (dynastie) 484, 694
Ngô Dinh Diêm 604
Ngô Tât Tô 316, 359, 423, 477, 482, 487, 496, 704
Ngô Thuc Dich 262
Nguu Lang 557
Nguyên 135
Nguyên Công Hoan 423
Nguyên (dynastie) 288
Nguyên (seigneurie) 196, 496, 653
Nguyên Ai Quôc 136, 164
Nguyên An Ninh 136
Nguyên Ba Hoc 266
Nguyên Ba Trac 264, 266
Nguyên Binh 289, 370, 372
Nguyên Cat Tuong 245, 518
Nguyên Công Hoan 204, 274, 278, 280, 285, 288, 290, 315, 337, 339, 341, 345, 353, 355, 359, 410, 490
Nguyên Công Tiêu 180
Nguyên Công Tru 186, 644, 657, 659, 705
Nguyên Dô Muc 275, 509
Nguyên Dông Chi 53, 500
Nguyên Du 409, 471, 657
Nguyên Du Chi 499
Nguyên Gia Tri 245
Nguyên Hàng Chi 500
Nguyên Huê 487
Nguyen Huu Khang 39
Nguyên Huu Kim 384, 389
Nguyên Huu Tiên 266
Nguyên Khac Hiêu 288, 515, 658
Nguyên Lân 655
Nguyên Manh Tuong 415, 570, 639
Nguyên Ngoc Phong 592
Nguyên Ngoc Xuân 145
Nguyên Phan Long 279
Nguyên Quyên 151
Nguyên Thai Hoc 279, 719
Nguyên Thê Truyên 245
Nguyên Thi 654
Nguyên Thi Huê 656
Nguyên Thi Khang 539
Nguyên Thi Kiêm 292
Nguyên Thi Thao 491
Nguyên Thi Tuyên 585
Nguyên Thu Lê 247
Nguyên Tiên Lang 267
Nguyên Trai 639
Nguyên Tri Phuong 230, 604
Nguyên Triêu Luât 285, 515
Nguyên Trong Thuât 266, 275
Nguyên Truong Tô 228
Nguyên Tu Chi 40, 45, 61 , 122, 705
Nguyên Tuân Anh 185
Nguyên Tuong Bach 245
Nguyên Tuong Lân 245
Nguyên Tuong Long 245
Nguyên Tuong Tam 23, 244
Nguyên Van Binh 663
Nguyên Van Da 262
Nguyên Van Hiêu 242
Nguyên Van Huyên 40, 61, 78, 218, 563, 639
Nguyên Van Luân 245
Nguyên Van Nam 391
Nguyên Van Ngoc 19, 509, 515
Nguyên Van Phong 498
Nguyên Van Siêu 658
Nguyên Van Tô 453, 507, 509, 515
Nguyên Van Ung 205, 603
Nguyên Van Vinh 151, 288, 322, 384, 401, 540
Nguyên Van Xuân 502, 511
Nguyên Vy 138, 408, 420, 448, 500, 504, 510, 514, 558, 567
Nguyên Xuân Khoat 642
Nhât Linh 23, 244, 246, 278, 282, 322, 326, 329, 334, 341, 421, 443, 452, 517, 568
Nhât Sach 456
Nhi Linh 256
Nhu Mai (pincesse) 555
Niepce N. 186
Nobel A. 174, 186
Ong Dùng 104
Ong Dùng-Bà Dà 93, 104, 118
Ory 39
Outrey E. 277
Papin D. 186
Parera 156
Paris C. 522
Parmentier H. 186
Pasquier P. 172, 180
Pasteur L. 173, 186
Perrault Ch. 8, 322
Perrot M. 628
Pham Hông Thai 136
Pham Huu Ninh 245
Pham Huy Luc 385
Pham Quynh 264, 268, 384, 503, 509, 515
Pham Thi Ngoan 267
Pham Van Dông 511
Phan Bôi Châu 128, 136, 163, 236, 511
Phan Châu Trinh 128, 132, 136, 157, 163, 511
Phan Cu Dê 315
Phan Dinh Phùng 24
Phan Kê Binh 275
Phan Khôi 289, 291
Phan Thanh Gian 229
Phan Thi Dac 103, 637
Phan Van Truong 164
Phù dông Thiên vuong 92
Poincaré H. 186
Pol-Droit R. 12
Polanyi K. 494
Prévost Abbé 322
Prost A. 632
Quang Duc (Thich) 604
Quang Trung 487
Rigaud 586
Rimbaud A. 249, 291, 362
Riou (général) 583
Robin R. 55
Rochlitz R. 12
Rousseau A. 566
Rousseau J.J. 302
Saint Simon 631
Sarraut A. 21, 127, 131, 172, 263, 607
Seu Ma Tsien 483
Shorter E. 551, 564
Si Ky 592
Si Nhiêp 33
Silvestre J. 487
Song An 324
Song Kim 385
Stone L. 553
T.T.KH 292, 368
Ta Dinh Binh 285
Ta Thu Thâu 230
Tam Lang 282
Tan Dà 280, 288, 515, 658
Tang (dynastie) 62, 175, 287
Tata (famille) 173
Tây Son 288, 487, 640
Tchang Tche Tong 196
Tcheou (dynastie) 483
Tell G. 418
Thach Lam 245, 517, 568
Thalamas 180
Thanh (dynastie) 487
Thanh Vân 537
Thành-Thai 131
Thê Lu 247, 289, 291, 316, 366, 385, 401
Thiers L. A. 415
Thuy An (Mme) 240, 259
Tô Hoài 410
Tô Mi Son 541
Tôn Thât Binh 245
Tôn Thât Thuyêt 160, 230
Touvier P. 712
Trân (dynastie) 40, 47, 53, 69, 80, 113, 481, 496
Trân Anh Tôn 488
Trân Ba Vinh 439
Trân Binh Trong 605
Trân Dinh Huou 498, 577, 638
Trân Duê Tông 656
Trân Khanh Giu 23, 245
Trân Lê Ky 661
Trân Quôc Vuong 62
Trân Tê Xuong 660
Trân Thai Tôn 39
Trân Thu Dô 481
Trân Trong Kim 284
Trân Tu 62
Tràng Khanh 568
Trinh (seigneurie) 496, 656, 671
Trinh Cuong 656
Trinh Doanh 656
Trinh Thuc Oanh 517
Trinh Trang 656
Trong Lang 592, 594, 596, 608
Trung (les soeurs) 93
Truong Chinh 511, 575
Truong Van Tham 161
Truong Vinh Ky 497
Tu Duc 160, 169, 213, 228, 253
Tu Ly 245
Tu Mo 289, 292
Tu-Xuong 660
Tuê Tinh 216
Tuyêt Hông 607
Vandermeersch L. 128, 633
Varenne A. 128
Verlaine P. 291, 362
Vi Huyên Dac 387, 393, 402
Viêt Sinh 245, 517, 568
Vinci L. de 186
Virgitti M.H. 562, 590, 602
Vo Nguyên Giap 245, 511
Vo Vuong 196
Vu Công Hoè 603
Vu Dinh Dy 284
Vu Dinh Liên 360
Vu Dinh Long 280, 383, 387, 389
Vu Hoàng Chuong 367, 377
Vu Khâm Lân 654
Vu Liên 262, 278
Vu Ngoc Huynh 482, 490
Vu Ngoc Phan 279, 282, 285, 344, 358 sv, 366, 373, 556
Vu Trong Phung 282, 284, 315, 346, 353, 358, 423, 426
Vu Xuân Thuât 544
Vuong Kha Tê 542
Vuong Kiêu An 369
Xa Xê 446 sv, 454
Xuân Diêu 289 sv, 367, 373
Yersin A. Dr. 197
1H.R. JAUSS, Pour une esthétique de la réception, Gallimard,
1978, p. 163.
1Ibid. p. 175-176.
2Ch. BAUDELAIRE, Oeuvres complètes, p. 884.
1H.R. JAUSS, op. cit. p. 194.
2H. LEFBVRE, Introduction à la modernité, Ed. de Minuit, Coll. "Arguments", Paris, 1962, p. 186.
1G. BALANDIER, Le détour. Pouvoir et modernité. Fayard, 1985, p. 131.
2K. MARX, Critique de la philosophie politique de Hegel, in Oeuvres III, Paris, Gallimard, coll. "Pléïades", 1982, cité par H. Lefebvre, op. cit., p. 170-171.
3Ibid.
4Ibid. p. 173.
1Ibid. p. 174.
2J. HABERMAS, Le discours philosophique de la modernité,Gallimard, 1984, traduit de l'allemand par C. BOUCHINDHOMME et R. ROCHLITZ, p. 5.
3J.P. RIOUX, "Une place royale perdue dans l'histoire", in Le Monde du 9 nov. 1984.
4J. HABERMAS, op. cit. p. 20.
5B. ALLIOT, Le monde du 9 nov. 1984.
6J. BAUDRILLARD, "Modernité", in Encyclopaedia universalis, corpus 12, Ed. 1985.
7Ibid.
1R.P. DROIT, "Un mot détestable", in Le monde du 9 nov. 1984.
2Paul Valéry, à propos de la liberté; Cette analogie est de Roger Pol Droit, op. cit.
3J. CHESNEAUX, De la modernité, Editions Découverte/Maspéro, Paris, 1984, 269 p.
« Un ralliement passif au modèle dominant" in Le monde, 09.11.1984.
4M. LEIRIS, "Modernité/Merdonité", in Nouvelle revue française, oct. 1981.
5F. GAUSSEN, dans un compte rendu de lecture de l'ouvrage de
Gilles Lipovetsky, L'ère du vide. Essai sur l'individualisme
contemporain, Coll. "Les essais", Gallimard, 1988.
1G. BALANDIER, op. cit., p. 167.
1Cité par Jean Baudrillard, op.cit.
1NGUYEN van Phong, La société vietnamienne de 1882 à 1902,
publication de la Sorbonne, P.U.F., 1971, 388p.
1G. VINCENT, "Une histoire du secret", in Histoire de la vie
privée, t. 5, Hachette, 1987, p. 162.
2E. SHORTER, Naissance de la famille moderne, Collec. Point-
Histoire, Seuil, 1977, p. 19.
1NGUYEN Van Ngoc, Tuc ngu phong dao (Adages et chansons
populaires), Ed. Mac lâm, en 2 volumes reliés, Saigon, 1967,
375 p. et 286 p. La première édition de ce recueil remonte à
1928.
1G. CONDOMINAS, L'exotique est quotidien, Terre humaine-Plon,
1965, §. V.
2GOUGAL INDO, Direction des archives et des bibliothèques,
Manuel de l'archiviste, Hanoi, imp. Lê van Tân, 1945.
1Ibid.
1Presque la totalité des romans de Nhât Linh et de Khai Hung
sont d'abord parus sous forme de roman-feuilleton dans Phong
hoa ou dans Ngày nay avant d'être publiés.
1M. GODELIER, L'idéel et le matériel, Fayard, 1984, p. 205.
1Les deux premiers vers d'un manuel confucéen disent en effet
Nhân chi so (l'être humain à sa naissance), tinh bôn thiên
(son caractère est bon), in Tam tu kinh (canon à trois
caractères).
1TRINH Van Thao, Vietnam du confucianisme au communisme,
L'Harmattan, Paris, 1990, 346 p.
1TRAN Tu, Co câu tô chuc cua làng viêt cô truyên o bac bô
(Structure d'organisation du village vietnamien dans le
Nord-Vietnam), Ed. des sciences sociales, Hanoi, 1984, p. 135
1Nông thôn viêt nam trong lich su (La campagne vietnamienne
dans l'histoire), Hà nôi, 1977 - 1978, acte de colloque.
2NGUYEN Huu Khang, La commune annamite. Etude historique,
juridique et économique. Thèse de la faculté de droit, Paris
1946.
1Tran Tu, op.cit. p.12.
2NGUYEN Van Huyên, Recherche sur la commune annamite.
Communication faite à l'Institut indochinoise pour l'étude de
l'homme. Hanoi, imp. Taupin, 1939. 10 p.
1Pour plus de précisions sur ce sujet, voir l'article de
HOANG Thi Châu, "Thô ngu và làng xa Viêt Nam" (L'accent
linguistique et le village vietnamien) in Nông thôn Viêt
Nam trong lich su, op. cit. pp. 394-416.
2NGUYEN Van Huyên, op. cit. p. 1.
1Voir les schémas d'occupation de l'espace dans l'ouvrage de
Pierre GOUROU, Les paysans du delta tonkinois. Etude de
géographie humaine, Publications de L'EFEO, les Editions
d'Art et d'Histoire, Paris, 1936, pp. 237-256.
2Voir l'article de NGUYEN Khac Tung, "Le village des
paysans du Bac Bô", in Etudes vietnamiennes, n° 65, 1981.
1NGUYEN Huu Khang, op.cit. p. 32.
1NGUYEN Huy Giai, La personnalité de la commune annamite,
thèse de la Faculté de droit, Paris, 1937, p. 8.
2Ibid.
1Instrument en bois de forme sphérique et dont l'intérieur a
été vidé pour servir de caisse de résonnance. On le tape
avec une sorte de baguette de bois. Les bonzes s'en servent
également en faisant des prières.
1NGUYEN Dông Chi, "Quan hê giua nhà nuoc và làng xa o Viêt
Nam truoc cach mang" (Rapports entre l'Etat et le village
au Vietnam avant la révolution), in Nông thôn Viêt Nam
trong lich su, op. cit. p. 53.
2Ibid, p. 69.
1Ibid, p. 69.
1Ibid, p. 73.
2Arrêtés n°784-I et 785-I et circulaire n°28-I du 25 fév.
1927 relatifs à l'administration des communes annamite
du Tonkin. Hanoi, imp. Ngô tu Ha, 1927.
1Article 2 de l'arrêté cité.
2Article 25 de l'arrêté cité.
1Article 13 et 22 de l'arrêté cité.
2Article 5 du même arrêté.
1Article 7 du même arrêté.
1TRAN Tu, op. cit.
2Ibid, p. 156.
1Ibid, p. 59.
1Expression employée délibérément dans le langage villageois
et substituant le terme "làng" au terme "giap".
1Traditionnellement, les Vietnamiens s'assoient sur les
nattes posées par terre, qu'il s'agisse des repas ou des
réunions.
1NGUYEN Van Huyên, op. cit.
1Cette partie consacrée au dinh reprend pour l'essentiel l'exposé de Nguyên Tu Chi, spécialiste des arts populaires du Musée des Beaux Arts à Hanoi, présenté à l'institut de la littérature populaire le 3 sept. 1930.
1Pour plus de détails liés aux pratiques funéraires se
reporter aux travaux de G. DUMOUTIER, Le rituel funéraire
des Annamites, Hanoi, 1902.
1LE Minh Ngoc, "Tin nguong thân hoàng và y thuc tâm ly
công dông làng xa" (Le culte du génie titulaire et la
conscience collective villageoise), in Nông thôn Viêt Nam
trong lich su, op. cit. p. 337.
2Ibid. p. 338.
3P. GOUROU, op.cit., p. 225.
4NGUYEN Van Huyên, "Répartition des génies populaires à Bac
ninh", in Institut indochinois pour l'étude de l'homme,
1940, cité par Georges BOUDAREL, "L'insertion du pouvoir
central dans les cultes villageois au Vietnam : esquisse des
problèmes à partir des écrits de Ngô Tât Tô", in Cultes
populaires et sociétés asiatiques, ouvrage collectif, Coll.
Recherches asiatiques dirigé par Alain FOREST, Editions
L'Harmattan, 1991, p. 144.
5DIEP Dinh Hoa, "Vài vân dê vê van hoa nguoi Viêt vùng Bac
huyên Qùynh phu -Thai binh- qua tin nguong tho o dinh"
(Quelques problèmes culturels posés par les cultes rendus
dans les dinh du nord du district de Qùynh phu - Thai binh,
in Tap chi dân tôc hoc (Revue d'ethnologie), Jan 1981, cité
par Georges BOUDAREL, op. cit. p. 113.
1Voir aussi Georges BOUDAREL, op. cit.
1Voir plus loin Les moeurs villageoises à travers les fêtes.
2Nous avons trouvé par ailleurs que ce génie s'appelle
Nguyên Duong Canh, dans un article consacré aux fêtes
et traditions de deux auteurs Giang Quân et Phan Tât Liêm
in Dia chi van hoa dân gian - Hà nôi, (Monographie de la
culture populaire de la région de Hanoi), Hanoi, 1991,
p. 201. Peu importe son nom qui ne change rien de ce qu'il
représente.
1Ce mont fait partie d'une chaîne de montagnes qui se trouve
à 60 km à l'Ouest de Hanoi Dans la région de Hoà binh-
Son Tây. Il symbolise aussi le génie de la montagne dans la
légende "Son tinh -Thuy tinh" (Le génie de la montagne et
le génie des eaux).Ces deux génies se disputaient la fille
du roi Hùng Vuong XVIII, la nommée My Nuong.
1Lê Minh Ngoc, op. cit. pp. 341-342.
1THU LINH - DANG Van Lung, Lê hôi truyên thông và hiên dai
(Les fêtes, tradition et modernité.), Hanoi, 1984, p.63.
2Se reporter à l'ouvrage de Thai Van Kiêm, Dât Viêt troi Nam
(La terre et le ciel du Vietnam), Saigon, 1960, pp. 211-228;
pour plus de descriptions sur ces fêtes et sur bien
d'autres.
1LE Thi Nhâm Tuyêt, "Môt hinh thuc sinh hoat van hoa xa thôn:
Hôi làng."(Une forme d'activité culturelle villageoise : La
fête du village) in Nông thôn Viêt Nam trong lich su,
op.cit. pp.248-258.
1Dia chi Hà bac (Monographie de la province de Hà bac),
publication de la Bibliothèque de la même province, 1982,
p. 571.
1Les détails de cette fête, qui viennent compléter nos
enquêtes par entretien avec LE Trung Vu, littérateur de la
culture villageoise, sont tirés de Dia chi Hà bac, op. cit.
1Dia chi Hà bac, op. cit. p. 572.
1Propos recueilli par nous lors de notre séjour au Vietnam
durant l'été 1990.
1A. PROST, "Frontières et espaces du privé", in Histoire de
la vie privée, t. 5, p. 72.
2Phan Thi Dac, Situation de la personne au Vietnam, Ed. du
CNRS, 1966, p. 29.
1Phong hoa, n° du 27 sept. 1935.
1Voir le dernier chapitre sur l'individu concernant cette
tradition du quan ho.
1La chique de bétel est un prétexte à la conversation.
Avant d'inviter quelqu'un à chanter, surtout quand on ne le
connaît pas, on l'invite d'abord à mâcher une chique de
bétel. Si on accepte de chanter, alors on accepte la chique
de bétel, sinon on la refuse.
1D'après les travaux de Dand Van Lung, Hông Thao et
Trân Linh Quy, Quan ho - Nguôn gôc và qua trinh phat triên
(Le Quan ho - Les origines et son essor), Hanoi, Ed. des
sciences sociales, 1978, pp.41-43.
1Dia chi Vinh phu (Monographie de Vinh phu), édité par le
Service culturel et d'information de Vinh phu, 1986, 330 p.
1J.L. FLANDRIN, Les amours paysannes. XVIe-XIXe siècles,
Coll. Archives, Gallimard/Juliard, 1975, p. 107.
2Ibid, p. 111.
3GERVAIS, JOLLIVET, TAVERNIER, Histoire de la Francce rurale,
p. 350.
4M. CARTIER "Chine", in Histoire de la famille, t. 1,
pp. 450-451.
1P. BEILLEVAIRE , "Le Japon" in Histoire de la famille, t. 1
p. 504.
2F. LEBRUN, " Le prêtre, le prince et la famille", in Histoire de la famille, t. p. 123.
1E. SHORTER, Naissance de la famille moderne, Coll. Histoire
Seuil, 1977, pp. 129-130.
1F. ZONABEND, "De la famille", in Histoiree de la famille, t. p. 32.
1M. MEAD, Moeurs et sexualité en Océanie, Ed. Terre humaine,
1973, p. 77.
2F. ZONABEND, op. cit. p. 34.
1Voir à ce sujet l'ouvrage de Pham Qùynh, Le paysan tonkinois à travers le parler populaire, Hà nôi, 1930, 126 p. Réédité par Sudestasie, Paris 1985.
2NGUYEN Van Ngoc, Tuc ngu phong dao (Adages et chansons populaires), Edition Mac lâm, Saigon, 1967, p. 204. La première édition de ce recueil remonte à 1928.
3Ibid. p. 206.
1Ibid. p. 101.
2VU Ngoc Phan, Tuc ngu ca dao dân ca Viêt Nam (Adages,chansons populaires et folklore du Vietnam), recueil classé par thèmes et par genres, Editions des Sciences sociales, Hà nôi, 1978, p. 461.
1S. O'HARROW, Histoire socio-littéraire de la langue viêtnamienne jusqu'au XIXe siècle et le rôle de Pham Qùynh (1917-1932), thèse de 3e cycle, INALCO, 1972, p.74.
1CEDAOM, C.10, A20(65).
2Direction de l'Instruction publique, Annam scolaire:
de l'enseignement traditionnel annamite à l'enseignement
franco-indigène, Hanoi, 1931.
3P. BEAU, Situation de l'Indochine. 1902-1907, t. 2, p. 80.
4Bulletin général de l'instruction publique (BGIP), sept.
1936, p. 57.
5CEDAOM, C.10, D.A20(63).
1L. VANDERMEERSCH, Le nouveau monde sinisé, Col. Perspectives
internationales, PUF, 1986, p. 144.
2Pour plus détails sur ce sujet, se rapporter au mémoire de
maîtrise de Nguyên van Ky, Les Vietnamiens et l'enseignement
franco-indigène: étude d'un facteur de transition socio-
culturel, INALCO, nov. 1983.
1Journal officiel de l'Indochine française (JOIF) du 16 mai
1904.
2CEDAOM, C. 316, X21(1).
1JOIF du 10 avril 1918.
2P. BEAU, op. cit.
1JOIF du 8 juil. 1917.
2JOIF du 10 avril 1918.
3BGIP, oct. 1924, extrait du Rapport sur le fonctionnement
des Services de la Direction de l'Instruction publique au
Conseil de gouvernement, session 1924.
1BEAU P., op. cit. p. 297.
2BGIP, op. Cit.
1JOIF, op. Cit.
2Ibid.
1NGUYEN Vy, Tuân chàng trai nuoc Viêt, en 2 Vol. Saigon 197.
Ouvrage qu'on peut qualifier de "mémoires"; Tuân désigne
vraisemblablement l'auteur lui même, qui relate des
souvenirs, des événements survenus dans la première moitié
du XXe siècle.
1Ibid, p. 38-39, t. 1.
1BGIP, mai 1925, p. 496.
2Ibid.
1BGIP, nov. 1924.
1BGIP, déc. 1924.
1Sur ce sujet, se rapporter à la thèse de Mireille FAVRE,
Un milieu porteur de modernisation: travailleurs et
tirailleurs vietnamiens en France pendant la première guerre
mondiale, Ecole nationale des chartes, 1986.
2NGUYEN Ngoc Xuân, Phap tu so hoc diên ca (Prononciation du
vocabulaire élémentaire français), 1er fascicule, Hà nôi,
1927; Phap tu diên âm ca (Prononciation du vocabulaire
français), 2e fascicule, 1ère édition, Hà nôi, 1918.
1P. HUARD, "Culture vietnamienne et culture occidentale", in
France-Asie, n°141-142, 1958, p. 7.
1L. ARMANTIER, Orientalisme et linguistique. Introduction aux
principales langues continentales de l'Extrême-Orient,
les Editions Univers, Québec, 1980, p. 83.
1Dông kinh nghia thuc (DKNT), s.d.n.l. 39 p.
1Ibid, p. 10.
1Ibid, p. 12.
1Ibid, p. 23.
2Allusion à la fondation du Vietnam à l'époque légendaire.
3DKNT, op. cit. p. 22.
1DKNT, op. cit. p.
2DKNT, op. cit. p. 36-37.
1Ibid, p. 14, 15, 16, 17.
1Ibid, p. 17, 18, 19.
2Ibid, p. 35.
3Ibid, p.28, 29, 30.
1Van minh tân hoc sach (Manuel moderne de la civilisation),
ouvrage fondamental du mouvement.
1Lich su Viêt Nam (Histoire du Vietnam), ouvrage collectif,
t. 2, 2e édition, Hanoi, 1989, p. 78.
1Les Archives nationales de Hanoi viennent de faire paraître
en 1989, la traduction en vietnamien d'un écrit de Phan bôi
Châu intitulé Tân Viet Nam (Le nouveau Vietnam).
1Sur les activités de Phan Chu Trinh en France, se reporter à
l'ouvrage de THU TRANG, Nhung hoat dông cua Phan châu Trinh
tai Phap. 1911-1925, Ed. Sudestasie, 1983.
1CEDAOM, Papiers Moutet, PA 28, C.5 D.131.
1P. BLANCHARD De la BROSSE, "Une année de réforme dans
l'enseignement public en Indochine: 1924-1925", in
supplément au BGIP, n°2, oct. 1925.
2Gougal, L'instruction publique en Indochine: 1938-1939.
3CEDAOM, Agence FOM, C 248 - D 360, article paru dans Echo
d'Outre-mer du 18 fév. 1931.
1P. HUARD & M. DURAND, "La science au Vietnam", in BSEI,
3e & 4e trim. 1963, p. 537.
1P. HUARD & M. DURAND, "Diffusion de la science au Vietnam",
in BSEI, 3e & 4e trim. 1963, p. 545.
2J. NEEDHAM, La science chinoise, Collec. Points-Science,
Seuil, 1973, p. 122.
3CEDAOM, Agence FOM, C 246 D 346.
1D. R. HEADRICK, The tentacles of progress. Technology
transfer in age of imperialism: 1850-1940, Oxford University
Press, 1988, p. 55, 90.
1Ibid, p. 110.
2Ibid, p. 135-136.
3JOIF du 14.01.1904 & CEDAOM op. Cit.
1CEDAOM, op. Cit.
1M. BARRERE, "La science", in La recherche, n° 180, sept. 1986.
1J.MARSEILLE, Empire colonial et capitalisme français, Coll.
Points-Histoire, Seuil, 1984, p.333.
1A.DAHAN-DALMEDICO & J.PEIFFER, Une histoire des
mathématiques. Routes et dédales, Collec. Point-Sciences,
Seuil, 1986, p. 36.
1P. HUARD, M.DURAND, op.cit. p. 543-544.
1CEDAOM - Agence FOM - C249 d367; H. CHANDET, "Jeunesse
d'Annam", in Revue de Paris, n° du 15 nov. 1938.
2D.G. MARR, Vietnamese tradition on trial, University of
California Press, 1981, p. 342.
1Souvenirs et notabilités d'Indochine, édité par le Gougal de
l'Indo, IDEO, 1943, p.91.
2KHTC, l'éditorial du n°1, 01.07.1931
1KHTC, n°21 du 01.05.1932.
1HOANG Xuân Han, Danh tu khoa hoc. Toan, Ly, Hoa, Co, Thiên
van (Vocabulaire scientifique. Mathématique, Physique,
Chimie, Mécanique, Astronomie), Ed. Minh tân, Paris, s.d. p.
XI.
2Ibid, p. XIX-XX.
1Ibid, p. XXI.
2Ibid, p. XXI-XXII-XXIII.
3KHTC, n°6 du 15.09.1931.
1KHTC, n°24 du 15.06.1932.
1KHTC, n°43 du 01.04.1933.
1KHTC, n°15 du 01.02.1932.
1KHTC, n°23 du 01.06.1932.
1Ibid.
2NG.H.V., "Cai luong cach dùng dua" (Réformer l'usage des
baguettes) in KHTC, n°22 du 15.05.1932.
1KHTC, n°27 du 01.08.1932.
2KHTC, n°4 du 15.08.1931.
3KHTC, n°27 du 01.08.1932.
1KHTC, n°85 du 01.01.1935.
1MING Wong, La médecine chinoise par les plantes, Editions
Tchou, 1976, p. 18.
1CEDAOM, Resuper Annam, FA – S1.
1Ch. GRALL, Hygiène coloniale appliquée, Ed. Baillière, Paris
1908, p. 187.
2Annuaire statistique de l'Indochine (ASI).
1Ibid. p. 186.
2CEDAOM - Fonds Guernut, Bc 23.
1CEDAOM, Papiers Moutet, PA 28 - C3 D77.
1CEDAOM, Fonds Guernut, Ba 22.
2CEDAOM - RST - NF. 1384. Notice de la province de Hai duong.
3LE ROY des Barres, Rapport sur la mortalité à Hanoi en 1904,
Hà nôi, 1905.
1Cette date est basée sur le dossier CEDAOM - S5-6118,
portant le titre de Cessions de vaccins faites au Tonkin par
l'Institut bactériologique de Saigon: 1895-1897.
2CEDAOM - F 03-19a.
3CEDAOM - F 03-20b.
4Ibid.
1Annuaire général de l'Indochine, 1919.
2CEDAOM - F 03-20b.
3NGUYEN Công Hoan, Nho và ghi (Souvenirs), Hà nôi, 1978,
p. 11.
4ASI, 1930-1931.
5CEDAOM, Papiers Moutet, PA 28 - C3 d77.
1NGUYEN Van Tuyên, La question des logements insalubres à Hà
nôi, Thèse de doctorat de médecine, Imp. Taupin, Hà nôi,
1938.
1ASI, années 1930, 1935.
2CEDAOM - RST - NF. 1374, notice de la province de Son la.
3AN - Fonds de la Mairie de Hà nôi - S 42-5841.
1Ibid.
2CEDAOM - RST - NF. 1387.
1CEDAOM - RST - NF. 1384.
2CEDAOM - F 03 – 20b.
1AN - Fonds de la Mairie de Hanoi, D88 – 3260.
1Ibid.
1ASI, 1er volume, Hà nôi, 1927, p. 28.
1DUONG Ba Bành, "La médecine traditionnelle du Viêt nam au
contact de la médecine européenne, in Archives
internationales d'histoire des sciences, n°15, 1951. p.459.
1DO Tât Loi, Nhung cây thuôc và vi thuôc Viêt Nam (Les
plantes médicinales et les remèdes vietnamiens), Editions
des Sciences et Techniques, Hà nôi, 1986, pp. 19-21.
1Ibid, p. 35.
2P. HUARD & M. DURAND, "La science au Vietnam", in BSEI,
3e & 4e trim. 1963, p. 541.
1Ibid.
1NGUYEN Van Huyên, La civilisation annamite, Hà nôi(?),
1944, p. 193.
1Blanc et Jaune, n° du 07.08.1938; CEDAOM - Service
économique, C49 c2(2).
1CEDAOM - Service économique - C 49 c2(2), rapport de la
sous-commission chargée de la question de la pharmacopée
sino-annamite.
2Ibid.
3Ibid.
4Ibid.
1Blanc et Jaune, n° du 07.08.1938; CEDAOM - Service
économique, C49 c2(2).
1La tribune indochinoise, n° du 27.07.1938.
1CEDAOM - Service économique - C 49 c2(2).
1Van tân, "Nguyên Truong Tô và nhung dê nghi cai cach" (Nguyên
Tuong Tô et les propositions de réforme) in Nghiên cuu lich
su (Recherche historique), fév. 1961.
2Propos recueilli par nous, lors du séjour à Hà nôi, auprès du
dramaturge Buu Tiên, originaire de Huê.
3Ibid.
1NGUYEN Vy, Tuân chàng trai nuoc Viêt, Sài gon, 1971.
1Voir Daniel HEMERY, Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir
colonial en Indochine, Maspéro, Paris, 1975, 526 p.
2Ibid, p. 127.
1CEDAOM - Service économique, Note sur le prolétariat en
Indochine, C49 - c2(3).
1Cité par TRINH Van Thao, Vietnam du confucianisme au
communisme, Ed. L'Harmattan, Paris, 1991, p. 186.
1D'après la "Liste des imprimés déposés en 1930", en 1922 le
Tonkin comptait 44 périodiques dont 8 en langue vietnamienne,
en 1925, 125 titres dont 13 en vietnamien, en 1929, 153 dont
14 en vietnamien; voir
QUANG DAM, "La presse vietnamenne depuis sa naissance jusqu'à
1930", in Etudes vietnamiennes, nouvelle série n°15(85),
1986.
Si on comptabilise tous les périodiques qui sont parus,
toujours au Tonkin, dans les années 1930, à un moment ou à un
autre, sans tenir compte de leur longévité, le nombre de
journaux et revues en langue vietnamienne dépasse aisément
les deux cents.
1AN de Hanoi, Fonds de la province de Hà dông.
2CEDAOM - Fonds Guernut, Bc 23.
3NGUYEN Van Hiêu, "Cuôc tiên hoa cua dân tôc Viêt nam" (La
marche vers le progrès du peuple vietnamien) in Nam phong,
n° 206 du 16.10.1934.
1HOAI THANH - HOAI CHAN, Thi nhân Viêt nam (Les poètes
vietnamiens), Hô chi minh-ville, 1988, réédition, p.10.
La première édition de cet ouvrage remonte à 1942.
2D.G.MARR, Vietnamese tradition on trial, ouvrage cité.
1Voir les travaux de Mme PHAM Thi Ngoan, Index analytique du
Nam Phong, thèse de 3e cycle, Paris 7, 1978; et
introduction au Nam phong", in BSEI, nouvelle série Tome
XLVIII, n°2-3, 2e et 3e trimestre 1973.
1NGUYEN Tuong Bach, Viêt nam, nhung ngày lich su (Vietnam,
les jours historiques), édité par le Groupe de recherche sur
l'histoire et la géographie de la diaspora vietnamienne au
Canada, Montréal, 1981, p. 49.
1AN de Ha noi, Fonds de la Mairie de Ha nôi, R29 - 5247.
2Ibid, p. 60.
1HOANG DAO, "Muoi diêu tâm niêm cua ban tre" (Les dix voeux
de la jeunesse) in Ngày nay, n°25 du 13.09.1936.
2Ces voeux sont d'abord parus dans Ngày nay sur plusieurs
numéros avant d'être publiés sous forme d'ouvrage.
1Ibid.
1Ibid.
2HOANG DAO, "Diêu tâm niêm thu hai" (Le deuxième voeu) in
Ngày nay, n°26 du 20.09.1936.
1HOANG DAO, "Diêu tâm niêm thu tu" (Le quatrième voeu) in
Ngày nay, n°28 du 04.10.1936.
2Phong hoa, n°3 du 07.07.1933.
3Phong hoa, n°87 du 02.03 1934.
1DAO Duy Anh, Han-Viêt Tu-diên, Ed. Truong thi, Saigon 1957,
p. 359, 3e édition.
1Phong hoa n° 107 et 108, 20 et 27 juillet 1934.
1NHI LINH, "Au hoa dân quê. Quan niêm moi" (Européanisation
de la paysannerie. La nouvelle conception), in Phong hoa,
20.07.1934.
2Ibid., n° 108 du 20.07.1934.
1J. HABERMAS, Le discours philosophique de la modernité,
traduit de l'allemand par C. BOUCHINDHOMME ET R. ROCHLITZ,
col. Bibliothèque de Philosophie, Gallimard, 1984, p. 20.
2Phong hoa, n° 87 du 02.03.1934.
3Ngày nay n° 28 du 04.10.1936.
1Dàn bà moi, n° 1 du 01.12.1934.
1Ngày nay n° 10 du 30.04.1935.
2Ibid.
3Ngày nay n° 11 du 07.05.1935.
1Ibid.
2Ibid.
1HOANG DAO, "Diêu tâm niêm thu sau" (Le sixième voeu) in
Ngày nay, n°32 du 01.11.1936.
1Ibid.
Ici l'auteur fait allusion à une anecdote et un principe
confucéens. Quelque temps avant sa mort, Confucius fait
venir un de ses disciples, et lui demande ce qu'il voit.
En même temps il ouvre la bouche. Celui-ci lui répond qu'il
ne voit plus que la langue, les dents n'y sont plus.
Saisissant cette remarque, Confucius poursuit son
enseignement en lui conseillant d'avoir dans la vie une
attitude souple comme la langue, qui parvient à rester en
vie plus longtemps que les dents pourtant si dures.
1CEDAOM - NF, C18-D196.
2S. O'HARROW, Histoire socio-littéraire de la langue
vietnamienne jusqu'au XXe siècle et le rôle de Pham Qùynh
(1917-1932), thèse du 3e cycle, INALCO, 1972, p. 207.
3Ibid.
1PHAM Thi Ngoan, "Introduction au Nam phong",op. cit. p. 183.
1Ibid. p. 206.
2NGUYEN Q. THANG - NGUYEN Ba Thê, Tu diên nhân vât lich su
Viêt Nam (Dictionnaire des personnages historiques du
Vietnam), Ed. des Sciences sociales, Hà nôi, 1991, p. 738.
3Mme PHAM Thi Ngoan a dressé la biographie détaillée des
principaux rédacteurs de la revue dans son Introduction au
Nam phong, nous n'extrayons ici que quelques traits de
singularité de certains journalistes de l'ancienne école.
1PHAM Thi Ngoan, Index analytique du nam phong, thèse de 3e
cycle, Paris 7, 1978.
1PHAM Thi Ngoan, op. cit. p. 415.
1PHAM Qùynh, "Influence française", Supplément en français,
in NP, n°103 août 1926.
2PHAM Qùynh, L'évolution intellectuelle et morale des
annamites depuis l'établissement du Protectorat français,
conférence faite à l'Ecole coloniale le 31 mai 1922.
1Ibid.
2PHAM Qùynh, "Quôc van" (La littérature nationale) in NP
juil. 1931.
1PHAM Qùynh, Influence française, op. cit.
2PHAM Qùynh, conférence, op. cit.
1Editorial du numéro marquant le dixième anniversaire du
Nam phong juil. 1927.
1Voir plus loin la partie sur le mode de chant "a dào".
2Voir à ce sujet R.V.GULIK, La vie sexuelle dans la Chine
ancienne, Gallimard, coll. Tel, 1971, 466p.
1NGUYEN Công Hoan, Doi viêt Van cua tôi (Ma vie d'écrivain),
Hà nôi, 1971, p. 54.
1AN de Hanoi - Fonds de la Mairie de Hanoi, D 643 - 5891.
2Ibid. Lettre du 18 octobre 1934 adressé à l'administrateur-
Maire de Hanoi.
1AN de Hanoi - Fonds de la Mairie de Hanoi, D 643 - 5891.
2Voir CEDAOM - Fonds Guernut-Bl 24, note sur la mutualité au
Tonkin et rapports de l'administrateur-adjoint Bailly.
3Dan bà moi, n° 35 du 02.09.1935.
1CEDAOM - Fonds Guernut-Bl 24.
2CEDAOM - Agence FOM, C 249-D 367.
1Dans ses mémoires, Nguyên Công Hoan relate une anecdote qui
s'est passée au tribunal. Pendant son interrogatoire,
le juge a demandé à Nguyên Tuân ce qu'il faisait comme
métier, il lui a répondu: "Ecrivain". On ne sait pas pour
quelle raison l'interprète a traduit cette réponse par "sans
profession". NGUYEN Công Hoan,_op. cit. p. 108.
1NGUYEN Công Hoan, op. cit. p. 51.
2Ibid. p. 97.
1Il s'agit ici d'un jeu de mots: "cheval-homme" désigne le
tireur de pousse-pousse, tandis que "homme" dans "homme-
cheval" prend le sens d'être humain, et qur "cheval"
désigne, au sens figuré, la femme lubrique et frivole. Voir
le contenu du roman dans la partie "littérature".
2Ibid, p. 115.
1HO Huu Tuong, 41 nam làm bao. Hôi ky (41 ans de journalisme.
Mémoires), Ed Sudestasie, 1984, p. 114.
Il s'agit d'une réedition, la première édition remonte au
début des années 1970 à Saigon.
2NGUYEN Công Hoan, op. cit. p. 174.
1Ibid, p. 188, ...
2VU Ngoc Phan, Nhung nam thang ây (Ces temps-là), Hà nôi,
1987.
3VU Ngoc Phan, Nhà Van hiên dai (Les écrivains modernes),
1ere édition, Doi nay, Hà nôi 1942.
1VU Ngoc Phan, Nhung nam thang ây (Ces temps-là), p. 157.
1Tuyên tâp Vu Trong Phung (Vu Trong Phung: Morceaux choisis),
Editions littéraires, Hà nôi, 1987, p. 10.
2VU Ngoc Phan, Nhung nam thang ây (Ces temps-là), p. 305.
1NGUYEN Công Hoan, op. cit. p. 169.
1VU Ngoc Phan, op. cit. p. 289.
1Phong hoa, n°du 22.09.1932.
1HOAI THANH-HOAI CHAN, Thi nhân Viêt nam, op.cit. p. 21.
2Ibid, p. 23.
3Tuyên tâp Tan Dà (Morceaux choisis de Tan Dà), Les Editions
littéraires, Hà nôi, 1986, p. 419. Cette prise de position
a été présentée par le poète lui-même dans Tiêu thuyêt thu
bây, dans les numéros de novembre et de décembre 1934, que
les présentateurs des "Morceaux choisis" n'ont pas
retrouvés.
1Le fait d'être agent technique dans l'Administration est
déjà considéré par les Vietnamiens de cette époque comme
donnant le rang de mandarin.
1Tuyên tâp Thê Lu (Morceaux choisis de Thê Lu), Les Editions
littéraires, Hà nôi, 1983, p. 544-545.
1Ibid, p. 43-45
1Définition donnée par Maurice Houis et Rémy Bôle-Richard,
dans l'étude: Intégration des langues africaines dans une
politique d'enseignement, Unesco, juin 1977, p. 1.
2Voir DAO Duy Anh, Chu nôm. Nguôn gôc - Câu tao - Diên biên
(Le chu nôm. Origine - Structure - Evolution), Editions des
Sciences sociales, imprimé en France, Sudestasie, 1979, 223 p.
1Ibid. p. 62.
1P. BEILLEVAIRE, "Le Japon", in Histoire de la famille, t. 2,
p. 253.
1LE Van Nuu, Essai sur l'évolution de la langue annamite,
Qui nhon, 1941. Cet ouvrage a été présenté au concours
littéraire organisé par le journal La patrie annamite en
1934-1935.
1Ibid, p. 40.
1DAO Duy Anh, Han-Viêt tu-diên (Dictionnaire sino-vietnamien).
1NGUYEN Thành, Bao chi cach mang Viêt Nam. 1925-1945.
(La presse révolutionnaire vietnamienne. 1925-1945), Ed. des
Sciences sociales, Hà nôi, 1984, p.76.
1Tuyên tâp Nguyên Công Hoan (Nguyên Công Hoan. Morceaux
choisis), Les éditions littéraires, Hà nôi, 1983, p. 21.
2Ibid.
1Tuyên tâp Thê Lu (Thê Lu. Morceaux choisis), Les éditions
littéraires, Hà nôi, 1983, p.9.
1VO Nguyên Giap, Nhung nam thang không thê nào quên
(Les journées inoubliables), Ed. de l'Armée populaire, Hà nôi, 1975, p. 28.
2Ibid, p. 7.
1Voir Vu Ngoc Phan, Nhà van hiên dai (Les écrivains modernes)
ouvrages cités, et Bùi Xuân Bào, Le roman vietnamien
contemporain. 1925-1945, Saigon, 1972.
2Extraits des mémoires de l'auteur servant de préface à une
édition récente de ce roman, Song An Hoàng Ngoc Phach,
Tô tâm, Hà nôi, 1988, p. 20.
1Ibid.
1Ibid., p. 48.
1Ce roman est paru d'abord sous forme de feuilleton dans le
journal Phong hoa en 1934 avant de paraître sous la forme
de roman dans la même année.
2NHAT LINH, Doan tuyêt, nouvelle édition, Hà nôi, 1988, p. 20
3Ibid. p. 23.
1Ibid. p. 38-39.
1Ibid., p. 68.
2La tradition veut que le marié fasse ce geste afin de savoir
si la mariée était encore vierge avant le premier rapport
sexuel.
3Ibid., p. 78.
1Ibid., p. 86.
1Ibid., p. 160-163.
2Ibid., p. 163.
1Bien que ce titre soit paru après Doan tuyêt (Rupture), en
1938, dans Ngày nay, avant d'être publié en entier, il est
conçu comme antérieur à Doan tuyêt. Ces deux romans forment
avec d'autres une série d'histoires continues ayant pour
titre Loan Dung.
2NHAT LINH, Dôi ban, nouvelle édition, Hà nôi, 1988, p. 155.
3Voir M. GODELIER, Le matériel et l'idéel, Fayard, 1984,
348 p.
1NHAT LINH, op. cit. p. 111.
2NHAT LINH, op. cit. p. 157-158.
1KHAI HUNG, Nua chung xuân (Le printemps inachevé), nouvelle
édition, Hà nôi, 1988, p. 134.
1Ibid., p. 227.
1NGUYEN Công Hoan, "Thang an cuop" (Le cambrioleur) in
Tuyên tâp Nguyên Công Hoan (Les morceaux choisis de Nguyên
Công Hoan), vol. 1, Les Editions littéraires, Hà nôi, 1983,
pp. 361-362.
1Ibid., pp. 106-114.
1Ibid., p. 153.
1Ibid., pp. 254-260.
1VU Ngoc Phan, Nhung nam thang ây (Ces temps-là),
Les Editions littéraires, Hà nôi, 1987, p. 167.
2KHAI HUNG, "Gia dinh" (La famille), in Van xuôi lang man
Viêt Nam: 1930-1945 (La prose romantique vietnamienne:
1930-1945), Vol.4, Editions des Sciences sociales, Hà nôi,
1989, pp. 7-240.
1Ibid., pp. 141-154.
2VU Trong Phung, "Vo dê", in Tuyên tâp Vu Trong Phung
(Les morceaux choisis de Vu Trong Phung), Les Editions
littéraires, Vol. 2, Hà nôi, 1987, pp. 270-271.
Ce roman est paru pour la première fois sous forme de
feuilleton dans le journal Tuong lai (L'Avenir) en 1936.
1A la campagne, il suffit de déposer les résidus de la
fabrication de l'alcool, qui est interdite, chez quelqu'un
pour qu'il soit puni par les autorités, lesquelles croient
avoir découvert un foyer de contrebande. Voir plus loin,
dans la partie "Les dessins humoristiques et satiriques".
1VU Trong Phung, op. cit. p. 148-149.
2Ibid., p. 151.
1Ibid., pp. 172-173.
1L'auteur fait sans doute allusion au journal Le travail
d'obédience communiste.
1VU Trong Phung, op. cit., p. 329-330.
2Cette association qui est présidée par Pham Quynh, préconise
le rapprochement culturel de la France et du Vietnam. Elle
organise des débats publics touchant à la culture
vietnamienne, des soirées-spectacles, et des actions
humanitaires.
1Vu Trong Phung, op. cit. p. 333.
1NGUYEN Công Hoan, Buoc duong cùng (La dernière chance),
Edité par l'Association des écrivains, Hà nôi, 1958.
1Ibid. p. 24.
1Voir à ce sujet la nouvelle biographie de Hô Chi Minh
élaborée par Daniel HEMERY, Hô Chi Minh. De l'Indochine au
Vietnam, Ed. Découvertes/Gallimard, nov. 1990, 192 p.
A ce propos, on racontait à Hà nôi une anecdote qui date du
temps où Hô Chi Minh était encore vivant: un membre
du comité central, indigné par cette appellation, interpelle
l'intéressé lors d'une réunion de travail: "Pourquoi devons-
nous tous vous appeler "oncle" alors que certains d'entre
nous sont plus âgés que vous?" Hô Chi Minh garde son sang-
froid et lui répond: "J'accepte votre critique". Mais peu de
temps après, l'indigné est mis au placard par l'entourage de
l'"Oncle".
1VU Ngoc Phan, Nhà van hiên dai (Les écrivains modernes),
vol. 3, p. 581.
1G. BOUDAREL, "L'insertion du pouvoir central dans les cultes
villageois au Vietnam: esquisse des problèmes à partir des
écrits de Ngô Tât Tô", in Cultes populaires et sociétés
asiatiques. Appareils cultuels et appareils de pouvoir,
pp. 87-146, Editions L'Harmattan-Sophia university (Tokyo),
nov. 1991.
1Nous gardons cette traduction habituelle de câu dôi. Le câu
dôi est composé souvent à l'occasion du nouvel an, entre
autres festivités, et est basé sur l'association de deux
vers qui "s'opposent" (dôi). Le sens de dôi ici peut aller
de "en-parallèle" à "en opposition", il s'applique aussi
bien à la sonorité qu'au sens. Voici l'exemple de deux
"sentences parallèles" les plus courtes et les plus simples:
Chim bay (l'oiseau vole)
Ca lan (le poisson nage).
Dans cet exemple, "l'oiseau" "s'oppose" au "poisson", et
"vole", à "nage". Le Câu dôi était un jeu d'esprit, qui
pouvait devenir un jeu de mots dans certains contextes, et
qui passionnait les lettrés de formation classique dans
leurs moments de détente.
1HOAI THANH-HOAI CHAN, Thi nhân Viêt nam (Poètes vietnamiens)
p. 33.
2Ibid. p. 35.
1Ibid. p. 34.
2Ibid.
3Ibid. p. 263-264.
4LUU Trong Lu, Tiêng thu (Les sons d'automne), réédition,
s.l.n.d. p. 33. La première édition de ce recueil remonte à
1939.
1Ibid. p. 58.
1HOAI THANH-HOAI CHAN, op. cit. p. 35.
2Ibid. p. 57.
1VU Ngoc Phan, op.cit. p. 749.
2Ce poème porte le titre de Yêu (Aimer), THE LU, Morceaux
choisis, op. cit. p. 81
3HOAI THANH-HOAI CHAN, op. cit. p. 32.
1Le titre du poème: Bên sông dua khach (Séparation au bord
de la rivière), THE LU, op. cit. p. 58.
1Allusion aux mariées qui s'habillent traditionnellement en
rouge.
2HOAI THANH-HOAI CHAN, op. cit. p. 338-339.
1Ibid. p. 180.
2Tuyên tâp Nguyên Binh (Morceaux choisis de Nguyên Binh),
Les Editions littéraires, Hà nôi, 1986, p. 13-14.
1Au temps où les concours triennaux n'étaient pas encore
supprimés, le lauréat reçu major avait droit à des
cérémonies solennelles. Le village entier devait aller le
chercher en cortège à la capitale, ou au chef-lieu de la
province. On ramènait au village le major (Ong Nghè) dans un
hamac porté par huit personnes. S'il étaitt marié, un autre
hamac était réservé à son épouse. Pour de plus amples
descriptions de ces processions qui étaient la fierté du
village, voir le roman Lêu chong (Le bat-flanc) de Ngô Tât
Tô qui décrit avec minutie ces manifestations.
2HOAI THANH-HOAI CHAN, op. cit. p. 319.
1Cô lai do (La passeusse) in Morceaux choisis, op. cit. p. 35
2Il s'agit de deux subdivisions (thôn) du même village:
l'auteur habite à l'ouest et son amoureuse à l'est.
3Il est impossible de traduire fidèlement les expressions
courantes employées par l'auteur. Nous nous contentons de
donner uniquement leur sens.
4Le bétel et la noix d'arec sont les symboles du mariage.
5Etre amoureux in Morceaux choisis, op. cit. p. 38.
1HOAI THANH-HOAI CHAN, op. cit. p. 315.
2VU Ngoc Phan, op. cit. p. 773.
1Partir c'est mourir un peu;
C'est mourir à ce qu'on aime:
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.
2Ce poème a pour titre Yêu (Aimer). cf.
XUAN DIEU, Dây chùm thuong nho (La grappe d'amour), Les Editions de Dà nang, 1986, p. 122.
1Ibid. p. 124-125.
2Giuc gia (Empressement), ibid. p. 126-127.
2Xa cach (Séparation), Ibid. p. 128-129.
1Le titre du poème: Phuong xa (Le lointain), HOAI THANH-HOAI CHAN, op. cit. p. 328-329.
1Le titre du poème: Quên (L'oubli), HOAI THANH-HOAI CHAN,
op. cit. p. 328.
2Le tire du poème: Say di em (Bois jusqu'à l'ivresse),
HOAI THANH-HOAI CHAN, op. cit. p. 326.
1VIET CHUNG, "La naissance du théâtre moderne au Vietnam", in
Études vietnamiennes, nouvelle série n° 17(87), 1988, p. 13.
1Propos recueilli par nos soins lors de notre séjour au
Vietnam.
1SONG KIM, "Phu nu voi doi diên kich" (La femme et la vie
d'actrice), in Revue Van Nghê (Littérature et Art), 1950,
cité par PHAN Kê Hoanh, "Le théâtre parlé ou kich noi" in
Etudes vietnamiennes, p. 52.
1PHAN Kê Hoanh, op. cit. p. 45.
1VU Dinh Long, Toà an luong tâm, Hà nôi, 1923.
1NGUYEN Van Ngoc, Tuc ngu phong dao (Adages et chansons
populaires), Ed. Mac lâm, Sài gon, 1967, p. 276.
1NGUYEN Van Nam, Cô Tân, pièce en 4 actes, Hà nôi, 1935.
2Khâm thiên était le quartier des "chanteuses" qui attirait
une frange de la jeunesse et des hommes à la recherche du
plaisir.
1VI Huyên Dac, Hai tôi tân hôn (Les deux nuits de noces),
Hai phong, 1928.
1Par abus de langage, et par habitude culturelle, les
Vietnamiens appelaient ceux ou celles qui avaient obtenu des
titres universitaires et qui se destinaient à l'enseignement,
"directeur" ou "directrice" même s'ils ou elles ne l'étaient
pas réellement. Ce qui est le cas de Minh qui est professeur
et non directrice.
1NAM XUONG, Ong Tây An nam (Le Franco-annamite), Hà nôi,
1931.
1PHAN Kê Hoanh, op. cit. p. 51.
2Ibid. p. 108-109.
1CEDAOM - Agence FOM C248-D363.
2Ibid.
3Ibid.
4Ibid.
1Ibid. Communiqué de "la presse indochine" du 30 juin 1924.
2CEDAOM - Service économique C19 c125. Liste des films
cinématographiques de l'Agence économique de l'Indochine
à Paris, 1935.
1CEDAOM - Service Economique, C43 c27.
2NGUYEN Vy, Tuân chàng trai dât Viêt (Tuân le jeune homme du
Vietnam), t.1, p. 279.
3CEDAOM - Agence FOM C248-D363. Les Annales coloniales du
2 août 1926.
4CEDAOM - Service économique C43-c27.
1L'Avenir du Tonkin, 7 mars 1924. CEDAOM - Agence FOM op.cit.
2Le Petit journal du 4 juin 1926. CEDAOM, op. cit.
1TO HOAI, Chuyên cu Hà nôi (Les vieilles histoires de Hà nôi)
2e édition, Hà nôi, 1990, p. 47. La première édition remonte
à 1986.
2La Presse coloniale du 16 sept. 1925. CEDAOM, op. cit.
1La Dépêche coloniale, 18 jan. 1933. CEDAOM, op. cit.
2CEDAOM - Agence FOM, op.cit.
3La dépêche coloniale du 18 janvier 1933. CEDAOM, op. cit.
4AN - Fonds Mairie Hanoi, D615-3167.
5Ibid.
6Ibid.
1AN - Fonds Mairie Hanoi, D615-3171.
1CEDAOM - Service Economique, C43 c27.
1Ibid.
1Ibid.
2Ibid.
1Ibid.
2NGUYEN Công Hoan, Nho và ghi (Souvenirs), Hà nôi, 1978, p.82
3CEDAOM - Service Economique, C43 c27.
1Ibid.
1Ces chiffres sont tirés des dossiers du Fonds Guernut du
CEDAOM.
1CEDAOM - Agence FOM, C 248 - D 360. Chronique coloniale du
10.01.1937.
1NGUYEN Vy, op. cit. p. 368, tome 1.
1Cai nan lam quyên (Le fléau de l'abus du pouvoir) in
Dàn bà moi, n°17 du 13 avril 1935.
2NGO Tât Tô, Tac phâm (Oeuvres), Les éditions littéraires,
Hà nôi, 1977, 2 tomes. Le tome 1 regroupe les petis articles
sur des sujets très variés, parus au cours des années 1930
dans la presse. Le tome 2 rassemble des reportages sur les
activités autour du Dinh, sous le titre de Tâp an cai dinh
(Procès du Dinh), et sur "Les affaires du village" (Viêc
làng), et deux romans: Tat dèn (Extinction de la lumière) et
Lêu chong (La tente et le bat-flanc) qui dénonce le
mandarinat.
1Voir plus loin dans la partie "Les lieux de plaisirs".
1L. BONNAFONT, Types tonkinois, (Dessins de A. CEZARD),
Hà nôi, imprimerie Schneider, 1903, p. 90.
1Les Vietnamiens considèrent traditionnellement que les
mandarins sont les parents du peuple.
1CEDAOM - Papiers Moutet - PA 28 - C3 d77.
1Ibid.
1Ibid.
2Les Vietnamiens appelaient les Français, quel que soit leur
fonction ou leur grade, de l'agent de police qui règle la
circulation au gouverneur général, "Monsieur le (grand)
mandarin".
3Dans l'ancien Vietnam on enfilait sur un lien 100 pièces de
monnaie percées (100 unités monétaires) pour former une
ligature, une somme déjà considérable.
1CEDAOM - F03 - 20b. Rapport du 17 juin 1909.
1Dr. Ch. GRALL, L'hygiène coloniale appliquée. Hygiène de
L'Indochine, Ed. Baillière, Paris, 1908, p. 44.
1NGUYEN Vy, op. cit. p. 242.
2ASI, période 1913-1922.
3AN - Fonds Mairie de Hà nôi, T23 - 4990.
1Van minh, n° 46 du 08.06.1927.
2ASI.
3NGUYEN Vy, op. cit. p. 101.
1Voir le chapitre suivant sur "Les lieux de plaisirs".
1Interview de Jacques Lizot sur France Culture au sujet des
indiens Yanomami en novembre 1991.
2A. BONIFACY, B.E.F.E.O., 1915, XV, p. 17-23. Cité par G. BOUDAREL, "L'insertion du pouvoir central dans les cultes
villageois au Vietnam: esquisse des problèmes à partir des
écrits de Ngô Tât Tô", in Cultes populaires et sociétés
asiatiques, Editions L'Harmattan-Sophia University (Tokyo), 1991, p. 120-121.
1NGO Tât Tô, "Lêu chong", in Tac phâm (Oeuvres), Les Editions Littéraires, Hà nôi, 1977, tome 2, p. 341.
1Voir le chapitre suivant sur le suicide
1NGO Tât Tô, Tac phâm, op. cit. p. 217. Cité par G. BOUDAREL, op. cit. p. 90.
1Vê vân dê xac dinh thành phân cac dân tôc thiêu sô o miên Bac
Viet nam (A propos de la détermination des minorités
ethniques au Nord Vietnam), ouvrage collectif de l'Institut
d'Ethnologie, Editions des Sciences sociales, Hà nôi, 1975,
p. 15-19.
1Voir l'ouvragre récent de l'Intitut d'Archéologie sur cette
question: Van hoa Hoà binh o Viêt Nam (La civilisation
hoabinhienne au Vietnam), Edité avec le concours de la
Fondation Toyota, Hà nôi, 1989, 260 p. Ouvrage bien documenté
avec des données chiffrées, des tableaux des sites
archéologiques et des vestiges correspondants trouvés,
bibliographie, photos.
1G. BOUDAREL, "L'insertion du pouvoir central dans les cultes
villageois au Vietnam: esquisse des problèmes à partir des
écrits de Ngô Tât Tô", in Cultes populaires et sociétés
asiatiques, ouvrage collectif dirigé par A. FOREST,
L'Harmattan-Sophia University (Tôkyo), 1991, p. 92.
2NGUYEN Huu Khang, La commune annamite. Etude historique,
juridique et économique, Paris, 1946, p. 32.
1NGO Tât Tô, "Tâp an cai dinh" (le procès du dinh), in Tac
phâm (Oeuvres), Hà nôi, Editions littéraires, 1977. Cité par
G.BOUDAREL, op. cit.
2DOAN thi Tinh, Tim hiêu trang phuc Viêt Nam (Recherches sur
les costumes vietnamiens), Hà nôi, 198., p. 38.
1Dr. VU Ngoc Huynh, Le laquage des dents en Indochine, Hà
nôi, Imprimerie Lê Van Phuc, 1937, p. 6.
Voir aussi l'article de P. HUARD, "Le noircissement des
dents en Asie orientale et en Indochine", in France-Asie,
n° 28 et 29.
2VU Ngoc Hùynh, op. cit. p. 7.
3Ibid.
1Ibid.
1Pour plus de précisions, notamment sur les proportions dans
ces mélanges ainsi que sur les techniques de noircissement,
se rapporter à l'ouvrage cité du docteur VU Ngoc Huynh.
2Ibid. p. 8.
3Ibid.
4B.H. CHAMBERLAIN, Moeurs et coutumes du Japon, traduction de
Marc LOGE, Payot, Paris, 1931, p. 144.
1L. FREDERIC, La vie quotidienne au Japon au début de l'ère
moderne (1868-1902). Hachette, Paris, 1984, p. 30, 163.
2E. LANGLET, Le peuple annamite. Moeurs, croyances et
traditions, Ed. Berger-Levrault, Paris 1913, p. 89.
3J. SILVESTRE, L'Empire d'Annam et le peuple annamite, Paris,
1889, p. 111-112. Cité par NGUYEN Van Phong, La société
vietnamienne de 1882 à 1902, PUF, Paris, 1971, p. 141.
1NGO Tât Tô, "Hoi dông bào Viêt Nam, chung ta nên ve minh cho
con cai chung ta" (Compatriotes vietnamiens, nous devons
tatouer le corps de nos enfants), in Dông phuong, n°394 du
30.03.1931.
Reproduit dans "Oeuvres", op. cit., tome 1, p.129-130.
1DOAN thi Tinh, op. cit.
2Ibid.
3Ibid. p. 11.
1La question des cheveux sera traitée plus loin.
1Dr. VU Ngoc Hùynh, op. cit. p. 18.
2Ibid.
3NGUYEN Công Hoan, Nho và ghi (Souvenirs), Hà nôi, 1978, p.
107.
1Dr. VU Ngoc Hùynh, op. cit. p. 54.
2Vit duc, 22.06.1938.
1NGO Tât Tô, "Lêu chong", in "Oeuvres", op. cit. tome 2.
1K. POLANYI, La grande transformation. Aux origines
politiques et économiques de notre temps. Traduit par C.
MALAMOND et M. ANGELO, Bibliothèque des Sciences humaines,
Gallimard, Paris, 1983, p. XVII.
2DOAN Thi Tinh, op. cit. p. 6.
1NGO Tât Tô, "Cette chose mérite d'être préservée", in Thoi
vu, n° 140, 04.07.1939. Repris dans Oeuvres, op. cit.
2Ibid.
1TRUONG Vinh Ky, Chuyên di Bac ky nam ât hoi (Le voyage au
Tonkin en 1876), Saigon 1881.
2E. LANGLET, op. cit. p. 84.
3Propos recueillis par nous lors de notre séjour au Vietnam
en été 1990.
1R.E. MICHEL, La lecture française au Cours moyen, Ed. My
thang, Nam dinh, 1928.
2NGUYEN Van Phong, op. cit.
1NGUYEN Vy, op. cit., tome 1, p. 128.
1Ce poème et les précisions sur Nguyên Hàng Chi nous ont été
généreusement fournis, lors de notre séjour au Vietnam durant l'été 1990, par Nguyên Du Chi, descendant de la famille, spécialiste des arts populaires.
2NGUYEN Van Xuân, Phong trào Duy Tân (Le mouvement Duy Tân),
Ed. La bôi, Saigon, 1970, p. 295-304.
1NGUYEN Vy, op. cit., tome 1, p. 111.
2NGUYEN Tao-S.SAMY, Nouveaux textes annamites, Hà nôi-Vinh, 1921.
1PHAM Qùynh, "L'évolution annamite", in Impartial,
03.11.1939, CEDAOM - Agence FOM, C 249 D 367.
2NGUYEN Vy, op. cit., tome 1, p. 80-81.
1M. FAVRE, Un milieu porteur de modernité: travailleurs et
tirailleurs vietnamiens en France pendant la Première Guerre
mondiale, thèse à l'Ecole nationale des Chartes, 1986, p.
533.
2Ibid. p. 335.
3Ibid. p. 541.
4Ibid. p. 545.
5Ibid.
1NGUYEN Vy, op. cit., tome 1, p. 277.
2Ibid.
3NHI LINH, "Môt ban chuong trinh" (un programme), in Phong
hoa, 02.02 1934.
1Voir les dessins humoristiques dans le chapitre précédent.
1NGUYEN Công Hoan, Nho và ghi (Souvenirs), Hà nôi, 1978, p.
117.
1PHAM Ta-LE Van Lê, Le petit écolier, Ed. Nam ky, Hà nôi,
1928.
2G. BALANDIER, Le détour. Pouvoir et modernité, Fayard,
Paris, 1985, p. 168.
1NGUYEN Vy, op. cit. p. 111.
2Ibid. p. 501.
3Ibid.
4Ibid. p. 506.
1NGUYEN Van Xuân, op. cit. p. 250.
2PHAN Chu Trinh, Trung ky dân biên thi mat ky, cité par
NGUYEN Van Xuân, op. cit. p. 251.
1TU LY, "Quôc hôn quôc tuy" (Essence nationale) in Phong hoa,
n° 125 du 23.11.1934.
2Ibid.
1Nhi linh, "Môt ban chuong trinh" (Un programme), in Phong
hoa n°84 du 02.02.1934.
2C. PARIS, Voyage d'exploration de Huê en Cochinchine par la
route mandarinale, Paris, 1889, p. 292. Cité par NGUYEN Van
Phong, op. cit. p. 145.
1NGUYEN Vy, op. cit. p. 204, tome 1.
2DUY TAC, "Vê sinh và cach an mac cùng nhà o cua ta"
(L'hygiène, l'habillement et l'habitat de chez nous), in
Khoa hoc tap chi,n°12 du 15.12.31.
3NGUYEN Van Ngoc, Tuc ngu phong dao (Proverbes et chansons
populaires), Ed. Mac lâm, Saigon, 1967 (réédition). La
première édition remonte à 1928 (Hà nôi).
1NGUYEN Vy, op. cit. p. 111, tome 1.
1Phong hoa, n° 56 du 21.07.1933.
2Viêt Sinh, " Quân ao moi" (La nouvelle tenue) in Ngày nay,
n° 1 du 30.01.1935.
3Ngày nay, n°1 du 30.01.1935.
1Publicité parue dans Ngày nay du 29.08.1937. On peut y lire
encore ces lignes:
"Le magasin de mode féminine moderne le plus grand du
Tonkin. Lemur, 16 rue Lê Loi - Hà nôi, du dessinateur Nguyên
Cat Tuong l'initiateur de la nouvelle tenue vestimentaire".
2VIET SINH, op. cit.
1E. LANGLET, op. cit. p. 84.
2CAT TUONG, "Y phuc cua phu nu" (Les habits des femmes), in
Phong hoa n°87 du 02.03.1934.
3Ibid., Phong hoa n° 89 du 16.03.1934.
4CO DUYEN, "Dàn bà ngày nay" (La femme d'aujourd'hui), in Ngày nay, n° 21 du 10.08.1936.
1CO DUYEN, "Bô nguc dàn bà" (La poitrine de la femme), in
Ngày nay, n° 36 du 29.11.1936.
1CAT TUONG, "Y phuc cua phu nu" (Les habits des femmes), in
Phong hoa, n° 90 du 23.03.1934.
2CO DUYEN, op. cit.
3NGUYEN Van Ngoc, op. cit. p. 74.
1J. BONET, Quelques notes sur la vie extérieure des Annamites, Ed. Leroux, Paris, 1905.
2C. PARIS, op. cit. p. 290-291. Cité par NGUYEN Van Phong, op. cit. p. 142.
1A. CORBIN, "Le secret de l'individu", in Histoire de la vie
privée, tome 4, p. 421.
2Voir "Les fêtes villageoises" dans un précédent chapitre ou
le quan ho au chapitre suivant.
1Phong hoa, n°103 du 23.06.1934.
2Cités par CO DUYEN, op. cit.
3PHAN Thi Nga, "Chi em Hôi-an voi phong trào y phuc Cat Tuong"(Les femmes de Hôi-an et le mouvement de la tenue Lemur), in Ngày nay n°5 du 10.03.1935.
1Quant à Phu nu tân van, un autre journal féministe paru dans le Sud (1929-1935) nous l'avons laissé de côté. David G. MARR l'a déjà bien dépouillé dans son ouvrage Vietnamese tradition on trial 1920-1945, University of California Press, 1981.
2Phong hoa n°100 du 01.06.1934.
1G. BOUDAREL, "L'insertion du pouvoir central dans les cultes
villageois au Vietnam : esquisse des problèmes à partir des
écrits de Ngô Tât Tô", in Cultes populaires et sociétés
asiatiques. Appareils cultuels et appareils de pouvoir,
ouvrage collectif dirigé par A. FOREST, L'Harmattan 1991,
p. 114.
1Dàn bà moi, n°19 et 20 des 27.04. et 04.05.1935.
1Dàn bà moi n° 17 et 18 des 13 et 20 avril 1935.
2Ibid.
1Ngày nay, n° 27 du 27.09.1936.
1THANH VAN, "Hiêu - tinh" (Piété et amour) in PNTD, n° 134
du 23.05.1931.
1La version originale de cette phrase est le vers de
Corneille dans Le Cid :
"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire".
2H.G.T.P., "Vân dê binh dang voi chi em ta" (Le problème de
l'égalité et nous [les femmes]), in PNTD n°1 du 08.12.1930.
3Editorial, n° 52 du 09/10.02.1931.
1NGUYEN Thi Khang, "Le féminisme annamite", in Monde, n°3
du 21.12.1933.
1Monde, n°6 du 18.01.1934.
2PNTD n°48 du 05.02 1931.
3PNTD n°23 du 05/06.01.1931.
4Voir plus loin dans la partie "Les lieux de plaisirs".
1Editorial, n° 30 du 15.01.1931.
2PNTD n° 78 du 16/17.03.1931.
3Editorial, n° 22 du 04.01.1931.
4PNTD n°31 du 16.01.1931.
1PNTD n° 136, 25/26.05.1931.
1VU Xuân Thuât, "Du mariage forcé au mariage libre", in PNTD
n° 32 du 17.01.1931.
1LUONG Xuân Huê, "Môt y kiên vê viêc cai cach chê dô hôn nhân
trong xa hôi Viêt nam" (Une idée de réforme du régime
de mariage dans la société vietnamienne), in PNTD n°79
du 18.03.1931.
2Ngày nay n° 58 du 09.05.1937.
3PNTD n°53 du 11.02.1931.
1Ngày nay n° 60 du 23.05.1937.
2CEDAOM - Fonds Guernut, Bd 24, "Condition de la femme et
de l'enfant".
1Ibid.
1Ibid.
1M. CARTIER, "Famille chinoise", in Histoire de la famille,
Armand Colin, Paris, 1988, p. 214, tome 2.
2Ibid.
1E. SHORTER, Naissance de la famille moderne, traduit de
l'anglais par S. QUADRUPPANI, coll. Points-Histoire, Seuil,
Paris, 1977, p. 39.
2Ibid. p. 40.
1A.BURGUIER & F.LEBRUN, "Le prêtre, le prince et la famille",
in Histore de la famille, op. cit. p. 111.
1Ibid. p. 111.
2Ibid.
3Ibid. p. 112.
1PNTD n°1 du 08.12.1930.
1Dàn bà moi n°25 du 17.06.1935.
1VU Ngoc Phan, Nhung nam thang ây. Hôi ky (Ces temps-là.
Mémoires), Hà nôi, 1987, p. 145.
1THAI Van Kiêm, Dât Viêt Troi Nam (Le ciel et la terre du
Vietnam), Ed. Nguôn sông, Saigon, 1960, p. 216.
1A cette époque les Vietnamiens ne s'embrassaient pas encore
à la manière occidentale mais "à la manière vietnamiene" qui
consiste à poser avec le nez de petits souffles surtout la
joue.
NGUYEN Vy, Tuân chàng trai dât Viêt, op. cit. p. 87-89.
2Ibid.
3Signes de richesse.
1THIEN CAN, "Yêu anh dô" (L'amour pour l'étudiant) in
Phong hoa n° 54 du 07.07.1934.
1NGUYEN Vy, op. cit. p. 145.
2Propos recueillis par nous au cours de notre séjour au
Vietnam durant l'été 1990.
1Ibid.
2TRONG LANG,op. cit.
3NGUYEN Van Huyên, La civilisation annamite, 1944, p. 40.
1E. SHORTER, op. cit. p. 192.
1Tan tiên, n°30 du 04.04.1936.
2E. SHORTER, op. cit. p. 180.
3République du 31.12.1938. CEDAOM - Agence FOM, C248-D360.
1DAO Dang Vy, L'annam qui naît, Imprimerie du Mirador, Huê,
1938, p. 52.
1Ibid. p. 48.
2NGUYEN Vy, op. cit. tome 1, p. 232.
3Chronique coloniale du 10.01.1937, in CEDAOM - Agence FOM,
C 248 D 360.
1TR0NG KHANH-VIET SINH, "Hà nôi ban dêm" (Hà nôi by night),
in Phong hoa, n° 51 du 16 juin 1933.
Ce reportage fait partie d'une série de reportages (mars-
juillet 1933) sur la prostitution à Hà nôi sous diverses
formes, des lieux populaires aux maisons de luxe.
1Ibid. Phong hoa n°48 du 26 mai 1933.
1DAO Dang Vy, op. cit. p. 115.
2Ibid. p. 232.
3Ibid. p. 236.
4NGUYEN Manh Tuong, L'individu dans la vieille cité
annamite. Essai de synthèse sur le code des Lê, Montpellier,
1932, 410 p.
1DAO Dang Vy, op. cit. p. 223.
2Ibid. p. 115.
1AN - Fonds de la Mairie de Phu tho, G 09 - 981.
1Ibid. G 33/G 5 - 1001.
2P. PASQUIER, L'annam d'autrefois. Essai sur la constitution
de l'Annam avant l'intervention française, Ed Augustin
Challamel, 1907, p. 37.
1NGUYEN Van Huyên, La civilisation annamite, sl, 1944,
p. 67.
2Ibid.
3Propos recueillis par nous lors de notre séjour à Hà nôi
en été 1990.
4Chuyên Phong hoa (Histoires des moeurs), n° 2 du 08.03.1928
1DBM n° 18 DU 20.04.1935.
2La dépêche coloniale du 03.04.1937, in CEDAOM - Agence FOM,
C 249 D 367.
1AN - Fonds de la Mairie de Phu tho, D638 - 105.
1AN - Fonds de la Mairie de Hà nôi, D638 - 2574.
2Ibid.
1Ibid., D 638 - 2587.
2Ibid.
3Ibid.
1Travaux de la Ligue prophylactique de la ville de Hanoi.
Procès verbal de la 7e réunion, IDEO, Hà nôi, 1938.
1AN - Fonds de la Mairie de Hà nôi, D 638 - 2580.
2Ibid., D 638 - 2587.
1AN - Fonds de la Mairie de Phu tho, D 638 - 105;
AN - Fonds de la Mairie de Hà nôi, D 638 - 2587.
2Ibid.
1AN, D 638 - 2587.
2Ibid.
3Ibid.
4Ibid.
1AN - Fonds de la Mairie de Phu tho, D 368 - 102.
1AN - D 638 - 2587.
2AN - Fonds de la Mairie de Hà nôi, T 12 - 4908.
1Dr. COPPIN, "La prostitution, la police des moeurs et le
dispensaire munciapl à Hanoi" in Bulletin de la Société
Médico-chirurgicale Indochine, juin 1925, cité par
M.H. Virgitti et le Dr. Joyeux, Le péril vénérien
dans la zone suburbaine de Hanoi, IDEO, Hà nôi, 1938.
Cette brochure résume "Les travaux de la ligue
prophylactique de la ville de Hanoi", dont les deux auteurs
sont respectivement le président et le secrétaire.
2AN - Fonds de la Mairie de Hà nôi, D 638 - 2590.
1Ibid.
1Procès verbal de la 7è réunion du Comité de la Ligue
prophylactique, Hà nôi, 1938.
1M.H. VIRGITTI - Dr. JOYEUX, op. cit.
1ASI, année 1937-1938.
2Ibid.
1TRONG LANG, Hà nôi lâm than (Hà nôi miséreuse), Hà nôi,
1938, p. 68.
1Melles NGAN PHUONG - LE HONG, Cô dâu không phai là gai mai
dâm. Tra loi ông Si Ky vê viêc xin bat cô dâu phai di kham
bênh (Les chanteuses ne sont pas des filles publiques.
Réponse à M. Si Ky à propos de l'obligation pour les
chanteuses de passer la visite médicale.), s.l.n.d.
2Ibid.
3Ibid.
1M.H. VIRGITTI - Dr. JOYEUX, op. cit.
1TRONG LANG, op. cit. p. 101.
2Ibid.
3Ibid. p. 108.
1Ibid.
1Ibid.
2Ibid.
1Tiêng dân, 13.01.1932.
2DAT VAN, "Nguyên nhân cua nan mai dâm" (Les causes de la
prostitution), in Tân tiên, n° 38 du 30.05.1936.
1M.H. VIRGITTI - DR. JOYEUX, op. cit.
2TRONG LANG, op. cit.
3Ibid.
1Ngày nay, n°3 du 20.02.1935.
2Ibid.
3M.H. VIRGITTI - DR. JOYEUX, op. cit.
4NGUYEN VY, Tuân chàng trai dât Viêt (Tuân le jeune homme du
Vietnam), tome 2, p. 148.
Dàn bà moi, n°34 du 26.08.1935.
1M.H. VIRGITTI - DR. JOYEUX, op. cit.
2Ibid.
1VU Công Hoè, Du suicide dans la société vietnamienne, thèse de médecine, Hà nôi, 1937, 63 p.
2NGUYEN Van Ung, Evolution démographique du Vietnam, Faculté de Droits, 1953.
1E. DURKHEIM, Le suicide, collec. Quadrige, 6e édition, PUF, 1991, p. 234-237.
1J.C. CHESNAIS, Histoire de la violence, Coll. Pluriel, Ed. Robert Lafont, Paris 1981, p. 202.
2Ibid.
3Chuyên Phong hoa, 21.02.1928.
4Phong hoa, n° 6 du 21.07.1932.
1Phong hoa, n° 8 du 04.08.1932.
2Khoa hoc tap chi, n° 23 du 01.06.11932.
3DAO Dang Vy, op. cit. p. 191.
1Ibid.
2TO HOAI, Câu chuyên môt dê tài (Histoire d'un sujet),in Nguoi Hà nôi (Les Hanoïens), n° 21(219) 25 mai-1er juin 1991.
Cet article est inspiré des questions que nous avons posées à l'auteur, lors de notre séjour au Vietnam pendant l'été 1990, sur les différents aspects de la vie culturelle et quotidienne des années 1930. Tô Hoài nous avait répondu partiellement lors des nos rencontres, puis il a complété ses réponses par cet article que nous avons découvert grâce à un concours de circonstances.
1TRONG LANG, op. cit. p. 52.
2Monde, n° 6 du 18.01.1934.
1J.C. CHESNAIS, op. cit. p. 202.
2E. DURKHEIM, op. cit.
3Ibid. p. 231.
1Ibid. p. 165-170.
2Ibid.
1J.C. CHESNAIS, op. cit. p. 245.
1Ibid. p. 201.
2Phong hoa, n° 6 du 21.07.1932.
3J.C. CHESNAIS, op. cit. p. 204.
4Ibid. p. 205.
1A. CORBIN, "Cris et chuchotements", in Histoire de la vie
privée, tome 4, p. 575-579.
1E. DURKHEIM, op. cit. p. 223.
1M. PERROT, "La famille triomphante", in Histoire de la vie
privée, tome 4, p. 94.
2A. CORBIN op. cit. p. 591.
3La dépêche coloniale, op. cit.
1A. LAURENT, L'individu et ses ennemis, Coll. Pluriel,
Hachette, Paris, 1987, 571 p.
1L. DUMONT, Essai sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, coll. Esprit, Seuil, Paris, 1983; p. 33.
2Citons quelques autres ouvrages :
* L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain
de Gilles Lipovetsky, coll. Folio/Essai, Gallimard, 1983;
* Le retour de l'individu de Jean-François Revel, in Le
Point du 5 décembre 1983;
* Souci de soi de Michel Foucault, 1984;
* 54 millions d'individus sans appartenance de Gérard
Mendel, 1983.
3A. LAURENT, op. cit. p. 28-34.
4Ibid. p. 240-270.
1Ibid. p. 20.
2Voir A. ZINOVIEV, Le communisme comme réalité, 1981, cité par A. LAURENT, op. cit. p. 494-497.
3A. LAURENT, op. cit. p. 17.
1L. DUMONT, op. cit. p. 35.
2L. VANDERMEERSCH, Le nouveau monde sinisé, Coll. Perspectives internationales, PUF, 1986, p. 173.
1Principes de la philosophie du droit, 1821, cité par M. PERROT, "La famille triomphante", in Histoire de la famille, tome 4, p. 94
2P. CLASTRES, La société contre l'Etat, Ed. de Minuit, Paris, 1974.
1A. LAURENT, op. cit. p. 15.
2Voir à ce sujet R. GARAUDY, Parole d'homme, Coll. Points-
Actuels, Ed. R. Laffont, Paris 1975, pp. 37-49.
3PHAN Thi Dac, Situation de la personne au Viet-nam, Ed. du CNRS, Paris 1966, 206 p.
4Ibid. p. 195.
1Propos recuilli par nous au cours de notre séjour au Vietnam durant l'été 1990.
2J. CHESNEAUX, Du passé faisons table rase ?, Ed. Maspero, Paris, 1976, p. 14.
3Propos recuilli par nous au cours de notre séjour au Vietnam durant l'été 1990.
1NGUYEN Manh Tuong, L'individu dans la vieille société annamite. Essai de synthèse sur le code des Lê, Montpellier, 1932, p. 12.
2NGUYEN Van Huyên, La civilisation annamite, 1944, p. 68.
3DO Bang Doàn-DO Tong Huê, Viêt Nam ca trù biên khao (Etude sur le mode de chant ca trù du Vietnam), Saigon, 1962, p. 57.
1NGO Tât Tô, "Lêu chong" (La tente et le bat-flanc), in Tac phâm (Oeuvres), Tome 2, Editions littéraires, Hà nôi, 1977, p. 499-500.
2Phong hoa n°135 du 08.02.1935.
1DO Bang Doàn-DO Trong Huê, op. cit. p. 45.
2Ibid. p. 46.
1Ibid. p. 38-43.
1Ibid. p. 38-43.
1Voir à ce sujet les ouvrages de
* A. AKIYAMA, Geisha girls, Yokohama, Yoshikawa book
store, 1937.
* K. YAMATA, Trois geishas, Ed. Domat, Paris, 1953;
ouvrage fort intéressant sur la formation des geishas et
leur rôle dans la société japonaise.
* Dr. TRESMIN-TREMOLIERES, La cité d'amour du Japon, Ed.
A. Michel, s.d.
1DO Bang Doàn-DO Trong Huê, op. cit. p. 57-58.
2Ibid., et
NGUYEN Q. Thang-NGUYEN Ba Thê, Tu diên nhân vât lich su
Viêt Nam (Dictionnaire des personnages historiques du
Vietnam), Ed. des Sciences sociales, Hà nôi, 1991, p. 122.
Rappelons également qu'après le règne de Lê Hiên Tông
(1497-1504) la dynastie des Lê tomba en décadence avec
succession de crises interminables du palais, ce qui
aboutit à la partition du pays en deux seigneuries à la
hauteur de la rivière Gianh : les Trinh au Nord et les
Nguyên au Sud. La réunion du pays n'a été ensuite entamée
qu'avec les révoltes des Tây son au XVIIIe siècle.
1NGO Linh Ngoc-NGO Van Phu, Tuyên tâp tho ca trù (Recueil
de poèmes en mode ca trù), Les Editions littéraires, Hà nôi, 1987, p. 13 et 17.
2DO Bang Doàn-DO Trong Huê, op. cit. p. 165.
1Ibid. p. 206.
1Voir le chapitre consacré à la poésie moderne.
1NGO Linh Ngoc-NGO Van Phu, op. cit. p. 68-69, et DO Bang Doàn-DO Trong Huê, op. cit. p. 316.
2Position qui caractérise la réflexion d'après les réflexes
des Vietnamiens.
1NGO Linh Ngoc-NGO Van Phu, op. cit. p. 78.
2En vietnamien hu hi, terme familier avec une forte connotation de plaisirs (charnels).
3NGO Linh Ngoc-NGO Van Phu, op. cit. p. 103.
1Dans la version originale, les expressions "aller à
l'école", "passer les concours", "être mandarins" sont
dédoublées avec une certaine altération dans la deuxième
expression qui donne à l'ensemble un caractère ironique
qu'il est impossible de retranscrire en français. Par
exemple, di hoc (aller à l'école) se double de di hiêc.
2NGO Linh Ngoc-NGO Van Phu, op. cit. p. 129-130.
1DO Bang Doàn-DO Trong Huê, op. cit. p. 419.
1Ibid. p. 503.
2Rappelons que chaque village vietnamien possède deux noms, l'un littéraire (tên chu) et l'autre populaire (tên nôm).
1Voir tableau de la page 172 de l'ouvrage de :
DANG Van Lung-HONG THAO-TRAN Linh Quy, Quan ho. Nguôn gôc và qua trinh phat triên (Le quan ho. Ses origine et son développement), Editions des Sciences sociales, Hà nôi, 1978, 527 p.
Ouvrage de référence, à notre avis, qui traite le sujet dans sa globalité; les auteurs fournissent entre autres, une bibliographie très complète sur la question.
1Ibid. p. 201.
1Ibid. p. 196.
1Ibid. p. 20.
2Ibid. p. 359.
1Voir le calendrier des fêtes dans la partie "Les moeurs
villageoises à travers les fêtes", et aussi l'ouvrage sur
le quan ho cité, p. 390.
2VU Ngoc Phan, Tuc ngu, ca dao, dân ca Viêt Nam (Dictons,
proverbes et chansons populaires du Vietnam), Editions des
Sciences sociales, 5e édition, 1978, p. 600.
1NGO Tât Tô, op. cit.
1DANG Van Lung-HONG THAO-TRAN Linh Quy, op. cit. p.381.
2Ibid.
1Dans la période 1956-1976, six ouvrages et une bonne vingtaines d'articles sur le quan ho ont été publiés. En outre, cinq colloques ont été organisés sur cette question avec la collaboration du Centre culturel de la province de Hà-bac (Ty van hoa tinh Hà-bac), le pays natal du quan ho.
Chiffres tirés de la bibliographie fournie par l'ouvrage de trois auteurs, DANG Van Lung-HONG Thao-TRAN Linh Quy, op. cit.
Notons aussi que dans les représentations officielles de spectacles, le quan ho figure en bonne place commefolklore du pays.
1Propos recueillis par nous.
1Ici comme ailleurs, quand les Vietnamiens se rencontrent,la première question qu'on pose à l'autre consiste à s'informer du village natal de l'interlocuteur.
1Voir sur "Les moeurs villageoises à travers les fêtes" le premier chapitre de la première partie.
1Chanson recueillie par nous.
1Chanson du village de Lim, recueillie par nous.
2Chanson de Lim, recueillie par nous.
1VU Ngoc Phan, op. cit. p. 609.
Ce recueil est classé par genres et par thèmes. En outre, on y trouve également des chansons populaires de certaines minorités ethniques, telles que les Thai, les Tày, les Muong, les E-dê, les Hmong.
1Ibid. p. 605.
2Chanson recueillie par nous.
3Le bois de Lim, qui a une forte densité, ne flotte pas
mais coule au fond de l'eau.
4Il s'agit plus précisément des trach, une sorte d'anguille assez rare qui pond naturellement ses oeufs dans l'eau.
5Les merles pondent naturellement leurs oeufs dans leur nid qui se trouve généralement au sommet de l'arbre. Il s'agit bien entendu, dans ces deux derniers vers, de l'inversion des lois de la nature.
1TRAN Quôc Vuong, DUONG Tât Tu et LE van Hao, Mùa xuân và phong tuc Viêt Nam (Le printemps et les traditions vietnamiennes), Hà nôi, 1970.
2Objet symbolisant une promesse d'amour.
3Allusion au risque de jalousie chez la femme de son ami.
1Allusion au mariage, au départ de son village pour rejoindre son ami.
2Chanson d'adieu de Lim, recueillie par nous.
3Bien que le terme vietnamien nguoi oi (employé pour appeler quelqu'un) dissimule sous une apparence neutre, il signifie bien dans ce contexte "mon-bien aimé" ou "mon amour".
4Chanson recueillie par nous.
1Ces informations nous ont été communiquées par un spécialiste vietnamien dont nous taisons le nom pour lui éviter des tracas.
2La thèse de Florence Yvon qui traite particulièrement cette question est en préparation.
1G. BOUDAREL, "L'insertion du pouvoir central dans les cultes villageois au Vietnam : esquisse des problèmes à partir des écrits de Ngô Tât Tô", in Cultes populaires et sociétés asiatiques, ouvrage collectif, collec. Recherches asiatiques, Edition L'Harmattan, 1991, p. 125.
1Propos recueilli par nous.
1Voir à ce sujet l'ouvrage fort intéressant de Kiku YAMATA, Trois geishas, Ed. Domat, Paris, 1953, qui retrace l'éducation, la formation des geishas, le rôle des patronnes, et la place des unes et des autres dans la société.
1J. CHESNEAUX, Du passé faisons table rase ?, Ed. Maspero,
Paris, 1976, p. 29.
|
Sommaire de la rubrique
|
Haut de page
|