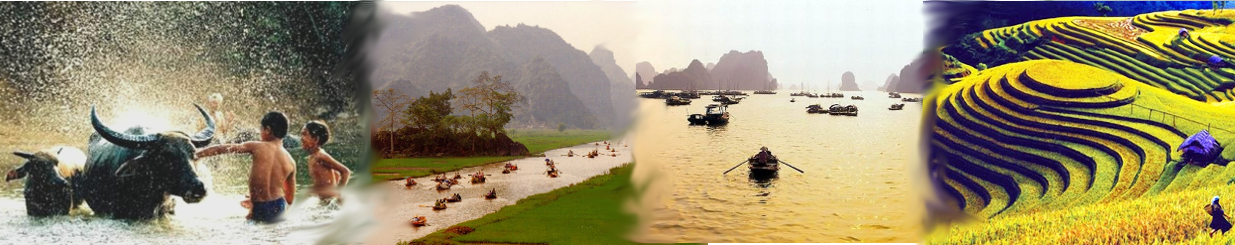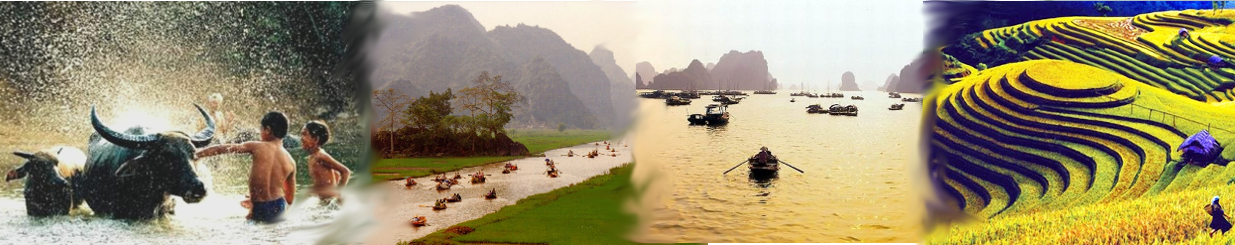Publications
Publications
Ouvrages
Ouvrages
Hanoi 1936-1996. Du drapeau rouge au billet vert,
Paris, Autrement, 1997, 203 p.,
avec G. Boudarel
Hanoi 1936-1996. Du drapeau rouge au billet vert,
Paris, Autrement, 1997, 203 p.,
avec G. Boudarel
Une cité-mémoire
Des villages labyrinthes
En fait, la ville était prise d'assaut et noyautée par la campagne. En 1946, 118 villages de l'agglomération hanoienne participèrent aux premières élections législatives après la déclaration d'indépendance l'année précédente. Certaines localités de Hanoi même conservent de nos jours encore leur appellation de "village" (làng). Après d'innombrables découpages administratifs effectués depuis 1954, Hanoi intra muros est actuellement divisée en cinq arrondissements subdivisés à leur tour en phường, et sa périphérie en cinq districts fractionnés en communes regroupant un ou plusieurs villages.
Les maisons hanoiennes, d'apparence modeste par la largeur de leur façade sur la rue, réservent bien des surprises à ceux qui y pénètrent pour la première fois, car la profondeur de certaines d'entre elles peut atteindre une cinquantaine de mètres, d'où l'appellation de nhà ống (maisons en tubes). On remarque en passant que ce mode d'occupation de l'espace d'origine chinoise fut adopté par les Vietnamiens après une longue domination de l'Empire du Milieu. D'ordinaire les Vietnamiens préfèrent plutôt des constructions larges et moins profondes, c'est ce qu'on voit à la campagne.
En été les orages et les pluies torrentielles qui inondent les rues rafraîchissent la cité accablée de chaleur. En hiver, par contre, le ciel bas et le crachin chargés de mélancolie la plongent dans une grisaille métaphysique.
Ce sont les tableaux de Bùi Xuân Phái
[12], à dominante grise, qui représentent sans doute le mieux le type d'architecture qu'on rencontre dans le vieux Hanoi. Les petites maisons juxtaposées dont les toits de hauteur inégale forment un ensemble disparate, bercent l'imagination. Autrefois les toits étaient en chaume et les murs en torchis, seuls les riches avaient les moyens de bâtir un logement en dur : charpentes en bois précieux, murs en briques, toit en tuiles et sol dallé. A l'arrivée des Français au XlXe siècle, une bonne partie des habitations des quartiers populaires étaient des paillotes.
Ces quartiers peuvent communiquer les uns avec les autres par d'innombrables ruelles (ngõ pour les Vietnamiens) qui soulignent la profondeur des habitations et leur enchevêtrement. La rue Khâm Thiên, réputée pour ses maisons de chanteuses dans les années 1930, et bombardée en décembre 1972 par un B-52 de l'US Air Force, ne compte pas moins de 26 ruelles, un record. Cet ensemble était un véritable labyrinthe, favorable lors de la colonisation à l'implantation de fumeries et de maisons closes ; elles échappaient plus ou moins au contrôle des autorités.
Le charme pittoresque dégagé par ces maisons contribue à façonner l'identité de la ville.
Hanoi truffée de tours perdrait sans doute son âme. La sauvegarde de la ville ancienne, confronté aux
enjeux économico-financiers, pose problème. Les
Hanoiens purent s'indigner à la vue de nouveaux complexes immobiliers élevés autour du Grand Lac. Quant
à l'aménagement du Petit Lac, les autorités ont prêté l'oreille aux protestations et décidé de ramener à cinq
étages la hauteur d'un grand hôtel prévu pour en compter une douzaine. Grâce aux efforts des amoureux de
Hanoi et aux appuis d'une organisation suédoise, la raison a fini par l'emporter : le vieux Hanoi vient d'être
classé monument historique par la ville. D'un autre côté, l'extension de la capitale se fera vers l'ouest. Le
Hanoi du vingt et unième siècle (centre d'affaires, zone industrielle, université, habitations prévue pour
quelque 200.000 personnes) sera implantée, d'après le récent plan d'urbanisme, dans la région de Xuân Mai,
à une cinquantaine de kilomètres de Hanoi. Au-delà du pittoresque, les autorités doivent tenir compte d'une
lourde réalité : la ville est peuplée de plus de deux millions d'âmes.
Une cité de gourmets
On ensaurait évoquer Hanoi sans l'un de ses plaisirs les plus appréciés, la gastronmie. C'est
d'ailleurs investie de sa réputation de ville gourmets qu'elle est entrée dans la littérature vietnamienne.
Thạch Lam lui a consacré de belles pages dans son
Hanoi aux trente-six quartiers, et plus près de nous
Vũ Bằng, saisi par la nostalgie de son Nord natal alors qu'il résidait au Sud, a écrit un long récit intitulé
La bonne chère de Hanoi (
Miếng ngon Hà Nội), publiéé à Saigon dans
les années soixante. Plus récemment encore Dương Thu
Hương n'oublie pas cet aspect dans son roman
Les Pardis aveugles.
Le moins qu'on puisse dire est qu'à Hanoi la diversité culinaire le dispute à la subtilité et à la richesse des saveurs.
A chaque moment du jour ou de la nuit, à chaque saison, à chaque sexe et pratiquement à chaque âge correspondent
des boissons et mets particuliers. On y a en outre l'avantage de pouvoir profiter d'une qualité importante du négoce
local : le commerçant hanoien sait allier les impératifs de la spécialisation à une solidarité tacite avec ses voisins
et néanmoins concurrents. Le marchand de soupe tonkinoise, le fameux
Phở,
par exemple, ne sert pas de
boissons. Si un client souhaite se désaltérer, le restaurateur passe simplement la commande à une buvette
proche. S'il désire du thé ou fumer une pipe à eau, une vieille dame installée
à proximité le servira. Sans doute, le charme de ces dégustations en plein air
n'empêche pas l'invasion des modes extérieures à l'heure de l'ouverture économique. Comme dans toute
l'Asie du Sud-Est, boire du whisky à table constitue une marque de distinction sociale dans un Vietnam en
plein boom. Pourtant cette occidentalisation a ses origines dans certaines habitudes du passé. Lors des
banquets, les Sud-Est Asiens buvaient de l'alcool de riz, mais avec l'introduction des produits de
consommation d'origine européenne, ceux qui jouissaient d'une situation sociale enviable, l'image de
l'Occident glorieux aidant, finirent par lui substituer le whisky, signe de savoir-vivre moderne.
Cependant la boisson alcoolisée la plus populaire demeure la bière, introduite elle aussi par des Occidentaux
au XlXe siècle. La fameuse "33" de la brasserie française de l'époque coloniale reconquiert aujourd'hui sa
renommée sous la nouvelle marque "333" (en vietnamien, pour faire vite, "33" et "333" se disent tous deux
indifféremment "trois-trois"). Les hommes se retrouvent donc entre eux, à la main un demi-pression ou
un "trois-trois" avec glaçons, dans les échoppes proposant des plats de "chèvre", dont le nom vietnamien
dê signifie au figuré "lubrique". Ces tournées ne manquent pas de rituels. On commence en général par un
petit verre d'alcool de riz mélangé au sang de chèvre, panaché aux effets supposés virilisants. Pour fêter une
occasion exceptionnelle on préfère du serpent dont on boit le sang mélangé à de l'alcool, véritable potion
censée remédier au mal de dos. Après quoi, on déguste ensuite les "sept plats" dans la bonne humeur.
On convie les invités d'honneur à avaler "cent pour cent" (cul sec), une macération de serpent et de produits
pharmaceutiques traditionnels.
Hanoi ne serait pas Hanoi sans le
chả cá, sa spécialité. Ce mets séculaire se
compose de morceaux de poisson grillé au feu de bois, servi sur un réchaud et accompagné de vermicelles,
d'herbes (ciboulette, aneth, coriandre) et d'une sauce de crevette (mắm tôm). La popularité et la réputation
en sont telles que la rue porte depuis 1954 le nom du restaurant Lã Vọng qui fut jusqu'à une date très récente
le seul de tout le Vietnam à le servir
[13]. Đoàn Xuân Phúc,
fondateur du restaurant, était un paysan originaire de la région de Bắc Ninh. Il fut l'un des
compagnons de Đề Thám, résistant qui mena la vie dure aux forces françaises et fut traité en pirate. Lorsque
ce dernier fut traqué, Phúc dut se replier sur Hanoi où il créa le restaurant, qui servit de lieu de contacts
secrets entre partisans. Après la capture du Đề Thám et son exécution en 1913, Phúc s'établit définitivement
à Hanoi comme restaurateur. Ses descendants continuèrent avec succès l'exploitation de l'établissement.
Avec l'ouverture économique, la ruelle Cấm chỉ retrouve sa réputation de lieu aux trente-six mille gourmandises.
Du matin jusqu'à tard dans la nuit, les marchands se relayent selon leur spécialité sur le même emplacement,
pour satisfaire aux goûts de la clientèle qui se bouscule. On y trouve de tout : depuis les gâteaux de riz à un
prix dérisoire, jusqu'aux plats savamment cuisinés comme du poulet, du pigeon ou du canard mijotés aux
produits pharmaceutiques traditionnels, en passant par une multitude de variétés de potage aux vermicelles.
La ruelle est aussi un lieu de rendez-vous très fréquenté. Ainsi les jeunes motards qui se livrent aujourd'hui
à des courses folles en pleine ville, provoquant terreur et fascination, s'y trouvent en simples consommateurs
pour déjouer les recherches de la police lancée à leurs trousses.

L'été, pour se désaltérer, rien ne vaut
sans doute un verre de canne à sucre pressée et légèrement parfumée au jus et au zeste de citron. Les
vendeurs s'installent sur les trottoirs passants, et tournent la manivelle de leur pressoir à la cadence des
commandes. L'hiver, l'odeur dégagée par la canne à sucre cuite sur la braise, ou à la vapeur, défie toute
résistance à la dégustation. Sur le chemin de l'école, les enfants croquent à longueur de journée, les tiges de
canne à sucre écorcées et pré-coupées en rondelles.
Rituels gourmands
Comme beaucoup d'autres villes d'Asie, Hanoi est matinale. Bien avant que les hauts-parleurs publiques
commencent à diffuser des textes officiels ou des rappels à l'ordre, les marchands ambulants réveillent
l'appétit, tentent le diable gourmand qui somnolait encore, par leurs cris qui résonnent dans les ruelles
habituelles. A chaque marchand son quartier et sa clientèle. On propose toute une gamme appétissante
de "riz gluant" : nature, au soja, au sésame, aux cacahuètes, aux échalotes grillées, etc. Beaucoup de
Hanoiennes assaillent, entre deux courses, les marchandes ambulantes de vermicelles aux crabes
[14]
(
bún riêu cua) ou aux escargots (
bún ốc), deux plats typiquement féminins qui cependant mettent aussi
l'eau à la bouche des Hanoiens gourmands.
"Qui a remarqué, écrit Thạch Lam, en passant au moment
creux de l'après-midi ou tard dans la nuit devant les maisons de chanteuses ou les maisons de tolérance,
les femmes qui dégustent ce plat (bún ốc) avec diligence et attachement ? Le bouillon acide crispe leurs
visages fardés et fatigués, le piment fort fait chuchoter les lèvres fanées, et parfois, fait couler des larmes
qui sont plus sincères que des larmes d'amour. Cette marchande a un outil dont l'un des deux bouts est
un marteau et l'autre une pointe. Un petit coup puis un tour de main et l'escargot entier tombe dans un bol
de bouillon. Et pourtant cette cadence n'arrive pas à suivre le rythme des services. En regardant les autres
manger, elle-même en a envie, me confia-t-elle." [15]
C'est également au petit matin que l'on savoure les
bánh cuốn, sortes de raviolis servis avec échalote
grillée et lamelles de pâté de porc (
giò), on trempe le tout dans la sauce de poisson (
nước mắm).
L'après-midi est en général réservée à la gourmandise. Entre deux repas, on se précipite sur les oeufs de
cane couvés, qu'on saupoudre
de sel et de poivre avant de les croquer avec des pousses de renouée odorante, ou sur le
chè,
sucrerie à base de soja ou de haricot noir, de grains de lotus ou de riz gluant. Ce dessert typiquement
vietnamien est servi dans de petits bols et parfumé à l'essence de banane.
L'automne est certainement la saison la plus agréable et la plus appréciée des Hanoiens. Il a également à ses
spécialités. On récolte avant terme une espèce de riz gluant pour en faire le
cốm, identifiable à sa couleur
verte, le vert des feuilles de bananier. Cette friandise peut être préparée de différentes façons, certains
la préfèrent poêlée et légèrement sucrée, d'autres la dégustent nature. Riches ou pauvres, cultivés ou non,
les Hanoiens qui se respectent ne peuvent se passer de ce délice, voire de cette marque d'identité culturelle.
Contrairement à la cuisine chinoise, très riche et très savante, la cuisine vietnamienne, du moins celle du
peuple, se prépare avec des ingrédients tout à fait ordinaires. Les Hanoiens déploient leur ingéniosité dans
l'art d'accommoder les éléments. Par exemple,
un autre plat typique de Hanoi, mais dont la renommée n'égale pas celle du
phở, le
bún chả,
préparé avec de simples petits morceaux de porc grillés à la braise et servi avec des vermicelles, de la salade,
des herbes et l'inévitable sauce de poisson, a une saveur inégalée. Comme dans tous les plats vietnamiens,
la viande y est certes l'élément indispensable, mais elle
n'a pas le même rôle, ni n'occupe la même proportion, que sur une assiette occidentale. Elle elle est avant
tout un des éléments qui donne le goût, la base restant le riz. Dans le
bún chả, on lui "substitue" les
vermicelles, qui sont préparés avec du riz.
En passant par la rue des Poulets (Hàng Gà), les habitués peuvent humer le fumet de
cette spécialité, émanant d'une boutique tenue par un couple d'âge mûr. Le mari partage la tâche avec sa
femme : sur le trottoir, il surveille les grillades, et au besoin,
branche son petit ventilateur pour attiser le feu, tandis que dans la petite salle son épouse, un sourire amical
aux lèvres, sert les clients qui l'appellent
chị, (grande soeur) ou
cô (petite tante paternelle).
Un cas assez rare à Hanoi, où l'on voit la Vietnamienne trimer à longueur de journé, et le mâle vietnamien
dans les buvettes. Ce couple a même décliné l'offre d'un "homme d'affaires" qui voulait transformer son local
en mini-hôtel, pour se contenter de vivre de son petit commerce.
Notes :
[12]. Peintre Hanoien (1921-1988), ses tableaux sont très cotés
ces dernières années, et plusieurs jeunes artistes essaient d'imiter son style.
[13].Pour plus de détails sur ce plat, voir l'article de Nguyễn Thị
Hương Liên, "Nhà hàng Lã Vọng và món đặc sản chả cá" (Le restaurant Lã Vọng et la spécialité
chả cá) in
Văn hóa dân gian (Culture populaire), n° 2, 1990, pp. 30-32.
[14].On recueille uniquement la substance à l'intérieur de la carapace, pour en faire le bouillon.
[15]. Thạch Lam,
Hà Nội 36 phố phường (Hanoi aux 36 quartiers),
Éditions Đời nay, Hanoi, 1943.
Illustration :
Martin Hurliman, Ceylan et L'Indochine, Librairie des Arts décoratifs,
Paris, 1930, p. 252
|
Sommaire de la rubrique
|
Haut de page
|
Suite
|